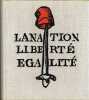Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (21)
19th (199)
20th (831)
21st (41)
-
Syndicate
ILAB (1103)
SLAM (1103)
Phénoménologie de l'esprit révolutionnaire.
Calmann-Lévy, 1974, in-8°, 366 pp, broché, couv. à rabats, bon état (Coll. Archives des sciences sociales)
L'incompatibilité entre la révolution et le droit.
Catherine Théot.
dans la Revue de Paris, 1901, gr. in-8°, 22 pp, broché, dos recollé, état correct. On trouve dans le même numéro une étude d'André Le Breton sur les Origines du Roman Populaire (15 pp).
Danton et la paix.
P., Renaissance du Livre, 1919, in-12, viii-262 pp, index, broché, bon état. Edition originale. Peu courant
"M. Mathiez aura peut-être mieux réussi que certains enragés réactionnaires à priver de leur auréole tant de révolutionnaires fameux... La Révolution reste grande malgré tout, mais combien de ses « héros » sont des énergumènes ou des coquins ! Dans son ouvrage, “Danton et la paix”, on se demande vraiment si la statue colossale du tribun ne sera pas déboulonnée bientôt sous les coups formidables que lui portent la logique acérée et l'impitoyable érudition du professeur de Dijon... Déjà, la vénalité de Danton, jouisseur vulgaire, n'est plus sérieusement discutée entre les juges compétents ; le nouveau travail de M. Mathiez semble mettre en doute son intelligence politique. Il nous montre le fougueux orateur, qui criait à la tribune : « De l'audace, de l'audace et encore de l'audace, et la France est sauvée ! » comme un « défaitiste » au moment de la crise qui menace d'anéantir la France et la République. Quelque étrange que puisse paraître, au premier abord, une accusation pareille, il faut bien reconnaître que l'auteur a su lui donner, par l'interprétation des textes allégués et l'abondance des détails groupés par lui, un tel air de vraisemblance que les admirateurs de Danton – il en reste – se verront obligés d'examiner de très près les arguments réunis dans ce livre, et qui nous paraissent d'autant plus pressants que la valeur morale de l'homme ne peut plus être alléguée désormais pour protéger sa mémoire contre les pires soupçons ; car M. Mathiez ne lui impute pas seulement « la poursuite aussi infructueuse qu'opiniâtre d'une paix insaississable » (p. 140), alors « qu'il prodiguait les airs de bravoure en public », mais d'avoir été pendant tout ce temps « l'agent de l'Angleterre » et « l'instrument de la coalition » (p. 234). II finit par le caractériser comme un « aventurier sans scrupules, très capable de se vendre à l'ennemi », comme le « chef honteux, mais redoutable, de tous les défaitistes », comme « traître à la France et à la République » (p. 250)..." (Rod Reuss, Revue Historique, 1920)
Danton et la paix.
P., Renaissance du Livre, 1919, in-12, viii-262 pp, index, reliure demi-chagrin bleu nuit, dos à 5 nerfs soulignés à froid (rel. de l'époque), dos lég. frotté, état correct
"M. Mathiez aura peut-être mieux réussi que certains enragés réactionnaires à priver de leur auréole tant de révolutionnaires fameux... La Révolution reste grande malgré tout, mais combien de ses « héros » sont des énergumènes ou des coquins ! Dans son ouvrage, “Danton et la paix”, on se demande vraiment si la statue colossale du tribun ne sera pas déboulonnée bientôt sous les coups formidables que lui portent la logique acérée et l'impitoyable érudition du professeur de Dijon... Déjà, la vénalité de Danton, jouisseur vulgaire, n'est plus sérieusement discutée entre les juges compétents ; le nouveau travail de M. Mathiez semble mettre en doute son intelligence politique. Il nous montre le fougueux orateur, qui criait à la tribune : « De l'audace, de l'audace et encore de l'audace, et la France est sauvée ! » comme un « défaitiste » au moment de la crise qui menace d'anéantir la France et la République. Quelque étrange que puisse paraître, au premier abord, une accusation pareille, il faut bien reconnaître que l'auteur a su lui donner, par l'interprétation des textes allégués et l'abondance des détails groupés par lui, un tel air de vraisemblance que les admirateurs de Danton – il en reste – se verront obligés d'examiner de très près les arguments réunis dans ce livre, et qui nous paraissent d'autant plus pressants que la valeur morale de l'homme ne peut plus être alléguée désormais pour protéger sa mémoire contre les pires soupçons ; car M. Mathiez ne lui impute pas seulement « la poursuite aussi infructueuse qu'opiniâtre d'une paix insaississable » (p. 140), alors « qu'il prodiguait les airs de bravoure en public », mais d'avoir été pendant tout ce temps « l'agent de l'Angleterre » et « l'instrument de la coalition » (p. 234). II finit par le caractériser comme un « aventurier sans scrupules, très capable de se vendre à l'ennemi », comme le « chef honteux, mais redoutable, de tous les défaitistes », comme « traître à la France et à la République » (p. 250). La parole est maintenant aux défenseurs du tribun des Cordeliers, et l'on doit attendre équitablement leur réponse pour savoir s'il y a lieu de reviser ou de ratifier cette terrible sentence de dégradation posthume." (Rod Reuss, Revue Historique, 1920)
La Révolution française.
Armand Colin, 1959, fort in-8° carré, (12)-577 pp, préface de Henri Calvet, édition illustrée de 225 gravures, portraits et et fac-similés de l'époque, dans le texte et hors texte, imprimé sur papier Téka, broché, couv. illustrée à rabats (maquette de Jeanine Fricker), bon état
I : La chute de la royauté. II : La Gironde et la Montagne. III : La Terreur. — "Notre souci principal a été de substituer à l'iconographie traditionnelle une illustration vivante tirée des sources les moins connues des bibliothèques, des archives et des musées. Circulant avec le texte, elle permet de suivre de la façon la plus "contemporaine" les personnages et les événements. C'est dire qu'on y trouvera avec des gravures populaires, des caricatures du temps, les portraits les moins connus des grands hommes de la Révolution ainsi que des objets et de nombreuses reproductions de la presse du temps."
La Révolution française. I. La chute de la Royauté. II. La Gironde et la Montagne. III. La Terreur.
P., Club du meilleur livre, 1959, fort in-8° carré (20 x 17), (12)-578 pp, préface de Henri Calvet, édition illustrée de 225 gravures, portraits et et fac-similés de l'époque, dans le texte et hors texte, reliure toile écrue décorée de l'éditeur, rhodoïd, signet, bon état
"Cette édition monumentale est comparable en ses intentions à ce qui a été fait pour “La Civilisation de la Renaissance en Italie”. Notre souci principal a été de substituer à l'iconographie traditionnelle une illustration vivante tirée des sources les moins connues des bibliothèques, des archives et des musées. Circulant avec le texte, elle permet de suivre de la façon la plus "contemporaine" les personnages et les événements. C'est dire qu'on y trouvera avec des gravures populaires, des caricatures du temps, les portraits les moins connus des grands hommes de la Révolution ainsi que des objets et de nombreuses reproductions de la presse du temps." (Club n° 73)
La Vie chère et le mouvement social sous la Terreur.
Payot, 1927, in-8°, 620 pp, broché, très frais, bon état (Bibliothèque historique). Edition originale, premier tirage, février 1927
"D'après M. Mathiez, la Terreur serait la résultante des difficultés de ravitaillement qu'éprouvait la population des villes, de Paris surtout, par suite d'une des crises économiques les plus épouvantables que l'histoire ait connues : L'inquiétude provoquée à l'intérieur par les pillages, les réquisitions nécessitées par la guerre contre la première coalition, l'abus des assignats – de nos jours, on dirait l'inflation – , d'autres causes encore provoquèrent le renchérissement des vivres. Le renchérissement des vivres amena la masse, peu au courant des lois inéluctables de l'économie politique, à réclamer d'abord toutes espèces de réglementations, parfois plus nuisibles qu'utiles, puis des taxations particulières et enfin le maximum général. Les grands chefs, tels que Danton, Marat, Hébert et Robespierre, qui au fond sont tous acquis aux théories du libéralisme économique, voient très bien où ce système va conduire la France. Ils résistent devant les enragés. La surenchère l'emporte. Et au fur et à mesure que les principes de la réglementation et de la taxation se développent, l'organisation de la Terreur s'impose davantage..." (H. Van Houtte, Revue belge de philologie et d'histoire)
Le Club des Cordeliers pendant la crise de Varennes et le massacre du Champ de Mars. Documents en grande partie inédits publiés avec des éclaircissements, des notes et une planche.
P., Champion, 1910, gr. in-8°, iv-392 pp, index, broché, bon état. Edition originale
"Il est indispensable de connaître l'histoire des clubs pour connaître celle de la Révolution, puisque ce sont les clubs ou sociétés populaires qui ont dirigé, et même qui ont créé le mouvement démocratique et républicain. Ce sont eux qui ont tiré des « principes de 89 » toutes les conséquences qui en découlaient logiquement et qui ont substitué au gouvernement, ou plutôt aux apparences de gouvernement bourgeois du début de la Révolution, le gouvernement direct du « peuple ». Le club des Cordeliers, surtout, a joué en 1791 un rôle prépondérant au moment de la fuite à Varennes, il a rallié tous les ennemis de la monarchie, et si l' « intérim républicain », qui cessa avec la Constituante, se termina par la victoire des monarchiens, cette victoire ne fut qu'illusoire et infiniment précaire. (...) L'ouvrage de M. Albert Mathiez est donc fort précieux. Il comprend surtout des documents, pour la plupart inédits, tirés des Archives nationales de la Bibliothèque nationale et de la ville de Paris : Journal du Club (contenant le récit, très incomplet, des séances du 21 juin au 4 août 1791), pièces du procès intenté, sur l'ordre de la Constituante, aux émeutiers (information secrète et publique, rapports des officiers municipaux, conclusions de l'accusateur public, etc.). De substantiels« éclaircissements » constituent une monographie du club avant la fuite à Varennes (p. 1-41) et exposent l'historique des poursuites (p. 191-225). L'ouvrage se termine par une table des noms de personnes." (Gustave Gautherot, Revue des questions historiques, 1910)
Journal d'un étudiant (Edmond Géraud) pendant la Révolution, 1789-1793.
Calmann-Lévy, 1890, in-12, xi-393 pp, un portrait en frontispice, broché, qqs pâles rousseurs, bon état
Journal d'un étudiant (Edmond Géraud) pendant la Révolution, 1789-1793.
Plon, 1910, pt in-8°, vii-331 pp, broché, bon état
"M. Maugras a publié, sous le titre : Journal d'un étudiant pendant la Révolution, des lettres écrites de Paris, de décembre 1789 à décembre 1792, par un jeune Bordelais, Edmond Géraud, fils d'un négociant protestant, envoyé à Paris pour achever son éducation. Ces lettres, écrites par un bon jeune homme, sans mérite transcendant, appartenant à la bonne bourgeoisie libérale, vivant en dehors du monde de la politique, sont très précieuses pour la connaissance des mouvements de l'opinion publique pendant les trois premières années de la Révolution. En 1790, il parle avec attendrissement de Louis XVI, « ce roi citoyen, si digne du nom de roi des Français, » et ne manifeste même aucun éloignement pour la reine. Il voit avec la plus sereine confiance, avec le plus naïf enthousiasme l'ère de bonheur et de liberté que la nouvelle Constitution ouvre à la France. Mais, à la fin de 1790, l'émigration, l'opposition du clergé à la Révolution commencent à exciter chez lui des craintes et de l'irritation. En 1791, cette irritation grandit avec les menaces de l'étranger et le soupçon que la cour est complice des émigrés et de l'Autriche. La fuite du roi change cette irritation en fureur, au moins contre Marie- Antoinette, « cette reine infâme, cette Médicis moderne. » Le roi est encore « bon, honnête, vertueux, victime de son coeur et de sa faiblesse. » Mais, avec 1792, avec la résistance du roi à la Constitution civile du clergé, avec l'attente d'une guerre prochaine, ce reste de respect disparaît. Louis XVI n'est plus qu'un « traître, un parjure, vrai tigre déguisé en cochon. » C'est qu'alors, indépendamment de l'attitude menaçante de l'étranger et des émigrés, de la certitude d'une complicité secrète des Tuileries et des agitations royalistes dans les départements, il y a dans Paris même une réaction très forte en faveur du roi et contre l'Assemblée législative. Les lettres du jeune Géraud sont des documents très précieux sur ce point; elles montrent par quelles angoisses passèrent alors les partisans de la Révolution. Ils se sentaient menacés de toutes parts, entourés de conspirateurs. De là la joie avec laquelle ils saluent le 20 juin, le 40 août, et, il faut le dire, le peu d'horreur que leur causèrent au premier abord les massacres de septembre. Nous avons des lettres d'Edmond Géraud du 4 et du 6 septembre ; il parle des massacres, mais sans s'y arrêter, comme d'une explosion naturelle de la fureur populaire, et il insiste surtout sur l'enthousiasme belliqueux qui anime toutes les classes de la population. « Le patriotisme est dans son triomphe, » dit-il le 6, «... la gaieté et la sécurité marchent au son du tambour... Nous n'avons pas l'air d'un peuple menacé ni d'un peuple abattu, mais d'une grande famille qui est en liesse. » Mais aussitôt se produit dans les âmes honnêtes cette réaction de pitié que Michelet a si bien observée. Edmond Géraud, jusqu'alors très sympathique aux Jacobins, n'a plus que des paroles de mépris pour Marat et Robespierre, et il écrit le 16 octobre : « Que voit-on dans Paris, dans cette ville qui devrait donner aux départements l'exemple du patriotisme et de la soumission la plus aveugle aux lois ? Ils y voient un amas impur d'hommes dont tous les projets tendent à perpétuer l'anarchie sans laquelle ils ne sont rien , des hommes tout dégoûtanls encore du sang qu'ils ont versé dans les journées de septembre. » Le 11 novembre, il demande que les Bordelais marchent sur Paris pour délivrer l'Assemblée des assassins qui l'entourent. A la fin de 92, il s'enrôle et se rend au camp de Toulouse. On peut dire qu'on retrouve dans les lettres d'Edmond Géraud l'état d'âme girondin. A ce point de vue, elles sont un document d'une grande valeur..." (G. Monod, Revue historique) — "Ce n'est pas vraiment un journal, mais une biographie de ce jeune bourgeois bordelais fasciné par la Révolution, qui arrive à Paris en décembre 1789 (...). On y suit sa déception croissante devant les excès de la Révolution jusqu'en 1793 (...)" (Fierro, 618)
La Révolution du XXe siècle.
Plon, 1958, in-8°, 48 pp, broché, bon état (Coll. Tribune libre)
"Sous un titre ambitieux, cette plaquette est destinée à montrer, à la lumière de l'insurrection hongroise, l'effondrement du marxisme et du capitalisme au XXe siècle. L auteur propose l'instauration d'une « économie de besoin » où le salaire devienne plus un « pouvoir de consommation » que la rétribution du travail." (Revue française de science politique, 1958)
"Ça Ira". Récits des temps révolutionnaires.
Hachette, 1948, in-8°, 304 pp, biblio, broché, couv. illustrée, C. de bibl., bon état
Galerie historique de la Révolution française (1787 à 1799).
Paris, P. Amic l'aîné, 1843, 3 vol. pt in-4°, xvi-454, 474, 469-45 (table alphabétique et biographique) pp, illustré de 61 portraits lithographiés sur acier sous serpentes, reliures demi-chagrin carmin à coins, dos lisses avec titres, tomaisons et doubles filets dorés soulignés à froid, tranches jaspées (rel. de l'époque), coins inf. d'une vingtaine de feuillets abîmés au tome 2, qqs rousseurs éparses, sinon bon état
La Révolution en Rouergue. District d'Aubin, 1789-1795.
Salingardes, 1976-1978, 2 vol. in-8°, 255 et 268 pp, préface de Jacques Godechot, postface de Jacques Bousquet, 2 pl. de photos et une carte ancienne hors texte, brochés, couv. illustrées, qqs marques au crayon rouge en marges, bon état
Jacobinisme et Révolution. Autour du bicentenaire de Quatre-vingt-neuf.
Editions Sociales, 1984, in-8°, 305 pp, broché, couv. illustrée, annotations stylo sur 5 pp, état correct, envoi a.s.
"Notre ami Claude Mazauric a réuni dans ce volume huit études sur la Révolution. Elles sont groupées sous trois grands thèmes : « Politique et Révolution », « Jacobinisme et politique révolutionnaire », « Origine et trace de la Révolution jacobine ». Ce qui, toutefois, doit retenir l'attention, dans ce livre, c'est l'Introduction, dans laquelle Claude Mazauric se demande pourquoi la commémoration du bicentenaire de la Révolution se heurte à tant d'hostilité et à une véritable offensive des contrerévolutionnaires..." (Jacques Godechot, Annales historiques de la Révolution française, 1985)
Le général F.-S. Marceau. Sa vie, sa correspondance, d'après des documents inédits.
P., H.-E. Martin, 1889, in-4°, xvi-506 pp, un fac-simile et 12 pl. hors texte, 3 cartes dans le texte, index, reliure demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs filetés et orné de fleurons, tranches dorées, reliure de prix (rel. de l'époque), coins émoussés, sinon bon exemplaire
Augustin Cochin et la genèse de la Révolution. Introduction à son œuvre, suivie d'un choix de lettres.
Plon, 1928, pt in-8°, ix-368 pp, une photo d'Augustin Cochin en frontispice et un fac-similé hors texte, biblio, broché, dos recollé, bon état (Coll. Le Roseau d'or), exemplaire numéroté sur alfa, prière d'insérer joint
"En cet intéressant volume, très agréablement écrit, M. de Meaux montre d'abord comment a été élaborée l'œuvre historique d'Augustin Cochin, dont il expose avec une grande clarté les résultats essentiels. On sait que, dans deux importants ouvrages (Les Sociétés de pensée et la démocratie, et surtout les Sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne, 1788-1789), A. Cochin s'est efforcé de mettre en relief le rôle des Sociétés de pensée et notamment de la franc-maçonnerie, à la veille de la Révolution, de décrire leur organisation et leur propagande, l'action prépondérante qu'elles ont, d'après lui, exercée sur le déchaînement de cette Révolution. Il avait accompli des recherches longues et minutieuses, en plusieurs régions de la France surtout en Bretagne, recherches qui ont le grand mérite d'ajouter beaucoup à nos connaissances sur les antécédents directs de la Révolution. Mais on a pu lui reprocher, justement à notre avis, de n'avoir vu qu'une des faces du problème et d'avoir laissé dans l'ombre l'évolution antérieure. M. de Meaux s'efforce de répondre à ces critiques. Puis, il expose l'œuvre doctrinale d'Augustin Cochin sur la démocratie et les Sociétés de pensée, en montrant le parti qu'il avait tiré d'historiens comme Ostrogorsky et de sociologues comme Emile Durkheim. Enfin, i| écrit quelques pages émues sur la vie et sur la mort héroïque d'A. Cochin. La seconde partie du volume contient de nombreuses lettres écrites par Cochin et relatives surtout à ses recherches à travers la France. Ces lettres, spirituelles et alertes, le montrent sous un jour très sympathique ; elles donnent des détails intéressants sur ses pérégrinations de chercheur. Elles montrent aussi que personnellement il avait peu de sympathie pour la démocratie et les partis qui se réclament de la Révolution. On peut se demander s'il n'a pas quelque peu transposé dans le passé les idées qu'il se faisait de la franc-maçonnerie contemporaine, sans qu'on puisse, d'ailleurs, en aucune façon, suspecter sa probité scientifique, qui était grande." (Henri Sée, Revue Historique, 1929)
La Révolution et l'Empire, 1789-1815. Etude d'histoire politique.
P., Didier et Cie, 1867, in-8°, v-480 pp, reliure demi-basane cerise, dos lisse, titres et filets dorés, roulette en tête et palette en queue (rel. de l'époque), coiffe sup. arasée, C. de bibl. gratté, rousseurs, bon état. Première édition
Par Camille de Meaux (1830-1907), le beau-fils de Montalembert et l'une des personnalités conservatrices majeures de la Troisième République. Sur cet ouvrage, Montalembert écrira à Adolphe Dechamps : "Je crois que vous serez très content du livre de M. de Meaux. Il s'y montre un digne émule de Tocqueville pour le style et l'esprit général du livre, avec plus de netteté et surtout de courage chrétien dans les jugements. Mais lui aussi aura bien de la peine à se faire lire car il ne caresse aucune des passions mauvaises de notre temps." (Montalembert, lettre de 1867, publiée par Roger Aubert dans la Revue d'histoire de l'Eglise de France, 1970)
La région de Montlhéry dans la Révolution.
Le Mée-sur-Seine, 1989, in-8°, 256 pp, 55 gravures et plans, glossaire, édition originale, un des 500 ex. numérotés, envoi a.s.
Mémoires de Meillan, député par le département des Basses-Pyrenées à la Convention Nationale, avec des notes et des éclaircissements historiques.
P., Baudouin Frères, 1823, in-8°, 331 pp, reliure demi-basane havane, dos lisse avec filets dorés, pièces de titre et d'auteur basane noire, tranches mouchetées (rel. de l'époque), qqs rares rousseurs, dos lég. frotté, bon état (Coll. des Mémoires relatifs à la Révolution française)
"Ces Mémoires, qui sous la forme d'une adresse à ses commettants des Basses-Pyrénées, retracent la carrière politique du député Girondin : quoiqu'il ait toujours adopté des positions modérées, notament dans l'affaire du procès du Roi, il ne figure pas sur la liste des proscrits du 2 juin 1793, mais il quitta Paris de lui-même . Meillan commence ses mémoires aux Massacres de Septembre 1792 et les termine à la mort de Robespierre. Bien sûr il se montre très hostile à la Terreur et aux Jacobins." (Tourneux, 24051 ; Fierro, 985)
Charlotte Corday.
Perrin, 1972, in-8°, 350 pp, 16 pl. de gravures hors texte, biblio, reliure skivertex carmin de l'éditeur, bon état
Charlotte Corday, guillotinée le 17 juillet 1793 pour l'assassinat de Marat, a excité les imaginations. Certains ont transformé la jeune Normande, née en 1768, en une sorte de Jeanne d'Arc investie d'une mission divine et avide de sacrifice. D'autres l'ont présentée comme un bas-bleu, ne croyant ni à Dieu, ni à diable, ou encore comme un monstre. Cependant, que l'on encense ou que l'on vitupère, le mystère Corday reste entier. C'est à l'éclaircir que Bernardine Melchior-Bonnet a consacré de longs mois de recherches. Comment une aristocrate de petite extraction, élevée dans de pieuses traditions, recluse dans sa campagne, se met-elle à ruminer des pensées meurtrières ? Comment décide-t-elle de tuer, elle qui voulait vouer sa vie à Dieu ? Peut-on se contenter de penser que son exaltation religieuse s'est transformée en exaltation politique ? Au travers d'un récit documenté, l'auteur retrace les étapes d'une décision, d'un voyage vers Paris, d'un meurtre et d'un procès qui mobilisèrent tous les acteurs de la Révolution, jusqu'au terrible Vergniaud, avouant : "Elle nous tue, mais elle nous apprend à mourir".
Dictionnaire de la Révolution et de l'Empire.
Larousse, 1965, gr. in-12, 320 pp, nombreuses illustrations, texte sur 2 colonnes, broché, bon état
Le Monde médical dans la guerre de Vendée.
Tours, Arrault, 1939, gr. in-8°, viii-370 pp, broché, bon état
Paris pendant la Révolution (1789-1798) ou le Nouveau Paris.
Livre Club du Libraire, 1962, in-8°, 316 pp, préface de Pierre Bessand-Massenet, 18 pl. de gravures et portraits hors texte, reliure toile bleue de l'éditeur, gardes illustrées, bon état
Mémoires sur la Révolution du chroniqueur et écrivain Louis-Sébastien Mercier (1740-1814), publiés sous le Directoire, où il évoque les sulfureuses nuits au Palais-Royal.
La crise des subsistances à Niort à la veille et au début de la Révolution (1785-1790).
Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1950, in-8°, 75 pp, broché, couv. lég. tachée, bon état (Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, Tome I, 4e série). Peu courant
Table : La grande disette de 1785 ; La boulangerie municipale niortaise ; L'extension de la boulangerie municipale niortaise aux paroisses de l'élection ; La disette de l'hiver 1788-1789. La crise mincipale niortaise ; Le Conseil d'administration du Bien public ; La première municipalité révolutionnaire ; L'émeute du 5 septembre 1790 ; Les conséquences de l'émeute du 5 septembre 1790.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers