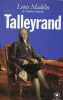Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (21)
19th (203)
20th (835)
21st (42)
-
Syndicate
ILAB (1112)
SLAM (1112)
Eleonora. La vie passionnée d'Eleonora Fonseca Pimentel dans la Révolution napolitaine.
Editions du Félin, 1995, in-8°, 377 pp, 12 pl. de gravures hors texte, index, broché, couv. illustrée, bon état
Dans le droit fil de la Révolution française, Naples connaît en 1799 des jours de révolte et d'espérance. Cette Révolution napolitaine, qui se termine par une répression sanglante, a son héroïne : Eleonora Fonseca Pimentel. Fille des Lumières, nourrie de Voltaire et des encyclopédistes, elle veut changer les pouvoirs et la vie, faire vivre à Naples les mots venus de France. "Seuls, dit-elle, les peuples libres aiment la liberté." Eleonora veut faire découvrir aux Napolitains les droits de l'homme, les aider à vaincre la faim et la misère. Et aussi transformer la condition féminine. Mariée à un butor cupide et sadique, elle a éprouvé l'humiliation et le désespoir. Documentée aux meilleures sources, Maria Antonietta Macciocchi retrace avec rigueur et passion cette vie d'exception.
Danton.
Hachette, 1914, in-8°, 324 pp, un portrait en frontispice et 7 pl. de gravures hors texte, reliure pleine toile verte, dos lisse avec titres dorés, bon état (Coll. Figures du passé)
"L'étude de M. Madelin se lit avec un intérêt soutenu. Il a réuni et groupé en un tableau vivant le peu qu'on sait des premières années et de la jeunesse de « l'enfant terrible » de la petite ville d'Arcis-sur-Aube, du petit clerc de procureur parisien, devenu avocat aux Conseils du roi. Puis nous voyons passer sous nos yeux toute sa vie politique, démagogue aux Cordeliers, substitut de la commune, ministre dela Justice qui signe son laissez-passer tacite au crime de septembre ; nous assistons à ses combats contre la Gironde, à son attitude passive vis-à-vis de Robespierre, aux accès de neurasthénie de cet « Hercule de la Révolution » qui, tout en songeant parfois à modérer la Terreur, se refuse à la lutte nécessaire et va à la dérive pour aboutir à l'échafaud. Sans entrer dans trop de détails, M. Madelin en dit. assez pour qu'on puisse juger le personnage, vis-à-vis duquel il s'efforce visiblement d'être équitable, surtout sur les deux points Íes plus discutés de sa carrière : Danton a-t-il été vénal, a-t-il été sanguinaire ? ..." (Rod. Reuss, Revue Historique) — "De tous les personnages de la Révolution il n'en est pas de plus équivoque que ce Champenois rusé et corrompu chez qui la violence fut l'effet du calcul autant que du tempérament. Sa biographie touche aux points les plus controversés de l'histoire de ce temps. Elle plonge dans les bas-fonds de la police, dans le monde interlope des financiers cosmopolites, des souteneurs, des filles et des agents provocateurs. C'est une vie toute en coulisses. Pour en retrouver tous les traits, pour en démonter tous les ressorts secrets, il faut posséder de l'époque et des hommes une connaissance approfondie qui ne s'improvise pas. Il faut surtout aborder le sujet saus aucun parti pris, faire litière de toute passion, de toute préférence. M. Madelin sait, à l'occasion, faire oeuvre d'érudition. Il peut tout comme un autre vider un document de son contenu. Il a de la finesse, il est expert aux rapprochements ingénieux. Mais l'érudition n'est pas pour lui la passion dominante... (...) En bonne justice on ne peut pas être plus exigeant pour M. Madelin que pour les autres historiens de la Révolution. Son livre, qui sera lu et qui le mérite, sera un stimulant pour nos études." (Albert Mathiez, Annales révolutionnaires)
Fouché, 1759-1820.
Plon, 1947 2 vol. in-8°, xxxiii-517 et 568 pp, un portrait hors texte, index, brochés, bon état
"Fouché a fait en 1901 l'objet de la thèse quasi exhaustive, de Louis Madelin, en deux volumes. Cet ouvrage a été condensé par l'auteur en 1958 en un volume d'accès plus facile. L'étude de Madelin n'a pas été dépassée et n'a guère été complétée, toutes les biographies de Fouché, publiées depuis 1901 ne sont que des démarquages du livre de Madelin..." (Jacques Godechot, Revue belge de philologie et d'histoire, 1976)
La Jeunesse de Bonaparte.
Hachette, 1946 in-8°, 359 pp, notes et références, broché, couv. illustrée, bon état (Histoire du Consulat et de l'Empire, I).
La Révolution.
Hachette, s.d. (1942), in-8°, 578 pp, biblio, reliure pleine toile écrue, dos lisse, pièce de titre basane havane, couv. illustrée (lég. salie) conservée, bon état (Coll. L'histoire de France racontée à tous)
"Ce volume a été accueilli, dans les journaux et les revues, par des éloges à peu près sans réserves. Il vient de valoir à son auteur, à l'Académie française, un prix de 9.000 francs, comme étant l'ouvrage « le plus éloquent » qui ait paru sur l'histoire de France en ces derniers mois. Ce n'est pas un manuel, ni un petit livre de vulgarisation ; c'est un volume de dimensions assez considérables, œuvre d'un écrivain connu... Le style plaira à beaucoup de personnes ; mais il en est certainement qu'il agacera. M. Madelin appartient à la lignée des historiens romantiques ; ses maîtres sont Taine et Sorel ; comme eux, il attache une très grande importance à la forme, à l'effet littéraire ; il s'efforce à être constamment dramatique ou pittoresque, à frapper l'esprit du lecteur par des images ou des formules...." (Pierre Caron, Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 1912)
Le Crépuscule de la Monarchie. Louis XVI et Marie-Antoinette.
Plon, 1936, pt in-8°, 327 pp, broché, papier lég. jauni, bon état
De la mort de Louis XV à la convocation des États généraux. Conférences prononcées à la « Société des Conférences » en 1936.
Talleyrand.
Marabout, 1984 in-8°, 511 pp, broché, bon état (Coll. Marabout Université)
« Je veux que, pendant des siècles, on continue à discuter sur ce que j’ai pensé et ce que j’ai voulu », aurait-dit un jour Talleyrand. Celui que Napoléon traitait de « diable d’homme » y est parvenu.
Bibliographie historique du Dauphiné pendant la Révolution française. Tome III.
Grenoble, De l'imprimerie dauphinoise, 1891, gr. in-8°, 350 pp, broché, bon état
Tome III seul (sur 3). L'auteur était conservateur de la bibliothèque de Grenoble.
Malesherbes, le pouvoir et les Lumières. Textes réunis et présentés par Marek Wyrwa.
France-Empire, 1989, gr. in-8°, 264 pp, broché, bon état (Coll. Lire la Révolution)
Qui eût cru que la tolérance même aurait ses fanatiques ?
Champs de bataille de l'Armée française : Belgique, Allemagne, Italie.
Hachette et Cie, 1901, in-4°, 406 pp, 111 gravures et portraits et 25 cartes en noir dans le texte, 12 aquarelles en couleurs hors texte d'Alfred Paris sous serpentes, reliure demi-chagrin havane à coins rehaussés d'un double filet à froid, dos lisse orné de filets à froid et d'un fleuron doré, pièce de titre verte, avec pièce de titre basane bleue et fleuron doré,1er plat toilé jaune illustré d'une gauloise casquée et de deux coqs en brun et or, 2e plat orné d'une rosace avec le monogramme de l'éditeur dans les mêmes tons, couv. conservées, tête dorée (rel. de l'éditeur), bon état
De Marignan en 1515 aux batailles de Magenta et Solférino en 1859, 27 batailles sont ici décrites en détail, dont 19 concernent les guerres de la Révolution et du premier Empire (Arcole, Rivoli, Marengo, Austerlitz, Iéna, Auerstaedt, Eylau, Friedland, Essling, Wagram, Lützen, Dresde, Leipzig, Waterloo...) — "Le succès obtenu, l'année dernière, par les “Champs de bataille de France” de M. Charles Malo a déterminé la maison Hachette à confier à l'auteur une tâche identique pour les “Champs de bataille de l'Armée française à l'Étranger”. On connaît le plan précédemment suivi : après une description de visu du champ de bataille lui-même, vient une relation choisie de la bataille dont il a été le théâtre ; le tout est accompagné de plans et d'illustrations. Ce plan n'a pas changé. Les pays étrangers explorés par M. Malo sont la Belgique, l'Allemagne, l'Italie ; les batailles racontées sont au nombre de vingt-sept, toutes prises dans la période de notre histoire militaire qui s'étend du XVIIe siècle au Second Empire. L'ouvrage forme un très beau volume de 406 pages, d'impression soignée, avec certaines dispositions typographiques très heureuses. Il est orné, outre les plans, de nombreux portraits d'après des documents authentiques et de douze aquarelles hors texte de M. Alfred Paris." (Revue d’Histoire moderne et contemporaine)
Le Beau Montrond.
Emile-Paul, 1926, in-12, xv-329 pp, un portrait en frontispice, index, reliure toile rouge, dos lisse avec pièce de titre chagrin noir, couv. conservées, dos lég. passé, papier jauni comme toujours, bon état, envoi a.s. au romancier et auteur de livres d'histoire Georges Lecomte (1867-1958)
Claude Philibert Hippolyte dit Casimir de Montrond (1769-1843) est un diplomate, officier de cavalerie et aide de camp. Pendant la Révolution, se tournant vers la politique, Casimir de Montrond devient vite la coqueluche des salons parisiens. Homme d'esprit, joueur invétéré et grand amateur de femmes, il devint presque naturellement, vers la fin du XVIIIe siècle, l'inséparable ami de Talleyrand et fut pendant toute sa vie son confident et son agent politique. Talleyrand avouera même plus tard qu'il était fasciné par cet homme dont il fit le maître d'œuvre de son « cabinet occulte » : c'est lui qui traitait avec les voleurs, escrocs, aventuriers et espions que Talleyrand fréquentait mais avec qui il ne pouvait néanmoins pas se compromettre. En 1792, Casimir de Montrond accompagne à Londres Aimée de Coigny qui est inquiétée après la journée révolutionnaire du 10 août 1792, et dont le mari, le duc de Fleury, est un de ses amis. En janvier 1793, redoutant le séquestre de ses biens, Aimée, toujours accompagnée de Casimir de Montrond, qui est devenu son amant, revient en France au moment du procès de Louis XVI. À la veille de la loi des suspects, elle entraîne de Montrond à Mareuil-en-Brie, où ils vivent quelques mois avant d’être arrêtés alors qu'il s'enfuyaient vers les Pays-Bas. Incarcérés à la prison Saint-Lazare, ils apprennent que leurs noms ont été placés sur une liste de proscription, avec le risque d’avoir à répondre d’une accusation de conspiration dans les prisons, ce qui est la mort assurée. Grâce à un indicateur de prison, et moyennant la somme de cent louis, ils obtiennent que leurs noms soient enlevés de cette liste. Ils sont libérés après la chute de Robespierre en juillet 1794, se marieront en 1795, mais se sépareront à l'issue de leur lune de miel à Londres, pour divorcer en 1802... — "C'est à la vie privée et aux aventures personnelles, plus qu'au rôle politique du Beau Montrond, que M. Malo s'est attaché dans le petit livre qu'il consacre à ce complice de Talleyrand, et qu'on trouvera fort intéressant, mais d'une indulgence un peu excessive. Les archives françaises, publiques et privées, lui ont fourni du piquant et de l'inédit." (Raymond Guyot, Revue Historique, 1926)
Rahel, ma grande sœur... Un salon littéraire à Berlin au temps du Romantisme.
Ramsay, 1980, in-8°, 170 pp, broché, couv. illustrée, bon état, bande éditeur conservée
Rahel Varnhagen von Ense, née Rahel Levin, est une écrivaine allemande de l'époque du romantisme, née le 19 mai 1771 et décédée le 7 mars 1833 à Berlin. À l’aube du romantisme, Rahel assiste à la naissance du nationalisme allemand et participe à son renouveau culturel. Elle tient un salon littéraire à Berlin et connaît, reçoit ou rencontre Goethe, Hegel, Louis-Ferdinand de Prusse, Beethoven et Heine, qu’elle influence. Déjà, elle plaide pour la liberté et l’égalité des femmes et en « héroïne » romantique, aime jusqu’au délire avant de rencontrer celui qui l’acceptera totalement : Auguste Varnhagen. Avec lui, elle voyage en France, en Hollande... À travers la vie de Rahel Levin qu’elle dépeint avec passion et talent, c’est aussi d’elle et de notre époque que nous parle Clara Malraux. — "Le titre donne déjà le ton de l'œuvre, soulignant le rapport privilégié de l'auteur avec son personnage mais aussi la singularité d'une approche dont l'auteur ne cache pas les tendances « exhibitionnistes » (p. 76). En s'attachant à faire revivre la figure de Rahel Levin-Varnhagen (1771-1833), Clara Malraux s'avoue tout d'abord fascinée par l'évident sentiment d'identité intérieure que peut avoir cette femme dans un milieu qui lui est à bien des égards hostile. Mais, comme par ses origines, sa condition de femme et sa volonté d'être sans cesse en prise sur son temps, l'auteur n'a de cesse de s'identifier à son personnage, ce livre qui au départ se voulait un « livre de complicité » (p. 11) devient au fil des pages un livre-prétexte où les « Revenons à Rahel » jalonnent une réflexion sur soi-même. Certes, nous apprenons sur Rahel, Berlin, les milieux juifs et intellectuels du début du XlXe siècle nombre de détails intéressants : évolution de la condition juive et, parallèlement, de celle des femmes, rapports neufs du social et du politique, élaboration d'une sociabilité nouvelle etc., mais le tout reste dominé par un souci permanent d'identification qui étouffe jusqu'à la superbe évidence à soi qui caractérise Rahel (« Toute ma vie je me suis prise pour Rahel et rien d'autre », cité p. 12). Certes cette identification a l'avantage de souligner l'actualité de certains problèmes, l'ampleur de certains changements dans les mentalités comme dans les mœurs, mais elle présente aussi l'inconvénient de pousser parfois jusqu'à l'absurde l'éclairage modernisant braqué sur le personnage. De plus, elle finit par isoler Rahel de cette période de transition – temps de la Philosophie des Lumières, temps de la Révolution française – qui constitue le véritable terreau du Romantisme allemand. C'est finalement à une analyse à rebours des mouvements littéraires du début du XIXe siècle qu'aboutit cette approche singulière. (...) Dans ce livre écrit avec passion et partialité, il est un point cependant où la volonté identificatrice de l'auteur fait merveille, c'est la description de la nouvelle sociabilité, l'analyse des nouveaux rapports amoureux. Là, le regard, le langage, l'écriture du XXe siècle finissant permettent de saisir un phénomène de société en pleine mutation : inversion des rôles, bouleversement des rapports homme- femme, importance de contacts sociaux si bien décrits et mis en pratique par Rahel («J'ai fait du talent de vivre ma principale étude »), valeur enfin reconnue du témoignage au féminin que sont le salon, la correspondance et le journal intime. Bref, du titre à l'index des noms cités, Rahel, ma grande sœur... reste un livre subjectif, attachant par les deux figures qui l'animent, l'auteur et son personnage." (Marie-Claire Hoock-Demarle, Romantisme, 1982)
Les Hommes de la liberté.
Laffont, 1973-1987, 5 vol. gr. in-8°, 687, 558,xx-448, xxii-468 et xviii-523 pp, index dans chaque volume, cart. éditeur, jaquettes illustrées, bon état
Complet des 5 volumes parus. — Tome I : Les vingt ans du roi. De la mort de Louis XV à celle de Rousseau (1774-1778) – II : Le vent d'Amérique. L'échec de Necker et la victoire de Yorktown (1778-1782) – III : Le bon plaisir. Les derniers temps de l'aristocratie (1782-1785) – IV : La Révolution qui lève. De l'affaire du collier à l'appel aux notables (1785-1787) – V : Le sang de la Bastille. Du renvoi de Calonne au sursaut de Paris (1787-1789).
Les Hommes de la liberté. III : Le Bon Plaisir. Les derniers temps de l'aristocratie (1782-1785).
Laffont, 1976, gr. in-8°, xx-448 pp, index, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
Voici le troisième volume de la fresque biographique géante de la Révolution française, dans laquelle Claude Manceron a engagé toute sa vie d'historien. 1782. Un dauphin est né. Maurepas est mort. La guerre d'Amérique est gagnée. Louis XVI, enfin mûri, et Marie-Antoinette, enfin femme, vont connaître quatre années de règne absolu et vraiment responsable. Ils pourraient en profiter pour des réformes. Ils font au contraire l'impasse à la montée de la bourgeoisie, en favorisant la réaction nobiliaire eu profit d'une noblesse de Cour décadente. Diderot meurt. Entrons-nous dans le temps des médiocres ? Mais Beaumarchais fait jouer Le Mariage de Figaro et Schiller Les Brigands. Les ballons conquièrent le ciel. Laclos publie Les Liaisons dangereuses Et Louis-Sébastien Mercier Le Tableau de Paris. Quelques inconnus commencent à faire craquer le corset d'une vie empesée. Ils s'appellent – entre autres – Collot d'Herbois, Robespierre, Brissot, Manon Roland, Clavière, Barnave, Rossignol, Marat, Buzot, Carnot, Buonaparte. Goya débutant saisit au vol les visages et les couleurs de l'Espagne et de la Cour. Il esquisse, dirait-on, le décor pour ce qui va se passer demain. Trois hommes très divers, déjà, commencent à occuper le devant de la scène en France : Condorcet, La Fayette et Mirabeau. Mais à quoi bon ? Tout semble bloqué. Jusqu'au jour où la facture d'un collier fabuleux est présentée à la Reine...
Les Hommes de la liberté. II : Le Vent d'Amérique. L'échec de Necker et la victoire de Yorktown (1778-1782).
Laffont, 1974, gr. in-8°, 558 pp, index, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
Ce deuxième volume d'une fresque biographique géante des acteurs de la Révolution marque la transition entre l'avènement de Louis XVI, décrit par « Les Vingt Ans du Roi », et l'effondrement de l'Ancien Régime. Nous retrouvons entre autres Mirabeau, broyé par la prison de Vincennes, Brissot et Marat, liés d'amitié, le futur Louis XVIII et ses ambitions, Lauzun conquérant le Sénégal, Franklin amoureux de Mme Helvétius... Nous voyons se profiler dans l'ombre d'autres visages de demain : Hébert, le futur « Père Duchesne »), les Roland, Vergniaud, l'abbé Siéyès, l'abbé Jacques Roux, Gilbert Romme. Napoléon Bonaparte quitte la Corse pour Autun ; Joséphine de La Pagerie vient de la Martinique en France afin d'épouser Alexandre de Beauharnais. La grande affaire, c'est la guerre d'Amérique. La France échoue dans sa tentative d'envahir l'Angleterre, mais les vaisseaux de Suffren et de Grasse vont aider à la victoire de Washington, de La Fayette et de Rochambeau, dont nous suivons pas à pas les péripéties hasardées. Le vent d'Amérique commence à souffler en tempête sur les structures figées de la France où Necker est renvoyé et Raynal exilé sous l'influence de l'homme qui monte, Vergennes. Qu'importe ? Marie-Antoinette, qui commence à « pencher » vers le comte de Fersen, donne le jour à un Dauphin, et les Parisiens semblent surtout passionnés par le haquet de Mesmer. Mais les terribles imprécations de Diderot font écho à l'écrasement sanglant de la grande révolte conduite au Pérou par Tupac Amaru...
Les Hommes de la liberté. I. Les vingt ans du roi. De la mort de Louis XV à celle de Rousseau (1774-1778).
Laffont, 1972, gr. in-8°, 687 pp, index, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état, envoi a.s.
Les Hommes de la liberté. IV : La Révolution qui lève. De l'affaire du collier à l'appel aux notables (1785-1787).
Laffont, 1979, gr. in-8°, xxii-468 pp, index, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
La Révolution française n'a pas commencé en mai 1789 mais le 22 février 1787, jour où Louis XVI et Calonne, son ministre des Finances, font appel aux notables du royaume pour combler le déficit du Trésor. A partir de là, tout allait se précipiter...
Les Hommes de la liberté. IV. La Révolution qui lève. De l'affaire du collier à l'appel aux notables (1785-1787).
Laffont, 1979, gr. in-8°, xxii-468 pp, index, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état, envoi a.s.
Bien avant Max Gallo et son « Napoléon », mais chez le même éditeur, Robert Laffont, Claude Manceron fut un formidable « romancier de l'histoire ». Mort le 23 mars 1999 à l'âge de soixante-seize ans, cet autodidacte frappé très jeune par la poliomyélite, fidèle de Mitterrand (dont il fut le conseiller pour les présidentielles de 1965, 1974 et 1981 avant d'entrer à l'Elysée, où il est resté jusqu'en 1995, comme chargé de mission), a écrit, seul ou avec sa femme Anne, une vingtaine d'ouvrages historiques. Dont plusieurs sur l'Empereur, « Le Dernier Choix de Napoléon », « Austerlitz », « Napoléon reprend Paris », « La Comédie de Bonaparte ». Mais c'est sa grande fresque sur la Révolution, « Les Hommes de la liberté », qui, surtout, l'a fait connaître d'un très vaste public. Cinq volumes, publiés entre 1973 (« Les Vingt Ans du Roi ») et 1987 (« Le Sang de la Bastille »), couvrant l'Histoire de la France entre 1774 et 1797 et qui, « partant du particulier pour atteindre le général », traitent des hommes en une « histoire biographique et entrecroisée », de façon vivante et passionnée. Auteur également de biographies de « Beaumarchais » et de « Mirabeau », Claude Manceron a aussi publié un livre sur « Mitterrand » (en 1981) et sur « La République ». (Les Echos, 26/03/1999)
Essais d'histoire de France du XVIIIe au XXe siècle.
Moscou, Editions du Progrès, 1969, in-8°, 622 pp, reliure toile éditeur, titres en bleu au 1er plat et au dos, bon état
16 études érudites : Jean-Jacques Rousseau, précurseur de la Révolution ; Jean-Paul Marat, l'Ami du peuple ; Controverses autour de Robespierre ; Maximilien Robespierre ; Robespierre dans l'historiographie russe et soviétique ; Le Comité central de la Garde Nationale de 1871, premier gouvernement révolutionnaire de la classe ouvrière ; Le mouvement révolutionnaire français après la Commune de Paris et N. Tchernychevski ; Les rapports russo-français après le Traité de Francfort (1871-1872) ; Les rapports russo-français à la fin du XIXe siècle ; Jean Jaurès contre la réaction et la guerre ; etc. — "Albert Manfred vient de réunir en un volume un certain nombre d'études sur l'histoire de la France du XVIIIe au XXe siècle publiées pendant quelque vingt années à Moscou. Ces textes concernent aussi bien la Révolution française – en particulier les personnages de Robespierre et de Marat – que la vie politique de la France de 1871 à 1914 ou les années de l'entre-deux-guerres. Manfred soutient, tout au long de son livre une thèse qui culmine dans son dernier article : face à la croissance de l'Allemagne et aux menaces qu'elle a fait peser depuis un siècle sur l'Europe, l'entente franco-russe est inscrite dans la nature des choses dès lors que les deux pays sont soucieux de leur intérêt national, et cette entente est un élément important pour la sécurité et la paix en Europe et dans le monde. Ce point de vue, particulièrement développé dans la dernière partie de l'ouvrage inspire aussi deux gros articles de son corps central, où sont étudiées les origines de l'alliance franco-russe entre 1871 et 1891. A. Manfred y combat la thèse jadis soutenue par Georges Michon, selon laquelle l'alliance franco-russe servit, après le congrès de Berlin, les seuls intérêts de la Russie, empêtrée dans la question d'Orient..." (Madeleine Rebérioux, Annales ESC, 1971)
Essais d'histoire de France du XVIIIe au XXe siècle.
Moscou, Editions du Progrès, 1969, in-8°, 622 pp, reliure toile éditeur, titres en bleu au 1er plat et au dos, pt tache au 1er plat, bon état, envoi a.s. à l'historien Ernest Labrousse
16 études érudites : Jean-Jacques Rousseau, précurseur de la Révolution ; Jean-Paul Marat - l'Ami du peuple ; Controverses autour de Robespierre ; Maximilien Robespierre ; Robespierre dans l'historiographie russe et soviétique ; Le Comité central de la Garde Nationale de 1871, premier gouvernement révolutionnaire de la classe ouvrière ; Le mouvement révolutionnaire français après la Commune de Paris et N. Tchernychevski ; Les rapports russo-français après le Traité de Francfort (1871-1872) ; Les rapports russo-français à la fin du XIXe siècle ; Jean Jaurès contre la réaction et la guerre ; Etc. — "Albert Manfred vient de réunir en un volume un certain nombre d'études sur l'histoire de la France du XVIIIe au XXe siècle publiées pendant quelque vingt années à Moscou. Ces textes concernent aussi bien la Révolution française – en particulier les personnages de Robespierre et de Marat – que la vie politique de la France de 1871 à 1914 ou les années de l'entre-deux-guerres. Manfred soutient, tout au long de son livre une thèse qui culmine dans son dernier article : face à la croissance de l'Allemagne et aux menaces qu'elle a fait peser depuis un siècle sur l'Europe, l'entente franco-russe est inscrite dans la nature des choses dès lors que les deux pays sont soucieux de leur intérêt national, et cette entente est un élément important pour la sécurité et la paix en Europe et dans le monde. Ce point de vue, particulièrement développé dans la dernière partie de l'ouvrage inspire aussi deux gros articles de son corps central, où sont étudiées les origines de l'alliance franco-russe entre 1871 et 1891. A. Manfred y combat la thèse jadis soutenue par Georges Michon, selon laquelle l'alliance franco-russe servit, après le congrès de Berlin, les seuls intérêts de la Russie, empêtrée dans la question d'Orient..." (Madeleine Rebérioux, Annales ESC, 1971)
Les Généraux meusiens de la Révolution et de l'Empire.
Bar-le-Duc, Syndicat d'Initiative, 1969, gr. in-4°, 355 pp, portraits hors texte, blasons, une carte, biblio, reliure toile bordeaux de l'éditeur, titres dorés au 1er plat et au dos, bon état
Une noblesse d’empire : des maréchaux et généraux meusiens. La période napoléonienne a permis d’installer sa propre noblesse, et de vite faire grimper ses plus dévoués serviteurs. Ouvrage bien documenté, illustré de nombreux portraits et blasons. Il donne la biographie, les états de services, les campagnes, blessures et décorations, et la signature en fac-similé des 38 généraux présentés.
Les faux Louis XVII. Le roman de Naundorff et la vie de Carl Werg. Recueil de 700 documents tirés des Archives d'Allemagne et de France (1774-1920).
P., Gamber, 1926, 2 forts vol. gr. in-8°, 1274 pp, pagination continue, 16 pl. de documents hors texte et une généalogie rempliée in-fine, important index des noms de lieux et de personnes (42 pp), brochés, bon état
"Une valeur documentaire de premier ordre." (Parois 698)
Les Lucs. La Vendée, la Terreur et la mémoire.
Fromentine, 1993, in-8° carré, 227 pp, nombreux documents et gravures, édition originale, un des 564 ex. numérotés, broché, bon état
La Femme au temps de la Révolution.
Stock, 1989, gr. in-8°, 417 pp, 61 gravures sur 32 pl. hors texte, broché, couv. illustrée, bon état
Les clichés ont la vie dure, s'agissant de la Révolution, et particulièrement en ce qui concerne les femmes. Pour les uns, c'est le souvenir des tricoteuses, des dames de la Halle qui haranguent la foule, de quelques amazones hystériques. Pour les autres, suivant en cela Michelet, les femmes manipulées par les prêtres fournissent les gros des troupes de la Contre-Révolution – tandis que les patriotes tentaient de les affranchir. Sans parti pris, avec le souci permanent de déchiffrer les attitudes individuelles derrière des images trompeuses, Catherine Marand-Fouquet rétablit la vérité, et fait revivre pour nous toutes les femmes de ces dix années capitales. Celles qui tentèrent d'agir, aux premières heures de la Révolution, qui voulurent prendre la parole, écrire, manifester, mais que les conventionnels renvoyèrent au rôle d'épouse vertueuse qu'ils rêvaient pour elles. Les passionnées, d'un bord ou de l'autre, Théroigne de Méricourt ou Charlotte Corday ; celles qui survécurent, comme Madame Tallien, et celles qui moururent, comme Madame Roland et Marie-Antoinette, qui cristallisa sur elle toutes les haines. Il y eut aussi toutes celles qui subirent : fuyardes dans la Vendée ravagée par la guerre, femmes de prisonniers qui hantaient inlassablement les allées du pouvoir pour quémander la libération de leur époux, mères déchirées aux heures les plus noires de la Terreur, veuves de soldats de l'An II auxquelles la Patrie monnayait chichement sa reconnaissance. Parce qu'elles étaient en charge du foyer, ce sont les femmes qui éprouvèrent le plus durement les désordres et la pénurie. Aucune réflexion sur la Révolution ne pourra désormais ignorer l'apport de ce livre, et l'éclairage qu'il jette sur cette moitié de la société qu'on oublie trop souvent à l'heure des comptes : les femmes.
Marat. Autobiographie de Marat. Les Chaînes de l'Esclavage. – Plan de Législation criminelle. – L'Ami du Peuple. – Journal de la République française. – Biographie, bibliographie, choix de textes par Charles Simond.
P., Louis Michaud, s.d. (1909), in-12, xvi-136 pp, portraits de Marat et illustrations, broché, bon état (Les Prosateurs illustres français et étrangers)
 Write to the booksellers
Write to the booksellers