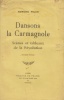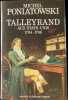Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (21)
19th (199)
20th (831)
21st (41)
-
Syndicate
ILAB (1103)
SLAM (1103)
Histoire d'un régiment, la 32e Demi-Brigade (1775-1890). Lonato, 1796 - Les Pyramides, 1798 - Friedland, 1807 - Sébastopol, 1855.
P., Le Vasseur et Cie, s.d. (1891), in-4°, xxiii-381 pp, un frontispice de Sergent, 98 illustrations et culs-de lampe d'après Raffet (la plupart), Carle Vernet, Charlet, Detaille, Sergent, pièces justificatives, cartonnage percaline rouge, dos et plat ornés, tranches dorées (reliure de l'éditeur), reliure lég. salie, bon état
Le seul historique de cette unité que l'on retrouve aux Pyramides, à Friedland et à Sébastopol.
L'Eglise et la Révolution, 1789-1889.
P., Nouvelle Cité, 1988, in-8°, 273 pp, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Ce livre couvre cent ans d'histoire. Cent ans au cours desquels l'Eglise, après avoir subi – et parfois promu – le choc de la Révolution, a dû continuellement se situer par rapport à elle : de l'Eglise constitutionnelle à la "Contre-révolution irréconciliable", de l'Eglise des évêques-réunis au concordat, autant d'attitudes dont nous sommes pour une part les héritiers. 1789, 1830, 1848, 1870, Pierre Pierrard suit pas à pas, sans polémique, cette histoire où la passion et les préjugés ont servi trop souvent d'arguments. Cet ouvrage extrêmement documenté ouvre au lecteur des perspectives inattendues.
Les Hymnes et chansons de la Révolution. Aperçu général et catalogue avec notices historiques, analytiques et bibliographiques.
Imprimerie Nationale, 1904, gr. in-4°, xiv-1040 pp, qqs illustrations et partitions dans le texte, copieuses tables en fin d'ouvrage, reliure cartonnée à la bradel de l'éditeur, très bon état (Ville de Paris. Publications relatives à la Révolution française)
Ouvrage de référence, répertoriant 2337 compositions avec notices historiques, analytiques et bibliographiques, recueillies et transcrites par Constant Pierre. Table : prédilection du peuple pour la chanson ; nature, forme et but des chansons de la période révolutionnaire, sujets traités ; les airs ou timbres ; les hymnes ; les documents manuscrits ou imprimés ; les éditions musicales ; les sources bibliographiques ; les collections publiques et privées ; tables alphabétiques des hymnes et chants, des chansons populaires, des airs ou timbres, des auteurs... — "Outre un inventaire chronologique des hymnes et chansons, ce monument procure une bibliographie complète des recueils et imprimés, une préface considérable et tous les index souhaitables. C. Pierre a estimé à trois mille environ les chansons produites par la Révolution française, plus 177 "hymnes" destinés aux fêtes patriotiques. Cela fait en gros une chanson par jour entre 1789 et 1800, mais avec une évolution statistique très diverse : progression moyenne de 1789 à 1792 – de 116 à 325 chansons –, brusque accélération en 1793-1794 – 590 et 701 chansons –, chute brutale en 1795, et ensuite, malgré une reprise en 1795, déclin continu : de 137 chansons en 1795 à 25 en 1800. L'évolution est, on s'en doute, étroitement liée à la conjoncture politique : liberté créatrice de la Révolution, propagande chansonnière d'Etat sous la Convention, méfiance ensuite et contrôle accru jusqu'au 18 brumaire." (François Moureau, Stratégie chansonnière de la Révolution française, 1989)
Musique des fêtes et cérémonies de la Révolution française. Oeuvres de Gossec, Chérubini, Lesueur, Méhul, Catel, etc. Recueillies et transcrites par Constant Pierre.
Imprimerie Nationale, 1899, gr. in-4°, lxxx-584 pp, partitions dans le texte, copieuses tables en fin d'ouvrage, reliure cartonnée papier beige à la bradel de l'éditeur, très bon état (Ville de Paris. Publications relatives à la Révolution française)
"Cet important ouvrage fait partie de la série historique relative à la Révolution française, publiée par le conseil municipal de Paris. Ce volume est presque exclusivement consacré à la reproduction des partitions musicales. Dans son introduction l'auteur cite l'opinion de M. René Brancour : « Ce magnifique élan d'enthousiasme, ce renouveau grandiose dont la Révolution dota le monde, n'avait guère été étudié dans ce domaine spécial, si riche si intéressant. On se doutait peu, en général, de ce réveil musical – disons mieux – de cette naissance de la musique à la fois solennelle et populaire dont les fêtes publiques furent tout ensemble la cause et l'objet. Les cérémonies de l'antiquité grecque et romaine furent renouvelées sur notre sol, et les Chérubini, les Gossec, les Méhul, que l'on se borne trop souvent à admirer sans les connaître, composèrent des hymnes destinés à être exécutés par les masses chorales et orchestrales, véritablement imposants. » M. Constant Pierre rappelle encore que « c'est à la participation des artistes musiciens de la garde nationale parisienne aux fêtes et aux cérémonies publiques de la période révolutionnaire qu'est due la création du Conservatoire »." (Fr. Funck-Brentano, Revue des Questions historiques, 1900) — Le musicologue Constant Pierre (1855-1918), dont les travaux font toujours autorité, a recensées, recueillies et transcrites les musiques des principaux hymnes et chants de la Révolution française. Appartenant à cette grande génération de découvreurs à l’extrême fin du XIXe siècle et à l’aube du XXe, il a publié ces recueils qui restent toujours si précieux : Musique des fêtes et cérémonies de la Révolution française (1899) et Les Hymnes et chansons de la Révolution (1904).
Lucien Bonaparte, Prince romain.
Perrin, 1985, in-8°, 347 pp, 16 pl. de gravures hors texte, généalogie, reliure skivertex vert empire de l'éditeur, demi-jaquette illustrée, rhodoïd, bon état
Les débuts de Lucien Bonaparte semblent annoncer un avenir prometteur au jeune frère de Napoléon. Mais les deux hommes n'ont que peu de choses en commun. Le caractère indépendant, contestataire et obstiné de Lucien irrite le futur empereur. Pourtant, Lucien joue un rôle clef dans l'accession au pouvoir de son aîné : jeune jacobin enflammé, président du Conseil des Cinq-Cents, il est l'un des auteurs du coup d'Etat du 18 Brumaire. En retour, il espère la reconnaissance de son frère. Il n'en est rien. En désaccord avec le Premier Consul, il est nommé ambassadeur en Espagne, puis membre du Tribunat et sénateur. Son mariage avec Alexandrine à la réputation légère l'éloigne encore de son frère farouchement opposé à cette liaison qui dura pourtant quarante ans. Il se réfugie en Italie, sa seconde patrie, et devient l'ami du pape Pie VII qui le fait prince romain. Collectionneur, amateur d'art et de jolies femmes, poète et même romancier, d'une honnêteté souvent discutable, Lucien occupe une place à part dans la galaxie Bonaparte : celle du rebelle qui sut tenir tête à l'Empereur.
Dansons la Carmagnole. Scènes et tableaux de la Révolution.
P., Mercure de France, 1939, in-12, 306 pp, broché, bon état
La lettre volée de Marie-Antoinette ; Paris en 1789 : le voyage de Martin ; Le pain des frères ou le poison de Cabanis ; Les vainqueurs de la Bastille ; L'ennemi des rois, la vicomterie ; Le fade Robespierre ; Un déporté de Fructidor ; etc. — "Ce livre réunit des tableaux de la Révolution de 89, hommes et choses échappés à la grande histoire et qu'une bonne plume semble sauver de la mort éternelle. Et pourtant, ne semble-t-il pas que personnages et épisodes de seconde zone livrent mieux la marque particulière et l'atmosphère d'une époque ? Les vainqueurs de la Bastille, le combat de l'avocat de Sèze devant le tribunal révolutionnaire, la vie d'Hubert Robert sous la Terreur, l'enfance du duc d'Enghien, Marseille dans les temps troubles, etc. M. Edmond Pilon est un érudit exemplaire, puisque, de cette poussière évidemment précieuse, il sait tirer un attrait..." (Le Figaro, 1939)
L'Emigration militaire. Emigrés de Saintonge, Angoumois et Aunis. Dans les corps de troupe de l'Emigration française, 1791-1814.
Picard, 1974, gr. in-8°, 295 pp, broché, bon état
Recueil de notices biographiques très complet de tous les officiers, originaires des régions situées entre La Rochelle et Angoulème, qui ont émigré entre les débuts de la Révolution française et la fin de l'Empire et servis dans les corps de l'Armée des Princes. — "Les travaux de Jean Pinasseau seront très utiles à tous ceux qui ont à faire des recherches sur les émigrés." (Jean-Claude Devos, Bibliothèque de l'école des chartes)
Cambacérès, 1753-1824.
Perrin, 1996 in-8°, 272 pp, sources, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Cambacérès, homme de l'ombre, des réseaux, du pouvoir et de l'argent, est un personnage clef de la Révolution et de l'Empire. Ce provincial, né à l'époque des Lumières, sait prendre le vent d'où qu'il vienne. Révolutionnaire de la première heure, il rédige les cahiers de doléances de la noblesse de Montpellier. Juriste habile, il se taille une réputation comme président du tribunal criminel de l'Hérault. Franc-maçon militant, il s'attache des fidélités indéfectibles. Mais c'est à Paris que se fait l'histoire du temps. Et Cambacérès y montre les mêmes qualités de sérieux et d'entregent, d'abord à la Convention, puis au Comité de Salut public et au Directoire. Son triomphe, il le doit à un homme, Napoléon Bonaparte, auprès duquel il devient tout à la fois le premier juriste de l'Empire – c'est lui qui rédige le code civil – et une sorte de vice-empereur qui, derrière le goût du luxe, de la pompe, de la table et des fêtes, régente la Cour et dispute à Talleyrand les rênes du pouvoir intérieur. Grâce à des archives inédites, Pierre-François Pinaud, enseignant à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, brosse le portrait de celui qui fut, avant la lettre, le "Premier ministre" de la France.
La Domination française dans l'Italie du Nord (1796-1805). Bonaparte président de la République italienne. Tome II.
Perrin, 1914, in-8°, 529 pp, index, reliure demi-basane ocre à coins, dos à 5 nerfs pointillés et soulignés de doubles filets dorés, pièces de titres et de tomaison basane rouge, couv. conservées, signet (rel. moderne), bon état
Tome II seul (sur 2).
Etudes sur la ville et paroisse de Courbevoie. Pierre Hébert, premier curé de Courbevoie, guillotiné sous la Terreur, et ses successeurs.
P., Honoré Champion, 1908, gr. in-8°, vii-385 pp, 77 gravures, reliure récente pleine toile écrue, pièce de titre chagrin vert, 1er plat conservé (toile légèrement salie, bon état)
Les Déportés de Fructidor. Journal. Annoté d'après les documents d'archives et les memoires par Albert Savine.
P., Louis-Michaud, 1909, pt in-8°, 191 pp, 30 gravures de l'époque, reliure percaline souple de l'éditeur, couv. conservée, tranches rouges, bon état (Coll. historique illustrée)
Le départ pour la déportation ; La traversée ; La Guyane.
Pratiques religieuses dans l'Europe révolutionnaire (1770-1820). Actes du colloque, Chantilly 27-29 novembre 1986, réunis par Paule Lerou et Raymond Dartevelle, sous la direction de Bernard Plongeron.
Brépols, 1988, gr. in-8°, 777 pp, 24 illustrations, dont 8 en couleurs, chronologie, index, broché, C. de bibl., bon état
A-t-on assez répété que la France, puis l'Europe occupée par les armées de la Révolution, avaient sombré dans l'athéisme militant, cause d'un vaste "désert cultuel" ? Comment alors expliquer les efflorescences religieuses du début du XIXe siècle, sinon en enquêtant sérieusement sur les réactions des millions de laïcs catholiques, protestants, juifs vivant leur foi au quotidien soit dans la clandestinité, soit au grand jour de la vie publique ? Pour la première fois, ce livre aborde cette question centrale moins pour apporter des réponses définitives que des éclairages inédits sur cette grande inconnue : la vie religieuse des laïcs sous la Révolution. Les meilleurs spécialistes d'Europe, au long de soixante-dix contributions (table ronde, rapports, communications et débats), explorent les pratiques, les mentalités, les courants de spiritualité sur des cas précis: transformations des paroisses, mariage et divorce, sacramentalisation et désacralisation, les femmes et leur rôle nouveau, les confréries et les congrégations, etc. Vingt-neuf régions ou provinces de France et d'Europe manifestent ainsi leurs différences, leurs parades et leurs résistances face au pouvoir jacobin. Livre savant par la rigueur de textes s'appuyant directement sur les archives, livre prudent dans des jugements en forme de voies ouvertes à la recherche, il reste d'une lecture parfaitement accessible. En effet, les huit grands thèmes qui en forment la structure peuvent être consultés indépendamment les uns des autres, au gré de la curiosité du lecteur.
Terreur et terroristes à Rennes, 1792-1795.
Mayenne, Joseph Floch, 1974, gr. in-8°, xvi-467 pp, une carte du district de Rennes, sources, biblio, index, broché, couv. défraîchie, bon état. On joint la carte de visite de l'auteur
"... S'il y eut des terroristes à Rennes, il est bien certain qu'ils se sont sinon révélés, du moins furent mis en état d'agir par l'arrivée dans la ville le 1er septembre 1793 de la Terreur, c'est-à-dire du représentant en mission Carrier. « Le proconsul, écrit l'auteur, avait pour tâche d'exterminer le fédéralisme et de maîtriser ses adhérents. Il y déploya une énergie qui, on ne doit pas se le dissimuler, lui valut des partisans et des admirateurs. Cela explique que, même éloigné de Rennes, son prestige, son ascendant ait continué à s'y faire sentir ». (...) Le travail érudit de notre confrère permettra « de fournir des éléments à ceux qui se chargeront de reviser l'histoire de la Terreur à Rennes » et de nuancer leur jugement en mettant en relief les difficultés d'être terroriste à Rennes en 1793-1794 ou plus exactement en l'an II de la République." (Jacques Charpy, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1975)
Garnerin. Le premier parachutiste de l'histoire. (Octobre 1797).
Albin Michel, 1983, in-8°, 272 pp, 20 gravures, documents en annexe, biblio
Talleyrand aux Etats-Unis, 1794-1796.
Presses de la Cité, 1967, in-8°, 379 pp, 16 pl. de gravures hors texte, documents en annexes, reliure skivertex éditeur, rhodoïd, bon état
"Le prince Michel Poniatowski comptait Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord au nombre de ses ancêtres, fusse en ligne non officielle : l’arrière-grand-mère paternelle de Michel Poniatowski était elle-même arrière-petite-fille de Talleyrand par le comte de Flahaut et le duc de Morny (voir Gérard de Villeneuve, Les Giscard d’Estaing, 1975)." (André Beau) — "Le seul livre qui traite de la période d'exil de Talleyrand aux Etats-Unis est celui de Michel Poniatowski, Talleyrand aux Etats-Unis, 1794-1796. C'est un livre assez bien écrit mais un peu superficiel et on peut se demander s'il valait la peine de consacrer tout un livre à ce sujet." (Philip G. Dwyer, Revue du Souvenir Napoléonien, 1996)
Talleyrand aux États-Unis, 1794-1796.
Perrin, 1976, fort in-8°, 671 pp, 32 pl. de gravures hors texte, reliure skivertex éditeur, demi-jaquette illustrée, rhodoïd, bon état, envoi a.s.
"Le prince Michel Poniatowski comptait Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord au nombre de ses ancêtres, fusse en ligne non officielle : l’arrière-grand-mère paternelle de Michel Poniatowski était elle-même arrière-petite-fille de Talleyrand par le comte de Flahaut et le duc de Morny (voir Gérard de Villeneuve, Les Giscard d’Estaing, 1975)." (André Beau) — "Le seul livre qui traite de la période d'exil de Talleyrand aux États-Unis est celui de Michel Poniatowski,. C'est un livre assez bien écrit mais un peu superficiel et on peut se demander s'il valait la peine de consacrer tout un livre à ce sujet." (Philip G. Dwyer, Revue du Souvenir Napoléonien, 1996)
Compte rendu des grains achetés par la province du Comté Venaissin. Imprimé par ordre de l'Assemblée des Trois-Etats du Comté Venaissin.
A Carpentras, chez Dominique-Gaspard Quenin, 1789, in-4°, 68 pp, 3 tableaux dépliants hors texte montés sur onglet, reliure demi-maroquin carmin, dos lisse, titre et fleurons (bonnets phrygiens) dorés (reliure moderne), bel exemplaire. Rare
Bien complet des trois grands tableaux des sorties et des entrées des grains et des fonds pour le Comtat Venaissin avec un résumé général d'achat et de vente. Importante et rare publication sur le problème de la disette et de la rareté des grains en 1789. Jean-Pierre de Pons était le trésorier général de la province du comté Venaissin.
Revolutionary News. The Press in France, 1789-1799.
Durham et Londres, Duke University Press, 1990, in-8°, xx-216 pp, 6 gravures, notes bibliographiques, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état. Texte en anglais
"Voici une bonne synthèse concernant les journaux pendant la Révolution, par l'un des spécialistes américains de l'histoire de la presse. L'auteur montre d'abord le rôle essentiel qu'a joué la presse en plaçant sur la scène publique le débat politique. Rappelant que 140 nouveaux périodiques voient le jour à Paris pendant la seule année 1789, il souligne qu'en l'absence de partis politiques au sens moderne du terme, la presse a servi de relais indispensable et vital entre la nation et ses représentants. Car les journaux révolutionnaires sont politiques avant tout, et représentent, sauf pendant la période de la Terreur, un large éventail d'opinions : aucune assemblée n'osa remettre en cause le principe de la liberté de la presse, un des grands acquis de 1789, même si des lois tentèrent à diverses reprises de la limiter. Dans un intéressant chapitre consacré aux journalistes, aux éditeurs et aux lecteurs, l'auteur montre également que la période révolutionnaire se caractérise par une médiatisation du politique, conférant brutalement la célébrité à d'obscurs journalistes, multipliant les ateliers d'imprimerie et faisant tout à coup gagner beaucoup d'argent à ceux qui se mêlent d'écrire ou d'imprimer. Avec un chiffre approximatif de 300.000 exemplaires vendus quotidiennement à Paris pendant les années les plus fécondes, la Révolution française a inauguré une ère nouvelle où la presse, porte-parole de l'opinion publique, devenait un élément indispensable de la vie démocratique." (L. Andries, Dix-huitième Siècle, 1991)
Cahiers des Curés et des Communautés ecclésiastiques du bailliage d'Auxerre pour les Etats Généraux de 1789. Département de l'Yonne.
Auxerre, Impr. L'Universelle, 1927, gr. in-8°, clxxxviii-407 pp, broché, bon état (Coll. de documents inédits sur l'Histoire économique de la Révolution française publiés par le Ministère de l'Instruction publique)
"Les curés, trop éloignés du chef-lieu du bailliage pour se rendre en personne à l'assemblée électorale du clergé, eurent le droit de s'y faire représenter par des procureurs auxquels ils remirent, avec leurs pouvoirs, des instructions et mémoires. La plupart de ces « cahiers » des curés n'ayant pas été déposés dans des dépôts publics sont aujourd'hui perdus. M. Porée a été assez heureux pour retrouver ceux du bailliage d'Auxerre. Sa publication – extrêmement soignée comme toutes celles qui portent sa signature – est d'un intérêt de premier ordre pour la connaissance non seulement des vœux et des sentiments réels du clergé à la veille de la Révolution, mais encore de sa situation économique comme du mécanisme compliqué des institutions ecclésiastiques. M. Porée a dressé, paroisse par paroisse, l'état des revenus des cures du diocèse comprises dans le bailliagé (dîmes de diverses natures, biens-fonds, rentes, fondations, casuel, portion congrue, etc.), et il a commenté ce tableau, avec la méthode critique et l'impartialité foncière qui font l'admiration de tous ceux qui lisent ses beaux travaux. Il en résulte que pour les 151 paroisses envisagées, le revenu net total ne se montait qu'à 140.000 livres, pas 1.000 livres en moyenne par cure. Mais ce revenu était en outre très inégalement réparti. Un gros décimateur possédait 2.500 livres de revenus, 14 curés approchaient ou dépassaient 1.500 livres, 12 autres 1.000 ou 1.200, mais la grande majorité, soit 123, n'avaient pas 1.000 livres, la plupart devaient se contenter de 5 à 700 livres. Il y on avait 17 qui n'avaient pas 500 livres. Or, le clergé régulier, le clergé oisif, – dont M. Porée dresse aussi avec une précision parfaite l'état des revenus, établissement par établissement, – contrastait par sa richesse avec la misère du clergé paroissial Les 11 abbayes et 2 prieurés avouaient 193.985 livres de revenus déclarés, sur lesquels 7 abbés et 2 prieurs commendataires prélevaient pour eux seuls 112.488 livres. Ces statistiques ne sont-elles pas une justification du tableau que les écrivains contemporains nous ont tracé du clergé de leur temps ? Elles éclairent d'une vive lumière les vœux des curés, leurs projets de réforme et aussi la campagne électorale qu'ils menèrent contre l'évêque et le haut clergé. Sur tous ces points, M. Porée est d'une précision qui contentera les plus difficiles. Dans le diocèse d'Auxerre les curés ne réussirent pas à empêcher l'élection de l'évêque qui passa à une voix de majorité absolue. M. Porée nous dit, par le détail, à la suite de quelles manœuvres curieuses ils échouèrent. L'introduction de 133 pages qu'il a mise au recueil des cahiers est pleine d'enseignement pour l'histoire générale." (Albert Mathiez, Annales historiques de la Révolution française, 1927) — "On ne s'étonnera pas que la publication de M. Porée soit très satisfaisante, tant on est accoutumé à louer toutes celles qu'il nous donne, Son introduction contient une étude minutieuse de la situation économique du clergé dans le bailliage d'Auxerre, à l'aide du pouillé de 1781 et des déclarations de revenus de l'époque révolutionnaire ; les données numériques ont été réunies en tableaux, On dira seulement ici que la grande majorité des curés n'avaient pas 1.000 livres de revenu tandis que les réguliers étaient riches et enviés : deux curés au moins ne voient aucun inconvénient à leur disparition. La publication de ces cahiers constitue par elle-même une nouveauté de grand intérêt, iIs sont en effet fort rares, parce qu'ils n'étaient pas à proprement parler des documents officiels et n'ont pas été conservés comme tels ainsi que les cahiers de paroisses. 166 curés ont comparu ou ont été représentés à Auxerre ; M. P. a retrouvé 48 cahiers ; mais tous les curés n’en ont pas rédigé et plusieurs cahiers sont collectifs : les 48 cahiers publiés représentent probablement les vœux de 87 curés. M. P. leur à adjoint les cahiers de 14 communautés ecclésiastiques parmi lesquels dominent ceux des chapitres et de chanoines. M. P. dit avec raison que c'est la première fois que pareils documents sont publiés en corps." (G. Lefebvre, Revue d'histoire moderne, 1929)
Le Général Dumouriez (1739-1823), d'après des documents inédits.
Perrin, 1914, in-8°, ix-350 pp, 2 portraits hors texte, sources, broché, bon état
"M. Pouget de Saint-André a consacré un volume au vainqueur de Valmy et de Jemmapes. Son Général Dumouriez a le mérite de nous faire connaître plus à fond, d'après les papiers de famille, sa vie intime et ses aventures de cœur avec sa cousine, Mlle de Broissy , aventures qui se terminèrent par leur mariage en 1774, après onze ans d'une passion traversée par mille obstacles. Malheureusement, le mariage lui- même aboutit bientôt après à une rupture, amenée par l'inconduite du général, qui pourtant n'avait plus l'excuse de la jeunesse. Mais, pour sa carrière militaire et politique, comme agent secret de Louis XV en Pologne, comme commandant de Cherbourg, comme ministre et général de la Révolution, l'on ne trouvera chez M. Pouget de Saint-André que des choses bien connues. On y lira tout au plus quelques traits nouveaux et piquants sur l'extrême vieillesse de Dumouriez, alors que l'ermite de Turville-Park « se remuait pour proposer la béatification de Louis XVI et la rentrée des Jésuites » (p. 295)." (Rod. Reuss, Revue Historique, 1915)
Un village avallonnais (Voutenay) sous l'Ancien Régime et la Révolution.
La Chapelle-Montligeon, Imprimerie-Librairie de Montligeon, 1907, in-12, vi-37 pp, broché, couv. muette, bon état
Etude sur un village bourguignon (Voutenay-sur-Cure, dans l'Yonne, au sud d'Auxerre) dans les dernières années de l'Ancien Régime à partir des registres des délibérations communales conservés dans les archives de la mairie. — "Il y a à Voutenay même un antiquaire qui, depuis plusieurs années, explore avec zèle les environs du village ; c’est le curé de la paroisse, M. l’abbé Poulaine. Il a formé au presbytère une petite collection d’objets antiques recueillis principalement sur la colline dite de Cora. Cette collection comprend un médaillier et un assez grand nombre de terres cuites, vases, lampes et figurines diverses. M. l’abbé Poulaine a déjà consigné dans quelques publications personnelles les résultats de ses recherches." (Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France)
Etudes littéraires. Epoque révolutionnaire.
P., Librairie de C. Borrani, 1868, in-12, 376 pp, broché, couv. piquée, qqs rares rousseurs, bon état
Mirabeau ; Volney ; Marie-Joseph Chénier ; Madame Roland ; Les Journaux de la Révolution ; Ducis ; Népomucène Lemercier ; Andrieux ; Picard ; Jacques Delille ; Bernardin de Saint-Pierre ; Burke et Fox ; Goethe ; Schiller ; Alfieri.
Monsieur du Barri et sa famille.
Armand Colin, 1932, in-8°, 238 pp, qqs notes bibliographiques, broché, imprimé sur papier d'alfa, bon état (Coll. Ames et visages)
L'histoire de Mme du Barri n'est plus à faire, mais celle de M. du Barri, pourtant fort intéressante, est restée dans l'ombre. Comment ce hobereau, enlisé dans son domaine familial de Gascogne, voit-il soudain la fortune s'offrir à lui, au prix de quel marchandage donne-t-il son nom à la maîtresse du roi, quels avantages en résultent pour lui et pour les siens, c'est ce que nous conte avec esprit M. Armand Praviel. Piquantes anecdotes, tableau fidèle et animé de la Cour, de Toulouse, sous Louis XVI et sous la Révolution, esquisse brillante des paysages de Gascogne, tout contribue à faire vivre cet ouvrage, captivant comme un conte, mais scrupuleusement établi sur les documents les plus sûrs. (L'Editeur) — Jean-Baptiste Dubarry, comte du Barry-Cérès, vidame de Châlons-en-Champagne, né en 1723 à Lévignac et guillotiné à Toulouse le 17 janvier 1794 a été l'amant puis le beau-frère de la comtesse du Barry, devenue la favorite du roi Louis XV.
Journal du Club des Cordeliers. Rédacteur : Antoine François Momoro.
P., EDHIS, 1981, in-8°, 90 pp, reliure skivertex bordeaux de l'éditeur, bon état
Réimpression de la collection complète de l'édition originale publiée à Paris du 28 juin à août 1791, soit : un prospectus et 10 numéros de 8 à 10 pages., avec des suppléments. Ce journal fut l’organe officiel de la Société des Droits de l’Homme et du citoyen, l’une des plus importantes de l’histoire de la Révolution française. Il mena campagne contre le roi et contre la majorité des constituants, favorables au rétablissement du pouvoir royal. Les Cordeliers constituèrent alors le cœur du mouvement républicain.
La Sentinelle, 1792. Rédacteur : J.-B. Louvet.
P., EDHIS, 1981, in-4°, non paginé, 73 numéros de une page sur 3 colonnes, pleine reliure skivertex fauve de l'éditeur, très bon état. Réimpression de l’édition originale de la collection complète, publiée à Paris, par l’imprimerie du Cercle Social du 24 mai 1792 (n° 1) au 21 novembre 1792 (n° 73)
Réédition en fac-similé des 73 numéros de "La Sentinelle", très rare journal d'inspiration girondine dont le principal rédacteur était Jean-Baptiste Louvet de Couvray. Ce « journal patriotique » se présentait sous la forme d’affiches imprimées en gros caractères, placardées tous les deux jours sur les murs de Paris et des grandes villes françaises à partir de mai 1792. Organe de propagande des Girondins, ce journal-affiche fut placardé à profusion dans les rues, les lieux publics, les salles de réunions et même à la porte des églises. La rédaction en fut confiée à J. B. Louvet, brillant et célèbre polémiste et à Petion, maire de Paris, sous la surveillance de Roland. Il s’agit bien d’un document de toute première importance, tant pour l’histoire des techniques de la presse et des techniques de propagande que pour l’histoire générale de la grande Révolution. Ces affiches nous mettent en contact direct avec la réalité vivante et fluctuante de la pensée politique des Girondins arrivés à leur apogée. En celà, la Sentinelle se classe au tout premier rang des grands journaux révolutionnaires. D'abord dirigée contre les menées royalistes des Feuillants, La Sentinelle dirigea ses attaques contre les Montagnards Marat, Danton et Robespierre accusés d’aspirer à la dictature. La parution s’interrompit en novembre 1792 avant de reprendre l’année suivante. L'ouvrage reproduit les 73 premiers numéros du journal.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers