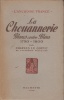Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (21)
19th (199)
20th (831)
21st (41)
-
Syndicate
ILAB (1103)
SLAM (1103)
Les Paysans du Nord pendant la Révolution française. (Thèse).
Armand Colin, 1972, gr. in-8°, xxv-1013-v pp, nouvelle édition, tableaux, biblio, index, broché, bon état. Peu courant
Reproduction à l'identique de la première édition (Lille, 1924). — "Il n'y a pas à rendre compte à proprement parler de la thèse du regretté G. Lefebvre. Elle date de 1924, et chacun en connaît, sinon le contenu précis, du moins la portée, puisque toute l'oeuvre ultérieure de Georges Lefebvre, récrivant à partir de ces investigations sociales en profondeur l'histoire de la Révolution française, l'a en quelque sorte élargie et prolongée. Quant au contenu propre de cette oeuvre, le but de cette réédition est précisément de le rendre accessible par une édition plus largement diffusée que ne le fut (300 exemplaires !) l'original de 1924. (...) Ce livre présente « les paysans à la fin de l'ancien régime » et « les paysans et la Révolution » ; est-il besoin de dire cependant que l'ancien régime et la révolution ne s'opposent pas ici comme le noir et le blanc, mais que, si les tares de l'ancien régime sont démontrées avec une force et une précision accablantes, les lacunes de l'oeuvre, pourtant considérable, du nouveau régime en faveur des paysans sont pour la première fois mises en lumière. C'est ici en effet que prend naissance ce thème majeur (et bien connu) de l'oeuvre de G. Lefebvre : l'existence d'un corps complexe de revendications paysannes (surtout de la paysannerie pauvre), aspirations sociales, indépendantes des régimes et des valeurs politiques, aspirations dont la Révolution a satisfait les principales en abolissant droits féodaux et dîmes, par exemple (et c'est pourquoi l'ancien régime – G. Lefebvre conclut sur cette assertion – n'a jamais été regretté), mais dont elle a méconnu beaucoup, soit du fait de l'incompréhension des bourgeois individualistes à l'égard des vieilles pratiques sociales communautaires, soit tout simplement du fait des circonstances, guerre et réquisitions, inflation et disette, répression enfin..." (Maurice Agulhon, Études rurales)
The Coming of the French Revolution. Translated by R. R. Palmer.
Princeton University Press, 1976, pt in-8°, xx-233 pp, index, broché, bon état, envoi a.s. de Robert R. Palmer à l'historien Louis Bergeron. Texte en anglais
Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 1782-1861. (Thèse).
Plon, 1957-1965, 3 vol. in-8°, 491, 667 et 859 pp, un portrait en frontispice du tome I, 9 cartes et 4 gravures hors texte, sources et biblio, index, brochés, très bon état
Tome I : De la noblesse de robe au ministère des pauvres, les étapes d'une vocation, 1782-1814 ; Tome II : Missions de Provence. Restauration du diocèse de Marseille, 1814-1837 ; Tome III : L'oeuvre pastorale et missionnaire, adaptation et extension, 1838-1861. — "On s'est trop souvent heurté à la médiocrité conformiste et verbeuse de maintes biographies épiscopales du siècle dernier, à peine distinctes de l'oraison funèbre, pour ne pas se réjouir de voir paraître le « Mazenod » si précis, si vivant, que vient d'achever Mgr Leflon. Ce dernier a dû maîtriser ici, non seulement une immense documentation, mais aussi la difficulté que présentait la double appartenance de son héros : fondateur et évêque ; il fallait en faire revivre la riche personnalité en l'insérant, sans l'y enfermer, dans le double cadre de sa congrégation et de son diocèse. Le premier volume (1782-1814) suit, « de la noblesse de robe au ministère des pauvres, les étapes d'une vocation », dont la maturation coïncide avec le temps des orages révolutionnaires. Les deux suivants retracent inséparablement « l'œuvre pastorale et missionnaire », en adoptant pour charnière la date de 1837, à laquelle Eugène de Mazenod accède au siège episcopal de Marseille. (...) Mgr Leflon n'a pas seulement mené à bien une solide biographie épiscopale, mais projeté de nouvelles lumières sur toute une époque du catholicisme français." (Claude Savart, Revue d'histoire de l'Église de France)
Nicolas Philbert, évêque constitutionnel des Ardennes.
Mézières, Archives départementales, 1954, in-8°, 193 pp, un portrait de Philbert hors texte, une carte, broché, bon état. Ex-libris Dominique Labarre de Raillicourt
"Le personnage dont M. Leflon retrace la vie intéresse à plus d'un titre. Philbert, qui fut évêque constitutionnel des Ardennes de la fin de 1790 à 1797, n'a certes pas l'intelligence, même à œillères, ou le caractère, même abrupt, qui distinguent tel ou tel autre prélat de cette Eglise. Il est plus « retors » que subtil, plus opportuniste que constant en sa théologie, plus coutumier des voies indirectes que du combat à visage découvert. Cela se discerne non seulement dans sa carrière ecclésiastique, mais lors des événements politiques auxquels le mêlèrent, après le 10 août 1792, la révolte de La Fayette et l'attitude « fédéraliste » de la municipalité sedanaise. Il arriva pourtant à cet évêque de se montrer rigide et courageux. Un mandement de janvier 1793 contre le mariage des prêtres et le divorce lui valut d'être conduit sous bonne escorte à la Convention. La chose aurait pu mal tourner. Bien sûr, Philbert, en fâcheuse posture, déploya en faveur de sa cause quelques-unes des « astuces » auxquelles il était loin de répugner. Mais ce n'est pas un mince honneur pour lui de se voir inscrit à côté des Grégoire et des Gratien, parmi ceux qui s'élevèrent vigoureusement contre les plus graves réformes religieuses de la Révolution toute-puissante. On appréciera beaucoup l'étude de M. Leflon sur le serment constitutionnel dans le département des Ardennes. L'intérêt historique de cette question est loin d'être épuisé..." (Ch. Ledré, Revue d'histoire de l'Église de France, 1955)
Le Cardinal de Bouillon à Saint-Martin de Pontoise (1671-1697).
dans les Mémoires de la Société historique de Pontoise et du Vexin, t. XL, 1930, gr. in-8°, 28 pp, (p. 69-96 sur 120), une pl. hors texte, broché, bon état
Travaux à l'abbaye de Saint-Martin. Bâtiments construits par Mansard ; jardins dessinés par Lenôtre. Réceptions à l'abbaye ; les habitués. — On trouve également dans le même numéro les souvenirs sur la Révolution à Osny de Madame de Nicolay : Souvenirs de quatre-vingts ans (Extraits des Mémoires inédits de Madame de Nicolay, née de Lameth) (11 pp), une étude sur Honoré de Balzac et ses deux amis de l'Isle-Adam (15 pp), une notice sur Champagne-sur-Oise au Moyen Age (12 pp), etc.
Le général Bigarré, 1775-1838. Vingt-cinq années de guerre sous la Révolution et l'Empire.
Bernard Giovanangeli, 2005 in-8°, 317 pp, un portrait, sources, index, broché, couv. illustrée, bon état
La vie et la carrière exceptionnelles du plus célèbre des généraux bretons de Napoléon. Marin à Saint-Domingue à seize ans, engagé dans l'infanterie en 1794, il est à Hoenlinden, puis à Austerlitz. Il passe ensuite au service de Joseph Bonaparte, qu'il suit à Naples, puis en Espagne, avant de revenir en France, en 1814, défendre le sol national. Vingt-cinq années de guerre remarquablement retracées par un auteur, qui conjugue un réel talent de plume à une grande connaissance de son sujet.
La Chouannerie. Blancs contre Bleus (1790-1800).
Hachette, 1930, in-12, 238 pp, broché, dos lég. bruni, bon état
La Galerie des homonymes, 1780-1840.
Abbeville, Paillart, 1993, gr. in-8°, 134 pp, préface de Jean Tulard, 4 pl. de portraits hors texte, sources, annexes, index des noms de personnes, index des noms de lieux, index et nombre des homonymes, broché, couv. illustrée, bon état
Par Robert Legrand (1912-2006), historien spécialiste de la Révolution française et en particulier de Gracchus Babeuf. — "Il m'arrive parfois, parlant du Comte de Saint-Simon, d'avoir pour réponse : « Oui, le duc, le célèbre auteur des Mémoires... ». Certes il est facile de confondre, par manque d’attention ou de connaissances. Et des personnages ayant le même patronyme, on les croit, parfois à tort, parents. J'ai donc commencé à noter des noms, fixer des prénoms et des dates, susceptibles de prêter à confusion. Je me suis vite aperçu que les homonymes se trouvaient assez nombreux dans la période si riche en événements de la fin de l’Ancien régime à la révolution de Juillet, et j'ai continué à chercher. J'ai ainsi découvert nombre de destinées intéressantes, ou curieuses, certaines mêmes exceptionnelles. Certains homonymes ont même été confondus : l’un arrêté pour l’autre, et tel général condamné à la place de son frère. Et que de destins tragiques, heureusement parfois sauvés par l’amour ! L'ouvrage a pris corps ainsi, le livre s'est fait au cours de mes lectures, finissant par rassembler près de 110 patronymes différents, rassemblés en 490 personnages dont la vie est ici plus ou moins longuement retracée. Avec tant de destinées retrouvées, et groupées, c'est le tableau d’une époque et d’une société en conflits, d'hommes et de femmes qui luttent pour la réussite, la gloire ou les honneurs. Jean Tulard écrit dans la préface : « ce livre sera consulté avec un intérêt évident mais aussi avec plaisir car l'auteur a su donner vie à ses portraits grâce aux bons mots. Être à la fois savant et agréable à lire, tel à été le souci de Robert Legrand ». J'ai composé cette étude avec entrain, j'espère que les lecteurs liront ces pages avec curiosité, et aussi quelque étonnement." (4e de couv.) — "L'ancien « compagnon » de Babeuf, historien connu de la Révolution en Picardie, nous livre ici sa dernière moisson, une bonne centaine de patronymes que la fréquentation assidue des archives l'a amené à rencontrer. Souci d'un aîné de faciliter la route à qui s'engagerait dans des recherches ? Peut-être, et, dans cette seule perspective, l'ouvrage serait à saluer comme l'une de ces manifestations aujourd'hui si nombreuses et si enrichissantes des liens qui peuvent exister entre une recherche conduite au pays et celle qui se construit dans les établissements universitaires. Mais il ne fait aucun doute qu'un tel travail est né du plaisir même de l'auteur qui ne cesse d'ajouter des textes, des références, des anecdotes qui font de son ouvrage tout sauf un sec répertoire d'érudition. A tous ceux donc qui aiment la bonne compagnie des acteurs d'autrefois, signalons ce petit livre dont le titre ne dément pas le contenu." (J. Boissière, Dix-Huitième Siècle, 1994)
La vie extraordinaire de Pierre Augereau, sergent du roi de Prusse et maréchal de France.
Lille, Editions Janicot, 1945 in-12, 237 pp, broché, bon état. Peu courant
Biographie sous forme romancée de Charles Pierre François Augereau (1757-1816), général puis maréchal d'Empire et duc de Castiglione.
Le Démolisseur de la Bastille. La Place de la Bastille. Son histoire de 1789 à nos jours.
Perrin, 1929, in-12, xiii-230 pp, un portrait de Palloy en garde national en frontispice, introduction bibliographique, broché, couv. illustrée lég. salie, bon état (Coll. Bibliothèque d'histoire Parisienne)
I. Pierre-François Palloy (22 janvier 1755-19 janvier 1835) ; II. La Place de la Bastille de 1789 à 1900. — "Le « patriote Palloy » est bien connu de tous ceux qui etudient la Révolution française. C'est l'homme qui se « bombarda » entrepreneur de démolition de la Bastille. Et avec le matériel tiré de cette démolition il fit confectionner des modèles réduits de la forteresse; des « chaînes de servitude » et maints autres souvenirs qu'il envoyait partout. Soixante « apôtres de la Liberté » qu'il avait réunis et dont plusieurs jouèrent par la suite un rôle sur la scène politique parcouraient le pays pour répandre les objets recueillis ou confectionnés. Ces apôtres formaient une société très curieuse avec un règlement, des signes distinctifs, serments, diplômes, etc., plus ou moins imités de la Maçonnerie. M. Lemoine suit Palloy aux armées comme volontaire, en prison à la Force puis après sa libération à Sceaux où toujours patriote, malgré les avatars subis, il devient l'un des chefs de la Société populaire et l'organisateur méticuleux des cérémonies civiques. C'est là qu'il finira ses jours, dans un état voisin de la misère, en janvier 1835, après avoir chanté la palinodie comme tant d'anciens révolutionnaires. L'ouvrage se termine par une histoire de la place de la Bastille de 1790 à 1900." (Maurice Dommanget, Annales historiques de la Révolution française,1930)
La Diplomatie française pendant la Révolution.
Editions de Maule, 1989, in-4°, 222 pp, 160 illustrations (gravures, fac-similés, peintures) en noir et en couleurs, reliure pleine toile bleue éditeur, jaquette, bon état
La Révolution et la guerre. Hoche à l'armée de la Moselle. Les généraux du Directoire.
Besançon, 1920, gr. in-8°, 72 pp, biblio, broché, bon état
"La délivrance de l' Alsace en 1793 fut obtenue par le génie de Hoche « qui a, d'instinct, appliqué les principes de la grande guerre, la plus moderne, la plus actuelle ». Napoléon « n'a jamais fait plus, autrement, ni mieux.»" (Annales révolutionnaire, 1919)
Les Grandes heures de la Révolution française. 1. L'agonie de la royauté.
Perrin, 1968, in-8°, 333 pp, très nombreuses gravures et portraits en noir dans le texte et à pleine page, 12 pl. hors texte en couleurs, reliure skivertex bordeaux éditeur, bon état
Bleus, Blancs et Rouges. Récits d'histoire révolutionnaire d'après des documents inédits.
Perrin, 1913, in-8°, xxiv-389 pp, un portrait gravé par Dété et 7 dessins de Gérardin gravés sur bois par Deloche sur 8 pl. hors texte, broché, bon état
"L'on reconnaîtra, dans chacun de ces récits, quelques spécimens variés de cette redoutable et répugnante engeance des politiciens de district, terroristes de bourgade, membres tarés et tout-puissants de vagues comités révolutionnaires, rançonnant leurs concitoyens, marquant pour l'échafaud les honnêtes gens qui leur sont suspects et rétablissant cyniquement à leur profit une basse et cruelle féodalité..." (Préface) — Table : Taupin. – Le mariage de M. de Bréchard. – L'Abbé Jumel. – Mademoiselle de la Chauvinière. – Angélique des Melliers. – Auguste.
D'une Révolution à l'autre.
Flammarion, 1932, pt in-8°, 126 pp, 4 pl. hors texte tirées en héliogravure, broché, couv. illustrée, bon état.
Le miracle de la Marseillaise ; Les Cantinières ; Le dernier sacre ; Le premier pas du Second Empire ; Les derniers jours de Louis-Philippe en France.
Existences d'artistes. De Molière à Victor Hugo.
Grasset, 1949, in-12, 342 pp, 8 gravures hors texte, broché, couv. illustrée, papier lég. jauni, bon état (Coll. La petite Histoire, 11)
"Les “Existences d'artistes”, de G. Lenotre (Grasset), sont un choix de ses chroniques relatives à la vie privée de quelques grands hommes des arts ou des lettres. Ces pages n'ont pas perdu leur fraîcheur, et permettent d'espérer que plusieurs recueils posthumes pourront être encore édités du plus amusant des historiens." (André Thérive, “Le Temps”, 10 janvier 1941)
La Poignée de main du bourreau, suivi de vingt récits inédits.
Rombaldi, Club de la Femme, 1972, pt in-8°, 253 pp, 15 pages d'introduction sur G. Lenotre par Gaston d'Angelis, 18 gravures, reliure percaline blanche illustrée de l'éditeur, rhodoïd, bon état
"L’exécuteur des jugements criminels qui supplicia Louis XVI se nommait, comme nul ne l’ignore, Charles Sanson. Cinquantenaire en 1790, il avait alors offert sa démission, sous prétexte de fatigue, mais, en réalité, parce qu’il lui répugnait d’employer la machine à décapiter dont le docteur Guillotin préconisait l’adoption..." — 21 études : La poignée de main du bourreau ; Les fiançailles de Madame Roland ; Madame de Mirabeau ; Le roman d'un bas-bleu ; Un plaidoyer de Robespierre ; Martin Dauch ; Le mariage de Mademoiselle Palloy ; Une ambassade ; Le roman d'un terroriste ; Les désenchantements d'un d'Artagnan prussien ; Lalligand-Morillon ; Précy ; Teufel-Feuer ; Un paria ; Le secret du prince ; Un régicide amoureux ; Un fonctionnaire ; Dupérou ; L'abbé Psaume ; Madame ; Panis.
Le Baron de Batz, 1792-1795. Un conspirateur royaliste pendant la Terreur, d'après des documents inédits.
Perrin, 1907, pt in-8°, xiii-391 pp, deux planches hors texte (portraits de Mme de Sartines et Chabot), reliure demi-maroquin acajou à coins, dos à 4 faux-nerfs pointillés orné en long avec un symbole révolutionnaire, auteur et titre dorés, doubles filets dorés sur les plats, tête dorée (rel. de l'époque), mors frottés, bon état
"M. Lenotre est épris de l'histoire secrète et la préfère hautement à l'autre histoire qu'il nomme avec Balzac l'histoire officielle et menteuse. Et, en effet, il a du flair et une curiosité ardente : il recherche avec passion et trouve avec bonheur des documents de grande importance ; il retrace avec verve, avec talent, les aventures de mystérieux personnages, d'insaisissables conspirateurs, de grands aventuriers oubliés. Il raconte aujourd'hui l'histoire du baron de Batz..." (Revue critique d'histoire et de littérature)
Le Mysticisme révolutionnaire. Robespierre et la « Mère de Dieu ».
Perrin, 1926, in-8°, 333 pp, 9 gravures et un plan hors texte, reliure demi-basane verte à coins, dos lisse orné de symboles révolutionnaires, titres dorés, couv. conservées, tête dorée (rel. de l'époque), dos uniformémént passé, bon état
"Malgré tout ce qu'on a écrit sur Robespierre, on peut encore trouver de l'inédit et du neuf sur sa vie et sur le régime de la Terreur, comme on le voit par l'ouvrage de Lenotre. Après avoir parlé de la famillie de Robespierre, de ses années d'études et de ses commencements au barreau d'Arras, l'auteur montre le tribun entouré de nombreux adhérents et à l'apogée de sa puissance. C'est alors qu'en fidèle disciple de J.-J. Rousseau, il fit décréter la fête de l'Etre Suprême et la fit célébrer au milieu des cérémonies les plus extraordinaires : mais quelques semaines plus tard, c'est le 9 thermidor et la chute du tyran. La première origine de cette chute remonte au mécontentement que l'annonce de la fête de l'Etre Suprême suscita parmi les nombreux Voltairiens de la Convention. Un gascon, Vadier, avait fait saisir une vieille presque octogénaire, Catherine Théot, qui se disait « la Mère de Dieu », et l'avait fait jeter en prison avec plusieurs adeptes, entre autres l'ex-chartreux Dom Gerle. Comme Robespierre ne voulut pas souscrire à la condamnation de ces illuminés, Vadier qui avait déjà cherché des connexions entre la mère Théot (il l'appelait « Théos ») et le chef de la Terreur, crut trouver là une nouvelle connivence, et il en profita pour ridiculiser Robespierre. Quand ce dernier tomba, Catherine Théot était encore en prison, où elle mourut le 31 août 1794. M. Lenotre ne s'arrête pas à parler de ce qui est déjà suffisamment connu ; la nouveauté de son livre consiste précisément en ce qu'il dit de la famille et de la jeunesse de Robespierre, de la manière dont il organisa la fête de l'Etre Suprême, de sa « séquelle » , c'est- à-dire de ses protégés (par ex., le menuisier Duplay, l'imprimeur Nicollas, etc), et enfin des événements du 9 et 10 thermidor. Si l'histoire de la « Mère de Dieu » ne forme pas la partie principale du livre, comme le titre pourrait le faire supposer, elle en forme au moins un des épisodes les plus neufs et les plus attachants." (G. Allemang, Revue d'histoire de l'Eglise de France, 1927)
Le Roi Louis XVII et l'énigme du Temple.
Perrin, 1930, in-8°, ii-451 pp, 6 pl. de portraits et gravures hors texte (dont le frontispice et une planche double), 5 plans et une illustration à pleine page dans le texte, broché, bon état
"« N'empruntant rien qu'aux documents officiels et aux témoignages autorisés, négligeant à dessein les émouvantes et suspectes légendes sous lesquelles disparaît trop souvent la trame de cette douloureuse histoire », l'éminent historien G. Lenotre nous offre, dans ce remarquable ouvrage, une solution nouvelle de ce que Louis Blanc appelle "le Mystère du Temple" : « solution partielle, dit il, mais inattendue » et qui présente cet avantage d'une connexité rigoureuse avec ce que l'on sait de l'histoire du Temple. On peut ainsi, semble-t-il, dégager les points saillants de cette étude : M. G. Lenotre établit que ce n'est pas précisément la Convention, mais la Commune qui a réclamé qu'on lui remit la famille royale. Sous les révolutionnaires, Chaumette et Hébert, commissaires de la Commune, cachaient des hommes. Ces hommes, dont il trace le vivant portrait, l'historien les retrouve, les démasque. Il montre que, comme la plupart de leurs contemporains, ils ne croyaient pas à la perpétuité du régime révolutionnaire, qu'ils prévoyaient un rétablissement de la royauté et qu'en s'emparant du Dauphin ils s'assuraient un otage. Après d'obscures machinations, le renvoi de Simon, dont la femme soignait affectueusement le Dauphin, est décidé. Le départ de Simon coïncide avec la disparition de l'enfant royal puisque, depuis ce jour, la Dauphine qui logeait à l'étage supérieur, qui l'apercevait de temps à autre, qui l'entendait jouer et chanter, ne l'a plus jamais vu ni entendu. La substitution était faite. Par suite, tous ceux qui prirent le pouvoir voulurent s'emparer du Dauphin : Robespierre, Barras comprirent qu'il y avait eu substitution ; peut-être au surplus, celle-ci avait-elle été double. C'est pourquoi, malgré l'ordre bienveillant du Directoire de réunir le Dauphin et la Dauphine, jamais le frère ne fut mis en présence de sa soeur. Qu'est devenu l'enfant royal ? M. Lenotre ne prétend pas éclairer définitivement le mystère. Mais il examine le cas de Mathurin Bruneau et de Hervagault et il laisse entendre que ce dernier pourrait bien avoir été le vrai dauphin. Et peut-être, ce malheureux, mort à Bicêtre où on l'avait interné comme fou, était-il le duc de Normandie, « le dernier roi légitime de France »..." (Le Figaro, 1921) — "Une étude magistrale, s'appuyant notamment sur le dépouillement des archives du Conseil général de la Commune. Malgré quelques interprétations contestables, l'ouvrage demeure une référence." (Jean-Baptiste Rendu, L'énigme de Louis XVII, 2011)
Le Roi Louis XVII et l'énigme du Temple.
Perrin, 1932, in-8°, (8)-451 pp, 6 pl. de portraits et gravures hors texte (dont le frontispice et une planche double), 5 plans et une illustration à pleine page dans le texte, reliure demi-basane fauve éditeur, dos à faux-nerfs orné de fleurs de lys et d'un symbole révolutionnaire, tête dorée, couv. conservées, bon état
"« N'empruntant rien qu'aux documents officiels et aux témoignages autorisés, négligeant à dessein les émouvantes et suspectes légendes sous lesquelles disparaît trop souvent la trame de cette douloureuse histoire », l'éminent historien G. Lenotre nous offre, dans ce remarquable ouvrage, une solution nouvelle de ce que Louis Blanc appelle "le Mystère du Temple" : « solution partielle, dit il, mais inattendue » et qui présente cet avantage d'une connexité rigoureuse avec ce que l'on sait de l'histoire du Temple. On peut ainsi, semble-t-il, dégager les points saillants de cette étude : M. G. Lenotre établit que ce n'est pas précisément la Convention, mais la Commune qui a réclamé qu'on lui remit la famille royale. Sous les révolutionnaires, Chaumette et Hébert, commissaires de la Commune, cachaient des hommes. Ces hommes, dont il trace le vivant portrait, l'historien les retrouve, les démasque. Il montre que, comme la plupart de leurs contemporains, ils ne croyaient pas à la perpétuité du régime révolutionnaire, qu'ils prévoyaient un rétablissement de la royauté et qu'en s'emparant du Dauphin ils s'assuraient un otage. Après d'obscures machinations, le renvoi de Simon, dont la femme soignait affectueusement le Dauphin, est décidé. Le départ de Simon coïncide avec la disparition de l'enfant royal puisque, depuis ce jour, la Dauphine qui logeait à l'étage supérieur, qui l'apercevait de temps à autre, qui l'entendait jouer et chanter, ne l'a plus jamais vu ni entendu. La substitution était faite. Par suite, tous ceux qui prirent le pouvoir voulurent s'emparer du Dauphin : Robespierre, Barras comprirent qu'il y avait eu substitution ; peut-être au surplus, celle-ci avait-elle été double. C'est pourquoi, malgré l'ordre bienveillant du Directoire de réunir le Dauphin et la Dauphine, jamais le frère ne fut mis en présence de sa soeur. Qu'est devenu l'enfant royal ? M. Lenotre ne prétend pas éclairer définitivement le mystère. Mais il examine le cas de Mathurin Bruneau et de Hervagault et il laisse entendre que ce dernier pourrait bien avoir été le vrai dauphin. Et peut-être, ce malheureux, mort à Bicêtre où on l'avait interné comme fou, était-il le duc de Normandie, « le dernier roi légitime de France »..." (Le Figaro, 1921) — "Une étude magistrale, s'appuyant notamment sur le dépouillement des archives du Conseil général de la Commune. Malgré quelques interprétations contestables, l'ouvrage demeure une référence." (Jean-Baptiste Rendu, L'énigme de Louis XVII, 2011)
Les Fils de Philippe-Egalité pendant la Terreur.
Perrin, 1947, in-8°, 306 pp, 6 pl. de gravures hors texte, broché, état correct (Mémoires et souvenirs sur la Révolution et l'Empire publiés avec des documents inédits)
Translation de Philippe-Egalité : Journal du duc de Chartres (1790-1791) – Récit du duc de Montpensier : Ma captivité de quarante trois mois) – Translation de Philippe-Egalité : récit de Louis-François Gamache – La déportation, d'après les documents originaux conservés aux Archives nationales. — "Renseignements utiles et habilement présentés." (Revue Historique, 1908) — Historien et auteur dramatique, élu à l’Académie Française en 1932, Théodore Gosselin avait adopté le pseudonyme Lenôtre, qui était le nom de l'architecte-jardinier de Louis XIV, son arrière-grand-père. Il publia de nombreux ouvrages historiques, pour l’essentiel consacrés à la Révolution et bâtis à partir de documents d’époques (journaux, rapports de police, registres d’état-civil). Rendant hommage à son travail d'historien, Émile Gabory a écrit : “Il avait le culte du parfait détail et la foi dans une impalpable survivance du passé”.
Les Fils de Philippe-Egalité pendant la Terreur.
Perrin, 1907, pt in-8°, 306 pp, 6 pl. de gravures hors texte, reliure demi-basane havane, dos à 5 nerfs filetés et caissons ornés à froid, pièce de titre chagrin chocolat, tête dorée (rel. de l'époque), coiffes lég. frottées, bon état (Mémoires et souvenirs sur la Révolution et l'Empire publiés avec des documents inédits)
Translation de Philippe-Egalité : Journal du duc de Chartres (1790-1791). – Récit du duc de Montpensier : Ma captivité de quarante trois mois. – Translation de Philippe-Egalité : récit de Louis-François Gamache. – La déportation, d'après les documents originaux conservés aux Archives nationales. — "Renseignements utiles et habilement présentés." (Revue Historique, 1908) — Historien et auteur dramatique, élu à l’Académie Française en 1932, Théodore Gosselin avait adopté le pseudonyme Lenôtre, du nom de sa grand-mère, dernière descendante du célèbre dessinateur des jardins de Versailles. Il publia de nombreux ouvrages historiques, pour l’essentiel consacrés à la Révolution et bâtis à partir de documents d’époques (journaux, rapports de police, registres d’état-civil). Rendant hommage à son travail d'historien, Émile Gabory a écrit : “Il avait le culte du parfait détail et la foi dans une impalpable survivance du passé”.
Le Tribunal révolutionnaire, 1793-1795.
P., Club du meilleur livre, 1959, in-8°, 270 pp, 25 gravures hors texte (certaines dépliantes), reliure soie rouge éditeur, dos lisse, titres dorés, une vignette contrecollée au 1er plat, bon état. Bien complet du plan dépliant volant du Tribunal, qui manque souvent
"M. L. possède, on le sait, un réel talent de conteur, qui trouvait ici une occasion particulièrement favorable de se manifester. L'ouvrage est de lecture intéressante, et la faveur que lui a témoignée le grand public – il a eu rapidement plusieurs éditions – n'a rien de surprenant. Mérite-t-il également le suffrage des historiens ? Il semble bien qu'il épuise, au moins dans l'état actuel des sources, une partie du sujet, celle qui concerne la distribution et l'aménagement des locaux, l'organisation et le fonctionnement matériels du Tribunal, et M. L. a montré une fois de plus qu'il savait tirer, des mémoires d'architectes et d'entrepreneurs, des éléments de pittoresque et de vie. (...) Nous pourrions reprocher à l'auteur de s'être laissé aller, plus qu'il n'en a coutume, à exprimer son antipathie pour les hommes de l'an II. (...) Un livre agréable, nous le répétons, mais qui est loin d'épuiser le sujet. L'histoire, au sens plein du mot, du Tribunal révolutionnaire reste à faire." (P. Caron, Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1909)
Le vrai chevalier de Maison-Rouge.
UGE, 1962, in-12, 187 pp, couv. illustrée. Texte intégral. Très bon état (Coll. 10/18)
 Write to the booksellers
Write to the booksellers