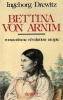Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (1)
19th (862)
20th (2145)
21st (175)
-
Syndicate
ILAB (3194)
SLAM (3194)
La Mission des Grands Plateaux.
France-Empire, 1961, pt in-8°, 317 pp, 8 pl. de photographies de Christian Simonet hors texte, une carte, broché, jaquette illustrée (lég. abîmée), bon état
Récit de 1870 du père Dourisboure (« Les sauvages Ba-Hnars (Cochinchine orientale). Souvenirs d'un missionnaire »), remanié et complété par le père Christian Simonnet des Missions étrangères de Paris sur l'histoire de la Mission de Kontum et celle des missionnaires français et la situation des grands plateaux d'Indochine centrale en 1960. Les minorités ethniques peuplant l'intérieur de ce qui est devenu le Viêt-nam, étaient, à la fin du XIXe siècle et jusqu'à la seconde guerre mondiale, encore moins connues que la société vietnamienne, et nullement étudiées. C'est pourquoi Dourisboure, préférant à la recherche ethnographique impartiale une démarche volontairement apologétique, a cependant a son actif d'être, en ce domaine, pour l'Indochine, et au sein de la petite tribu des missionnaires, un réel précurseur et un précurseur utile.
The Adventures of Sherlock Holmes.
London, George Newnes, Ltd, 1902, pt in-8° (19 x 12 x 2.5 cm), (8)-341 pp, Souvenir edition, un frontispice et 23 illustrations hors texte par Sidney Paget, cartonnage toile bleue avec titres et décor doré de l'éditeur, logo à froid de l'éditeur au 2e plat, tête dorée, coupes inf. lég. frottées, bon état. Texte en anglais
Souvenir edition ; printed by Love & Malcomson Ltd, Great Queen Street, London W.C. (Mary Shore Cameron Collection, 2A.21)
Le Crime de Pantin : l'affaire Troppmann.
Denoël, 1985, in-8°, 199 pp, biblio, broché, couv. illustrée, pelliculage de la couv. en partie décollé, bon état
Le crime de Jean-Baptiste Troppman : une affaire criminelle, qui fut l'un des faits divers les plus marquants de la fin du Second Empire et occupa pendant plusieurs mois les devants de la scène. Le détail des crimes perpétrés, la personnalité déroutante et l'âge de l'assassin, le nombre et l'état civil des victimes (une famille quelconque), la manière dont l'affaire fut instruite, suivie par le chef de la Sûreté, relatée par la grande presse, divulguée par la rumeur et les canaux populaires de la chanson, des brochures et des cabarets, les résonances enfin qu'elle eut chez les hommes de lettres ou de pensée, et sa mise en mémoire, font de l'affaire Troppmann l'une des plus révélatrices de l'imaginaire criminel du XIXe siècle.
Joyeuses histoires du mess et de la chambrée. Le 145e régiment. Edition illustrée par Draner.
P., Librairie illustrée, s.d. (1886) gr. in-8°, 316 pp, page de titre ornée d'une vignette, 39 pl. hors texte dont 10 en couleurs et nombreuses illustrations gravées sur bois dans le texte par Draner, reliure demi-chagrin prune à coins, dos à 4 nerfs soulignés à froid, titres dorés (rel. moderne), bon état (Vicaire, I, 136)
Le Carnet d'un Réserviste.
P., Librairie Blériot, Henri Gautier, successeur, 1893, in-12, 411 pp, illustrations dans le texte de J. Blass et E. Mesplès, reliure demi-chagrin vert, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres et fleurons dorés (rel. de l'époque); bon état. Rare
Disciple de Drumont, Alfred Gendrot, dit Jean Drault (1866-1951) fut un polygraphe abondant, auteur des romans humoristiques et spécialiste des histoires de troupiers, et un antisémite forcené. Collaborateur d'Edouard Drumont à La Libre Parole de 1892 à 1910, il devient directeur de La France au Travail en 1940 et publie une Histoire de l'Antisémitisme en 1941. Il accepte la direction du journal Au Pilori proposée par les Allemands en février 1943. Arrêté en septembre 1944, il est condamné en novembre 1946 à sept ans de réclusion. En décembre 1947, sa peine est commuée en cinq ans de réclusion. Libéré en 1949, il meurt en septembre 1951.
Bettina von Arnim. Romantisme, révolution, utopie.
Denoël, 1982, in-8°, 310 pp, traduit de l'allemand, tableau chronologique, tableau généalogique, index, broché, couv. illustrée, bon état
Née en 1785, morte en 1859, Bettina von Arnim a vécu l'une des plus riches périodes de l'histoire allemande marquée par la guerre de libération contre Napoléon, par l'épanouissement de la musique et de la poésie romantiques, par la montée des revendications révolutionnaires politiques et sociales qui ont abouti à l'explosion – et à l'échec – de 1848. Or, Bettina von Arnim n'est pas seulement témoin de tous ces événements : elle y joue un rôle actif. En tant qu'amie de Goethe (Correspondance de Goethe avec une enfant), soeur du poète Brentano, femme de l'écrivain von Arnim. En tant que conseillère de Frédéric-Guillaume IV à qui elle adressera son ouvrage “Ce livre appartient au roi”, plaidoyer généreux en faveur du libéralisme politique et de la justice sociale... — "Soeur, épouse, mère d'écrivain, amie de Goethe, de Beethoven, des Grimm, de von Humboldt, de Frédéric Guillaume IV, Bettina von Arnim est au coeur du deuxième romantisme allemand et une des "Mères" du mouvement de la "Jeune-Allemagne". Douée pour tous les arts, elle compose, dessine, peint et écrit avec une facilité étonnante. On distingue plus ou moins trois périodes dans sa vie, une jeunesse effervescente, exaltée, principalement marquée par sa passion fantasmée pour Goethe. Ensuite les vingt années de mariage (de 26 à 46 ans) pendant lesquelles elle met 7 enfants au monde. Au cours de cette période, Bettina est encombrée non seulement par les soucis familiaux et domestiques, mais aussi par sa relation difficile avec son mari Achim von Arnim, relation qui ne semble épanouissante ni pour l'un ni pour l'autre. Bettina qui ne supporte guère la vie à la campagne finira, par vivre principalement à Berlin tandis que son époux qui supporte mal la ville vit principalement dans leur propriété de Wiepersdorf . A Berlin, Bettina reçoit beaucoup, tient salon, entretient diverses correspondances. Enfin, la troisième période de sa vie suit la mort de son mari et se caractérise par le début de la publication de ses propres oeuvres et l'édition de celles de son mari. Au cours de cette période les préoccupations de Bettina se tournent de plus en plus vers le"social". Depuis l'épidémie de choléra qui a sévi à Berlin en 1831 et au cours de laquelle, avec d'autres femmes, elle a entrepris d'organiser des secours aux victimes, elle reste préoccupée par le problème du paupérisme. Elle se documente et prépare un "livre des pauvres" qui ne sera pas publié. Le rôle de Bettina von Arnim dans la vie littéraire allemande est assez connu. On a souvent montré que le romantisme allemand se caractérise par l'importance des femmer cultivées qui ont mis en pratique les nouvelles valeurs: amour sensuel, liberté de moeurs, rejet des conventions, primauté du sentiment... S 'émancipant, pour mieux se soumettre eux conseils de leurs maîtres à penser, peu d'entre elles sont cependant devenues de grands auteurs. Et la plus grande qualité de le biographie d'Ingeborg Drewitz, est probablement d'arriver à nous entraîner dans ces méandres, ces allées et venues, ces ébauches, ces velléités, ces insatisfactions, ces passions froides, ces fidélités maternelles et maternantes, cette insatiable curiosité, cette aptitude inouïe à saisir ce qui est nouveau, ou à reconnaître l'art, ... qui ont fait la personnalité de Bettina von Arnim..." (Hedwige Peemans-Poullet, Les cahiers du GRIF, 1982)
Ce qu'il me reste à dire. Un demi-siècle de choses vues et entendues. II. 1848-1900.
P., Ollendorff, s.d. (1913), in-12, 392 pp, index, reliure demi-percaline rouge, dos lisse avec fleuron et double filet doré en queue, pièce de titre basane noire, couv. conservées (rel. de l'époque), bon état. Edition originale
"Familier des milieux littéraires, politiques et scientifiques, l'auteur compta parmi ses amis Zola, Daudet, les frères Goncourt mais aussi Faidherbe, Schoelcher, Gambetta. Témoignage agréable et précis sur l'époque." (Bourachot, 136)
L'Affaire telle que je l'ai vécue.
Grasset, 1978, gr. in-8°, 307 pp, broché, couv. illustrée, bon état. Edition originale (il n'est pas mentionné de grands papiers)
"Le 31 octobre 1894, j'étais, comme tous les mercredis, à la Bourse de Mulhouse, lorsqu'on me remit une dépêche. Ma belle-soeur Lucie me priait de venir de suite à Paris pour affaire extrêmement urgente. Il s'agissait de mon frère Alfred." Ainsi commence le récit de Mathieu Dreyfus, dont l'amour fraternel gagnera la plus dure des batailles : celle qu'il lui fallut livrer contre l'indifférence. La raison d'Etat n'est donc pas toujours la plus forte. Victoire de l'innocence, oui, mais au prix de la plus exceptionnelle abnégation : toute la fortune de Mathieu est employée à payer avocats et "détectives", qui étudient la vie, le comportement et le caractère de tous les officiers de l'Etat-Major. Alfred, "l'honneur même", paie pour quelqu'un d'autre. L'incroyable acharnement mis par Mathieu à sauver son frère porte ses fruits : preuves en main, il aboutit à Esterhazy, le coupable caché. Grâce à l'extraordinaire enquête qu'il a menée, Mathieu Dreyfus parvient à convaincre ceux qui deviendront les plus illustres et les plus efficaces des défenseurs de son frère. Très simplement, il a voulu témoigner, raconter son combat et ses hantises, sa victoire. Récit que l'on qualifierait de "romanesque", tant à cause de son contenu qu'à cause de son style, si l'on n'en connaissait la tragique vérité. Ce document authentique a été tenu secret jusqu'à ce jour, conformément à sa volonté. Cet homme de coeur n'a pas voulu que les descendants des personnes mises en cause souffrent du déshonneur de leurs parents. Aujourd'hui, le temps a passé, seul l'amour d'un frère persiste, exemplaire.
La République de Monsieur Thiers (1871-1873).
Gallimard, 1930, in-12, 353 pp, broché, papier lég. jauni, bon état (Coll. Sous la Troisième). Edition originale, ex. du SP
"Cet ouvrage ne mérite que des éloges. Sans faire montre d'érudition, l'auteur connaît admirablement cette histoire et l'expose avec talent. Il a été séduit par son héros, par ce vieillard actif, ambitieux, éloquent, capable de tout comprendre et de tout diriger ; mais cette séduction ne l'empêche pas de signaler malicieusement les ruses de Thiers, ses accès de vanité parfois puérile, ses faux-fuyants. En même temps, il admire l'habileté avec laquelle le vieux pilote évolue au milieu des écueils de la politique; il admire surtout le labeur colossal qui aboutit à la libération du territoire. Le seul reproche qu'on pourrait faire à l'auteur est d'avoir un peu trop négligé la France, la province, pour ne voir que Thiers et l'Assemblée nationale." (Georges Weill, La Quinzaine critique des livres et des revues, 1930)
Monsieur Thiers contre l'Empire, la guerre, la Commune, 1869-1871.
Grasset, 1928, in-8°, 351 pp, notes bibliographiques, broché, état correct
"... L'effondrement de Gambetta marqua l'ascension de Thiers au pouvoir suprême. Il fit de son mieux pour obtenir des Allemands les conditions les moins draconiennes, mais à Paris les protestations étaient vives, les passions patriotiques ou révolutionnaires étaient singulièrement surexcitées ; l'entrée des Prussiens à Paris par l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées porta l'irritation à son comble : ce fut l'une des causes et le prétexte de l'Insurrection de la Commune. Après avoir combattu l'Empire, après avoir déconseillé la guerre, Thiers allait être appelé à entreprendre une lutte civile d'une ampleur formidable. M. Robert Dreyfus expose fort bien les phases de cette guerre sanglante, tragiquement faite, sous les regards narquois des troupes prussiennes, et suivie d'une implacable répression..." (Revue des questions historiques, 1929) — "Ouvrage racontant l'action de Thiers pendant les derniers mois de l'Empire et pendant la guerre. Ce n'est pas un panégyrique, ce n'est pas non plus une attaque, c'est une étude impartiale et précise sur le rôle de cet homme d'État, sur son action et ses erreurs." (Revue militaire française, 1929)
Vie des hommes obscurs. Alexandre Weill, ou le prophète du faubourg Saint-Honoré (1811-1899).
Cahiers de la Quinzaine, 1908, pt in-8°, 84 pp, 2 portraits hors texte, broché, papier jauni, état correct
Lois annotées, ou Lois, décrets, ordonnances, avis du Conseil d'Etat, etc., avec notes historiques, de concordance et de jurisprudence, 1ère série, 1789-1830 – 2ème série, 1831-1844.
P., Pouleur, 1843-1845, 2 vol. in-4°, viii-1250-94 et (4)-888-156 pp, texte sur 3 colonnes, tables analytiques des matières, reliures demi-veau glacé havane, dos lisses avec titres dorés et filets dorés et à froid (rel. de l'époque), bon état. Edition originale, exemplaire bien relié et très frais, envoi a.s. dans chaque volume. Rare, tout particulièrement en très bon état
Monumental recueil législatif qui couvre 55 ans de lois, décrets et ordonnances du Conseil d'Etat, abondamment commentés par Antoine-Auguste Carette (1803-1885), docteur en droit et avocat aux conseils du Roi et à la Cour de Cassation.
De la Restauration à la Révolution, 1815-1848.
Armand Colin, 1970, in-12, 288 pp, 8 cartes, biblio, broché, état correct (Coll. U2)
"Edition française, revue et augmentée d'une bibliographie, d'un livre paru en anglais en 1967, sous le titre 'Europe between révolutions'. Cet ouvrage se présente sous la forme condensée et claire des livres de cette collection. J. D. retrace l'histoire des principaux Etats européens durant cette période en insistant sur l'essor de l'idéologie libérale. Il donne une vue très précise d'une Europe traversée par les mouvements libéraux et nationaux à la veille des révolutions de 1848." (Revue française de science politique, 1971) — "Ce manuel, limité à l'Europe, s'articule autour de quelques grands thèmes, et l'évolution politique interne des Etats occupe seulement le tiers de l'ouvrage. Les chapitres généraux ont trait à la philosophie de la Restauration, l'évolution économique des grands Etats, la bourgeoisie et l'idéologie libérale, le socialisme et le mouvement ouvrier, l'Eglise devant le monde moderne, les relations internationales et, enfin, les causes des révolutions de 1848. Cette disposition permet de nombreux rapprochements intéressants. Des cartes très suggestives facilitent la lecture de cet ouvrage attrayant." (Revue d'histoire de l'Eglise de France, 1971)
Le Socialisme démocratique, 1864-1960.
Armand Colin, 1966, gr. in-8°, 360 pp, qqs cartes, chronologie, biblio, index, cart. éditeur, soulignures, bon état (Coll. U)
Histoire générale du Socialisme.
PUF, 1972-1978, 4 forts vol. pt in-4° carré, 658, 674, 714 et 707 pp, 192 planches d'illustrations hors texte reproduites en héliogravure, biblio, index, reliures toile rouge éditeur, sans les jaquettes, ex. du service de presse, bon état
Complet en 4 volumes. Tome I : Des origines à 1875, par Jacques Droz, Albert Soboul, F. Bédarida, Jean Bruhat, Annie Kriegel, Cl. Mossé. - Tome II : De 1875 à 1918, par Jacques Droz, Madeleine Rebérioux, Paul Guichonnet, Pierre Vilar, F. Bédarida, Roger Portal, Marianne Debouzy, Jean Chesnaux, Annie Kriegel. - Tome III : De 1918 à 1945, par F. Bédarida, Pierre Brocheux, Georges Castellan, Jean Chesnaux, Jacques Droz, Paul Guichonnet, Annie Kriegel, Georges Lefranc, Roger Portal, Pierre Vilar, etc. - Tome IV : De 1945 à nos jours, par Marianne Debouzy, Jacques Droz, René Galissot, Jean Lacouture, Robert Paris, Yves Person, Madeleine Rebérioux.
Histoire générale du Socialisme. Tome I : Des origines à 1875.
PUF, 1972, gr. in-8° carré, 658 pp, 48 pl. d'illustrations hors texte reproduites en héliogravure, index, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état
Par Jacques Droz, Albert Soboul, F. Bédarida, Jean Bruhat, Annie Kriegel, Cl. Mossé. "Voici un ouvrage dont on peut affirmer, en tous les sens du terme, le caractère considérable. Considérable, il l'est d'abord par sa masse (650 pages, des bibliographies multiples etc.) ; il l'est aussi par la personnalité de ses auteurs, car les diverses contributions sont signées des plus grands noms de l'histoire sociale en France, sous la direction de J. Droz. Enfin et surtout, cette Histoire du socialisme s'offre comme un monument d'érudition. Elle est une oeuvre collective, due à des spécialistes qui se sont, en gros, réparti la matière par pays : Jean Bruhat pour la France, F. Bédarida pour l'Angleterre, J. Droz enfin, le maître d'oeuvre, pour l'Allemagne et la Belgique. Mais ce dernier auteur a tout de même traité aussi des utopies sociales à l'aube des temps modernes, comme A. Soboul a étudié, en deux chapitres, le socialisme français du XVIIIe siècle. Jean Chesnaux s'est occupé de la Chine et de l'Islam, Claude Mossé des origines antiques du socialisme et Annie Kriegel de la Première Internationale. Les pays tels que l'Espagne et l'Italie seront traités au tome II. Quant la période étudiée, elle s'étend des origines à 1875, le tome II devant couvrir les années 1875 à 1919 et le tome III, l'époque postérieure à 1919." (Jean Lhomme, Revue économique, 1974)
L'Allemagne, 1789-1973.
Hatier, 1970-1976, 4 vol. in-8°, 224, 222, 224 et 223 pp, 13 cartes et tableaux, 10 figures, brochés, bon état (Coll. d'Histoire contemporaine)
Tome 1 : La formation de l'unité allemande, 1789-1871, par J. Droz. Tome 2 : L'Empire allemand, 1871-1918, par P. Guillen. Tome 3 : République de Weimar et Régime hitlérien, 1918-1945, par J. Bariéty et J. Droz. Tome 4 : La construction de deux Etats allemands, 1945-1973, par P. Guillen et G. Castellan.
La Dernière Bataille. Nouvelle étude psychologique et sociale.
P., Dentu, 1890, in-12, xix-572 pp, index, reliure demi-percaline verte, dos lisse orné d'un fleuron et d'un double filet doré en queue, pièce de titre chagrin brun, couv. conservée (rel. de l'époque), bon état
La Fin d'un monde. Etude psychologique et sociale.
P., Albert Savine, 1889, in-12, xxxiii-556 pp, index, broché, état correct (Vicaire, III, 300).
"Dans sa tentative de rapprochement avec les socialistes et de démonstration que les Juifs incarnent le capitalisme, Drumont inaugure, et ce sera encore plus net dans La Fin d'un monde, une tradition qu'entretiendra jusqu'à nos jours une tendance de l'extrême-droite : la défense de la Commune de 1871, c'est à dire la défense du peuple face à la bourgeoisie libérale." (Winock, La France et les Juifs de 1789 à nos jours) — "L'incontournable Drumont, sociologue distingué, psychologue et historien à ses heures, publie au début de l'année une brochure d'un antisémitisme catastrophique : « La fin d'un monde ». Le péril juif est dénoncé avec toute la fougue et le lyrisme de ce grand persécuté qui invite ses compatriotes à une « dernière bataille » qui débarrassera la France du talmudisme et confisquera les biens israélites... pour les redistribuer aux ouvriers !" (M.-A. Wolf, Romantisme, 1990)
La France Juive devant l'opinion.
P., Marpon et Flammarion, 1886, in-12, 308 pp, index, broché, couv. abîmée, dos brisé, rousseurs, état moyen
La « France juive » et la Critique ; La Conquête juive ; Le Systême juif et la question sociale ; L'escrime sémitique ; Ce qu'on voit dans un tribunal. — "Dans “La France juive devant l’opinion”, publiée quelques mois après “La France juive”, Drumont réaffirme que « l’antisémitisme n’est pas une question religieuse [et que] la question antisémitique a constamment été ce qu’elle est aujourd’hui, une question économique et une question de race »." (Pierre-André Taguieff, « L'invention racialiste du Juif », Raisons politiques, 2002)
Souvenirs militaires d'un officier français, 1848-1887.
Plon, 1896, in-12, 287 pp, broché, couv. lég. salie, bon état
"L'auteur raconte ses campagnes d'une façon familière et captivante ; il retrace pas à pas les épisodes militaires les plus intéressants auxquels il lui a été donné d'assister, depuis les journées de Juin 1848 jusqu'à nos jours. Expédition de Kabylie, guerre de Crimée, guerre d'Italie, guerre de 1870-1871, telles sont les étapes de cette existence toute devouée au service du drapeau. On y lit, entre autres, des pages extrêmement vivantes sur le siège de Sebastopol, l'assaut de Malakoff, et des détails curieux sur les relations amicales qui existaient, dès cette époque, entre les militaires français et les russes, malgré la guerre des deux nations, ou plutôt des deux gouvemements." (Revue Militaire Suisse, 1896) — Né en 1827, officier subalterne au 11e léger entre 1848 et 1870, Charles Duban est engagé contre les barricades en juin 1848, en Algérie (expédition de Kabylie), puis en Crimée à partir de l'été 1855. Il est serieusement blessé à Magenta (Italie). Ses descriptions comportent des pages intéressantes sur la vie de garnison au début du second Empire (catastrophe du pont d'Angers le 16 avril 1850) et sur le calvaire des blessés après Magenta. En 1870, il participe au siège de Paris comme officier supérieur. Cet officier sorti du rang finit sa carrière comme colonel du 56e de ligne. — "Excellente relation." (Bourachot, 140)
Mes souvenirs. Tome 1 : 1820-1851. Tome 2 : 1851-1864. Tome 3 : 1864-1879.
Plon, 1894-1898, 3 vol. in-8°, 452, 516 et 612 pp, 3 portraits en frontispices, index général au dernier volume, reliures demi-basane prune, dos à 5 nerfs soulignés à froid et ornés de fleurons dorés, couv. conservées (rel. de l'époque), dos passés, qqs rousseurs, bel exemplaire
Passionnants et vivants mémoires, très bien écrits, dont la consultation est indispensable pour l'histoire militaire française au XIXe siècle, depuis l’Algérie en 1835 jusqu’à son ministère de la guerre en 1873, en passant par l’expédition du Mexique, la guerre de 1870, la captivité en Allemagne, et les combats contre la Commune de Paris. Le premier volume concerne les guerres menées en Afrique du Nord et notamment en Algérie. — "On sait le succès qu'ont eu les Mémoires de Marbot. A mon avis, Mes souvenirs, du général du Barail, dont le premier volume va de 1820 à 1851, ne le leur céderont ni pour le talent du narrateur ni pour l'intérêt des événements racontés. Ce n'est pas l'épopée impériale que nous retrouvons ici, c'est une guerre moins éclatante, moins grandiose, c'est la guerre d'Afrique avec ses surprises, son imprévu, mais où le soldat français se montre tout aussi brave, tout aussi hardi que son aîné. On n'en finirait pas de citer tous les faits d'armes contés dans ce volume avec une verve, un entrain, une légèreté de plume étincelants. Et quelles figures, quelles silhouettes finement enlevées ! depuis les héros bien connus de la conquête, Yusuf, La Moricière, Pélissier, Canrobert, le duc d'Aumale, Bugeaud, Cavaignac, Mac-Mahon, jusqu'à d'autres moins connus. Quel étonnante odyssée que celle de ce Maurice Persat, « décoré par l'Empereur, » qui proclamait la république dès 1840 dans une île où il était seul avec une compagnie de zéphyrs ! quelle figure que celle de Napoléon Bertrand, le fils du maréchal, qui n'était jamais où il devait être, mais qui était partout où on se battait ! Je ne parle pas du lieutenant Guichard, qui, resté à Mostaganem, on devine pourquoi, rentra seul de nuit à Mazagran presque au moment où les Arabes allaient y faire leur attaque légendaire. L'auteur parle de lui-même avec une modestie que l'on sent bien sincère; un peu de cette vanité qu'il n'a pas lui serait cependant aisément pardonnée, car, outre le charme qu'on éprouve à le lire, il donne l'impression d'un homme très brave et d'un très brave homme. Il fallait un courage et un coeur bien rares pour se conduire comme il le fît à l'égard de son ancien sous-officier Ibrahim-ben-Chakar (p. 268). Je n'aurai qu'un point à signaler, un seul, sur lequel je ne partage pas l'avis du général du Barail. Qu'il me permette de lui dire que le véritable esprit républicain n'est pas, comme il le dit, l'antipode de l'esprit militaire (p. 438). Il est au contraire de même nature : qui dit républicain, comme qui dit soldat, veut dire un homme qui met avant tout l'honneur et le devoir. Compris autrement, ces mots n'ont plus de sens. La République en a d'ailleurs bien jugé ainsi..." (Louis Farges, Revue Historique, 1894) — "Comme Barail a accompli en Algérie, où son père déjà exerçait un commandement, toute la première partie de sa carrière depuis son engagement comme cavalier aux Spahis de Yusuf, jusqu'au grade de colonel, ses mémoires sont (le tome I en entier et une partie du tome II) l'histoire d'une partie de l'armée d'Afrique, des dures campagnes de la province d'Oran, de la poursuite d'Abd-el-Kader, des razzias du siège de Zaatcha, de la prise de Laghouat, etc. C'est une image d'un corps de troupes bien singulier, les spahis ; et c'est aussi le défilé de tous les chefs de l'armée d'Afrique, dont beaucoup furent des noms illustres de la IIe République et de l'Empire." (Tailliart, L'Algérie dans la littérature française)
Mes souvenirs. Tome I : 1820-1851.
Plon, 1894, in-8°, 452 pp, un portrait en frontispice, broché, état correct
Tome I seul (sur 3). Importants mémoires très bien écrits, dont la consultation est indispensable pour l'histoire militaire française au XIXe siècle. Engagé comme simple soldat dans les Spahis en 1839, l'auteur termina sa carrière comme général et fut ministre de la guerre en 1873. Le premier volume concerne les guerres menées en Afrique du Nord et notamment en Algérie. — "On sait le succès qu'ont eu les Mémoires de Marbot. A mon avis, Mes souvenirs, du général du Barail, dont le premier volume va de 1820 à 1851, ne le leur céderont ni pour le talent du narrateur ni pour l'intérêt des événements racontés. Ce n'est pas l'épopée impériale que nous retrouvons ici, c'est une guerre moins éclatante, moins grandiose, c'est la guerre d'Afrique avec ses surprises, son imprévu, mais où le soldat français se montre tout aussi brave, tout aussi hardi que son aîné. On n'en finirait pas de citer tous les faits d'armes contés dans ce volume avec une verve, un entrain, une légèreté de plume étincelants. Et quelles figures, quelles silhouettes finement enlevées ! depuis les héros bien connus de la conquête, Yusuf, La Moricière, Pélissier, Canrobert, le duc d'Aumale, Bugeaud, Cavaignac, Mac-Mahon, jusqu'à d'autres moins connus. Quel étonnante odyssée que celle de ce Maurice Persat, « décoré par l'Empereur, » qui proclamait la république dès 1840 dans une île où il était seul avec une compagnie de zéphyrs ! quelle figure que celle de Napoléon Bertrand, le fils du maréchal, qui n'était jamais où il devait être, mais qui était partout où on se battait ! Je ne parle pas du lieutenant Guichard, qui, resté à Mostaganem, on devine pourquoi, rentra seul de nuit à Mazagran presque au moment où les Arabes allaient y faire leur attaque légendaire. L'auteur parle de lui-même avec une modestie que l'on sent bien sincère; un peu de cette vanité qu'il n'a pas lui serait cependant aisément pardonnée, car, outre le charme qu'on éprouve à le lire, il donne l'impression d'un homme très brave et d'un très brave homme. Il fallait un courage et un coeur bien rares pour se conduire comme il le fît à l'égard de son ancien sous-officier Ibrahim-ben-Chakar (p. 268). Je n'aurai qu'un point à signaler, un seul, sur lequel je ne partage pas l'avis du général du Barail. Qu'il me permette de lui dire que le véritable esprit républicain n'est pas, comme il le dit, l'antipode de l'esprit militaire (p. 438). Il est au contraire de même nature : qui dit républicain, comme qui dit soldat, veut dire un homme qui met avant tout l'honneur et le devoir. Compris autrement, ces mots n'ont plus de sens. La République en a d'ailleurs bien jugé ainsi..." (Louis Farges, Revue Historique, 1894) — "Comme Barail a accompli en Algérie, où son père déjà exerçait un commandement, toute la première partie de sa carrière depuis son engagement comme cavalier aux Spahis de Yusuf, jusqu'au grade de colonel, ses mémoires sont (le tome I en entier et une partie du tome II) l'histoire d'une partie de l'armée d'Afrique, des dures campagnes de la province d'Oran, de la poursuite d'Abd-el-Kader, des razzias du siège de Zaatcha, de la prise de Laghouat, etc. C'est une image d'un corps de troupes bien singulier, les spahis ; et c'est aussi le défilé de tous les chefs de l'armée d'Afrique, dont beaucoup furent des noms illustres de la IIe République et de l'Empire." (Tailliart, L'Algérie dans la littérature française)
Le Syndicalisme révolutionnaire. Textes choisis et présentés.
Armand Colin, 1969, pt in-8°, 316 pp, chronologie, notices biographiques, biblio, broché, bon état (Coll. U)
"Une introduction d'un accès parfois difficile, si l'on songe que cette collection s'adresse tout particulièrement à des étudiants, mais des textes intéressants, notamment : extraits des débats du Congrès d'Amiens concernant les rapports entre syndicats et partis politiques ; débat entre Monatte et Malatesta au Congrès anarchiste d'Amsterdam (1907) ; et « Ne tirez pas ! » exhortation lancée aux soldats par The syndicalist." (Revue française de science politique, 1970)
L’Œil-de-chat.
P., E. Dentu, 1888, 2 vol. in-12, 333 et 340 pp, reliures demi-basane aubergine, dos à 4 nerfs pointillés et filets dorés, titres et tomaisons dorés (rel. de l'époque), dos uniformément passés, qqs rares et pâles rousseurs, bon état. Édition originale
Un mystérieux regard de félin semble suivre chaque mouvement des protagonistes dans « L’Œil-de-chat », un roman de Fortuné du Boisgobey (1821-1891), célèbre et prolifique feuilletoniste du XIXe siècle, qui publiera plus de soixante ouvrages entre 1869 et sa mort. L'intrigue se déroule dans le Paris du XIXe siècle, une époque où les rues pavées et les salons feutrés cachent des secrets inavouables. Au cœur de cette atmosphère envoûtante, un bijou d'une rare beauté, l'œil-de-chat, devient l'objet de toutes les convoitises. Ce joyau, aussi captivant que dangereux, est le point de départ d'une série d'événements qui vont bouleverser la vie de plusieurs personnages. L'auteur nous plonge dans une enquête haletante, où les thèmes de la cupidité, de la trahison et de la rédemption s'entrelacent pour former une toile narrative captivante. En suivant les péripéties de ses personnages, le lecteur est invité à explorer les recoins obscurs de la société parisienne, où les apparences sont souvent trompeuses...
 Write to the booksellers
Write to the booksellers