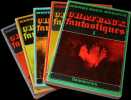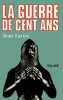Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (2)
19th (116)
20th (975)
21st (66)
-
Syndicate
ILAB (1160)
SLAM (1160)
Henri II Plantagenêt, comte d'Anjou, roi d'Angleterre. Illustrations de Maurice Pouzet.
Angers, Atelier d'art Philippe Petit, 1976, gr. in-4°, 171 pp, illustrations dans le texte et sur 13 pl. en couleurs hors texte, dont une en frontispice, texte sur 2 colonnes, cartes et généalogies in fine, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
Châteaux fantastiques.
Flammarion, 1969-1973, 5 vol. in-8°, 268, 270, 271, 271 et 267 pp, environ 500 photos et photos dans le texte et hors texte, plans, biblio, brochés, couv. illustrées, bon état. Rare complet des cinq volumes
"C'est de bien jolis livres que M. Eydoux propose au grand public pour lui rendre le goût de cet aspect longtemps négligé de l'archéologie qu'est la castellologie. Des livres quelque peu teinté de romantisme, eux aussi, mais sérieux et documentés – comme le prouve les bibliographies en fin de volume – , des livres écrits avec le talent que l'on connaît à l'auteur et qui, en évoquant l'histoire de chacun des châteaux choisis, rend pour un moment la vie à ces fantômes de pierre depuis longtemps inutiles. Châteaux fantastiques ! On pourrait certes en retenir beaucoup d'autres, car il n'est guère de forteresse médiévale qui ne réponde à cette définition ; du moins les 104 que M. Eydoux nous présente sont-ils, en effet, des constructions fantastiques, quelques-uns, comme Peyrepertuse, véritablement stupéfiantes. La plupart ont éveillé l'attention passionnée des romantiques, que ce soit Victor Hugo, Prosper Mérimée ou Viollet-le-Duc..." (Francis Salet, Bulletin Monumental) — Tome 1 : Arques-la-Bataille (Seine-Maritime), Peyrepertuse (Aude), Termes (Aude), Bonaguil (Lot-et-Garonne), Gavaudun (Lot-et-Garonne), Druyes-les-Belles-Fontaines (Yonne), Chauvigny (Vienne), Châlucet (Haute-Vienne), Ortenberg (Alsace), Largoët-en-Elven (Morbihan), Mornas (Vaucluse), Comarque (Dordogne), Tiffauges (Vendée), La Ferté-Milon (Aisne), Septmonts (Aisne). Tome 2 : Falaise (Calvados), Clisson (Loire-Atlantique), Le Coudray-Salbart (Deux-Sèvres), Les Tours de Merle (Corrèze), Fleckenstein (Bas-Rhin), Wasenbourg (Bas-Rhin), Crussol (Ardèche), Tarascon (Bouches-du-Rhône), Montaner (Pyrénées-Atlantique), Sauveterre-la-Lémance (Lot-et-Garonne), Castelnau-de-Lévis (Tarn), Penne d'Albigeois (Tarn), Puivert (Aude), Roquefixade (Ariège), Le Crac des Chevaliers (Syrie). Tome 3 : Quéribus et Puylaurens (Aude), Lagarde (Ariège), Najac (Aveyron), Tonquédec et La Hunaudaye (Côtes-du-Nord), Landsberg (Bas-Rhin), Portes (Gard), Vivieures (Hérault), Blot-le-Rocher (Puy-de-Dôme), Domeyrat (Haute-Loire), Boulbon (Bouches-du-Rhône), La Tour-d'Aigues (Vaucluse), Angles-sur-l'Anglin (Vienne), La Roche-Guillebaud (Allier), Le Sahyoun (Syrie), Okhaydhir (Irak). Tome 4 : Tournoel (Puy-de-Dôme), Gençay (Vienne), Murat (Allier), Rauzan (Gironde), Arlempdes (Haute-Loire), Polignac (Haute-Loire), Ventadour (Corrèze), Boulogne (Ardèche), Présilly (Jura), Andlau (Bas-Rhin), Schoeneck (Bas-Rhin), Aguilar (Aude), Saint-Martin-de-Toques et Saint-Pierre-des-Clars (Aude), Bassoues (Gers), Sainte-Mère et Le Tauziat (Gers), Belvezet (Gard), Vianden (Luxembourg), Châteaux du Liban (Saida, Byblos, Beaufort, Caves de Tyron, Le Toron, Le Maron, Belhacem, Msailha, Tripoli, Akkar). Tome 5 : Villandraut (Gironde), Herisson (Allier), Lavardin (Loir-et-Cher), Murol (Puy-de-Dôme), Coucy (Aisne), Beaucaire (Gard), Rochebaron (Haute-Loire), Montfort (Côte-d'Or), Vaujours (Indre-et-Loire), Rochechinard (Drôme), Le Tournel (Lozère), Ranrouet (Loire-Atlantique), La Haute-Guerche (Maine-et-Loire), Armentières (Aisne), Saint-Ulrich (Haut-Rhin), Arques (Aude), Montalet (Gard), Busséol (Puy-de-Dôme).
Cités mortes et lieux maudits de France.
Plon, 1963, in-8°, 241 pp, 30 illustrations in-texte et 15 illustrations hors texte, reliure souple illustrée de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état
"Ce nouveau volume de notre confrère Henri-Paul Eydoux est consacré à un certain nombre de villes et de châteaux détruits depuis le Moyen Age : Thérouanne, rasée par ordre de Charles-Quint ; La Mothe, bastion de l'indépendance lorraine pendant la guerre de Trente ans ; Maguelonne, dont la cathédrale demeure seule, comme un témoin grandiose de la cité épiscopale qui s'était élevée dans la lagune languedocienne ; l'extraordinaire ruine du château de Montségur, sur l'Ariège, dernier refuge des Cathares ; Coucy ; les villages du Lubéron, Saint-Guilhem-le-Désert. « Ce sont là quelques exemples, au milieu de beaucoup d'autres victimes du pouvoir royal, de Richelieu et de Mazarin, des ravages des guerres, des razzias des brigands et de la « Bande noire », surtout des jacqueries et des révolutions, et des guerres de religion : châteaux et manoirs envahis par les ronces, cités désertes, églises et abbayes dont on ne retrouve qu'à peine les traces. Hélas, les ruines elles-mêmes ont péri ! » Toutes ces histoires, appuyées sur des sources sûres, sont rapportées d'un style alerte et évocateur. H.-P. Eydoux fait revivre pour nous quelques-uns des épisodes les plus dramatiques et les plus pénibles du Passé." (Marcel Aubert, Bulletin Monumental, 1960)
Jeanne d'Arc.
France Loisirs, 1998, in-8°, 540 pp, préface de Régine Pernoud, 16 pl. de documents hors texte, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
L'auteur a cherché à comprendre la nature profonde de la "mission" de la Pucelle, à saisir le sens historique de cette épopée qui dépasse l'entendement. Et il a trouvé des clefs : des clefs qui "sont dans les caractères de l'époque et ceux des personnages", dit-il. C'est là toute l'originalité de ce livre à l'écriture dense et animée, où d'incomparables portraits des acteurs du drame voisinent avec des tableaux frémissants de la vie et des moeurs du XVe siècle.
Jeanne d'Arc.
Tallandier, 1978, in-8°, 541 pp, 16 pl. de gravures hors texte, chronologie, broché, couv. illustrée à rabats, bon état (Coll. Figures de proue)
L'auteur a cherché à comprendre la nature profonde de la "mission" de la Pucelle, à saisir le sens historique de cette épopée qui dépasse l'entendement. Et il a trouvé des clefs : des clefs qui "sont dans les caractères de l'époque et ceux des personnages", dit-il. C'est là toute l'originalité de ce livre à l'écriture dense et animée, où d'incomparables portraits des acteurs du drame voisinent avec des tableaux frémissants de la vie et des moeurs du XVe siècle.
Jeanne d'Arc.
Tallandier, 1977, 2 vol. in-8°, 345 et 337 pp, 2 reproductions de miniatures médiévales en couleurs contrecollées en frontispices, 54 gravures, chronologie, reliures plein cuir carmin très ornées de l'éditeur, têtes dorées, bon état (Coll. Figures de proue)
L'auteur a cherché à comprendre la nature profonde de la "mission" de la Pucelle, à saisir le sens historique de cette épopée qui dépasse l'entendement. Et il a trouvé des clefs : des clefs qui "sont dans les caractères de l'époque et ceux des personnages", dit-il. C'est là toute l'originalité de ce livre à l'écriture dense et animée, où d'incomparables portraits des acteurs du drame voisinent avec des tableaux frémissants de la vie et des moeurs du XVe siècle.
La Sainte République romaine. Profil historique du Moyen Age.
Fayard, 1970, in-8°, 408 pp, traduit de l'italien, biblio, index, broché, couv. illustrée à rabats, bon état (Coll. L'Histoire sans frontières, dirigée par Denis Richet)
Ce livre est un profil historique du Moyen Age axé autour de la fondation de l'Europe sur des bases chrétiennes et romaines, de la formation et de la dissociation de la « Sainte République romaine », c'est-à-dire de l'unité catholique et occidentale qui cimentait l'Europe avant que naissent les nations. C'est la nature unitaire et transcendante du Moyen Age conçu dans son rayonnement à partir de Rome qui forme la trame de cette grande esquisse historique.
La Vie quotidienne au temps de saint Louis.
Hachette, 1952, in-8°, 277 pp, notes bibliographiques, broché, couv. illustrée, bon état
"Cette étude ne concerne naturellement que la France, mais il s'agit surtout de Paris. L'indication chronologique « au temps de saint Louis », volontairement vague, nous indique que l'auteur ne s'en tiendra pas aux limites exactes du règne. Au cours des chapitres, nous apprenons quel était le cadre où se déroulait cette « vie quotidienne » : lieux, temps, organisation sociale ; comment l'homme de cette époque satisfaisait ses besoins vitaux, car il lui fallait se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, se chauffer, s'éclairer ; comment il était éduqué ; comment il se comportait lors des grands événements de la vie : mariage et mort, quelles étaient ses occupations, travail professionnel ou divertissement ; quels étaient ses rapports avec ses semblables ; s'il croyait à Dieu et comment il concevait ses rapports avec la divinité. L'ouvrage se lit avec grand plaisir ; de nombreuses anecdotes, des tableaux colorés viennent animer le récit ; cet agrément est dû au parti très habile que l'auteur a su tirer de ses sources. Celles-ci, dont les notes bibliographiques, rejetées en fin de volume, permettent de dresser aisément le tableau, sont presque uniquement littéraires." (Roger Sève, Romania, 1946) — "Une intéressante et solide évocation de La vie quotidienne au temps de saint Louis." (Philippe Ménard, Les fabliaux, 1983) — "Un ouvrage où l'auteur résume pour le public cultivé la vaste somme de son savoir." (Julia Bastin, Revue belge de Philologie et d'Histoire, 1958) — "Sans aucunement négliger ce pittoresque que les romantiques prisaient avant tout dans le Moyen Age, M. Faral s'est de préférence appliqué à « montrer, derrière la façade, la pensée qui en expliquait le décor, c'est-à-dire à rendre compte de l'activité quotidienne par certaines dispositions foncières des individus et des groupements ». Le tableau de la vie quotidienne que nous présente ce livre, est un tableau limité, à la fois dans le temps, et aussi dans l'espace. En principe il ne concerne pas tout le Moyen Age, mais seulement le temps de saint Louis. De même, il ne concerne pas la France tout entière, mais seulement Paris, du moins en principe. Toutefois, à vouloir s'en tenir strictement à ce propos, il eût fallu se résigner à ne donner qu'un tableau fragmentaire. Aussi, et cela pour le plus grand profit du lecteur, qui en recevra supplément de lumière, M. Faral s'est-il vu amené parfois à utiliser des traits empruntés à d'autres époques du Moyen Age, ou bien encore à sortir de Paris. A suivre un guide aussi averti et aussi sûr que l'est M. Faral, le lecteur trouvera à la fois agrément et profit. Parmi les divers chapitres de l'ouvrage, nous avons particulièrement apprécié ceux qui constituent la quatrième partie, portant comme rubrique les Idées et la vie. Sur l'esprit public, sur la religion et la morale, sur la « diffusion des lumières », sur l'ordre social, ces chapitres sont riches en idées et en faits. M. Faral est, on le sait, l'un des érudits qui connaissent le mieux notre Moyen Age français. Des notes bibliographiques, sommaires, mais très précieuses, accompagnent l'ouvrage." (E. Durtelle de Saint-Sauveur, Revue d'histoire de l'Église de France, 1942)
La Vie quotidienne au temps de saint Louis.
Hachette, 1959, in-8°, 279 pp, biblio, reliure skivertex rouge, un mors fendu, état correct
"Cette étude ne concerne naturellement que la France, mais il s'agit surtout de Paris. L'indication chronologique « au temps de saint Louis », volontairement vague, nous indique que l'auteur ne s'en tiendra pas aux limites exactes du règne. Au cours des chapitres, nous apprenons quel était le cadre où se déroulait cette « vie quotidienne » : lieux, temps, organisation sociale ; comment l'homme de cette époque satisfaisait ses besoins vitaux, car il lui fallait se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, se chauffer, s'éclairer ; comment il était éduqué ; comment il se comportait lors des grands événements de la vie : mariage et mort, quelles étaient ses occupations, travail professionnel ou divertissement ; quels étaient ses rapports avec ses semblables ; s'il croyait à Dieu et comment il concevait ses rapports avec la divinité. L'ouvrage se lit avec grand plaisir ; de nombreuses anecdotes, des tableaux colorés viennent animer le récit ; cet agrément est dû au parti très habile que l'auteur a su tirer de ses sources. Celles-ci, dont les notes bibliographiques, rejetées en fin de volume, permettent de dresser aisément le tableau, sont presque uniquement littéraires." (Roger Sève, Romania, 1946) — "Une intéressante et solide évocation de La vie quotidienne au temps de saint Louis." (Philippe Ménard, Les fabliaux, 1983) — "Un ouvrage où l'auteur résume pour le public cultivé la vaste somme de son savoir." (Julia Bastin, Revue belge de Philologie et d'Histoire, 1958) — "Sans aucunement négliger ce pittoresque que les romantiques prisaient avant tout dans le Moyen Age, M. Faral s'est de préférence appliqué à « montrer, derrière la façade, la pensée qui en expliquait le décor, c'est-à-dire à rendre compte de l'activité quotidienne par certaines dispositions foncières des individus et des groupements ». Le tableau de la vie quotidienne que nous présente ce livre, est un tableau limité, à la fois dans le temps, et aussi dans l'espace. En principe il ne concerne pas tout le Moyen Age, mais seulement le temps de saint Louis. De même, il ne concerne pas la France tout entière, mais seulement Paris, du moins en principe. Toutefois, à vouloir s'en tenir strictement à ce propos, il eût fallu se résigner à ne donner qu'un tableau fragmentaire. Aussi, et cela pour le plus grand profit du lecteur, qui en recevra supplément de lumière, M. Faral s'est-iLvu amené parfois à utiliser des traits empruntés à d'autres époques du Moyen Age, ou bien encore à sortir de Paris. A suivre un guide aussi averti et aussi sûr que l'est M. Faral, le lecteur trouvera à la fois agrément et profit. Parmi les divers chapitres de l'ouvrage, nous avons particulièrement apprécié ceux qui constituent la quatrième partie, portant comme rubrique les Idées et la vie. Sur l'esprit public, sur la religion et la morale, sur la « diffusion des lumières », sur l'ordre social, ces chapitres sont riches en idées et en faits. M. Faral est, on le sait, l'un des érudits qui connaissent le mieux notre Moyen Age français. Des notes bibliographiques, sommaires, mais très précieuses, accompagnent l'ouvrage." (E. Durtelle de Saint-Sauveur, Revue d'histoire de l'Église de France, 1942)
Les Chevaliers de Rhodes et de Malte. (Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem). Chroniques et récits.
Tours, Alfred Mame et Fils, 1893, in-4°, 400 pp, 21 illustrations hors texte dont un frontispice et 12 dans le texte, dessinées par Freeman, Karl Girardet, F. Lix, L. Mouchot, gravées par F. Méaulle, 8 cartes et plans, biblio, joli cartonnage polychrome de l’éditeur de pleine percaline rouge (or, argent, noir et bleu nuit), dos et 1er plat richement décoré d’une plaque signée A. Souze fils, représentant d’un côté un chevalier hospitalier étendard à la main et de l’autre un guerrier sarrazin tenant un cimeterre, tranches dorées, 2e plat frotté, gardes recollées, qqs rousseurs, bon état
Au premier plat, composition néo-classique polychrome, à l'or et au palladium, à gauche un chevalier en armure, brandissant un étendard, le pied posé sur le cadavre d'un ennemi, à droite un Sarrazin portant casque, bouclier et cimeterre, au centre débris de muraille, trophée d'armes (lances, bouclier, haches, gerbe, cadavre), au second plan incendie et fumées, derrière chaque personnage, colonne autour de laquelle sont enroulés des rubans portant les noms des grands maîtres de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (avant l'établissement à Rhodes : Gérard, Raymond Dupuis, de Villaret ; à Rhodes : Villeneuve, [Goz]on, Villiers de L'Isle-Adam ; à Malte : de Savignac, de la Sangle, La Valette, de La Cassière, de H...), en haut au centre, monogramme de Jésus IHS (lettres entrelacées au centre d'une couronne d'épines sur une croix de Saint Louis rayonnante), de part et d'autre, blasons à la croix de Jérusalem. Au second plat, encadrement de motifs géométriques. (...) Le livre relate l'histoire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem depuis sa fondation à Jérusalem par le frère Gérard en 1080 jusqu'au siège de Malte par les Turcs en 1565. (Le Plat Historié, 2014) — Cette chronique des chevaliers de Malte ressuscite l'histoire mouvementée de leur ordre combattant, celui des Frères de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. L'ouvrage se divise en trois parties, l'Orient, Rhodes et Malte. L'histoire commence par la fondation de l'Ordre en Terre Sainte avant la prise de Jérusalem, et son rôle au cours des Croisades. Chassé d'Orient après la chute d'Acre, l'Ordre se replie sur Rhodes et poursuit la lutte contre les assauts turcs jusqu'à la chute de l'île qui le repousse vers un nouvel exil, Malte. Cette dernière partie retrace les nombreux combats en Méditerranée et achève le récit de cette épopée par le grand siège de l'île par la flotte turque en 1565.
Histoire de saint Louis.
Hachette, 1866, 2 vol. in-8°, 630 et 676 pp, brochés, très bon état (Grand prix Gobert 1867 de l'Académie française). Edition originale
Par Joseph-Antoine-Félix Faure (1822-1914). Un chapitre important est consacré à l'administration de Saint-Louis. — "Les deux gros volumes que M. Félix Faure a consacrés à l'Histoire de saint Louis débutent brusquement, sans avant-propos ni introduction, par le tableau des dernières années du règne de Philippe-Auguste, et des événements auxquels Louis VIII fut mêlé : l'historien raconte donc la vie du père avant celle du fils. Il entre ensuite au coeur de son sujet ; il l'embrasse sous toutes ses faces ; et, dans un récit habilement présenté et puisé scrupuleusement aux sources, il nous conduit au terme de l'histoire du saint roi..." (Revue des Questions historiques, 1866)
Charlemagne.
Fayard, 1999, fort in-8°, 769 pp, 16 pl. en couleurs hors texte, 9 cartes et plans, chronologie, biblio, index, 4 généalogies, reliure souple illustrée de l'éditeur, bon état
Successeur des Césars, Charlemagne dont la personnalité fut multiple, aura influencé la politique de la France et de l’Europe bien au-delà de son règne. Jean Favier brosse ici le plus magistral des portraits de l’Empereur. De l'héritier de l'Empire romain à l'empereur à la barbe fleurie, de l'inventeur de la Couronne de France à celui de l'école, l'Histoire donne bien des visages à Charlemagne ; il est souvent difficile de distinguer la part du mythe et de la réalité. Aussi Jean Favier a-t-il consacré une partie entière de son ouvrage au personnage construit par les siècles. Le grand médiéviste s'attache d'abord à replacer le personnage dans son contexte historique, analysant minutieusement la société dont il est issu. Il brosse également un portrait fouillé de ce souverain dont l'action était toute entière tournée vers un seul but : l'unité politique et religieuse de l'Occident chrétien. Sous le mythe, on découvre un homme raffiné, épris de poésie latine, lisant le grec, artisan d'une renaissance intellectuelle qui n'aura pas d'équivalent avant longtemps. Du système monétaire à l'Église, pas un domaine n'a échappé à son ardeur réformatrice que ses conquêtes ont étendue à un énorme empire : tous les éléments d'une légende étaient réunis, le temps a fait le reste.
Charlemagne.
France Loisirs, 2000, fort in-8°, 769 pp, 16 pl. d'illustrations en couleurs hors texte, 9 cartes et plans, chronologie, biblio, index, 4 généalogies, reliure simili-cuir carmin de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état
Il y a le Charlemagne de l'histoire et celui de la légende, l'homme qu'il fut et le personnage construit au fil des siècles. L'homme et son oeuvre sont d'une diversité qui touche au paradoxe. L'empereur à la barbe fleurie fut un chef de guerre sans pitié, un défenseur de la foi, l'initiateur d'une renaissance intellectuelle, d'un système monétaire qui dura mille ans et l'organisateur d'un véritable Etat. Pas un domaine n'a échappé à son ardeur réformatrice que ses conquêtes ont étendue à un immense empire : tous les éléments d'une légende étaient réunis, le temps a fait le reste...
De Marco Polo à Christophe Colomb, 1250-1492.
Larousse, 1973, in-8°, 379 pp, 134 illustrations en noir dans le texte et à pleine page, 23 illustrations hors texte en couleurs, 11 cartes, chronologie, index, biblio, reliure simili-cuir fauve de l'éditeur, titres et encadrements dorés sur les plats, qqs annotations crayon, bon état (Histoire universelle Larousse)
"Jean Favier a choisi comme point de départ le milieu du treizième siècle ; à cette date, la société féodale semble avoir atteint son point d'équilibre, mais Jean Favier y discerne un certain nombre de failles dont il va montrer l'élargissement au long du quatorzième siècle ; le déclin de la papauté, les crises politiques et la guerre de Cent Ans, les difficultés économiques... Puis il décrit l'État nouveau, la bureaucratie naissante, le tableau des bouleversements intellectuels et commerciaux à la fin du quinzième siècle... Comme l'indique le titre, l'accent est mis sur les relations entre l'Europe et les autres continents." (Le Monde)
La guerre de Cent Ans.
Fayard, 1985, fort in-8°, 678 pp, 16 pl. de gravures hors texte, généalogies, sources et biblio, index, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
Fallait-il écrire l'histoire d'une guerre ? Jean Favier montre que ce conflit n'est pas seulement un phénomène en soi mais exprime les mouvements profonds qui animent la société médiévale : par-delà les batailles, où il arrive que le sort d'un royaume se joue en quelques heures, la guerre devient un facteur déterminant des infléchissements de l'histoire dès lors que le noble et le clerc, le bourgeois et le paysan pensent et se comportent en fonction de cette guerre. La guerre de Cent Ans a été le lot commun des individus comme des groupes humains, celui des féodaux encore pris dans leurs fidélités contractuelles, celui des officiers royaux découvrant le service de l'Etat à mesure qu'ils le conçoivent, celui de maîtres de l'Université que leurs engagements intellectuels mènent à des conflits qui n'étaient point les leurs. En un étonnant contrepoint, Jean Favier fait jouer les thèmes divers qui s'appellent le nationalisme naissant, la réforme de l'Etat ou encore l'unité de l'Eglise.
Les Grandes Découvertes. D'Alexandre à Magellan.
Fayard, 1991, in-8°, 619 pp, 21 cartes, chronologie, biblio, index, reliure souple illustrée de l'éditeur, bon état
Curiosité intellectuelle, maîtrise des techniques de la navigation, mais aussi soif de l'or et des richesses, et volonté d'évangélisation furent à l'origine des grandes découvertes de la fin du Moyen Age. En replaçant cette histoire dans le temps long de l'exploration de la terre par l'Occident, le livre de Jean Favier nous restitue la totalité de l'aventure qui commença dans l'Antiquité avec la mesure de la planète, les intuitions beaucoup plus précoces qu'on ne le croit de sa rotondité, les impulsions politiques et religieuses qui animèrent les premiers grands voyageurs. Il fait revivre le mélange de connaissances, de courage et d'ambition que chacun d'entre eux a dû rassembler : Alexandre, Marco Polo, Vasco de Cama, Christophe Colomb et Magellan, pour ne citer qu'eux, sont les héros de cette histoire passionnante.
Le Temps des principautés, de l'an mil à 1515.
Fayard, 1984, fort in-8°, 499 pp, 14 généalogies et tableaux, chronologie, biblio, index, broché, couv. illustrée à rabats, bon état (Coll. Histoire de France, 2)
De l'an mil aux débuts de la Renaissance, c'est l'histoire de cinq siècles aux couleurs bien diverses. C'est le temps des dynamismes que manifestent les défrichements, le réveil des villes, l'élargissement des horizons politiques, la floraison des ordres monastiques, la naissance des universités et l'ampleur nouvelle des grandes cathédrales. C'est aussi le temps des épreuves et des maturations, des crises et des épidémies, des guerres et des luttes civiles. La France passe de l'anarchie féodale à l'absolutisme monarchique, à travers la construction politique des grandes principautés. Et l'on va, dans ce même temps, des chansons de geste aux premiers fruits de l'humanisme en passant par l'aristotélisme de Thomas d'Aquin et l'universalisme encyclopédique du Roman de la Rose.
Paris au XVe siècle, 1380-1500.
P., Association pour la publication d'une Histoire de Paris, 1974, in-4°, 486 pp, une planche en couleurs hors texte, 82 illustrations, 19 cartes, plans et graphiques, copieuse bibliographie (313 titres), index, reliure vélin aux armes dorées de la ville de Paris de l'éditeur, bon état (Coll. Nouvelle histoire de Paris), envoi a.s. à Emmanuel Le Roy Ladurie
"Le Paris des derniers siècles du Moyen Age ne s'offre pas aux yeux de nos contemporains. Même dans ses quartiers les plus centraux, la ville que nous parcourons ne remonte guère au-delà du XVIe siècle. C'est le Paris des grands Capétiens, celui des XIIe et XIIIe siècles, que rappellent quelques hauts lieux comme Notre-Dame ou la Sainte-Chapelle. La ville où s'affrontèrent les princes des fleurs de lis, la ville-forteresse longtemps fidèle à Bedford et toujours à Louis XI, mais fermée à Jeanne d'Arc comme plus tard aux ligueurs du Bien public, où la trouvons-nous ? Où sont ses ponts « maisonnés » et ses rues obscurcies par les encorbellements ? Où sont les galeries des Halles et les pontons du port en Grève ? Où sont les clochers des cent égliseset les donjons du Louvre, du Temple ou de la Bastille ? Où notre esprit peut-il aisément suivre la trace d'Eustache Deschamps et celle de François Villon ? Parce que ces temps difficiles ont laissé peu de souvenirs dans la pierre, il m'a paru nécessaire d'ouvrir cette histoire par une description. Esquissant le paysage urbain, j'ai voulu atteindre plus intimement l'espace parisien – c'est-à-dire le cadre de vie des Parisiens – et tenter une géographie des activités, des fonctions et des relations. De 1380 à 1500, c'est une vague qui déferle sur la capitale. Après la fragile prospérité des années 1400, c'est le grand bouleversement que jalonnent l'assassinat du duc d'Orléans, l'aventure cabochienne, la terreur, l'occupation, les sièges. Quand on ne parle pas du ravitaillement difficile ou des prix qui flambent, on ne parle que d'émeutes, complots, bannissements, confiscations, exécutions. A ces luttes et à ces souffrances, j'ai consacré ma deuxième partie. L'Université y a sa place à part, ville dans la ville, société dans la société, aussi particulière par son essence qu'emportée par l'occasion dans le mouvement général." (Avant-propos)
Christine de Pisan. Muse des cours souveraines.
Lausanne, Editions Rencontre, 1967, pt in-8°, 222 pp, 32 pl. de gravures hors texte, biblio, reliure simili-cuir noir de l'éditeur, un portrait en médaillon au 1er plat, bon état (Coll. Ces femmes qui ont fait l'Histoire)
La ville de Poitiers à la fin du Moyen Age. Une capitale régionale. (Thèse).
Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1978, 2 vol. gr. in-8°, lxxxix-720 pp, pagination continue, 31 cartes et plans, la plupart dépliantes (dont un plan dépliant de Poitiers et ses environs de 1582-1586), 8 tableaux généalogiques, 8 illustrations hors texte, 5 graphiques et tableaux, copieuse biblio (89 pages), index, brochés, jaquettes illustrées, bon état
"Robert Favreau vient d'éditer sa thèse de doctorat sur cette ville de Poitiers qu'il connaît si bien et depuis si longtemps. Travail de grande qualité, œuvre d'un érudit qui est aussi un historien. Il est clair que la gloire de la ville est ancienne et que son nom évoque les premiers siècles médiévaux plus que les temps modernes ; ce n'est pas une ville d'activé marchandise comme Arras ou Marseille, de bourgeoisie conquérante comme Metz ou Bordeaux ; sa cathédrale et ses écoles ne posent pas les problèmes de Chartres ; son rôle militaire est bien inférieur à celui de Besançon ; on pense plutôt à Tours ou à Reims. La démonstration est des plus satisfaisantes. Non pas seulement parce que je ne vois pas ce qu'on pourrait dire de plus sur Poitiers à la fin du Moyen Age, et que tout l'appareil érudit qui accompagne l'ouvrage témoigne assez de la conscience, de la mesure et de la prudence de Robert Favreau, sans oublier un remarquable ensemble cartographique de 30 planches ; mais aussi parce que Poitiers nous offre une « grille » des activités urbaines médiévales. (...). Au total, au milieu du XVIe siècle, une ville de 15.000 habitants sans doute, la dixième ou douzième de France..." (Robert Fossier, Bibliothèque de l'École des chartes, 1980)
Bonnes villes du Poitou et des pays charentais du XIIe au XVIIIe siècles (Communes, franchises et libertés).
Société des Antiquaires de l'Ouest, 2002, gr. in-8°, 468 pp, broché, couv. illustrée, bon état. Actes du colloque tenu à Saint-Jean-d'Angély, les 24-25 septembre 1999, à l'occasion du 8e centenaire des chartes de commune
Dans le royaume de France la création de communes se situe principalement aux XIIe et XIIIe siècles. Dans la région du Centre-Ouest, alors aux mains des Plantagenêts, quatre communes, créées probablement par Henri II, La Rochelle, Poitiers, Saintes et Oléron, sont confirmées par Aliénor d'Aquitaine en 1199. Jean sans Terre concède la création d'une commune à Saint-Jean d'Angély et à Niort en 1199, à Angoulême en 1204, à Cognac en 1215. Saint-Maixent recevra aussi le statut communal en 1440 par Charles VII, seule création de son règne. Toutes ces communes ont la même organisation, mairie annuelle, corps d'échevins, conseillers et pairs. Leur création, leur fonctionnement, leurs rapports avec le pouvoir central, sont ici étudiés jusqu'à la Révolution. On trouvera aussi dans ce volume l'historique des armoiries de ces villes, un état des archives communales et des listes des maires jusqu'en 1790.
Les Capétiens et la France. Leur rôle dans sa construction.
PUF, 1942 in-8°, 223 pp, broché, bon état
"Ce livre ne concerne que les Capétiens directs (987-1328). Son but est de montrer quelle action les princes de cette dynastie ont eue sur la formation de notre pays. L'historien montre avec quelle habileté, avec quelle sûreté instinctive les premiers Capétiens ont su consolider leur dynastie, faire valoir leurs droits de suzeraineté même à l'égard des plus puissants vassaux et affirmer à l'intérieur comme à l'extérieur l'un des droits essentiels de la souveraineté royale, celui de ne prêter l'hommage à qui que ce soit. La faiblesse de la dynastie à ses origines leur interdisait de grandes conquêtes et des visées trop ambitieuses. Ils se sont appuyés résolument sur leur droit, sur les règles mêmes de la coutume féodale. Sans hâte, sans programme nettement tracé d'avance, ils ont su profiter de toutes les occasions favorables pour s'étendre et arrondir leurs domaines. Aucun d'eux n'a possédé de qualités géniales, mais la continuité de leurs efforts a fondé définitivement leur puissance. On trouvera de même dans ce remarquable essai des analyses judicieuses sur le développement de la justice royale et institutions administratives, sur le ralliement à la personne du roi de toutes les classes sociales du royaume." (Joseph Lecler, Etudes, 1942) — "Le livre de M. Fawtier est un brillant essai. Il n'épuise pas le sujet, mais il ne sera pas facile de dire encore beaucoup de neuf après lui. C'est avant tout un livre intelligent." (Jean Dhondt, Revue belge de philologie et d'histoire, 1943)
La double expérience de Catherine Benincasa (Sainte Catherine de Sienne).
Gallimard, 1948, in-8°, 368 pp, broché, non coupé, papier jauni, couv. salie, état correct
"A l'époque où Catherine de Sienne mit son grand cœur et sa volonté ardente au service de Dieu et de ses frères humains, l'allégorie fleurissait en Italie, dans la littérature et dans l'art, et n'épargnait pas la théologie. Les belles fresques par lesquelles les plus grands artistes ont essayé de traduire une représentation symbolique du monde sont parfois difficiles à interpréter maintenant, et les historiens, pour y parvenir, doivent se replonger dans une “Weltanschauung” qui nous paraît bien lointaine. C'est ce qu'ont tenté de faire les deux auteurs de cette nouvelle biographie d'une sainte illustre. Ils ont voulu dérouler sous les yeux de leurs lecteurs une existence réelle, dans une période de l'histoire fort agitée, et exposer une doctrine spirituelle difficile à préciser, puisqu'il s'agit d'une femme ignorante et non d'un théologien. Le titre même qu'ils ont choisi montre qu'ils ont eu dans l'esprit le diptyque fréquemment représenté dans nos cathédrales : vie active d'une créature passionnée et volontiers autoritaire que sa charité entraîne à se mêler aux affaires séculières, et qui, nous n'en serons pas surpris, y trouve des mécomptes et des épreuves ; vie contemplative, où elle rejoint, dans un monde libéré du temps et de l'espace, les plus grands mystiques. C'est à M. R. Fawtier que revient le mérite d'avoir arraché à l'hagiographie banale l'une des plus étonnantes figures du Moyen Age. La biographie qu'il nous présente n'existe qu'en fonction des recherches qui l'ont précédée. Mais son érudition n'est pas aride. Rien de plus vivant que cette description de l'Italie de la seconde moitié du XIVe siècle, dévastée par les guerres incessantes et les épidémies, où une jeune femme au courage indomptable lutte pour la paix de l'Église et le bien des âmes..." (Marie-Thérèse d'Alverny, Bibliothèque de l'École des chartes, 1950)
Poitiers, 1356.
London, Charles Knight, 1972, in-8°, xiii-64 pp, 4 cartes, biblio, cart. illustré de l'éditeur, bon état (Coll. Knight's Battles for Wargamers)
Naples, 1343. Aux origines médiévales d'un système criminel.
Seuil, 2019, gr. in-8°, 279 pp, traduit de l'italien par Jacques Dalarun, notes, biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. L'Univers historique)
En 1343, un navire génois, empli de vivres, est intercepté dans le port de Naples par une population affamée agissant sous la conduite de membres de familles nobles. Le capitaine est sauvagement assassiné et la cargaison du navire est détournée. En 2005, dans la province de Naples, trois jeunes hommes menottés sont tués d'un coup de revolver dans la tête devant les portes d'un collège. Quels sont les liens entre ces deux faits divers, l'un et l'autre tristement banals rapportés à leur époque (dans un cas une révolte de la faim, dans l'autre un crime de la Camorra) ? Y en a-t-il même au-delà de leur localisation – mais n'est-ce déjà pas beaucoup quand le lieu en question, Naples, est connu pour être celui du crime organisé et de l'épanouissement d'un système clientéliste mafieux ? Amedeo Feniello invite le lecteur à revisiter l'épisode de 1343 comme étant révélateur de l'identité même de la ville, de la conception d'une "nation napolitaine" spécifique dont les origines sont à rechercher au XIIe siècle, lors de l'annexion de Naples par les Normands. L'intégration au royaume normand de Sicile s'est faite en effet au prix de la concession de larges pans du pouvoir souverain aux cinquante-sept grandes familles napolitaines, créant ainsi une structure politique divisée en parcelles rattachées à un territoire et marquées par une solidarité et un honneur propres. Cette appropriation clanique de la ville, devenue structure mentale, est liée à la vie la plus profonde de cette cité, à son imaginaire le plus archaïque, à sa part maudite, qui s'exprime aujourd'hui comme hier, en 2005 comme en 1343...
 Write to the booksellers
Write to the booksellers