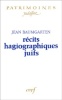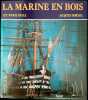Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
17th (3)
18th (13)
19th (252)
20th (2116)
21st (264)
-
Syndicate
ILAB (2656)
SLAM (2656)
Franz Kafka devant la critique communiste.
dans Critique n° 41, octobre 1950, in-8°, 96 pp, broché, bon état
Autres articles par Maurice Blanchot (Thomas Mann et le mythe de Faust), Eric Weil (l'histoire littéraire et l'érudition : Ernst Curtius), etc, plus quelques notes de lectures (dont une par G. Bataille sur l'existentialisme).
Le matérialisme et la fable.
dans Critique n° 43, décembre 1950, in-8°, 96 pp, broché, bon état
Autres articles par Maurice Blanchot (le musée, l'art et le temps, I., sur A. Malraux), Mircea Eliade (actualité de la mythologie), W. Weidle (T. S. Eliot), etc.
Le paradoxe de la mort et la pyramide.
dans Critique n° 74, juillet 1953, in-8°, 96 pp, broché, bon état
Autres articles par André Masson (Révélation de la peinture antique), etc.
Nietzche et Jésus selon Gide et Jaspers.
dans Critique n° 42, novembre 1950, in-8°, 96 pp, broché, bon état
Autres articles par Jacques Brenner (sur Henri Thomas), etc, plus quelques notes de lectures (dont trois par G. Bataille sur la sociologie, Henri Calet, Beatrix Beck).
Sommes-nous là pour jouer ou pour être sérieux ? (1).
dans Critique n° 49, juin 1951, in-8°, 96 pp, broché, bon état
Autres articles par Jean Rostand (Raymond Queneau et la cosmogonie), Monique Nathan (sur Henry James), Paul Jaffard (André Dhôtel romancier), etc.
Les Paquebots des Croisades aux Croisières. Traduction A. Van de Wiele. Documentation Denise Blum.
Fribourg, Office du Livre, 1972, in-4° (28 x 31,5), 298 pp, 357 illustrations dont 30 en couleurs (vignettes contrecollées), biblio, reliure toile bleue éditeur, jaquette illustrée. Bon exemplaire
Curiosités esthétiques.
P., Michel Lévy frères, 1868, in-12, 440 pp, reliure demi-chagrin brun foncé à coins, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres dorés, monogramme doré en queue (pas de tomaison au dos), tête dorée (rel. de l'époque), dos lég. frotté, bon état
Edition en partie originale, avec le faux-titre, qui porte l'intitulé "Œuvres complètes". L'ouvrage se vendait séparément seul ou comme le second volume des œuvres complètes dont l'édition s'étalera sur plusieurs années. Clouzot précise : "ne se rencontre qu'exceptionnellement en reliure d'époque sans tomaison au dos". Tout au long de sa carrière littéraire, Baudelaire n'a cessé de rechercher et de glorifier les témoins de l'art pur, quelle que pût être leur célébrité ou leur obscurité, quelles que fussent leurs théories ou leurs écoles. Ces textes, composés entre 1845 et 1863, parurent d'abord dans les journaux puis en volume (1868), après la mort du poète, chez l'éditeur Michel Lévy. Ce volume comprend, outre les deux Salons de 1845 et 1846 déjà parus, six textes de critique d’art en édition originale : Le Musée classique du bazar Bonne-Nouvelle, De l’Essence du rire, Quelques caricaturistes français, Quelques caricaturistes étrangers, Exposition universelle de 1855 et Salon de 1859. — Baudelaire y écrit par exemple dans son étude sur Boudin : « À la fin de tous ces nuages aux formes fantastiques et lumineuses, ces ténèbres chaotiques [...], ces firmaments de satin noir ou violet, fripé, roulé ou déchiré, ces horizons en deuil ou ruisselants de métal fondu, toutes ces profondeurs [...], me montèrent au cerveau comme une boisson capiteuse ou comme l’éloquence de l’opium. Chose assez curieuse, il ne m’arriva pas une seule fois, devant ces magies liquides ou aériennes, de me plaindre de l’absence de l’homme » (p. 334).
La petite bourgeoisie en France.
P., François Maspero, 1974, in-8°, 305 pp, broché, couv. à rabat, bon état (Coll. Cahiers libres). Edition originale, premier tirage (mai 1974)
Qui sont, aujourd'hui en France, les petits bourgeois ? Combien sont-ils ? À quels critères objectifs peut-on les reconnaître ? On ne peut définir scientifiquement les petits bourgeois français d'aujourd'hui sans définir les rapports qui les distinguent et les opposent aux autres classes de la société : bourgeoisie, prolétariat, paysannerie travailleuse. Parmi tous les rapports sociaux qui divisent et opposent des classes, les rapports sociaux de production sont déterminants. Il s'agit donc de définir d'abord la place qu'occupent aujourd'hui les petits bourgeois dans ces rapports capitalistes de production. La place qu'ils y occupent les fait bénéficier d'une rétrocession de plus-value sous des formes diverses : bénéfice commercial, avantages liés à l'exercice d'une profession salariée dans l'appareil d'Etat ou à la détention d'une compétence technique rare, scientifique, juridique, etc. La petite bourgeoisie constitue-t-elle pour autant une classe aujourd'hui, en France ? Elle n'est ni un magma informe et nébuleux de privilégiés individuels, ni une classe aussi structurée et unifiée que la classe ouvrière. On peut distinguer aujourd'hui trois fractions de classe : 1) la petite bourgeoisie commerçante de biens et de services ; 2) la petite bourgeoisie d'encadrement des compromis d'Etat ; 3) la petite bourgeoisie d'encadrement de l'appareil économique capitaliste. Chacune de ces fractions petites bourgeoisies se caractérise par des positions de classe spécifiques qui les distinguent à la fois de la bourgeoisie et du prolétariat et peuvent aussi les opposer entre elles. On peut sur ces bases recenser 3,500,000 actifs petits bourgeois en 1968. (4e de couverture)
Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique. Publié sous la direction de Mgr Alfred Baudrillart, Albert Vogt et Urbain Rouziès.
Letouzey et Ané, 1912-1924, 3 vol. in-4°, vii-872, 916 et 835 pp, texte sur deux colonnes, reliure demi-toile, pièce de titres de maroquin noir, couv. conservées. Tome I. Aachs-Albus. - II. Alcaini-Aneurin. - III. Anforaria-Arfons. Tête de série bien reliée de cette importante publication.
Le baptême et ses symboles. Aux sources du salut.
Beauchesne, 2001, in-8°, 196 pp, biblio, index, broché, bon état
Cet ouvrage a pour but d'ouvrir à l'intelligence du sacrement de baptême, d'offrir aux catéchistes, aux pasteurs et aux si nombreux catéchumènes ou "grands recommençants" un dossier qui dévoile les richesses spirituelles de la liturgie baptismale. L'auteur reprend ici la méthode des Pères de l'Église, toujours actuelle et efficace, dont Vatican II a souligné la grande valeur pédagogique : il présente, analyse et commente chacun des symboles fondamentaux de l'initiation chrétienne, non seulement bibliques mais universels, mis en jeu dans l'action liturgique et qui contribuent par eux-mêmes à l'éducation chrétienne : l'eau, l'huile d'onction, le vêtement blanc, le symbole du sceau, la métaphore des deux voies..., ainsi que la grande symbolique paulinienne de la mise au tombeau avec le Christ, pour ne citer que les plus significatifs. Ces symboles ne relèvent pas dune curiosité archéologique : touchant les sens et l'intelligence, ils expriment et effectuent à la fois l'action sacramentelle. En les mettant en lumière, l'auteur permet d'accéder à la dynamique interne du baptême. — "La mentalité occidentale est particulièrement insensible au monde du symbole, notamment dans la célébration des sacrements dont on a surtout retenu l'efficacité. Or, c'est au travers du signe que s'exprime et s'actualise le don de Dieu dans les médiations sacramentelles du salut. Le baptême (mais aussi la confirmation et l'eucharistie), objet de la présente recherche, est particulièrement riche au plan de la symbolique littéraire et rituelle. C'est en scrutant les significations bibliques de chaque symbole, mais aussi la préhistoire des symboles dans les religions non bibliques, leur interprétation dans les textes patristiques et leur situation à l'intérieur de l'action rituelle que l'A. inventorie les mille facettes de chacun. Cette approche transversale est particulièrement heureuse. L'A. passe en revue les symboles les plus importants de l'initiation chrétienne : le « sacrement de l'eau » (Tertullien) qui porte la vie, la mise au tombeau (certaines cuves baptismales, comme à Arles, avaient la forme d'un sarcophage), l'huile du salut étendue sur la tête ou le corps (tantôt dans l'exorcisme, tantôt dans la consécration du baptisé), le « sacrement de la lumière » (le Christ plongeant dans les eaux du baptême n'est-il pas comme le soleil qui se perd dans les eaux ?), le « sacrement de la liberté chrétienne » (le baptême comme « sacrement frontière » postulant une décision libre exprimée dans la double renonciation vers l'ouest et profession de foi vers l'est), la nourriture et la boisson de l'eucharistie (notamment la triple coupe mentionnée dans la Tradition Apostolique : coupe d'eau, de lait et de miel, et de vin consacré), le sacrement du « sceau de la foi » (Tertullien), appelé tantôt signum tantôt signaculum, signe du croyant, sceau de l'Esprit exprimant l'appartenance à l'Alliance et la protection du Christ." (A. Haquin, Revue Théologique de Louvain, 2003)
L'Art et le Temps. Regards sur la quatrième dimension.
Albin Michel, 1985, in-4° carré, 270 pp, très nombreuses illustrations en noir et en couleurs, dans le texte et à pleine page, notes, index, reliure toile noire de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état
L'Art et le Temps analyse les rôles qu'à pu jouer et que joue aujourd'hui le temps dans l'art. — La quatrième dimension dans l'art, l'histoire, les sciences, la philosophie, par Michel Butor, Umberto Eco, Jean-François Lyotard, Ilya Prigogine, L. Dalrymple Henderson, Luc de Heusch, Paul Virilio... Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition "L'Art et le Temps" organisée par la Société des expositions du Palais des beaux-arts de Bruxelles et présentée au Palais des beaux-arts de Bruxelles du 21 novembre 1984 au 20 janvier 1985.
Les Terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire. Terrorisme et révolution par les textes.
PUF, 2010, in-8°, vii-355 pp, chronolologie 1969-1988, biblio, index, broché, bon état
Récits hagiographiques juifs.
Cerf, 2001, in-8°, 573 pp, biblio, glossaire, index, broché, très bon état (Coll. Patrimoines Judaïsme). Exemplaire du SP avec 2 petits cachets SP sur la tranche sup.
Depuis la Bible jusqu'à l'époque contemporaine, la littérature juive comprend un vaste ensemble de récits retraçant la vie exemplaire et les actions miraculeuses de saints, de justes, d'hommes pieux ou de martyrs ; à chaque époque de l'histoire émergent des figures saintes représentatives des multiples aspects de la société. “Récits hagiographiques juifs” retrace l'histoire de ces légendes au sein de la culture ashkénaze et insiste sur les conditions d'émergence, l'évolution, les formes et les contenus des différentes traditions. Apparaît ainsi une multitude de matrices narratives qui seront reprises et transformées au cours des siècles selon les contextes sociaux ou religieux. La mise en lumière de ces récits permet d'élaborer une typologie des figures saintes propres à la tradition juive et de dégager les fonctions de ces recueils : usages religieux, didactiques, moraux ou politiques. Sont étudiés ici principalement des 'exempla' (récits édifiants, personnages modèles) concernant les rabbins médiévaux, les louanges de rabbi Isaac Luria, des kabbalistes de Safed, ou d'Israël Baal Shem Tov, fondateur du hassidisme. Ces recueils de légendes auront une influence déterminante sur les récits hagiographiques des époques postérieures, entre autres les contes sur les 'tsaddikim', les 'rebbes' hassidiques ou les histoires relatant la vie de rabbins, de sages, de savants tel le Gaon de Vilna. “Récits hagiographiques juifs” est la première synthèse en langue française concernant cette tradition.
Essai historique sur le Droit d'élection et sur les anciennes assemblées représentatives de la France.
Genève, Mégariotis Reprints, 1979, in-8°, viii-437 pp, reliure simili-cuir de l'éditeur, bon état
Réimpression de l'édition de Paris, 1874. I : Du principe électif dans les temps anciens. II : Du principe électif depuis le Moyen Age jusqu'à Hugues Capet. III : Du principe électif depuis Hugues Capet jusqu'à 1789. IV : Lois électorales de puis 1789 jusqu'à nos jours.
Les Rose-Croix.
P., MA Editions, 1986, in-8°, 168 pp, 44 gravures et figures, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Pourquoi ce nom de Rose-Croix ? Comment associer un instrument de supplice qui résume tout le drame de la passion du Christ à la grâce et à la fraîcheur de la rose ? Le creuset de la beauté éphémère peut-il s'imposer à la lourdeur de la croix éternelle ? D'après Gustave Naudé, la mission des Rose-Croix consiste à "accomplir le rétablissement de toute chose en un état meilleur, avant que la fin du monde arrive". Ces mystérieux maîtres spirituels "ont au suprême degré la piété et de la sagesse, connaissent mieux les choses qui se passent dans le reste du monde que si elles leurs étaient présentes". Il reste à révéler le sens secret de ce discours.
Sacres et couronnements royaux.
Guy Trédaniel, Editions de la Maisnie, 1984, gr. in-8°, 375 pp, un frontispice et 49 illustrations en noir et en couleurs sur 28 pl. hors texte, annexes, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
"Les études sur l'institution monarchique dans l'Ancienne France sont en plein renouveau. Le livre s'ouvre avec un chapitre sur les origines magiques de la royauté ; « Le Roi prêtre et chaman ». Quatre parties : l'histoire (avec une longue analyse du rituel), la symbolique, le pouvoir temporel et spirituel. L'ouvrage ne manque ni de mérite ni d'intérêt, mais son savoir n'a pas la rigueur et les exigences d'un historien de métier." (Emile Poulat, Archives de Sciences Sociales des Religions, 1985)
Histoire de France. Edition revue et mise à jour.
P., Editions du Sagittaire, 1947, in-8°, 337 pp, index, broché, bon état
Parlant de cette nouvelle histoire de France, Edouard Herriot écrit : « A chacune de ses pages, elle oblige à réfléchir, elle contraint à penser ».
La Marine en bois.
Fayard, 1978, in-4°, 209 pp, 165 gravures et photos, annexe, glossaire, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état
Unissant leur connaissance des choses de la mer et de l'histoire de France les auteurs ont choisis vingt-quatre bateaux d'autrefois représentés, dans cet album richement illustré, par des maquettes originales. (...) Brossée à grands traits, c'est toute l'histoire de la marine en bois, depuis les galères jusqu'aux derniers vaisseaux de ligne. (...) La plupart de ces maquettes sont de véritables chefs-d'œuvre du Musée de la Marine. Certaines, contemporaines des navires qu'elles représentent, ont été construites il y a plus de deux siècles. Toutes évoquent une page de notre histoire maritime. L.-M. Bayle a été directeur du musée de la Marine à partir de 1972. J. Mordal a été responsable du service de documentation et des études de Chaillot.
Paradeisos ou l'Art du jardin.
P., Chêne, 1988, in-4°, 264 pp, nombreuses illustrations en noir & en couleurs, reliure d'éditeur & jaquette (bon état)
La Douce France. Illustrations de J. M. Breton.
P., J. de Gigord, 1911, pt in-8°, viii-311 pp, illustrations dans le texte et à pleine page du peintre et illustrateur Joseph Marcel Breton (1879-1955), qqs cartes, reliure demi-chagrin carmin, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres dorés, couv. conservées (rel. de l'époque), dos lég. et uniformément passé, bon état
"Voici comment ce livre est né. Au mois d'août 1909, l'Alliance des maisons d’éducation chrétienne tenait, à Nancy, son assemblée générale. Elle s'occupa, parmi d'autres questions, des livres de lecture courante en usage dans les écoles, et voulut bien m'inviter à en écrire un. Je songeai que c'était un beau service qu'on m'avait demandé et un bel honneur qu'on m'avait fait ; je pensai qu'il serait bon, toujours, qu'il était nécessaire aujourd'hui de montrer, aux petits Français et aux petites Françaises, pourquoi nous devons aimer la France et ne jamais désespérer d'elle. Oui, j’écrirai pour les écoliers de France. Je leur dirai ce qu'est l'âme de ce pays, son caractère, sa vocation, son visage de nation. Le titre allait de soi. Ce serait La Douce France. Un de mes lecteurs m'a écrit : "c'est le catéchisme de la France que vous faites !" Ah ! que je voudrais l'avoir fait ! Que je voudrais avoir glorifié toute l'âme de la France !" (Avant-propos)
Les Arts. Revue mensuelle des Musées, Collections, Expositions.
P., Goupil, Manzi, Joyant, 1903-1920, 13 vol. gr. in-4° (357 x 290), très nombreuses illustrations, la plupart à pleine page ou sur demi-page, tables, texte sur 2 colonnes, 11 volumes reliés en demi-toile bordeaux, pièces de titre basane havane, les 3 derniers volumes en reliures demi-chagrin caramel, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres dorés, tous les volumes en bon état. Rare
Collection presque complète de la deuxième année (1903) à la seizième et dernière année (1920), soit du n° 20 au n° 192 (chaque année comprend 12 numéros de 24 à 46 pages sur papier glacé), elle est ornée de très nombreuses reproductions. Bel exemplaire de cette excellente documentation.Détail : Vol. 2 (août à décembre 1903) et Vol. 3 (1904) reliés en un volume, Vol. 4 (1905), Vol. 5 (1906), Vol. 6 (1907), Vol. 7 (1908), Vol. 8 (1909), Vol. 9 (1910), Vol. 10 (1911), Vol. 11 (1912), Vol. 12 (1913), Vol. 13 (1914-1916 : aucun numéro n'a paru entre septembre 1914 et avril 1916), Vol. 14 (1917-1918) et Vol. 15 (1919) reliés en un volume, Vol. 16 (1920). Compte-tenu du poids de l'ensemble (50 kg environ), nous serons amenés à demander des frais d'expédition plus importants en cas d'envoi.
Chausse-Trapes.
Lausanne, Pierre Demaurex, 1982, in-4° à l'italienne (26,5 x 33), 83 pp, 81 dessins de Michel Devrient en noir et en couleurs et un texte de Sylvio Acatos, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, sous emboîtage carton, bon état. Edition originale. Exemplaire enrichi d'un envoi a.s. de Michel Devrient
Première publication de Michel Devrient. Ce très beau livre du dessinateur français né à Lausanne en 1943 s'intitule “Chausse-trapes” avec un seul p.
Picasso : Métamorphoses et unité, avec témoignages de poètes et amis de l'artiste.
Genève, Albert Skira, 1971, gr. in-4° (35,6 x 27,8), x-306 pp, très nombreuses illustrations en noir et en couleurs, certaines contrecollées, notes biographiques de Jean-Luc Daval, biblio, table des illustrations, références des citations, index des noms cités, reliure pleine toile havane illustrée d'une composition de Picasso contrecollée au 1er plat, titre imprimé en blanc, pt accroc au bas du dos, bon état. Edition originale
Importante iconographie documentaire en noir et en couleurs reproduisant plus de 600 oeuvres. Table : Le mystère de la vie - La révolution de la forme - L'univers féminin - Drame et histoire - Mythes et Méditerranée - La comédie humaine ou "les caprices" - L'atelier perpétuel.
Staël : Du trait à la couleur.
P., Imprimereie nationale, 2001, in-4° (28.2 x 32), 339 pp, très nombreuses reproductions en noir et en couleurs à pleine page, notes, annexe, biblio, index, reliure pleine toile bleue éditeur, jaquette illustrée, sous étui cartonné illustré en couleurs, bon état
"Il est né à Saint-Pétersbourg le 5 janvier 1914, dans la ville de Pierre le Grand, conçue «dans le tissu infini de la Baltique», véritable invitation au rêve. En retraçant la vie et l'œuvre de son père, Nicolas de Staël, Anne nous offre l'extraordinaire portrait, tout à la fois intime et artistique, du peintre de la lumière. Nourri de nombreux dessins inédits tout comme d'écrits inconnus, cet ouvrage éclaire avec intelligence le parcours de cet exilé, orphelin à 8 ans, qui trouva son salut dans la langue française et dans ses paysages transfigurés. «Son pays était le monde», affirme l'auteur; un nomadisme qu'il réalisa à travers sa peinture, et notamment les superbes huiles sur toile reproduites dans cet album. Du trait à la couleur, des dessins au fusain du Maroc de 1936 à l'Agrigente de 1953, du Portrait de Jeannine en 1939 à la Marine de 1954, toute la palette des talents de Staël, disparu en 1955, est ici sublimée par une maquette irréprochable." (Marianne Payot, L'Express, 06/12/2001)
Ingres.
Citadelles et Mazenod, 1995, in-4°, 349 pp, très nombreuses illustrations en noir et en couleurs, notes, annexe, biblio, index, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, sous coffret illustré (pt accroc sur un plat du coffret), bon état. Ouvrage épuisé, prix neuf de l'éditeur : 189 €
Mort en 1867, à l'âge de quatre-vingt-six ans, Jean-Auguste-Dominique Ingres eut une personnalité qui a incontestablement dominé son siècle, et dont les influences se font encore sentir au XXe siècle. Paradoxalement, aucune monographie n'était aujourd'hui disponible. D'où la nécessité d'une biographie complète et documentée, développée par Georges Vigne après plusieurs années de l'étude approfondie de l'oeuvre d'Ingres. À travers une trame chronologique, il donne la priorité à l'oeuvre, ne s'intéressant aux détails de la vie, que lorsqu'ils influencent le travail de l'artiste. Un critique contemporain l'avait qualifié de "Chinois perdu dans les ruines d'Athènes", et effectivement, Georges Vigne s'attache à montrer le hiatus qui existait entre le peintre et le monde dans lequel il voulait s'intégrer. Entre Montauban, Paris, Florence ou Rome, l'auteur nous guide à travers les grands tableaux, replaçant l'artiste dans la vie de son époque, et montrant l'importance qu'ont pu avoir ses élèves dans son travail. Sachant perpétuellement se renouveler achevant même à quatre-vingt-deux ans un chef-d'oeuvre absolu : Le Bain turc, il ne laissa jamais ses contemporains indifférents. Somptueusement illustré, l'ouvrage est complété par la première transcription exhaustive des Cahiers IX et X, (dans lesquels l'artiste rédigea son propre "catalogue raisonné", pour l'Exposition universelle de 1855), une bibliographie, une liste d'expositions, et un index.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers