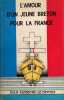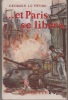Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
20th (1487)
21st (248)
-
Syndicate
ILAB (1740)
SLAM (1740)
Croix de guerre pour une grève. Cent mille mineurs contre l'occupant, 27 mai-10 juin 1941.
Plon, 1971, pt in-8°, 186 pp, 8 pl. de fac-similés et photos hors texte, broché, bon état. On joint des articles de presse sur le livre avec des entretiens avec l'auteur (le Monde, le Figaro)
En mai-juin 1941, en pleine zone interdite, les mineurs cessent le travail face à l'occupant allemand. Auguste Lecœur, à l'époque dauphin de Maurice Thorez, qui organisa cette « manifestation patriotique » en explique le sens à une époque où le PCF entretenait avec l'Allemagne des « rapports de neutralité bienveillante ». — Lecœur, dirigeant de la fédération communiste du Pas-de-Calais, sera l'un des principaux animateurs de la grande grève des mineurs de mai-juin 1941. Cette grève a représenté, dans les premières années de l'occupation, le seul mouvement de rébellion d'une certaine ampleur développé sur le territoire national. L'organisation syndicale clandestine qui s'est mise en place dans le bassin minier, – les CUSA (Comités d'unité syndicale et d'action) –, a, dès la fin 1940, développé en dehors des directives nationales une ligne revendicative qui n'excluait pas l'affrontement avec les Allemands. Les traditions patriotes sont plus vivaces qu'ailleurs dans cette région qui a déjà connu l'occupation pendant la première guerre mondiale et qui, de surcroît, est directement rattachée à l'administration allemande de Bruxelles. Les conditions de vie sont aussi dures que dans tout le pays, mais les Allemands maintiennent les cadences de production à un niveau extrêmement élevé. À la suite d'un incident banal entre des mineurs et un chef porion, le débrayage de la fosse numéro 7 de Dourges s'étend en quelques jours à tout le bassin minier. Lecœur et la direction des CUSA ont lancé le mot d'ordre de grève. Le mouvement culmine le 4 juin : 100.000 mineurs sont alors en grève dans le bassin, soit la quasi-totalité de l'effectif ouvrier. Les mineurs obtiennent rapidement satisfaction, mais les Allemands se sont lancés dans une sanglante chasse aux meneurs : emprisonnement et déportation d'hommes et de femmes, souvent désignés avec la complicité des cadres des Compagnies minières. Jusqu'à la fin de l'occupation, la résistance ouvrière demeurera particulièrement vivace dans la région du Nord.
L'amour d'un jeune Breton pour la France, 19 juin 1940-8 mai 1945.
Saint-Herblain, Pierre Gauthier, 1979 in-8°, 215 pp, préface du Contre-Amiral Pépin Le Halleur, 32 pl. de photos hors texte, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état. Edition originale, un des ex. numérotés (n° 27) et signés par l'auteur (justification non précisée), enrichie d'un envoi a.s. de l'auteur à un camarade
Souvenirs d'un Lorientais engagé dans les Forces Navales Françaises Libres.
Goering, l'homme qui a perdu la guerre.
Rossel Edition, 1974, gr. in-8°, 271 pp, 16 pl. de photos hors texte, biblio, broché, couv. illustrée à rabats, discret C. de bibl. sur la page de faux-titre, bon état
Les Conversations secrètes des Français sous l'Occupation.
Plon, 1993, in-8°, 444 pp, 8 pl. de photos hors texte, chronologie, biblio, 8 documents en fac-similé in fine, chronologie, sources et biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Les archives de l'Occupation réservent encore des surprises de taille. Ainsi le régime de Vichy a-t-il systématiquement ouvert le courrier des Français et écouté leur conversations téléphoniques en mobilisant des milliers de fonctionnaires qui opéraient clandestinement. Ce travail d'espionnage représente aujourd'hui une formidable masse de documents totalement inédits, témoignages exceptionnels sur l'époque la plus trouble de notre histoire nationale. Ces échanges "volés", sélectionnés et resitués dans leur contexte tracent une chronique saisissante des années noires : descriptions de l'exode et de la défaite, récits au jour le jour des mille difficultés de la vie quotidienne, lettres de prisonniers, de travailleurs en Allemagne autant de témoignages d'un pays qui souffre et se plaint. Ces documents interceptés permettent également de mieux comprendre la politique de l'occupant allemand, l'état d'esprit des simples citoyens comme celui des résistants ou des collaborateurs, les étapes de la persécution des Juifs. Des histoires où se mêlent témoignages bouleversants, banalités du quotidien et récits épiques révèlent une France en guerre à la fois inconnue et au plus près de la vérité.
Notes d'un Correspondant de Guerre. 1939-1940, le suicide.
P., Durassié, 1942, in-12, 252 pp, broché, état correct
"Correspondant de guerre, Jacques-Henri Lefebvre se déplace sur la frontière franco-allemande et livre, sous forme de notes d'une ou deux pages, de multiples anecdotes relatives à ce qu'il a vu sur le front et à l'arrière. Chacune d'entre elles est l'occasion d'illustrer la "drôle de guerre" et surtout la Campagne de France. Ancien combattant de 1914-1918, l'auteur dénonce surtout l'attitude des civils, et plus particulièrement de la bourgeoisie et de la classe ouvrière. S'il met en exergue de nombreux actes de bravoure de soldats des Armées de terre et de l'air, il critique aussi les erreurs du commandement, la lourdeur administrative, la politique socialiste de la IIIe République qui constituent autant d'explications de la défaite." (Françoise Passera, « Ecrits de Guerre et d’Occupation » EGO 1939-1945)
Brandenburg Division. Commandos of the Reich.
Histoire & Collections, 2000, in-8°, 333 pp, 16 pl. de photos hors texte, biblio, broché, bon état. Texte en anglais
Lady Mensonges. Mary Lindell, fausse héroïne de la Résistance.
Alma éditeur, 2015, in-8°, 371 pp, biblio et principales sources, broché, couv. illustrée, bon état
Hollywood vit en Mary Lindell une héroïne de la Résistance. Lorsqu'elle mourut, en 1986, le portrait était parfait. L'infirmière anglaise, devenue comtesse de Milleville par son mariage, aurait fait passer en Angleterre des milliers de personnes et pris la tête d'un réseau basé à Ruffec, dans les Charentes, avant d'être arrêtée puis déportée... Histoire trop bien fabriquée, mémoire très sélective. Dès la fin des années 1940, Mary Lindell entreprend de se fabriquer une légende. Alertée par Anise Postel-Vinay – qui fut déportée à Ravensbrück avec Germaine Tillion – la journaliste Marie-Laure Le Foulon décide de mener l'enquête. Elle consulte les archives en France, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Au lieu d'une héroïque comtesse, elle découvre une affabulatrice flanquée d'une bien étrange famille et une déportée dont l'attitude à Ravensbrück pose bien des questions. “Lady Mensonges” démonte, pièce à pièce, l'imposture. Cette plongée dans les années noires met ainsi d'autant mieux en valeur la trajectoire de celles et ceux qui n'ont pas transigé. Et dont on entend ici la voix, à commencer par celle d'Anise Postel-Vinay.
Demain la liberté (1944-1945).
Flammarion, 1993, in-4°, 200 pp, très nombreuses photos, 32 pl. de photos et documents en couleurs hors texte, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
... Et Paris se libéra.
Hachette, 1945, in-12, 188 pp, broché, couv. illustrée, bon état
La Libération de Paris racontée par Georges Le Fèvre (1892-1968), l’historiographe officiel de l’expédition Citroën Centre-Asie (la « Croisière Jaune ») et l'un des fondateurs du prix littéraire Théophraste Renaudot.
Raz de Marée. Visions de guerre.
Éditions Baudinière, s.d. (1942), in-12, 252 pp, broché, traces de scotch en haut et bas du dos, bon état
Souvenirs écrits au lendemain de l'Armistice par Roger Lefèvre (1907-1981), l'ouvrage retrace les dernières heures de la défense de Dunkerque, bataille à laquelle il avait participé. — Roger Lefèvre fut élu député socialiste en 1936. Au congrès de Vichy, le 10 juillet 1940, il vota les pouvoirs constituants au maréchal Pétain. Déchu de ses mandats par le gouvernement de Vichy, Roger Lefevre sollicita un poste à l'Université, qui lui fut refusé, et travailla à une thèse de doctorat sur Descartes, ainsi qu'à des ouvrages sur Condillac, avant de participer à la Résistance... "Ce livre n'est pas un roman. Lieux, dates, personnages, anecdotes, tout est strictement authentique." (Note de l'éditeur) — "Roger Lefèvre raconte l'invasion allemande de mai 1940 alors qu'il stationne avec son régiment d'artillerie à la frontière franco-belge. Il s'attache à décrire sa guerre face à une Armée allemande qui lui semble invincible et à expliquer les raisons de la défaite due, à ses yeux, essentiellement au retard de l'Armée française (en matériel, en stratégie, en tactique). La division dont il fait partie est refoulée vers Dunkerque et se retrouve à défendre la ville sous les bombes. L'auteur réussit à s'embarquer vers l'Angleterre où la population réserve aux soldats un accueil bienveillant. Le temps de quelques jours de repos, il rembarque pour la France où, depuis la Somme, il se replie vers la Normandie. Sa mission consiste à défendre les ponts sur l'Orne. A la suite du message radiophonique du maréchal Pétain du 17 juin 1940, appelant à cesser les combats, les soldats se rendent et sont capturés à Vassy (Calvados). Alors que l'armistice n'est pas encore signé, des milliers de soldats prisonniers sont dirigés vers l'est. Certains tentent de s'évader et y parviennent, tel l'auteur." (Françoise Passera, « Ecrits de Guerre et d’Occupation » EGO 1939-1945)
Calais 1940 : la corde au cou.
Presses de la Cité, 1975 in-8°, 289 pp, préface du général de Cossé-Brissac, 8 pl. de photos hors texte, biblio, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
Au milieu de la défaite de 1940. une lueur d'espoir : Calais. Malgré les Panzers et les Stukas les défenseurs de la ville ne se rendront qu'après épuisement total des moyens. Un livre dense à l'honneur du combattant allié de cette sombre période. — "Ces pages sont un hommage aux défenseurs de Boulogne et de Calais. Les témoignages des différents acteurs de ce drame, français et britanniques, les rapports officiels sur les différentes formations qui ont combattu à Boulogne et à Calais permettent de serrer au plus près la vérité. La progression des troupes allemandes depuis la frontière, les circonstances qui ont amené la percée, la rupture, l'exploitation, la course à la mer et le redressement vers les ports de la Manche et de la mer du Nord y sont évoqués afin de mieux suivre la chronologie des événements vue du côté allemand..."
Chronique de la seconde guerre mondiale.
CHRONIQUE, 1990, in-4°, 789 pp, Editions Chronique 1990, 789p., nombreuses illustrations, in-4, reliure d'éditeur & jaquette (état neuf).
En écoutant Weygand, ou comment M. Churchill écrit l'histoire.
Nouvelles Editions Latines, 1949, in-12, 155 pp, broché, bon état
La Bataille des Frontières ; Pendant le sursis ; La Bataille de France ; Des derniers combats à l'Armistice ; Le sort en est jeté ; L'irréparable malentendu. — François Le Grix (1881-1966) fut directeur de la "Revue hebdomadaire", revue littéraire et politique fondée en 1892 par Fernand Laudet et publiée jusqu'en 1939, homme aux joues fardées et à la perruque cocasse, il fut le « découvreur » de Georges Bernanos et Julien Green. — "Jusqu'à la déclaration de la guerre, François Le Grix reste profondément germanophobe, à la différence de son ami Philippe Henriot qui devient partisan de la réconciliation franco-allemande – il défend les accords de Munich en 1938 –, pro-hitlérien et qui sera, on le sait, un collaborateur actif sous l'Occupation. En juin 1940, François Le Grix conduira sur la route de l'exode la femme et les filles de Jean-Louis Vaudoyer, ainsi que la belle-mère de François Mauriac, jusqu'au refuge de Malagar, maison familiale de celui-ci. Sous l'Occupation, il collaborera – avec Pierre Lafue, Jean Soulairol (1892-1959), le philosophe Jean Daujat (1906-1998) et Emmanuel Beau de Loménie (1896-1974) – à la collection « Hier et demain », publiée par les éditions Sequana de René Julliard. Après la guerre, François Le Grix collaborera aux “Écrits de Paris” et publiera, aux Nouvelles Éditions latines, “En écoutant Weygand” (1949). Il entrera comme lecteur chez Julliard – où il défendra notamment la publication de “Bonjour tristesse” de Françoise Sagan en 1953." (Patricia Sorel, Plon : Le sens de l'histoire (1833-1962), 2016)
Le Maréchal et la France.
Nouvelles Editions Latines, 1994, in-8°, 407 pp, nombreuses photos et fac-similés dans le texte et à pleine page, index, broché, couv. illustrée, soulignures stylo sur 30 pp, bon état
Pétain et les Allemands.
Nouvelles Editions Latines, 1997, in-8°, 459 pp, 36 photos et fac-similés dans le texte, index, broché, couv. illustrée, qqs annotations crayon, bon état
Dans un combat pour défendre la mémoire du maréchal Pétain et demander, conformément au voeu du général de Gaulle et du maréchal Juin, la translation à Verdun de l'illustre soldat inhumé à l'île d'Yeu, l'auteur avait écrit “Pétain, gloire et sacrifice” qui fut couronné en 1991 du Prix des Intellectuels Indépendants. Puis en 1994, il écrivait “Le Maréchal et la France” suivi, en 1995 de “Pétain et les Américains”. Dans le cadre de cette lutte pour réécrire à l'endroit l'histoire de celui qui avait acquis "des titres impérissables à la reconnaissance nationale", paraît en 1997, ce nouvel ouvrage : “Pétain et les Allemands”. Ce livre complète heureusement le précédent, dans la mesure où l'aversion de Pétain à l'égard du militarisme allemand eut pour corollaire l'indéfectible amitié qu'il portait à Pershing et aux combattants américains. Amitié qui ne signifie pas qu'il se serait réjoui de la forme prise, en cette fin de siècle par l'impérialisme américain. A contrario, en ces jours qui marquent la fin des guerres fratricides entre Francs et Germains, son aversion pour les "Boches" le céderait aux sentiments de respect mutuel et d'union qu'il exprimait, dans un voeu formulé devant le maréchal Rundstedt, en mai 1944, alors que la défaite allemande était inéluctable : "Je ne voudrais pas mourir avant d'avoir vu la réconciliation de nos deux peuples. Je veux oublier toutes les guerres ; je ne veux plus connaître que les dates des traités de paix."
Pétain face à l'histoire.
Nouvelles Editions Latines, 2000, in-8°, 286 pp, 21 photos et 37 fac-similés, annexes, index, broché, couv. illustrée, bon état
Pétain, gloire et sacrifice.
Nouvelles Editions Latines, 1991, in-8°, 331 pp, préface de Jean Borotra, 8 pl. de photos et fac-similés hors texte, index, broché, couv. illustrée, bon état (Prix des Intellectuels indépendants, 1991)
"... Je vous soumets mes réflexions sur votre étude. Elle est remarquable par la précision de l'information, la sobriété du style, l'impartialité du jugement..." (Jean Guitton)
Une Bordelaise martyre de la Résistance, Manon Cormier, 1896-1945.
Bordeaux, Impr. de J. Pechade, s.d. (1945), gr. in-8°, 28 pp, un fac-similé de lettre et 4 pl. hors texte (3 photos et une carte), broché, bon état
"« Féministe convaincue », Manon Cormier fonde en 1924 puis préside la section girondine de la Ligue française pour le droit des femmes (LFDF). Devenue chef de bureau au ministère du Ravitaillement le 1er août 1940, elle s'engage dans la Résistance, au Front national et peut-être même aux Francs-tireurs et partisans. Arrêtée le 30 septembre 1943, elle est déportée politique « NN », emprisonnée à Lauban puis le 26 octobre 1944 au camp de Ravensbrück et transférée dans celui de Mauthausen le 7 mars 1945. Elle est libérée le 22 avril mais, épuisée, elle est hospitalisée et décède, non sans avoir pu donner son témoignage à sa sœur." (Bernard Lachaize, Dictionnaire des féministes, 2017)
Mein Kampf. Documents sur Hitler et le Troisième Reich d'après le film d'Erwin Leiser ; adaptation française de Léon Zitrone.
Laffont, 1962, in-12, 199 pp, très nombreuses photos, broché, couv. illustrée, bon état
"Ces photos, tirées du film suédois d'E. Leiser et accompagnées de brefs commentaires, veulent « opposer la réalité nazie à la phraséologie du livre d'Hitler » et faire revivre devant nos yeux l'horreur de l'époque hitlérienne." (Revue française de science politique, 1963) — "Pendant l'été de 1924, interné à la forteresse de Landsberg, après un putsch manqué à Munich, Adolf Hitler commença d'écrire un livre qu'il voulut d'abord intituler : Quatre ans et demi de combat contre le mensonge, la stupidité et la lâcheté. Sur les conseils de Max Amman, directeur des publications nazies, il adopta un titre plus lapidaire : Mon Combat (Mein Kampf). Ce livre contenait la doctrine nationale socialiste, la pensée politique et philosophique d'Hitler, le plan de la conquête du pouvoir en Allemagne et de l'ordre nouveau qui devait être établi en Europe. Mais ni les Allemands – qui, à partir de 1933 en firent leur bible – ni les démocraties européennes ne comprirent ce terrible avertissement. En 1959, un journaliste, Erwin Leiser, rassembla des documents filmés et photographiques, tirés des archives nazies, pour réaliser un film de montage, intitulé, lui aussi, Mein Kampf. Né à Berlin en 1923, émigré plus fard en Suède et naturalisé suédois, Erwin Leiser voulait "que les images et les documents parlent directement à une génération pour qui ce temps sanglant fait déjà partie de l'histoire" et montrer à la jeunesse "que l'avilissement de l'homme par l'homme est le plus grand crime qui soit". Le film Mein Kampf a donc toute la rigueur d'un documentaire dans lequel aucun moment de vérité n'a été interprété ou reconstitué (le commentaire sobre et précis de la version française est de Léon Zitrone). Il part de la guerre de rues à Berlin, en 1945, pour suivre, ensuite, par un retour en arrière, le déroulement chronologique des événements (causes et conséquences) qui ont conduit Hitler à la dictature de l'Allemagne et à la guerre. C'est le contenu du livre vérifié par des faits irréfutables : les "actualités" allemandes. Dans les quelque 200.000 mètres de pellicule qu'il avait à sa disposition, Erwin Leiser a fait une sélection intelligente et didactique. Mais il a conservé intégralement un film tourné dans le ghetto de Varsovie par les services de propagande antisémite du gauleiter de la Pologne, Hans Frank. Ce long morceau d'horreur, loin de détruire l'équilibre du montage, en renforce le propos historique. Cela, que nous ne pouvions imaginer, cela est réellement arrivé, de par la volonté d'un homme et de ceux qui ont agi en son nom..." (Jacques Siclier, Le Monde)
J'avais vingt ans. Souvenirs de ma vie de soldat (1940-1948).
Editions Pour Mémoire, 1999, in-8°, 98 pp, 4 pl. de photos hors texte, broché, qqs rares annotations crayon, bon état. Peu courant
Souvenirs de Michel Lemaignan (1921-2011), responsable national de la JEC (1940-1942), officier d’active de cavalerie (1942-1948) ; ingénieur (1948-1982) ; président de l’Association des cadres et dirigeants de l’industrie pour le progrès social et économique ; résistant. En juillet 1942, il rejoignit l’école de cavalerie de Saumur, qui ferma en novembre suivant, suite à l’invasion de la zone libre par la Wehrmacht. Après quelques mois d’incertitudes, il partit pour l’Afrique du Nord où il prit le commandement d’un régiment de cavalerie en septembre 1942. Il participa aux campagnes d’Italie, de France et d’Allemagne. Cette expérience lui valut la Croix de guerre et la Médaille des évadés. À l’issue du conflit, il servit encore la France deux ans, de juillet 1945 à avril 1947, comme agent du contre-espionnage à Berlin. Puis il gagna l’école de haute-montagne de Chamonix et – une fois diplômé – fut chargé de monter un centre d’instruction annexe à Cauterets, dans les Pyrénées. Il n’y resta que quelques mois, devenant, de janvier à juin 1948, l’aide de camp du général Augustin Guillaume, alors adjoint de l’inspecteur général de l’armée Jean de Lattre de Tassigny. (Maitron)
Erwin Rommel.
GLM/Perrin, 2009, gr. in-8°, 518 pp, 10 cartes, biblio, index, reliure souple illustrée de l'éditeur, bon état
Erwin Rommel est le plus connu des généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale. Plus de soixante ans après sa mort, il personnifie encore le soldat allemand exemplaire, qui inspire le respect aussi bien pour sa formidable maîtrise de l'art de la guerre que pour s'être montré réservé avec le régime nazi. Or, à la lumière des archives et notamment des correspondances privées de Rommel, comme des rapports officiels, Benoît Lemay remet en question cette image apologétique. En réalité, Rommel a été un partisan convaincu du Führer qui lui est resté fidèle jusqu'à la fin et sa gloire est redevable en partie à la propagande nazie qui en a fait un "dieu de la guerre" issu du peuple. Mais cela n'aurait pas suffi à faire du "Renard du désert" un héros capable d'inspirer Hollywood : l'adversaire britannique a contribué presque autant à la fabrication du "mythe Rommel". C'est l'histoire paradoxale d'un soldat d'exception au service d'un régime criminel que raconte ce livre.
Aventures et Mésaventures.
Tours, Editions J. L., 2001 gr. in-8°, 251 pp, 9 photos sur 7 pl. hors texte, 9 photos dans le texte, broché, couv. illustrée, trace de pli sur la couv., bon état, envoi a.s.
L'Homme de l'ombre. Georges Albertini, 1911-1983.
Balland, 1989, in-8°, 264 pp, biblio, chronologie, index, broché, une photo d'Albertini en couv., bon état
Chef de cabinet de Marcel Déat, collaborateur notoire, Georges Albertini refusa catégoriquement, à la Libération, malgré la gravité des faits qui pourraient lui être reprochés, de quitter Paris et de se joindre aux émigrés de Sigmaringen. Ce qui en dit long sur sa personnalité. Ancien socialiste, pacifiste convaincu cet homme fluet avait toujours eu un goût particulier pour noter et archiver toutes ses rencontres. Déjà à l'époque, chacun s'interrogea sur le sort des fameux “papiers” d'Albertini, brûlés selon ses amis, pieusement conservés selon certains. Est-ce pour cela qu'il bénéficia, lors de son procès, d'une extrême clémence : cinq ans de travaux forcés alors que d'autres subirent le peloton d'exécution ? Sa peine purgée, il participe alors à toutes les croisades anti-communistes et fonde avec Boris Souvarine les célèbres cahiers Ouest-Est. Réduit au silence en raison de ses activités sous l'Occupation, il n'en devient pas moins l'éminence grise, très appréciée, d'hommes d'Etat aussi différents que Vincent Auriol, Edgar Faure, Guy Mollet et Georges Pompidou. Il ne manque pas ensuite d'influencer certains éléments de la nouvelle classe politique française : Marie-France Garaud, Jacques Chirac, Alain Madelin, etc. Et là commence la légende de cet homme de l'ombre.
Sédentaires, Réfractaires et Maquisards. L'Armée secrète en Haute-Corrèze, 1942-1944.
Ussel, Association Amicale des Maquis de Haute-Corrèze, 1977, in-8°, 509 pp, 24 pl. de portraits et photos hors texte, qqs cartes, broché, 2e plat lég. sali, bon état
"Dans l’histoire de la Résistance en France, le développement des maquis et leur rôle dans la lutte armée contre l’occupant allemand et ses auxiliaires de Vichy ont certainement constitué la page la plus glorieuse. Mais si la mémoire a surtout retenu comme illustration du phénomène le maquis des Glières en Haute-Savoie ou celui du Vercors en Isère, le département de la Corrèze fut indéniablement l’endroit en France où les maquis connurent leur développement le plus important et menèrent les opérations armées les plus précoces et les plus spectaculaires. Il n’y eut pas ici de grand maquis mobilisateur, comme les maquis alpins ou celui du mont Mouchet en Auvergne, mais une multitude de petits camps disséminés dans les forêts et les zones de moyenne montagne. Au total, les statistiques officielles établies par le service historique de l’armée de terre ont ainsi recensé 71 emplacements de camps de maquisards dans l’ensemble du département pour la seule Armée secrète (AS, d’obédience gaulliste)..." (Fabrice Grenard, “Tulle. Enquête sur un massacre. 9 juin 1944”, 2014)
Forteresse Escaut. Novembre 1944 : le dernier débarquement des Bérets verts.
Albin Michel, 1994, in-8°, 190 pp, 8 pl. de photos hors texte, 4 cartes, biblio, broché, état correct
 Write to the booksellers
Write to the booksellers