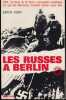Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
20th (1487)
21st (248)
-
Syndicate
ILAB (1740)
SLAM (1740)
Vie et mort d'un officier. Claus von Stauffenberg, 15 novembre 1907 - 20 juillet 1944.
Fayard, 1966, in-8°, 238 pp, 8 pl. de photos hors texte, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Claus Philip Maria Schenk, comte von Stauffenberg était colonel dans la Wehrmacht. Il est la figure centrale d'une tentative de coup d'Etat militaire, le 20 juillet 1944, contre le régime nazi. Stauffenberg était un patriote conservateur, sympathisant avec les aspects nationalistes et militaires du nazisme, avant de trouver des considérations patriotiques et morales à la résistance active. Il fut exécuté le soir du 20 juillet 1944 pour sa participation à l'attentat manqué contre Hitler. — "... L'homme qui peut-être comprit le mieux la monstruosité du régime fut Stauffenberg, et c'est pourquoi il se fixa la tâche à peu près impossible d'organiser la résistance. Sa biographie vient de nous être à nouveau contée par un ouvrage qui se distingue par une abondante documentation, écrite et orale, et une méfiance sympathique pour toute hagiographie. Mais, les papiers du héros ayant disparu, tout ce que l'historien consciencieux peut faire est de le présenter dans sa simplicité, de corriger certaines hypothèses un peu aventurées (comme celle d'une influence capitale de Stefan George sur le jeune homme), ou encore de prendre parti sur la question si controversée des contacts que Stauffenberg aurait souhaité prendre avec l'URSS : il ne semble pas, finalement, que sa position ait été fondamentalement différente de l'anticommunisme de ses amis." (Pierre Ayçoberry, Annales ESC, 1969)
La Prise de conscience de la nation autrichienne. Tome I : 1938-1945. (Thèse).
PUF, 1980, gr. in-8°, 482 pp, broché, jaquette illustrée, bon état
Tome I seul (sur 2) contenant les 1ère et 2ème parties : 1. Anschluss et désintégration de l'Autriche (février 1938 - septembre 1939) ; 2. Un pays sans nom sous la guerre (1939-1945) : L'Autriche sous le commissaire du Reich, La résistance intérieure et ses motivations, les exilés... Le tome II contient la 3ème partie qui traite de la nation autrichienne de 1945 à 1978.
Oradour-sur-Glane.
Fayard, 1975, in-8°, 185 pp, broché, couv. à rabats, bon état
La première partie du livre est consacrée au massacre. Mais le drame n'est pas fini. Huit ans et demi plus tard, on juge les coupables, c'est-à-dire ceux qui restent ou qu'on a pu arrêter. Et, chose terrible, on découvre que ce sont presque tous des Alsaciens, des hommes qui, souvent, avaient combattu dans les rangs de l'armée française en 1940, puis avaient été mobilisés de force par les Allemands et versés immédiatement dans les S.S. Dans le prétoire, dans la presse, les passions s'affrontent...
Ma carrière à l'Etat-Major soviétique.
Dominique Wapler, 1949, in-8°, 252 pp, traduction de Stepan Makhloff et Serge Maffert, broché, bon état
Les faux mémoires de guerre d'un colonel soviétique inventé, Ivan Nikitich Krylov, imaginés par le faussaire Gregori Bessedovsky, qui a commis également le livre "Les maréchaux Soviétiques vous parlent" (1950). Ces livres ont à l'époque abusé les principaux services de renseignement occidentaux. Même Boris Souvarine et d'autres experts avaient écrit que "Ma carrière à l'Etat-Major soviétique", contenait "des informations précises sur la formation, ce qui en fait un document historique intéressant" (B.E.I.P.I. - Bulletin d'études et d'informations politiques internationales n° 22, 1950) — "Signalons, avec toutes les réserves qu'appelle ce genre littéraire, la confession d'Ivan Krylov : Ma carrière à l'Etat-Major soviétique." (Roger Portal, Revue des études slaves, 1950)
Les Russes à Berlin.
Laffont, 1967, gr. in-8°, 383 pp, traduit de l'allemand, 12 pl. de photos hors texte, un plan du bunker de Hitler, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
"1945 : la chute du IIIe Reich, l'occupation soviétique. Ce que les Allemands n'avaient jamais voulu dire." — "Les débats qui se poursuivent depuis plus de vingt ans sur les derniers mois de la guerre en Allemagne, sur la prise et l'occupation de Berlin, ont amené Erich Kuby à reconstituer l'atmosphère dans la capitale du Reich où, selon lui, l'Armée rouge aurait pu entrer dès février 1945, les hitlériens ont fini dans l'anarchie la plus lamentable et les vainqueurs ont eu envers la population une attitude moins brutale que ne l'a affirmé la propagande antisoviétique ; son livre, qui date de 1965, vient d'être traduit en français." (Revue des Études Slaves, 1968)
Jankele est toujours vivant.
Grasset, 1985, in-8°, 296 pp, traduit de l'américain (“Child of the Holocaust”), broché, couv. illustrée, bon état, ex. du SP
"La nuit dernière les Allemands sont venus et ont emmené tous les Juifs." Par ces mots s'ouvre le cauchemar d'un petit garçon, Juif polonais de neuf ans, Jankele Kuperblum. En une nuit, il perd toute sa famille, se retrouve seul, fuyant de refuge en refuge, persécuté par les adultes dont il ne comprend pas l'acharnement. Avide d'amour encore plus que de pain, il est prêt à trahir sa race et sa foi pour être accepté par ceux qui le pourchassent. Mais on ne change pas ainsi de peau et d'âme, et Jankele l'apprendra cruellement à ses dépens au cours de quatre années de guerre. Ce témoignage authentique a été écrit par la seule personne qui pouvait le faire : Jankele Kuperblum, devenu citoyen canadien sous le nom de Jack Kuper. Sa victoire sur la mort et celle, miraculeuse, de l'innocence sur la haine. — "Jankele, enfant juif polonais, voit en une nuit toute sa famille emmenée par les Nazis. Perdu dans une Pologne rurale profondément antisémite, Il va errer, se cacher et chercher de difficiles et précaires refuges. Petit garçon abandonné, Jankele cherche autant à se faire aimer et accepter qu'à survivre. Au bout de quatre ans de guerre, Il aura effectivement survécu, mais au prix du reniement de ses onglnes et d'une pseudo intégration au monde polonais." (Lectures, juillet-août 1985)
La Mascotte.
Les Editions Noir Sur Blanc, 2008, gr. in-8°, 443 pp, traduit de l'anglais, 16 pl. de photos hors texte, broché, couv. illustrée, bon état
Alex Kurzem, un Australien moyen d'une soixantaine d'années, ne se sépare jamais d'une vieille mallette en cuir. Il décide un jour de l'ouvrir pour son fils, historien, et, à l'aide des photos et documents qu'elle contient, il lui raconte enfin le drame de son enfance. Par bribes, se désolant des lacunes de sa mémoire, il dévoile l'une des histoires les plus singulières de la Seconde Guerre mondiale : comment un enfant juif de sept ans est devenu la mascotte des nazis. Avec la patience d'un chercheur, mais aussi avec la ferveur d'un fils, Mark Kurzem va retrouver les pièces manquantes, réordonner les événements, identifier les lieux et les acteurs. Ce livre retrace à la fois l'histoire vécue et le chemin de l'enquête, mêlant la voix irremplaçable du survivant au récit d'un historien. Octobre 1941, la Shoah par balles ensanglante la Biélorussie. Caché dans un arbre, l'enfant de cinq ans voit périr sa famille. Sans grand espoir, il s'enfonce dans la forêt glaciale. Lorsqu'il sera découvert, à bout de forces, par des SS lettons, il apprendra à leur cacher qu'il est juif. Très vite, le régiment ira jusqu'à le déguiser d'un uniforme miniature de caporal SS. Malgré son jeune âge, Alex est déchiré entre la conscience du mal auquel il assiste et sa volonté de survivre. "J'étais un animal de compagnie qu'on dressait", explique-t-il à son fils. Les soldats lettons l'ont sauvé de la forêt. Ils lui ont aussi volé son enfance et son identité.
La course pour Rome. Comment la ville éternelle fut sauvée de la destruction nazie.
Elsevier Sequoia, 1977, in-8°, 323 pp, traduit de l'américain, 16 pl. de photos hors texte, 6 cartes, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Le 25 juillet 1943, Benito Mussolini est renversé ; le 4 juin 1944, quarante-huit heures avant le "Jour J", les Alliés libèrent la Ville éternelle. Entre ces deux événements, Rome a vécu sous la terreur de l'occupation nazie... et les plus sordides spéculations des parties engagées dans sa défense. En ce printemps 1944, Rome est une ville blessée, meurtrie, dont les habitants, surtout la communauté juive, connaissent à leur tour persécutions, sévices et répressions – pour avoir "trahi" le Troisième Reich. Dans l'ombre de la Résistance, les communistes préparent la "libération" et la prise du pouvoir. Rome pleure et veut venger les 335 morts de la fosse Ardéatine... Sur les lignes de front, au sud de la ville, cinq nations – au moins – s'affrontent pour "sauver" la métropole de la chrétienté. Les chefs d'état-major alliés, chacun dévoré par le désir – ardent – de franchir le premier l'enceinte de la Ville éternelle, s'efforcent avant tout de servir leur ambition personnelle... Rome devient dès lors le trophée d'une course effrénée, cruelle et impitoyable, qui met aux prises, face à l'occupant nazi, Anglais, Français, Américains, Polonais et Partisans, souvent prêts à sacrifier la ville et ses habitants à leur propre raison. A partir de milliers de documents et d'archives – la plupart exhumés pour la première fois – et de centaines d'interviews des acteurs de ce tragique "drame romain", Dan Kurzman recrée, en un récit bouleversant et captivant, l'atmosphère de ces longs mois de lutte, et nous fait revivre tous les héros de la liberazione : un pape intolérant, un roi sans trône, un général déçu, un rabbin désavoué, des prêtres généreux, des partisans désunis, des hommes d'Etat orgueilleux et, enfin, le peuple de Rome... qui a écrit de son sang une page de l'Histoire dont la réalité vécue restait insoupçonnée.
Hervé de Blignières. Un combattant dans les tourmentes du siècle.
Albin Michel, 1990, gr. in-8°, 341 pp, 16 pl. de photos hors texte, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Un ouvrage consacré à Hervé de Blignières, saint-cyrien de la promotion du maréchal Lyautey, officier de cavalerie ayant chargé des chars en 1940, prisonnier aux nombreuses tentatives d'évasion, ancien combattant d'Indochine et d'Algérie, chef de corps du 1er R.E.C. (1958-1960), « chef d'état-major de l'OAS en France » et catholique à la foi profonde. — "Mai 1940... Quatre-vingts cavaliers du 31e Dragons foncent dans les plaines de Belgique sous les ordres du lieutenant de Blignières. Les Panzerdivisions , à quelques kilomètres de là, ont déjà réussi leur formidable percée. Le lieutenant de Blignières lance alors à ses hommes cet ordre qui résume la situation tragique des soldats de 40 : « Messieurs, serrez vos gourmettes, nous allons avoir l'honneur de charger ! » Septembre 1961... Le ministre de l'Intérieur annonce la capture du colonel de Blignières, « chef d'état-major de l'OAS en France » et « plaque tournante » de toute l'organisation... Entre ces deux dates, il y avait eu les cinq années de captivité en Allemagne, marquées par sept tentatives d'évasion, la Légion, l'épopée indochinoise, la refonte des études de l'Ecole de Guerre, la pacification du Constantinois, dix décorations, deux blessures, six citations... De cette aventure humaine exceptionnelle dont Hugues Kéraly nous donne le récit, nul mieux que ceux qui ont connu le colonel de Blignières ne pouvait fixer les vraies dimensions..." (4e de couverture)
Les Places étaient chères.
La Table Ronde, 1969, in-8°, 587 pp, broché, couv. illustrée, bon état
Réédition d'un ouvrage devenu pratiquement introuvable. Le sergent Labat, qui fut engagé volontaire dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme (LVF), relate ses souvenirs du front de l'Est au cours de la dernière guerre mondiale.
Le chagrin et le venin. La France sous l'Occupation, mémoire et idées reçues.
Bayard, 2011, in-8°, 355 pp, index, broché, couv. illustrée à rabats, soulignures stylo, bon état
Le chagrin et le venin, c'est ce qu'il reste aujourd'hui d'une vision de l'Occupation et de la Résistance qui s'est largement mise en place dans les années 1970, particulièrement avec le film de Marcel Ophuls, “Le Chagrin et la Pitié”. Depuis lors, la vision de la France occupée, à la télévision comme dans les ouvrages d'historiens reconnus, est celle d'un pays immobile, préoccupé dans sa grande majorité de durer, replié dans un attentisme marqué par l'opportunisme, des arrangements consentants, voire une indifférence coupable aux minorités persécutées, avec à ses marges deux minorités décrétées équivalentes, les résistants (confondus avec les seuls maquisards) et les collaborateurs. Etonnante vision qui fut dès la fin de la guerre forgée et propagée par les hussards en défense des collaborateurs traduits en justice. Pierre Laborie, l'un des meilleurs spécialistes de la France des années noires, retrace la genèse de cette vision dans un ouvrage qui se révèle être la réflexion la plus acérée sur la France occupée, les usages de plus en plus dominants qui sont faits de cette période et son instrumentalisation pour les besoins d'un présent tenaillé par l'immédiat.
L'Opinion française sous Vichy.
Seuil, 1990, in-8°, 405 pp, repères chronologiques, sources et biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. L'Univers historique)
"Pour l'historien, le véritable enjeu est toujours de chercher à comprendre pourquoi la France a pu, sinon se coucher, du moins se laisser entraîner dans la spirale de la concession ; comment, au bout de quelle usure, de quelle fatigue, de quelle désespérance, de quelle humiliation, de quels désenchantements, de quelles incompréhensions, de quels aveuglements, de quelles attentes, de quelles illusions, de quels rêves de futur, elle a pu s'enliser dans cette culture de la défaite et du renoncement." Pierre Laborie, pour répondre à ces questions, donnait à l'historiographie de la France de Vichy un maître livre qui refusait d'enfermer les Français et leurs opinions dans une typologie convenue, préférant interroger les représentations et les imaginaires d'une nation soumise depuis le drame de 1914 à une des plus graves crises d'identité de son histoire. — "L'auteur de “Résistants vichyssois et autres. L'évolution de l'opinion et des comportements dans le Lot de 1939 à 1944” (Paris, Editions du CNRS, 1980, 395 p.), étend son enquête avec les mêmes qualités et atouts, mais en l'enracinant dans les années trente. Le processus de détachement vis-à-vis de Pétain apparaît antérieur à 1942, ce qui ne préjuge pas d'une attitude hostile envers les maquis et la résistance intérieure." (Choix des Annales, Annales ESC, 1990) — "C'est avec un regard d'historien que Vichy se trouve ici revisité – mais d'historien spécialiste de l'opinion publique. L'originalité du livre tient d'abord à la méthode. Il s'attache non seulement à reconstituer et à décrire les aspects dominants du mouvement général des esprits au cours des "années noires", mais il s'efforce, pour les expliquer, d'élucider les mécanismes qui commandent le fonctionnement de l'opinion. A cet effet, l'auteur s'appuie sur l'analyse des systèmes de représentations mentales à travers lesquels l'opinion appréhende la "réalité" des faits et l'interprète. C'est à partir de ces perceptions et des réseaux complexes de leur croisement que Pierre Laborie cherche à retrouver les facteurs multiples qui structurent en profondeur l'imaginaire social, qu'il cherche, au-delà des signes apparents, à discerner et à mettre en évidence les logiques de pensées qui, consciemment ou non, influencent les comportements et les font évoluer. "40 millions de pétainistes" en 1940 ? A voir ! Un certain nombre d'idées reçues – dont celle d'un opportunisme sommaire calqué sur le déroulement des événements extérieurs – sont démontées dans cet ouvrage, qui est aussi un traité de méthode."
L'Escadre Invisible. Ceux du Bombardement de nuit.
Toulouse et P., Editions Chantal, 1943, pt in-8°, 219 pp, 11 pl. de photos hors texte, reliure demi-chagrin bleu-nuit, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres dorés, couv. conservées (rel. de l'époque), dos uniformément passé, bon état. Peu courant
Dédié aux anciens du Groupe 2-34, le livre retrace la vie quotidienne du Groupement de Bombardement n° 9 du 10 mai à sa dissolution le 24 août 1940. — "Pour ne pas changer, le Commandant de Laubier décollera à la tête de ses équipages, à bord de l'avion Amiot 143, n° 56. Le n° 118, son avion habituel étant indisponible par suite du changement de son empennage." (p. 45)
Le Drame du Pacifique.
Payot, 1943, in-8°, 334 pp, 16 cartes dans le texte, broché, couv. lég. salie, bon état (Coll. de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire militaire)
"M. René La Bruyère a fait partie, au début de ce siècle, de la Station navale du Pacifique et il a rapporté de ce séjour les nombreuses considérations nautiques, climatiques, météorologiques, économiques et les notations pittoresques qui forment, avec d'imposantes statistiques, la partie la plus vivante de son livre. A cet égard, celui-ci constitue une mine de renseignements pas toujours très accessibles ailleurs. Mais l'exposé des opérations qui se déroulèrent de décembre 1941 à juin 1942 pour la conquête de l'Indonésie et l'encerclement de l'Australie apparaît un peu prématuré et fondé sur des renseignements encore fragmentaires. Encore plus prématuré peut paraître, en 1942, tout plan visant à « amener les peuples vers la conception de la Grande Asie » (in fine, p. 318), dont les Français d'Indochine ont fait les frais, et auquel ont échappé de justesse, en 1940-1942, ceux du Pacifique..." (Jean-Paul Faivre, Journal de la Société des océanistes, 1945)
Nouvelles vérités sur les Combattants. Nouveaux récits des grandes batailles de mai et juin 1940. Documentation de Pierre Léty.
Lyon, Lardanchet, 1941, in-12, 118 pp, 6 cartes, index des unités citées, broché, bon état (Les Documents historiques, II)
Jean Labusquière (1895-1941) a écrit deux livres, “Vérité sur les Combattants”, puis “Nouvelles vérités sur les Combattants”, afin de corriger, en 1941, la légende noire d'une Armée française déshonorée par la défaite. Cet ami de Louis Jouvet et d’Edouard Bourdet, collaborateur de Paul Poiret puis collaborateur pendant près de vingt ans de Jeanne Lanvin, était une figure de la couture parisienne. Combattant des deux guerres, il disparut le 12 novembre 1941 dans l’accident d’avion du général Charles Huntziger, commandant en chef des forces terrestres et ministre secrétaire d’Etat à la guerre. Capitaine de réserve, Jean Labusquière était alors chef du cabinet civil du général Huntziger.
Les Volontaires de l'aube.
Editions du Félin, 1999, gr. in-8°, 334 pp, biblio, broché, bon état (Coll. Résistance, Liberté, Mémoire)
Quelle était la motivation des premiers volontaires qui ont rejoint la France libre, en 1940-1942, souvent au péril de leur vie, rompant sans ambiguïté avec leur vie familiale et professionnelle ? Comment ont-ils réalisé ce ralliement, dans des conditions aventureuses parfois rocambolesques ou tragiques, se regroupant autour du général de Gaulle, en vue de continuer le combat pour la liberté ? Les Volontaires de l'aube s'efforce de rapporter la grande variété des circonstances dans lesquelles les premiers Français libres ont affirmé leur engagement et le rejet du gouvernement qui avait signé les armistices de juin 1940. Certains résistants sont devenus célèbres, d'autres ont rejoint le cortège des héros anonymes. Cet ouvrage honore la mémoire de leur lutte contre la barbarie nazie et la collaboration française.
L'Ambulance chirurgicale N°. Dunkerque, Mai-Juin 1940.
Arthaud, 1945, in-12, 171 pp, broché, bon état
Le docteur Lacaux est en 1940 le chef d'une Ambulance chirurgicale qui monte en Belgique à la suite de son corps d'armée. Avant même d'avoir pu fonctionner, elle est obligée de se replier sur Dunkerque. Elle s'arrête au sanatorium de Zuydcoote. Elle y vit des jours terribles, puis c'est le repli sur Rosendaël et l'embarquement sous le bombardement. Le livre, écrit en captivité par le Dr Lacaux d'après ses notes, fait revivre les heures terribles du drame des Flandres
Nazisme et Seconde Guerre mondiale dans le cinéma d'espionnage.
Henri Veyrier, 1983, gr. in-8°, 278 pp, 32 pl. de photos hors texte, lexique, index, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
Une étude du cinéma d'espionnage comme reflet du climat et des événements d'une époque. ,;Sommaire : Errol Flynn, espion nazi ? ; 1ere partie : Espionnage et Propagande ; 2ème partie : Espionnage et Vulgarisation ; lexique des abréviations ; index des films cités ; index des noms cités.
Un déporté comme un autre, 1943-1945.
SPID, 1946, in-12, 286 pp, 8 plans, index, broché, bon état, bande éditeur conservée. Rare
"Réfractaire au Service du travail obligatoire, Michel Lacour-Gayet [le fils de Jacques Lacour-Gayet] est arrêté par la Gestapo le 5 septembre 1943 à Paris alors qu'il s'apprête à gagner l'Espagne clandestinement. Emmené rue des Saussaies pour y être interrogé, il ne tente pas de cacher la vérité sur ses intentions et se retrouve emprisonné à Fresnes. Décrite avec forces détail, la rudesse de la vie carcérale qu'il découvre ne l'empêche pas de connaître des instants de « gaieté » (85) au contact de deux jeunes hommes de son âge avec qui il se lie d'amitié. Conduit le 16 novembre 1943 au camp de Royallieu, il en est brutalement extrait au début du mois de décembre et dirigé vers la caserne de la rue de la Pépinière, centre de rassemblement pour les départs des travailleurs en Allemagne. Michel Lacour-Gayet se résigne alors à accepter la proposition qui lui est faite de partir travailler en Allemagne dans le cadre du STO, profitant des trois jours de liberté qui lui sont octroyés afin de fêter Noël avec ses parents. Et pourtant, de retour rue de la Pépinière le 27 décembre 1943, il se voit interné sans explication à la prison du Cherche-Midi puis réintègre le camp de Royallieu le 3 janvier 1944. Le 20 du même mois débute un atroce voyage en wagons à bestiaux qui s'achève à Buchenwald. Placé en quarantaine, Michel Lacour-Gayet découvre avec effarement le fonctionnement du système concentrationnaire qu'il expose avec un soin méticuleux. Tombé gravement malade, il parvient à se rétablir puis est affecté à de durs travaux de terrassement. Tentant un jour d'échapper à ce harassant travail, il est découvert par un kapo russe qui l'inscrit pour un départ en kommando. Il parvient le 4 avril 1944 au camp de Hadmersleben qu'il décrit avec un regard quasi clinique. Le sort des déportés belges et français y est terrible : ils sont maltraités par les déportés russes et polonais qui usent d'une violence égalant celle des kapos et des SS. L’auteur peut heureusement compter sur quelques camarades avec qui il travaille à la transformation d'une mine de sel en usine d'aviation. Son sort s'améliore quelque peu lorsqu'il est affecté dans la dite usine où il côtoie des civils allemands qui l'informent des avancées de l'armée Rouge et lui donnent parfois des cigarettes ou de la nourriture. Le 10 avril 1945, les déportés du camp de Hadmersleben sont évacués à pied et embarqués quatre jours plus tard sur des péniches naviguant sur l'Elbe, sans but apparent. Le 8 mai 1945, les déportés se réveillent pour constater l'absence de leurs gardiens. Michel Lacour-Gayet retrace à partir de cette date son itinéraire, en le retranscrivant tel quel, d’après les notes prises au jour le jour sur un carnet déniché par hasard. Se trouvant dans la zone soviétique, lui et ses camarades parviennent par leurs propres moyens à gagner la zone américaine et la ville de Pilsen d'où un avion les rapatrie vers la France, le 28 mai 1945." (Manuel Valls-Vicente, « Ecrits de Guerre et d’Occupation » EGO 1939-1945)
Le Témoignage est un combat. Une biographie de Germaine Tillion.
Seuil, 2000, gr. in-8°, 340 pp, broché, couv. illustrée, bon état
Parce que le siécle qui s'achève fut plus qu'aucun autre lardé de crimes collectifs, il lui faut des témoins. Et parce que l'imposture, soudée au crime, lui a survécu, il importe que ces témoins soient, par l'expérience, la culture, le désintéressement et le courage, dignes de foi. En voici un, qui étudie depuis bientôt 93 ans les fureurs du temps, en éprouve sur elle les effets, et sait, de chaque épreuve affrontée, nourrir ses analyses du mal à venir. Des vices du régime colonial aux horreurs du système concentrationnaire, et de la pratique de la torture à l'usage du terrorisme ou de l'esclavage, elle a su éclairer l'une par l'autre les atteintes faites au genre humain, et créer une science de l'épreuve. C'est pourquoi Jean Lacouture, qui la connaît, l'interroge et l'admire depuis plus de 40 ans, a voulu écrire la vie de Germaine Tillion, ethnographe, résistante de 1940, déportée à Ravensbrück, sociologue du nazisme, interlocutrice des combattants algériens, ennemie de la torture, avocate de l'émancipation de la femme méditerranéenne – vie qui manifeste à grands périls courus que tout témoignage est un combat, avec l'autre et pour l'Autre.
Mai 1940, la Bataille des Flandres. Mémoires d'un combattant.
Presses des Oeuvres Littéraires, 1977, pt in-8°, 187 pp, 4 pl. de photos hors texte, 2 cartes, broché, couv. illustrée, état correct
"Récit authentique et vécu d'un combattant de première ligne au début de la deuxième guerre mondiale".
Fantassin de Gascogne. De mon jardin à la Marne et au Danube. (Mémoires).
Flammarion, 1962, in-12, 315 pp, 4 cartes, broché, qqs soul. stylo, bon état
Mémoires du général Laffargue de 1911 à 1945 : la Grande Guerre en Lorraine et Artois, l'entre-deux-guerres dans l'Etat-Major du général Weygand (il décrit les manœuvres ourdies contre ce général par les milieux politiques de gauche), la campagne de 1940, la Résistance, le procès Pétain (ou il témoigna en faveur de l'innocence de l'accusé). — "Saint-Cyrien, Gascon, le général Laffargue égrène ses souvenirs. Ils vont de 1914 où, jeune lieutenant élevé dans le culte de la Revanche, il part à l'assaut à la tête de sa section à Morhange, jusqu'aux lendemains de la 2e guerre mondiale. Entre- temps, il a servi dans les états-majors de Joffre, de Weygand et de De Lattre, il a siégé au Conseil Supérieur de la Guerre et a occupé des postes administratifs importants au ministère. Sans être lui-même un personnage de tout premier plan, il a connu bon nombre de personnalités, dont il dresse le portrait vivant, contrasté : d'un côté les « bons », Joffre, Foch, Weygand, Pétain, de l'autre, les « mauvais », Gamelin, de Gaulle, et la plupart des hommes politiques. Son témoignage est, pour l'historien, révélateur d'un état d'esprit, celui du militaire fougueux, spontané, sans nuances, qui ne voit que machiavélisme inavouable et passions viles dans les jeux de la politique, et attribue le désarmement de la France devant l'Allemagne hitlérienne à « une machination contre la Défense nationale, ourdie au sein même du Cabinet du ministre », et qui qualifie le procès de Pétain de « vengeance d'eunuque »." (J.-M. d'Hoop, Revue Historique, 1964)
Ceux qui vivent.
Les Editeurs Français Réunis, 1958, in-12, 380 pp, broché, bon état
"Ouvrier de formation, adhérent du Parti communiste depuis 1933, Jean Laffitte (1910-2004) est secrétaire politique de Jacques Duclos jusqu'en 1939. Prisonnier de guerre, il s'évade en novembre 1940 et participe activement au développement du Front national et des FTP, en région parisienne puis pour l'ensemble de la zone occupée. Arrêté le 14 mai 1942 à Saint-Mandé par la police française, il est interné à la prison de la Santé, à Fresnes et au fort de Romainville, d'où il est déporté le 27 mars 1943 en direction de Trèves dans un petit convoi d'ex-otages, en compagnie des membres du groupe "Valmy". Il est transféré trois jours plus tard à Mauthausen où il est soumis pendant plusieurs mois à des expériences alimentaires. Transféré le 9 mars 1944 à Ebensee, il y devient le responsable de l'organisation clandestine française. Libéré le 6 mai 1945 par les troupes américaines, il rentre en France le 24 mai suivant. Jean Laffitte témoignage de son expérience de déporté dans “Ceux qui vivent”, parus en 1947." (EGO 39-45. Ecrits de Guerre et d’Occupation)
39-45, une guerre inconnue.
Flammarion, 1995, gr. in-8°, 640 pp, 15 cartes hors texte, biblio, index, broché, couv. illustrée, signet, bon état
Ce livre est une exploration des choix stratégiques faits par les deux camps à chaque étape de la guerre. Elle conduit à de nouveaux éclairages qui surprendront et parfois stupéfieront de nombreux lecteurs, sur quelques-uns des événements principaux des années 1939-1945 : les projets franco-anglais de guerre contre l'Union soviétique en 1940, les pressions et manœuvres des dirigeants britanniques partisans d'un arrangement avec l'Allemagne, la fascination exclusive que la guerre à l'Est exerçait sur Hitler. Mais aussi la mise en échec par Roosevelt des négociations avec le Japon, l'engrenage qui conduisit les Alliés à retarder le débarquement en France jusqu'en 1944, les fautes de commandement qui les empêchèrent de gagner la guerre cette année-là... Ceux qui pensaient qu'il n'y avait plus rien à apprendre sur le second conflit mondial seront heureusement détrompés : en dépit des milliers d'ouvrages et de témoignages déjà parus, mais surtout grâce à l'ouverture des différentes archives dans tous les pays, il est enfin possible de procéder à une relecture complète et critique de cette guerre, dont on pourrait croire, au fond, qu'elle était inconnue... — "Cette guerre qu'on croyait connue, elle nous était en fait inconnue. On sait gré à P.-M. de la Gorce de nous offrir cette fresque de la seconde guerre mondiale dans sa globalité, militaire avant tout. Avec une maîtrise totale des questions d'armement, de stratégie, de moyens militaires d'état-major, l'auteur reconstitue la somme des fronts, des batailles, des victoires et des échecs qui ont marqué à tour de rôle ce conflit et, au-delà, le monde de cette seconde partie du siècle. D'une plume alerte et dans un style concis et limpide, l'auteur nous brosse le choix des alliances, la redistribution des rôles, les politiques des uns et des autres, les tactiques plus ou moins heureuses pour contrecarrer la guerre lorsqu'elle n'en était qu'à ses débuts, à un moment où la diplomatie tentait encore de l'arrêter ou au moins de l'ajourner, puis les péripéties du conflit et ses conséquences. Il ne se fie qu'à la vérité des faits, aux éclairages que donnent les archives consultées, au-delà de tout ce qui fut dit ou écrit en fonction d'un climat politique donné, d'un moment donné, sur tel ou tel aspect de cette gigantesque conflagration qui vit s'embraser la planète et faillit la détruire. Fondée sur une multitude de documents de première main – français, allemands, britanniques, soviétiques – et sur une masse considérable d'ouvrages consacrés à ce sujet au fil du temps, analysés honnêtement, objectivement, scientifiquement, cette immense étude permet aujourd'hui de porter un regard d'ensemble sur tous les aspects déterminants de cette guerre..." (Lilly Marcou, Revue française de science politique, 1995)
Le Rêveur casqué.
Laffont, 1972, gr. in-8°, 315 pp, broché, couv. illustrée à rabats, photo de l'auteur au 2e plat, bon état (Coll. Vécu). Edition originale
Mémoires d'un Français engagé volontaire dans la Waffen SS en août 1944, ancien de la division Charlemagne, condamné à cinq ans de prison en 1946, devenu après la guerre une figure de Saint-Germain-des-Prés, et célèbre pour son témoignage dans le film "Le Chagrin et la Pitié". — L'instruction au camp de Wildflecken, les combats de Poméranie, la bataille pour Körlin, la capture par les Polonais, l'interrogatoire des Soviétiques, le retour en France, l'arrestation, le procès, etc. — "De tous les témoignages rassemblés par Le “Chagrin et la Pitié”, celui de Christian de la Mazière, assurément, est un des plus saisissants. Comment les Français se sont-ils comportés durant les années d'Occupation ? Bousculant toutes les idées reçues, le film s'efforçait de répondre à cette question difficile. Son audacieuse objectivité allait lui attirer un succès aussi éclatant qu'imprévu. Témoin essentiel, Christian de la Mazière avait une tâche malaisée : n'était-il pas un de ces « maudits » sur lesquels on avait laissé le silence s'accumuler, lui, ancien volontaire de la Waffen-SS française ? A le voir, à l'entendre, on découvrait soudain que l'aventure de ce « paria » avait sa logique, qu'elle correspondait à un moment de la société française. Ce n'était pas un hasard si, en 1944, plus de sept mille hommes avaient partagé le même engagement. De cette division « Charlemagne » qui s'en vint mourir dans les neiges de Poméranie, Christian de la Mazière est un des derniers survivants. Dans le Chagrin de la Pitié, il avait commencé de lever le voile sur toute une part de vérité étrangemment méconnue. Mais il lui fallait la distance d'un livre pour tout dire. Et puisque la vérité naît du vécu, que les faits parlent d'eux-mêmes, il lui fallait raconter son histoire..." (4e de couverture)
 Write to the booksellers
Write to the booksellers