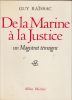Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
20th (1487)
21st (248)
-
Syndicate
ILAB (1740)
SLAM (1740)
Paroles aux Français. Messages et écrits 1934-1941.
Lyon, Lardanchet, 1941, in-12, xxi-256 pp, broché, bon état
Contient l'ensemble des discours, messages, appels et déclarations du Maréchal Pétain, du 17 juin 1940 au 31 août 1941, ainsi que les discours essentiels prononcés de 1934 à 1939. Sommaire : Avertissements (1934-1939) ; L'Armistice (juin 1940) ; La Reconstruction de la France ; La Politique sociale ; La Réforme intellectuelle et morale ; Appendices.
Panzers in Russia 1943-45. A Selection of German Wartime Photographs.
Cambridge, 1979, gr. in-8°, 96 pp, 150 photos reproduites, 2 cartes
Journal de la Bataille de Normandie, 1er juin-29 août 1944.
OREP Editions, 2013, pt in-4°, 191 pp, 265 photos et documents en noir et en couleurs, broché, couv. illustrée à rabats, bon état. Edition bilingue français-anglais
Avec le “Journal de la Bataille de Normandie”, revivez, jour après jour, les combats de l'été 1944, avec leurs temps forts, leurs grands moments mais aussi au travers de faits peu connus, voire pour certains largement ignorés. Chaque épisode est accompagné de photographies en partie inédites, de documents, affiches, "unes" de presse..., et d'une carte permettant de suivre quotidiennement l'évolution du front. — Jean Quellien, professeur émérite d'Histoire contemporaine à l'université de Caen, est reconnu comme l'un des spécialistes du débarquement et de la Bataille de Normandie.
La Normandie au coeur de la guerre.
Rennes, Ouest-France, 1994, in-8°, 248 pp, 2e édition, 16 pl. de photos hors texte, 19 cartes, biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Seconde guerre mondiale)
Par l'importance des forces navales, terrestres et aériennes déployées, le débarquement lancé le 6 juin 1944, au terme de longs mois de préparation, reste à coup sûr la plus impressionnante action combinée de tous les temps. La Bataille de Normandie s'est inscrite comme un temps fort dans la stratégie anglo-américaine pour la reconquête et la libération de l'Europe. Douze semaines d'engagements acharnés sur les plages, dans les haies du bocage ou dans les blés de la plaine de Caen vont décider du sort de la guerre à l'Ouest et précipiter la défaite du Troisième Reich. Au-delà de la simple description des opérations, cet ouvrage analyse le contexte politique, militaire et civil dans lequel se sont déroulés le débarquement et la bataille de Normandie. Dans un style vivant, ce livre offre une vue aussi globale et complète que possible des faits en respectant les divers éclairages : celui des alliés comme celui des Allemands sans oublier celui des premiers témoins, les Normands eux-mêmes. — "Un bon livre de synthèse, d'écriture facile et claire, richement documenté, intelligemment charpenté, complété par des cartes fort parlantes, et conduisant le lecteur à s'interroger sur des événements que l'on croit, trop souvent, parfaitement connaître." (Gabriel Désert, Annales de Normandie, 1993)
Résistance et sabotages en Normandie. Le Maastricht-Cherbourg déraille à Airan ! Printemps 1942.
Charles Corlet éditions, 1992, in-8°, 141 pp, 8 pl. de photos hors texte, une carte, broché, couv. illustrée, cachets d'un précédent propriétaire, bon état
Nuit du 16 avril 1942 : le train de permissionnaires de la Wehrmacht Maastrich-Cherbourg déraille entre Mézidon et Caen, à Airan : 30 soldats sont tués. Quinze jours plus tard, dans la nuit du 1er mai, un nouveau sabotage, au même endroit, entraîne cette fois la mort de 10 autres Allemands. La réaction de l'occupant à ce coup d'éclat de la Résistance normande – le premier du genre à le frapper en France – est terrible : des dizaines de prisonniers politiques fusillés en représailles, mais aussi l'arrestation de 130 otages « communistes ou juifs » à Caen et dans le reste du Calvados. Nombre d'entre eux seront déportés vers Auschwitz ; bien peu en reviendront ! Parallèlement, la police française, collaborant avec l'ennemi, entame une lutte acharnée pour retrouver les auteurs de ces sabotages – qui résolument poursuivent leur combat. Cette longue traque, aux multiples rebondissements, s'achève un an plus tard par le démantèlement du groupe de résistants et l'exécution au Mont Valérien de 14 de ses membres. Cinquante années ont passé. Les mémoires ont oublié ou occulté cette affaire, probablement la plus tragique qu'ait connu la région au cours de l'occupation. S'appuyant sur des témoignages exclusifs et des archives totalement inédites, l'auteur nous raconte pour la première fois ces événements jusqu'alors ignorés par l'Histoire.
Notre Chimie à l'heure allemande.
Nouvelles éditions Debresse, 1994, in-8°, 290 pp, biblio, broché, bon état
L'attitude des firmes chimiques françaises durant la période de la Collaboration de 1940 à 1945.
Journal de guerre. Londres-Alger, avril 1943-juillet 1944.
Plon/Fondation Charles de Gaulle, 1995, gr. in-8°, 379 pp, présenté et annoté par Olivier Dard et Hervé Bastien, préface de Serge Berstein, sources, biblio, index, broché, bon état
Si le nom d'Henri Queuille est couramment associé à la IVe République, on ignore souvent la carrière antérieure de cet homme politique qui, plusieurs fois ministre sous la IIIe République, rallia la France Libre du général de Gaulle en 1943. Associé à toutes les mesures préparatoires en vue du débarquement, président par intérim du Gouvernement provisoire, Henri Queuille apparaît comme un des acteurs essentiels de la période. Installé successivement à Londres puis à Alger, il tient son journal quotidiennement, d'avril 1943 à juillet 1944. Ce témoignage brut, exempt de toute retouche ultérieure, nous fait ainsi découvrir de l'intérieur, des milieux demeurés jusque-là mal connus : celui de la France Libre, à Londres, et celui du Gouvernement provisoire d'Alger. Au-delà du témoignage historique qu'il constitue, ce journal est également l'exemple du ralliement d'un notable de la IIIe République au général de Gaulle. Le texte du Journal de guerre d'Henri Queuille est éclairé par un vaste appareil de notes élaboré par deux historiens, Hervé Bastien et Olivier Dard, dans le prolongement de travaux menés à l'Institut d'études politiques de Paris. L'ensemble de cet ouvrage est préfacé par Serge Berstein, spécialiste de l'histoire de la France contemporaine.
Première page, cinquième colonne.
Fayard, 1945, in-12, 359 pp, broché, bon état
La Presse et l'épuration. — "Jean Quéval (1913-1990) fut critique de cinéma, traducteur, romancier et journaliste sportif. Son livre est une dénonciation des écrivains et journalistes qui se sont compromis dans la presse de la collaboration. Dans son pamphlet 'Après le déluge' (1956), Pierre-Antoine Cousteau a consacré un chapitre à ce livre et à son auteur, qu'il avait connu à l'agence collaborationniste Inter-France : « Il y avait une fois, sous l'occupation allemande, un petit journaliste besogneux fils d'un illustre marchand de tissus qui s'appelait Jacques Dormeuil et se faisait appeler Jean Quéval. [...] Pendant les années noires qui précédèrent les années roses, M. Quéval écrivit peu et copia énormément. Il copia tout ce que ses confrères écrivaient de marquant, de vigoureux, de décisif. Il copia le tout sur des fiches. Comme les flics de la Tour Pointue. [...] Quelle meilleure preuve pouvait-il donner de son civisme que le balançage des petits copains ? Ainsi font les chevaux de retour qui briguent — quelle zoologie ! — la bienveillance des poulets. Restait à trouver un éditeur pour le rapport de police. Ce fut extrêmement facile. La firme Fayard se rua sur l'aubaine. Comme tout le monde, elle avait un petit peu besoin, elle aussi, d'afficher son esprit de résistance, de faire oublier la publication en zone sud d'un Candide très orthodoxement maréchaliste. [...] Battant pavillon Fayard, le rapport de police parut donc sous le titre pimpant de « Première Page, Cinquième Colonne ». Du coup, la besogne des juges d'instruction chargés de tourmenter les écrivains se trouva faite. Plus besoin d'aller perdre des heures fastidieuses à consulter les collections de la Nationale. Tous les textes pendables (avec références, bien sûr) s'alignaient dans la dénonciation-digest de l'ex-rédacteur d'Inter-France. Il ne restait plus qu'à en donner lecture (avec des inflexions outragées) aux inculpés, à traduire ces mal-pensants devant les jurés-terrassiers des Cours de Justice, et à dénombrer ensuite, en rigolant, les cadavres et les siècles de bagne. [...] En 45, dans la clandestinité autrichienne, j'avais lu cette compilation avec un furieux écoeurement. Parce que les bourriques me donnent des nausées. Parce que dans la hiérarchie des vilenies, Première Page, Cinquième Colonne est sans doute ce que l'on peut concevoir de plus vil. »" (Henri Thyssens, Robert Denoël éditeur)
Les Français parlent aux Français, 18 juin 1940-18 juin 1941.
P., Omnibus, 2010, in-8°, 1152 pp, avant-propos, choix et commentaires de Jacques Pessis, préface et conseils historiques de Jean-Louis Crémieux-Brilhac, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
Un document historique exceptionnel : les textes de la mythique émission de la France Libre à Londres, Les Français parlent aux Français. — Le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC à Londres, un général prend la parole pour demander aux Français de poursuivre la lutte. Message fondateur, l'Appel du général de Gaulle, en donnant naissance à la France Libre, marque également le coup d'envoi d'une aventure singulière, celle d'une poignée de réfractaires qui, au micro de Radio Londres, multipliera quotidiennement de juin 1940 à octobre 1944 les messages d'espoir et de combat pour le peuple de France placé sous la botte nazie. Les voix qui deviendront familières, celles de Maurice Schumann, de René Cassin ou de Jacques Duchesne, voisinent avec celles des témoins anonymes et des grandes consciences nationales, tels Georges Bernanos ou Jules Romains ; toutes clament leur foi en la France éternelle et en la victoire finale, leur amour de la liberté. Ce premier volume couvre la première année de l'Occupation, alors qu'en France se met en place le gouvernement de Vichy et que l'Angleterre résiste avec succès aux assauts de l'aviation allemande.
Ma Vie.
France-Empire, 1958, pt in-8°, 411 pp, traduit de l'allemand, 8 pl. de photos hors texte, broché, couv. factice très bien réalisée à partir d'une reproduction en couleurs de la jaquette originale, bon état
Souvenirs de l'amiral commandant en chef la flotte allemande jusqu'en janvier 1943. Erich Johann Albert Raeder (1876-1960) a servi dans la marine allemande au cours de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Officier général de la Reichsmarine pendant l'entre-deux guerre, puis de la Kriegsmarine sous le Troisième Reich, il atteint le plus haut rang de la hiérarchie militaire navale, celui de Grand Amiral, en 1939. Il dirige la Marine allemande jusqu'à sa démission en 1943, date à laquelle il est remplacé par Karl Dönitz. Il est condamné à la prison à vie au tribunal de Nuremberg et est libéré en 1955 pour raisons médicales. — "Entré dans la marine impériale en 1895, Erich Raeder est chef d'état-major de l'amiral Hipper à la bataille du Jutland. Peu avant la révolte des marins, prélude de la révolution de 1918, il est appelé à Berlin où il joue un rôle de plus en plus déterminant dans l'organisation de la nouvelle marine définie par le traité de Versailles. En 1928, il en devient le chef. Quand Hitler arrive au pouvoir, en janvier 1933, l'amiral Raeder préside à l'extraordinaire expansion d'une marine qui se promet d'être millénaire et qui va sombrer, au bout de douze années, sous une tempête de sang et d'horreurs... Condamné par le tribunal international de Nuremberg, il est libéré de la prison de Spandau, en 1955, à l'âge de 80 ans. L'homme qui a façonné la Kriegsmarine, qui en a été la figure de proue pendant quinze ans, nous livre son histoire déterminante, dramatique et passionnée. Il revendique hautement ses responsabilités... « Ma vie » du grand amiral Raeder est un document d'un intérêt exceptionnel. Il apporte une contribution essentielle à l'histoire de l'Europe et du monde." (2e plat de la jaquette) — "La vie du Grand-Amiral Raeder, qui dirigea la marine allemande de 1928 à 1943, a été tout entière consacrée à celle-ci, au cours d’une carrière de près de cinquante ans. Il connut la marine allemande à ses grandes étapes : au moment où elle se constituait pour la première fois, au moment où elle était engagée dans la Première Guerre mondiale, au moment où elle se reconstituait pendant l’entre-deux-guerres, enfin au moment où elle se trouvait à nouveau au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour le lecteur d’aujourd’hui, ce sont évidemment les dernières périodes qui sont les plus intéressantes. Le Grand-Amiral expose, de façon très claire et fort simple, sur quelles données s’est reformée la marine allemande, lorsque Hitler se fut affranchi des stipulations du Traité de Versailles, puis comment la guerre sur mer a été menée par l’Allemagne dans les premières années du dernier conflit. Une figure domine : celle de Hitler ; sa personnalité s’éclaire d’un jour nouveau chaque fois qu’un des grands acteurs allemands du drame raconte ses mémoires. Pour le Grand-Amiral Raeder, Hitler reste un homme au caractère changeant, malgré sa détermination, une nature secrète, malgré les nombreux entretiens qu’il accordait aux grands chefs militaires et les grands discours qu’il leur adressait. Il est curieux, voire stupéfiant, de voir comment le responsable de la marine allemande était mal orienté par le Führer et devait déduire de ce qu’il disait et plus souvent de ce qu’il ne disait pas, les directives qu’il y avait lieu d’appliquer. Souvent en désaccord avec Hitler, le Grand-Amiral Raeder trouvait, dans la haute conception qu’il s’était faite de ses devoirs, une ligne de conduite à laquelle il restait fidèle. Son amour passionné de la marine, son désir de servir avec droiture, l’objectivité avec laquelle il envisageait les problèmes qui lui étaient soumis et ceux qui pourraient lui être proposés, lui masquaient quelque peu les conditions réelles dans lesquelles Hitler menait sa politique à l’intérieur même de l’Allemagne et hors de ses frontières. Aussi peut-on aisément croire l’Amiral Raeder lorsqu’il affirme qu’il eut connaissance pour la première fois au procès de Nuremberg, où il figurait avec les autres chefs allemands poursuivis comme criminels de guerre, des faits monstrueux qui étaient reprochés au régime nazi. Le récit du procès de Nuremberg, et le jugement qu’il porte sur lui, ne sont pas les parties les moins intéressantes du livre, dont les dernières pages ne manquent pas de grandeur. La traduction est particulièrement claire." (Jean Némo, revue Défense Nationale, 1959)
J’avais cinq ans en 1943 : le lent dévoilement d’une identité juive.
Editions du Cygne, 2019, in-8°, 216 pp, broché, couv. illustrée, bon état
Quand l’Histoire piétine les boîtes à musique des histoires familiales, quand il ne reste aux survivants que des mémoires blessées, il revient aux descendants de redécouvrir leur petite musique filiale, la seule qui leur permette d’affirmer leur pleine identité. C’est ainsi que Monique Raikovic est parvenue à se trouver en renouant avec des origines juives ashkénazes enracinées dans l’Odessa de l’empire tsariste : « En mars 1943, j’ai eu cinq ans. C’était la guerre, nous raconte-t-elle. Ma mère me disait souvent que j’avais de la chance, beaucoup de chance, ce qui m’exaspérait. Parce que je percevais ces propos comme un reproche, comme si elle me signifiait du même coup que cette chance, je ne la méritais pas. Je ne devais en comprendre la signification qu’en 1946. Mais en s’expliquant ma mère me chargeait d’un secret : personne dans notre entourage ne devait savoir qu’elle était d’origine juive. Du même coup, elle me rendait incompréhensibles ses parents, si différents de mes grands-parents paternels. J’avais huit ans. À cet âge, on ne trahit pas un secret, jamais. On ne sait pas, non plus, qu’au fil des années, on va se construire avec, puis, contre ce secret. Mais, quand on parviendra à se libérer de son emprise, on découvrira que celui-ci nous a fait ce qu’on est devenu. »
De la Marine à la Justice. Un Magistrat témoigne.
Albin Michel, 1972, in-8°, 309 pp, index, broché, bon état
"Très intéressant témoignage direct sur la période 1939-1945. L'auteur, secrétaire général à la Cour de Cassation à la veille de la guerre, reprend les notes personnelles prises au fil des événements et, de son pittoresque passage à l'Amirauté en qualité de matelot réserviste à la libération de Paris, nous apporte en particulier sur la personnalité de Darían, sur la carrière et l'attitude du Premier Président de la Cour de Cassation Pierre Caous, chargé de conduire le procès de Riom, une documentation de première main, avec le filial souci de redresser pour la postérité l'image de ce haut Magistrat son chef et ami, qui nous est présenté comme « un seigneur de la justice » et que le Maréchal Pétain avait désigné en qualité de membre du Collège de sept personnes appelé à pourvoir « à la suppléance et à la succession du chef de l'Etat » (acte constitutionnel n° 4 sexies)... D'utiles annexes – sur les notes obtenues par Darlan au cours de sa carrière militaire, sur l'ultime message de Pétain, sur les réactions de Pierre Caous à propos de la Cour Suprême de justice qu'il présidait – complètent ce livre vivant, minutieusement écrit et qui, sans toujours nous convaincre constituera de toute facon un ouvrage de référence pour les historiens de la guerre." (La Revue administrative, 1972)
Un Soldat dans la tourmente.
Albin Michel, 1963, pt in-8°, 523 pp, 56 photos hors texte, biblio, index, broché, couv. illustrée à rabats lég. salie, bon état
"Une biographie du général Weygand, pleine de sympathie à son égard. G. R. a eu en communication bon nombre de textes inédits..." (Revue française de science politique, 1964) — Maxime Weygand (1867-1965), adjoint de Foch en 1914, généralissime en 1940, favorable à l'armistice, incarna, dans la politique de Pétain, les velléités de résistance à l'Allemagne. Membre de la Commission d'Instruction de la Haute Cour, l'auteur a directement participé à l'instruction de l'affaire Weygand après le retour du général de sa captivité en Allemagne et à l'issue de son arrestation sur l'ordre du général de Gaulle. — L'auteur d'« Un soldat dans la tourmente » ne s'est pas borné à relater comment un enfant, né à Bruxelles le 21 janvier 1867, de père et mère inconnus, devint le bras droit du plus illustre de nos maréchaux, ensuite Commandant en chef de nos forces armées, puis Proconsul en Afrique, avant d'être incarcéré en Allemagne, détenu en France et finalement dispensé de comparaître devant la Haute Cour. En réalité, le jeune Maxime, après avoir été reconnu, en 1888, par François Weygand, est devenu le personnage central d'une oeuvre qui ressuscite des péripéties peu communes et met en scène les hommes exceptionnels qui en furent les protagonistes ou les héros. Décrivant les étapes primordiales de la longue existence de cet homme rigide et entier, « ombrageux et violent » qu'est le Général d'armée Weygand, Guy Raissac évoque sous un éclairage nouveau certains aspects dramatiques ou parfois saugrenus des évènements souvent confus, contradictoires et âprement controversés qui se sont déroulés de 1940 à nos jours. L'auteur, après de minutieuses recherches et maintes vérifications, relie entre eux, pour la première fois, des faits peu compréhensibles jusqu'alors. Il compose un portrait vivant de ceux qui, sur des plans différents et à des degrés divers, eurent un rôle à remplir au cours de ces années cruciales. Cette vaste fresque littéraire et historique entraîne le lecteur de la France occupée à la capitale britannique, de l'Afrique au Moyen-Orient et à l'Allemagne en guerre. Elle dépeint au passage les coulisses de l'Assemblée Nationale à Vichy, relate les délibérations secrètes de l'hôtel du Parc ou du Palais d'Hiver à Alger, évoque même les réactions de l'Académie française lors des temps difficiles. Elle retrace la mise en route laborieuse de la Haute Cour de Justice, de la Libération, et éclaire certains incidents curieux ou significatifs survenus au cours du procès Pétain. L'exposé détaillé du long conflit qui a opposé Weygand à De Gaulle permet à l'auteur de révéler quelques données particulières de l'antagonisme aussi pénible que fondamental qui a, peu à peu, mais inexorablement, dressé Pétain et De Gaulle face à face. Il décrit à cette occasion, et pour la première fois, les phases les plus caractéristiques du contentieux judiciaire dont, au cours de l'été 1940, Charles de Gaulle fut la victime, à titre d'ailleurs symbolique et analyse les mesures de révision qui en furent la conséquence. L'affrontement durable et souvent passionné qui a successivement mis aux prises le Général Weygand avec Pierre Laval et avec l'Amiral Darlan est relaté, tout au long, avec une complète impartialité. Telle est la substance d'un ouvrage qui comporte maintes révélations inédites et nombre de mises au point historiquement nécessaires. En le rédigeant, son auteur, réputé pour son indépendance d'esprit, sa pondération et sa probité intellectuelle, a eu le souci constant de sauvegarder son entière liberté d'appréciation à l'égard de tous. Il a entendu ne servir que la seule vérité. (4e de couverture)
Drancy, un camp de concentration très ordinaire, 1941-1944.
Levallois-Perret, Manya, 1991, in-8°, 414 pp, broché, couv. illustrée, bon état
Contrairement à une légende tenace, Drancy ne fut pas qu'un simple camp de transit. À seulement quelques kilomètres de Paris on entrait dans la mort. La violence et les souffrances physiques infligées aux déportés montrent à quel point Drancy était bien un camp de concentration très ordinaire. D'août 1941 à août 1944, 67.000 Juifs de France ont transité par le camp de Drancy. Moins de 2.000 d'entre eux reviendront des camps d'extermination. Avec l'appui de nombreuses archives et de très riches témoignages, le livre jette une lumière crue sur le fonctionnement de ce camp et surtout sur le rôle central de la police et de l'administration française dans son organisation. Placé sous l'autorité de la préfecture de police, il fut administré et gardé uniquement par des policiers et des gendarmes français jusqu'en juin 1943. Grâce à des archives inédites et de nombreux témoignages, ce livre dévoile des faits historiques trop vite passés sous silence...
L'an prochain, la révolution. Les communistes juifs immigrés dans la tourmente stalinienne, 1930-1945.
Mazarine, 1985, in-8°, 361 pp, index, broché, couv. illustrée, bon état
"Le livre suit, quinze années durant, des exilés d'Europe centrale, polonais pour moitié, chassés de leur pays par l'antisémitisme, et qui ont abandonné « la Torah de leur enfance » pour « Le capital et les œuvres complètes de Lénine » (p. 16). Comment ce petit peuple d'ouvriers et d'étudiants a-t-il vécu à l'ombre du Parti communiste et de ses organisations de masse, la MOI en particulier ? C'est ce que nous montre M. Rajsfus sans détours. Il nous promène du début des années 1930 à l'après-Libération via le Front populaire et la guerre d'Espagne, le pacte germano-soviétique et la Résistance. Chemin faisant, il prend un malin plaisir à placer ses acteurs et ses témoins devant leurs contradictions : comment ont-ils pris les « virages à 180° » du Parti, du mois d'août 1939 au printemps 1941 ? Comment y ont-ils réagi ? Ont-ils été des combattants « internationalistes » ou des résistants « antiboches » ? Ont-ils été des combattants à part entière ? On se chargea vite de les décevoir, au PCF comme dans l'armée « amalgamée », après la Libération ; je ne parle pas des désillusions qui les attendaient plus tard dans leurs pays d'origine où « se construisait le socialisme ». (...) Construit à partir de témoignages souvent inédits, cet ouvrage est utile sur une question trop longtemps occultée. Il aurait cependant gagné à être parfois moins diffus et moins polémique aussi. Ce sont les défauts de ses qualités." (Claude Lévy, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 1985)
La Police de Vichy. Les forces de l'ordre françaises au service de la Gestapo, 1940-1944.
Le Cherche Midi, 1995, in-8°, 286 pp, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Documents)
L’affaire Bousquet (il fut secrétaire général à la police d’avril 1942 à décembre 1943) a remis en lumière le rôle de la police française pendant l’Occupation. Mais, au-delà des responsabilités d’un homme, fussent-elles accablantes, il était temps d’étudier le comportement des policiers, à tous les stades de la hiérarchie, durant ces années noires. Témoignages et documents à l’appui, dont nombre d’inédits, Maurice Rajsfus démontre que si certains « collaboraient le jour pour mieux résister la nuit », la plupart des policiers anticipèrent et outrepassèrent les ordres de Vichy pour plaire aux autorités d’Occupation, Gestapo en tête. Plus de 200.000 personnes furent déportées après leur arrestation par la police française entre 1940 et 1944. La plupart d’entre elles auraient, à n’en pas douter, échappé aux griffes des nazis sans cette participation française aux répressions raciales et politiques.
Opération Etoile Jaune. Suivi de « Jeudi noir ».
Le Cherche Midi, 2002, gr. in-8°, 270 pp, 8 pl. de fac-similés et un dessin hors texte, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Documents)
Maurice Rajsfus a eu accès à de nombreuses pièces d'archives inédites et à des documents récemment mis au jour. Il a pu ainsi reconstituer une des pages les plus sombres de l'Occupation. Le port obligatoire de l'étoile jaune, imposé aux Juifs de la zone occupée, en application de la 8e ordonnance du 29 mai 1942, n'est que l'une des mesures répressives décidées par la Gestapo mais appliquée par les policiers français. Les étoiles jaunes seront délivrées dans les commissariats de police et non dans les officines de la Gestapo. À partir du 7 juin 1942, premier jour du port de l'étoile jaune, dès l'âge de six ans, la vigilance policière sera sans faille, et de nombreuses personnes seront arrêtées, internées puis déportées sous les prétextes les plus divers : sur les mains courantes des commissariats sont évoquées les étoiles mal cousues, peu visibles ou mal détourées. Il est également question du comportement "arrogant" des victimes. En cette circonstance, comme pour les déclarations des Juifs dans les commissariats, en octobre 1940, ou la réquisition des postes de TSF ou des récepteurs de téléphone l'année suivante, la police française fera respecter l'ordre nazi avec un zèle qui lui vaudra les éloges de ses maîtres. Cinq semaines plus tard, ce sera la rafle du 16 juillet 1942. Maurice Rajsfus relate ensuite dans “Jeudi noir” comment sa famille fut arrêtée à Vincennes. Lui et sa soeur aînée furent libérés, mais ses parents, déportés à Auschwitz, ne reviendront pas. Un récit émouvant et sans complaisance.
Dans le creuset sudète. De Karlsbad à Karlovy Vary. Choses vues. Préfaces de Gérard Delfau et Kurt Brenner. Illustrations de Jean Pallares.
Besançon, L'Amitié par le Livre, 1990, gr. in-8°, 214 pp, illustrations dans le texte, 2 cartes hors texte, broché, couv. illustrée, édition originale, un des 250 ex. numérotés sur Bouffant Astrid et signés par l'auteur, bon état. Journal d'un prisonnier de guerre, tiré de sa dernière année de captivité (6 juin 1944 - 6 juin 1945), depuis le camp de Schindelwald, en Tchécoslovaquie, jusqu'au retour à Paris.
Bernes-sur-Oise, 1939-1945. De la «drôle de guerre» à l'US Air Force.
Association du Mémorial de Bernes-sur-Oise, 1998, gr. in-8°, 144 pp, 44 photos, 10 illustrations, plans et fac-similés, une carte, broché, couv. illustrée, bon état
Ce livre retrace l’histoire du terrain d’aviation de Persan-Beaumont et de ses environs, pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette plate forme aéronautique à la limite des départements de l’Oise et du Val d’Oise sera utilisée successivement par l’Armée de l’Air Française (GB I/31, GB I/12 et GB II /12 équipés de LéO 451), puis de façon limitée par la Luftwaffe. Enfin à partir d’octobre 1944, le 386ème Bomb Group de la 9ème Air Force Américaine (équipé de B-26 Maraudeur et A-26 Invader) opèrera depuis cette base aérienne (A-60). La dernière partie de l’ouvrage présente l’inauguration du Mémorial en octobre 1994 sur la commune de Bernes-sur-Oise.
Occupée trois fois. Trois occupations militaires.
Sans lieu, sans nom, s.d. (1942), in-8°, 84 pp, broché, agrafé, couv. illustrée, bon état
Rare plaquette collaborationniste publiée en 1941 ou 1942. L'ouvrage s'intéresse aux trois occupations qu'a connu la France de la guerre de 1871 (occupation allemande) à la Seconde guerre mondiale (occupation allemande à partir de 1940) en passant par l'occupation française en Rhénanie à l'issue du premier conflit mondial pour tenter de justifier la collaboration. L'appel du Général De Gaulle est mentionné. — "Le bonheur et l'avenir de la France, le bonheur et l'avenir de l'Europe exigent une prompte victoire allemande. L'occupation, comme nous l'avons déjà dit, peut être un pont jeté entre deux pays..." (Conclusion) — Table : Principes du droit international concernant les occupations militaires ; Trois ans d'occupation allemande en France (1871-1873) ; Douze ans d'occupation française en Allemagne (1918-1930) ; Occupation allemande en France (1940) ; Conclusion.
Chroniques des années incertaines, 1935-1945.
France-Empire, 1989, gr. in-8°, 371 pp, 12 pl. de photos hors texte, broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s.
Jacques Raphael-Leygues est le petit-fils du grand ministre de la Marine, Georges Leygues. Dès sa jeunesse, il vécut dans l'ambiance de la Marine et en connut tous les chefs, à commencer par l'amiral Darlan. En 1938, jeune commissaire de la Marine, il fut attaché au cabinet du président du Conseil Daladier, participa à la campagne de Norvège, puis rejopingnit les forces combattantes. Trente ans après, il analyse les événements de la période 1939-1945 et apporte par des anecdotes pittoresques une contribution à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Darlan.
Plon, 1986, in-8°, 282 pp, nombreux documents en annexes (34 pp), broché, couv. illustrée, bon état
"La biographie que l'ambassadeur Raphaël-Leygues et l'amiral Flohic ont consacrée à l'amiral Darían n'a pas l'ambition d'être exhaustive – il y manque notamment le récit de l'assassinat, jugé sans doute trop connu pour être répété dans ce livre. Pas davantage celle d'être une explication des comportements contradictoires du personnage, qu'à vrai dire aucun des deux auteurs, l'un et l'autre gaullistes éminents, n'était prédisposé à admettre. Ceux-ci n'en ont que plus de mérite d'avoir été impartiaux. Ce qui est intéressant, ce sont les souvenirs et le jugement flatteur du petit-fils de Georges Leygues, qui fut de 1926 jusqu'à sa mort ministre de la Marine, après l'avoir été une première fois dix ans plus tôt, et dont l'amiral Darían fut le chef de cabinet. (...) L'ouvrage est également passionnant par les nombreux documents inédits tirés des archives personnelles de l'ambassadeur Raphaël-Leygues : lettres, notes et exposés de l'amiral, notamment un résumé des erreurs commises par Hitler, par l'Angleterre et par Vichy, auquel Darlan aurait dû ajouter la liste des fautes dont il se rendit lui-même coupable." (Jacques de Ricaumont, Revue des Deux Mondes, 1987)
Darlan-Laborde, l'inimitié de deux amiraux.
P., Editions de la Cité, 1990, in-8°, 208 pp, 8 pl. de photos hors texte, annexes, broché, couv. illustrée, bon état
Le 27 novembre 1942, la flotte française se sabordait à Toulon pour éviter de tomber entre les mains des troupes allemandes qui avaient envahi l'arsenal. Son commandant, l'amiral de Laborde, n'avait pas hésité à donner l'ordre fatal, refusant de déférer au message de son ancien chef l'amiral Darlan, qui d'Alger "l'invitait" à rallier l'Afrique du Nord pour reprendre le combat aux côtés des Alliés. Devant cette occasion manquée, on a parlé de "l'anglophobie" de Laborde. Mais il existait aussi une sourde rivalité entre les deux amiraux, dont J. Raphaël-Leygues et F. Flohic nous font suivre les sombres méandres, depuis l'Ecole Navale jusqu'à la consommation du drame. Ils révèlent en outre l'incroyable projet de Laborde qui, après avoir quitté le service actif de la Marine, comptait recruter une "Légion du désert" sous les ordres de Rommel en vue de reconquérir le Tchad et de précipiter la France aux côtés de l'Allemagne. C'est encore un portrait inédit de Darlan que nous brossent les auteurs.
Le Choix des Juifs sous Vichy. Entre soumission et résistance.
La Découverte, 1992, gr. in-8°, 391 pp, préface de François Bédarida, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Textes à l'appui)
"En France, Adam Rayski, engagé dès la première heure dans la Résistance, est responsable de la section juive de la MOI et de sa presse clandestine de 1940 à 1944. Cofondateur du Conseil représentatif des Juifs de France, président de l'Union des résistants et déportés juifs de France, ce témoin privilégié est aujourd'hui l'un des historiens les plus marquants de cette période - « Nos illusions perdues » ou « Le Sang de l'étranger » (avec Stéphane Courtois et Denis Peschanski). Son dernier ouvrage, « Le Choix des Juifs sous Vichy. Entre soumission et résistance », souligne comment des Juifs, en France, cessant d'être des victimes passives, ont décidé de devenir les acteurs de leur propre destin, tandis que tombaient, les armes à la main, les insurgés du ghetto." (L'Express)
Opération Lucy. Le réseau d'espionnage le plus secret de la Seconde Guerre mondiale.
Fayard, 1982, in-8°, 328 pp,
 Write to the booksellers
Write to the booksellers


![Les Français parlent aux Français, 18 juin 1940-18 juin 1941.. [Radio] – Collectif.](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CLI/64349_1_thumb.jpg)