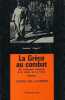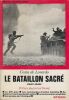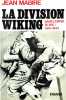Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
20th (1487)
21st (248)
-
Syndicate
ILAB (1740)
SLAM (1740)
Histoire de la guerre mondiale. Tableau de l'Europe en 1939. Tome 2 : Offensives et contre-offensives du 7 mars 1936 au 1er septembre 1939.
P. et Royat (Puy-de-Dôme), Institut des études américaines du comité France-Amérique, s.d. (1943), in-12, 231 pp, un portrait de l'auteur par François-Joachim Beer en frontispice, broché, couv. illustrée rempliée, bon état. Edition originale non mise dans le commerce, exemplaire nominatif (nom découpé), envoi a.s. (nom du destinataire découpé). Rare
Offensive allemande en Europe. Trois années d'histoire contemporaine (7 mars 1936 - 7 mars 1939).
Fernand Sorlot, 1939, in-12, 271 pp, 5 cartes, broché, couv. illustrée lég. salie, sinon bon état
"Rien de ce qui concerne l'Allemagne contemporaine ne saurait nous laisser indifférents, surtout lorsque son inquiétante évolution est commentée par un esprit aussi averti que M. G. Louis-Jaray. Sous ce titre : Offensive allemande en Europe, il nous présente l'histoire des trois dernières années de l'Europe, marquées par tant de transformations, dominées par le souci constant de l'établissement de l'hégémonie hitlérienne. Une mise au point juste et lucide, en une heure grave et incertaine, de la pensée et de la volonté de l'Allemagne, si expressément révélées dans sa bible moderne, Mein Kampf." (B. Combes de Patris, Revue des études historiques, 1939) — "Comme l'indique le titre, Offensive allemande en Europe, l'ouvrage de M. Gabriel Louis-Jaray déborde le cadre de la crise tchécoslovaque, bien que celle-ci demeure le centre dramatique des trois années de « guerre blanche » (mars 1936-mars 1939) qu'il s'attache à couvrir. Très justement, M. Louis-Jaray situe au 7 mars 1936 (remilitarisation de la rive gauche rhénane) le tournant de l'histoire contemporaine. « La déclaration de faillite est du 7 mars 1936, écrit-il, et le bilan a été déposé après coup le 29 septembre 1938 » (p. 240). L'auteur expose le dessein de l'Allemagne de constituer sous sa domination une Mittel Europa qui lui assurerait l'hégémonie européenne, la préparation méthodique jusqu'à Munich, qui semble avoir clos la phase préparatoire de la réalisation de ce vieux rêve, et enfin les larges perspectives de déploiement que lui a ouvertes la reddition de la barrière de Bohême. (.) La meilleure partie de l'ouvrage est celle qui concerne la période qui a suivi Munich. M. Louis-Jaray montre fort bien les effets désastreux que l'attitude adoptée en septembre par les gouvernements de Paris et de Londres a eue pour le prestige de la France et de la Grande-Bretagne dans l'opinion américaine et auprès des petites nations européennes. Il fait le point, avec beaucoup de lucidité, de la situation de la France en Europe au lendemain de Munich. Il dénonce avec force les dangers de la politique d'apaisement, dont le vrai nom est l'isolationisme..." (René Maheu, Politique étrangère, 1939)
La Grèce au combat. De l'attaque italienne à la chute de la Crète (1940-1941).
Calmann-Lévy, 1966, in-8°, 350 pp, 16 pl. de photos et 6 cartes hors texte, chronologie, biblio, broché, couv. illustrée à rabats, état correct
Sans l'accord de l'Allemagne dont elle contrariait alors les desseins, l'Italie fasciste engagea des hostilités contre la Grèce le 28 octobre 1940. Loin de se trouver devant une nation sans volonté, les armées de Mussolini, y compris les formations d'élite, se heurtèrent, après les succès du debut, à un adversaire certes inférieur en nombre et en armement mais résolu comme peut l'être un peuple défendant son sol et sa liberté. "Je place – disait Jean Métaxas, chef du gouvernement grec – la dignité de la Grèce au-dessus de tout problème." Et puis, c'est le miracle du Pinde, avec des héros comme le colonel Davakis, la déroute des Alpins. Les Grecs ayant passé à l'offensive, avancent rapidement en Albanie. Mais l'humiliation subie par Mussolini ne préserve pas la Grèce au combat de la menace hitlérienne, d'autant que la Bulgarie se range aux côtés de l'Axe. En avril 1941, sous le prétexte de la présence anglaise, les Allemands envahissent la Grèce épuisée. Les victorieux sont vaincus. Reste la Crète, ultime réduit de la souveraineté grecque. Elle cède à son tour, en mai, sous un déluge de parachutistes, malgré la défense opiniâtre des forces britanniques assistées d'unités crétoises, soutenues elles-mêmes par une population unanime. Le temps n'est plus de l' "aéra", cri de guerre des evzones repoussant l'agresseur. Les Grecs souffrent dans leur chair et dans leur âme. Les couleurs nazies offensent l'Acropole jusqu'aux jours de la délivrance – fin 1944 – préparés par des sacrifices correspondant, à la Libération, à la perte de 10% de la population. Costa de Loverdo a fait un tableau vibrant et scrupuleux de l'épopée de 1940-1941, qui en appelle aux Thermopyles, tout en donnant la chronologie de la résistance grecque, 1941-1944, à la fois nationale et divisée en maquis de Droite et de Gauche. Combattant et historien, il a rendu un témoignage qui forcé l'estime autant qu'il provoque l'intérêt.
Le Bataillon sacré, 1942-1945.
Stock, 1968, in-8°, 353 pp, préface du général Kœnig, 16 pl. de photos hors texte, 15 cartes, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
Après l’occupation allemande de la Grèce en 1941, le gouvernement grec s’exila en Egypte, où résidait une communauté de plus de 200 000 Grecs. Devant le nombre important d’officiers présents, il fut créé le 15 septembre 1942 un bataillon de 200 hommes, composés uniquement d'officiers, sous les ordres du colonel Gigantès. Ce bataillon prit le nom de Bataillon sacré. Rattaché aux Forces grecques libres, il fut entraîné par le SAS de David Stirling et se plaça d'abord sous les ordres de Leclerc. Il agit avec beaucoup d'efficacité au Moyen-Orient.
Les Grandes heures de la Guerre mondiale.
France-Empire, 1964, in-8°, 314 pp, traduit de l'italien (“La Guerra segreta”), cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
La Seconde Guerre mondiale fourmille en actions particulières dont il est bien difficile de juger encore lesquelles ont le plus influencé son dénouement. Certaines, comme le forcement de la Manche par le gros de ce qu'il restait de la flotte allemande en 1942, le débarquement de Dieppe, la bataille manquée de Paris en août 1944, sont, certes relativement plus connues des lecteurs français que Pearl Harbour, Katyn, Arnhem, les causes profondes de l'échec des V1 et des V2 sur l'Angleterre et quelques autres...
World War Two Through German Eyes.
London, Arms and Armour Press, 1987, pt in-4°, 192 pp, 108 photographies, biblio, index, reliure toile bordeaux de l'éditeur, sans la jaquette, soulignures crayon sur 3 pp et surlignures stabilo sur 12 pp, bon état. Edition originale. Texte en anglais
Comment traiter les Allemands.
New York, Editions de la Maison Française, 1944, in-12, 167 pp, traduit par Jean Liénard, broché, couv. lég. salie, bon état
Par Emil Ludwig (1881-1948), écrivain allemand célèbre pour ses biographies. Ce qui le consacra et lui valut la vindicte de l'extrême-droite allemande, c'est, en 1929, son livre “Juillet 1914”. Ce livre fut interdit puis brûlé par les nazis. Reconnu citoyen suisse en 1932, il émigre aux USA en 1940. Devenu un ennemi irréductible du Troisième Reich, il se met au service du gouvernement américain. Il publie plusieurs pamphlets antifascistes dont “Comment traiter les Allemands”, et en 1945, “La conquête morale de l'Allemagne”. Après 1945, il retourne en Suisse où il meurt le 17 septembre 1948.
Margis : de la Somme au Tonkin, 1939-1946.
Nîmes, C. Lacour Éditeur, 2015, in-8°, 125 pp, pièces annexes et photos (11 photos et fac-similés, suivis de 19 cartes postales anciennes), broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s.
Un ouvrage écrit à partir du carnet de guerre du père de l'auteur. Ce vieux cahier retrace l'histoire de Louis Luiggi, officier engagé volontaire en 1939, qui, après des combats acharnés et la débâcle échappe à la captivité grâce à l'armistice de 1940. En 1941, c'est le départ pour l'Indochine, qui connaît une période de paix jusqu'en 1945. Alors que la Métropole, entrevoit la fin de la seconde guerre mondiale, en Asie tout bascule dans un enchaînement dramatique oublié de notre histoire. C'est l'histoire du « Margis » (Maréchal des Logis) et de ses camarades. Jean-François Luiggi voulais faire connaître ce témoignage, "en hommage à tous les hommes tombés à Lang-Son en Indochine entre le 9 et le 12 mars 1945, pour que ces événements sortent de l'angle mort de notre histoire et prennent leurs justes places dans notre mémoire collective." (La Provence)
Le Forez et la Révolution Nationale (juin 1940 - novembre 1942).
Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes, 1972, gr. in-8°, 348 pp, 2 photos à pleine page, 36 cartes, graphiques et tableaux, annexes, biblio, index, broché, jaquette illustrée, bon état, envoi a.s. à René Rémond
"Le très beau livre que Mlle Monique Luirard vient d'écrire est incontestablement une oeuvre de sciences, où l'abondance et la nouveauté de la documentation le dispute à la rigueur et à la finesse d'une pensée toujours maîtresse d'elle-même et constamment objective. Il est aussi l'expression d'une douleur ; d'une quête, menée avec une domination de soi impressionnante et un soin qui force l'admiration, par la propre fille d'un Résistant, mort dans un camp d'extermination..." (Pierre Léon, préface)
Le Duel Churchill-Hitler. 10 mai-31 juillet 1940 : les 80 jours où se joua le sort de la guerre.
Laffont, 1992, gr. in-8°, 317 pp, traduit de l'anglais, une carte, broché, couv. illustrée, bon état
Je vous écris de France. Lettres inédites à la BBC 1940-1944.
L'Iconoclaste, 2014, gr. in-8°, 286 pp, préface de Jean-Louis Crémieux-Brilhac, nombreuses photos et fac-similés en noir et en couleurs, broché, couv. illustrée à rabats, bon état, envoi a.s.
Un témoignage unique et inédit sur le quotidien des milliers de Français qui ont placé leur espoir dans la France libre. Entre 1940 et 1944, des milliers de Français écrivent à la BBC. Jamais ils n'ont la certitude d'être lus tant les obstacles sont nombreux jusqu'à Londres. Malgré l'interdit, ils s'adressent en toute liberté à cette radio qui, depuis l'Angleterre, les encourage à résister. Soixante-dix ans plus tard, ces lettres sortent de l'oubli, miraculeusement intactes. De village en village, c'est toute une nation qui raconte l'Histoire telle qu'elle a été vécue : privations, arrestations, collaboration ou résistance, rumeurs de débarquement... De l'Alsace à l'Aquitaine, les voici. Vibrantes, uniques, inoubliables.
LUNEAU (Aurélie), Jeanne GUÉROUT, Stefan MARTENS.
Reference : 123038
(2016)
ISBN : 9791095438205
Comme un Allemand en France. Lettres inédites sous l'occupation 1940-1944.
L'Iconoclaste, 2016, in-8° carré, 300 pp, nombreuse photos et fac-similés en noir et en couleurs, une carte en couleurs, chronologie, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
Ils sont 80.000 en 1941, près d'un million à la veille du débarquement en juin 1944. Issus de tous les milieux et de toutes les régions, certains quittent leur foyer pour la première fois. Cinq années durant, ces Allemands qui occupent la France écrivent à leur familles, se confient à leurs journaux intimes, croquent leur quotidien dans des calepins, photographient les paysages. Avec le temps, leurs sentiments évoluent. Les lettres des premiers mois se veulent rassurantes, et même fanfaronnes ; peu à peu, le doute s'installe. Certains ont une foi absolue en Hitler. D'autres, tel le jeune soldat Heinrich Böll, futur Prix Nobel de littérature dont les lettres sont traduites pour la première fois, sont gagnés par l'empathie et tissent des liens avec les Français. Il a fallu deux années de recherche en Allemagne pour trouver, sélectionner et rassembler ces écrits complètement inédits en France. Ils renouvellent de manière passionnante notre regard sur cette période. Entre les lignes se dessine un nouveau visage de l'Occupant, plus complexe, plus subtil. Sous la plume des Allemands, une autre guerre nous est racontée.
La Grande Rafle du Vel d'Hiv. 16 juillet 1942.
Laffont, 1967, gr. in-8°, 269 pp, préface de Joseph Kessel, 16 pl. de photos et documents hors texte, sources et biblio, broché, couv. illustrée à rabats, bon état (Coll. Ce jour-là)
Imaginé par l'esprit pervers d'Heydrich et rendu possible par la complicité de Pierre Laval, un plan diabolique vient d'être mis sur pied. 27.388 fiches ont été préparées par les soins des services préposés aux questions juives. Le 16 juillet 1942, à l'aube, plus de 9.000 hommes des forces de l'ordre, sous contrôle de l'occupant, déclenchent l'une des plus grandes opérations policières menées dans Paris depuis l'arrestation des Templiers et la Saint-Barthélemy : ce jour-là, et le lendemain, 12.884 juifs étrangers ou d'origine étrangère vont être arrêtés. On expédie directement en Allemagne ou en Pologne, via Drancy, les célibataires ou les couples sans enfants ; les familles avec enfants sont concentrées au Vél d'Hiv : plus de 7.000 personnes vont demeurer prisonnières sous cette immense verrière, dans une chaleur effroyable, presque sans eau. Parmi elles, 4.051 enfants... Cela s'appelait l'opération «Vent Printanier». — "Nous assistons, dans ce livre profondément émouvant et accusateur, à la grande rafle des Israélites français entassés au Vél. d'Hiv. avant leur envoi par wagons et trains entiers, dans les sinistres camps de la mort d'Allemagne et de Pologne, d'Auschwitz en particulier. Entreprise qui, imposée par les dirigeants de l'Allemagne hitlérienne, fait partie de cette politique de génocide, que le national-socialisme prétendit étendre à l'Europe entière. Les auteurs, dont l'un, Paul Tillard, est ancien déporté de Mauthausen, se gardent de tout effet littéraire. Leur récit a le ton d'un rapport et constitue un témoignage historique irréfutable sur l'antisémitisme des sectateurs de Mein Kampf. Il apparaît aussi, hélas, que cette grande rafle fut une opération entièrement exécutée par la police et la gendarmerie françaises, dirigée par de hauts fonctionnaires de Vichy ; les instructions de l'occupant excluaient de l'extermination par les gaz les Juifs de moins de 16 ans : ce furent des fonctionnaires vichyssois, Laval en tête, qui insistèrent pour que les enfants fussent aussi arrêtés, et les auteurs nous content que devant cette proposition transmise à Berlin, Eichmann, le bourreau des Juifs, fut tellement estomaqué à la réception de la dépêche, qu'il mit quinze jours à répondre par l'affirmative." (Jean Hugonnot, Bulletin de la Société d'histoire moderne, 1967) — “La Grande Rafle du Vel d’Hiv” est le document de référence sur le crime du « Jeudi noir » de juillet 1942. Des témoins se souviennent, des acteurs parlent. La responsabilité des autorités de Vichy apparaît, décisive. Claude Lévy a rejoint la Résistance dès 1942. Arrêté en décembre 1943, livré aux Allemands par les autorités de Vichy, il est déporté en juillet 1944. Il s’évade fin août et rejoint le maquis. Il sera démobilisé en 1945. – Engagé très tôt dans la Résistance, Paul Tillard est arrêté par la police de Vichy en août 1942 et déporté au camp de Mauthausen. Dès son retour, il publie le premier témoignage français sur les camps nazis.
La Grande Rafle du Vel d'Hiv. 16 juillet 1942.
Laffont, 1992, gr. in-8°, 288 pp, préface de Joseph Kessel, 16 pl. de photos et documents hors texte, postface, annexes, biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Ce jour-là)
Imaginé par l'esprit pervers d'Heydrich et rendu possible par la complicité de Pierre Laval, un plan diabolique vient d'être mis sur pied. 27.388 fiches ont été préparées par les soins des services préposés aux questions juives. Le 16 juillet 1942, à l'aube, plus de 9.000 hommes des forces de l'ordre, sous contrôle de l'occupant, déclenchent l'une des plus grandes opérations policières menées dans Paris depuis l'arrestation des Templiers et la Saint-Barthélemy : ce jour-là, et le lendemain, 12.884 juifs étrangers ou d'origine étrangère vont être arrêtés. On expédie directement en Allemagne ou en Pologne, via Drancy, les célibataires ou les couples sans enfants ; les familles avec enfants sont concentrées au Vél d'Hiv : plus de 7.000 personnes vont demeurer prisonnières sous cette immense verrière, dans une chaleur effroyable, presque sans eau. Parmi elles, 4.051 enfants... Cela s'appelait l'opération «Vent Printanier». — "Nous assistons, dans ce livre profondément émouvant et accusateur, à la grande rafle des Israélites français entassés au Vél. d'Hiv. avant leur envoi par wagons et trains entiers, dans les sinistres camps de la mort d'Allemagne et de Pologne, d'Auschwitz en particulier. Entreprise qui, imposée par les dirigeants de l'Allemagne hitlérienne, fait partie de cette politique de génocide, que le national-socialisme prétendit étendre à l'Europe entière. Les auteurs, dont l'un, Paul Tillard, est ancien déporté de Mauthausen, se gardent de tout effet littéraire. Leur récit a le ton d'un rapport et constitue un témoignage historique irréfutable sur l'antisémitisme des sectateurs de Mein Kampf. Il apparaît aussi, hélas, que cette grande rafle fut une opération entièrement exécutée par la police et la gendarmerie françaises, dirigée par de hauts fonctionnaires de Vichy ; les instructions de l'occupant excluaient de l'extermination par les gaz les Juifs de moins de 16 ans : ce furent des fonctionnaires vichyssois, Laval en tête, qui insistèrent pour que les enfants fussent aussi arrêtés, et les auteurs nous content que devant cette proposition transmise à Berlin, Eichmann, le bourreau des Juifs, fut tellement estomaqué à la réception de la dépêche, qu'il mit quinze jours à répondre par l'affirmative." (Jean Hugonnot, Bulletin de la Société d'histoire moderne, 1967) — “La Grande Rafle du Vel d’Hiv” est le document de référence sur le crime du « Jeudi noir » de juillet 1942. Des témoins se souviennent, des acteurs parlent. La responsabilité des autorités de Vichy apparaît, décisive. Claude Lévy a rejoint la Résistance dès 1942. Arrêté en décembre 1943, livré aux Allemands par les autorités de Vichy, il est déporté en juillet 1944. Il s’évade fin août et rejoint le maquis. Il sera démobilisé en 1945. – Engagé très tôt dans la Résistance, Paul Tillard est arrêté par la police de Vichy en août 1942 et déporté au camp de Mauthausen. Dès son retour, il publie le premier témoignage français sur les camps nazis.
Drames et secrets de la Résistance. Des ombres enfin dissipées.
Presses de la Cité, 1984, gr. in-8°, 268 pp, 16 pl. de photos et documents hors texte, index, broché, état correct
A nous Auvergne ! La vérité sur la Résistance en Auvergne, 1940-1944.
Presses de la Cité, 1974, in-8°, 493 pp, 71 photos et documents sur 32 planches hors texte, une carte (réduits du mont Mouchet et de la Truyère), sources et biblio, annexes, copieux index (p. 465-488), cart. éditeur, sans la jaquette, bon état
Les régions montagneuses de la France ont été les bastions privilégiés de la Résistance. Il y a eu le Vercors et chacun en connaît l'héroïque histoire. Il y a eu aussi l'Auvergne dont l'épopée est moins connue. Cette lacune est aujourd'hui comblée. “A nous, Auvergne !” écrit par deux authentiques résistants, fait revivre au jour le jour la lutte contre l'occupant. Un ouvrage solide, fruit d'une longue enquête non seulement auprès des survivants, mais aussi auprès des adversaires d'hier. Le témoignage authentique et définitif sur la Résistance en Auvergne.
Division Nordland. Dans l'hiver glacé, devant Leningrad.
Grancher, 1997, gr. in-8°, 310 pp, 16 pl. de photos hors texte, 9 cartes et plans, broché, couv. illustrée, bon état
Créée début 1943, la division "Nordland" était composée de quelques milliers de Norvégiens et de Danois, de quelques centaines de Suisses, de dizaines de Suédois et même d'une poignée de Britanniques. Sitôt la division opérationnelle, l'état-major la dirige en plein hiver sur le front de Leningrad assiégée, face à la position soviétique d'Orianenbaum, qui résiste depuis 1941 à tous les assauts. C'est au tour des Russes de prendre l'offensive et ils repoussent les envahisseurs jusque dans les pays baltes. Pendant de longs mois, les volontaires germaniques se battent à Narva. Puis ils tentent de constituer en Estonie un front défensif, aux côtés des Hollandais, des Flamands et des Wallons de la Waffen SS. En dépit de ce renfort, ils doivent battre en retraite jusqu'en Courlande. Début 1945, la division "Nordland" échappe à l'encerclement en étant évacuée par mer vers la Poméranie. C'est là qu'échouera la dernière contre-attaque allemande, à la fin de l'hiver. Quelques centaines de survivants gagneront alors Berlin où ils livreront un ultime combat désespéré, appuyés par quelques Espagnols et un bataillon de marche de volontaires français de la division "Charlemagne".
La Bataille des Alpes 1944-1945.
Presses de la Cité, 1986-1990, 2 vol. gr. in-8°, 318 et 288 pp, 32 pl. de photos hors texte, 5 cartes, ordres de bataille en annexes, sources, brochés, couv. illustrées, bon état
Les exploits de la 7e brigade du colonel Le Ray. – Au début du mois de novembre 1944, trois bataillons de FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur issues de la Résistance, venant de l'Isère, arrivent en haute Maurienne. Les chasseurs de montagne allemands et les parachutistes italiens de la division "Folgore" ont été chassés de la vallée de l'Arc, mais ils tiennent les cols de la frontière et tout le massif du Mont-Cenis. Après avoir mené, pendant un très rude hiver, une guerre de harcèlements et de patrouilles, les éclaireurs-skieurs des 6e, 11e et 15e BCA passent à l'attaque au printemps 1945... Tome 1 : Maurienne – Novembre 1944-Mai 1945. Tome 2 : Septembre 1944-Mai 1945. Mont-Blanc, Tarentaise, Haute-Maurienne, Névachie.
La Division "Tête de mort" sur le front de l'Est, 1941-1945.
Grancher, 1994, in-8°, 261 pp, nombreuses photos, cartes, annexes, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
De toutes les unités allemandes engagées sur le Front de l'Est, la division Totenkopf « Tête de mort » fut l'une des plus redoutables. Se targuant d'avoir été recrutés parmi les formations de l'Ordre noir SS, les combattants de choc qui servaient dans ses rangs étaient considérés comme des nationaux-socialistes fanatiques à qui on pouvait confier les plus dures missions. C'est sur le Front de l'Est que la « Tête de mort » devait donner toute sa mesure ; elle y gagna une réputation qui amena tous les généraux à souhaiter son intervention dans leur secteur. La division participa à la grande attaque sur Leningrad et s'ouvrit de vive force un passage à travers la ligne Staline. Encerclée au sud-est du lac Ilmen, par un froid de -40°, les combattants allemands, ravitaillés par avion, parvinrent à résister à tous les assauts russes. Pratiquement réduite à néant après ces durs combats, la Totenkopf fut reformée en France et équipée de blindés. Elle participa à la reprise de Kharkov avant de devenir, quelques mois plus tard, une unité d'intervention que l'on engageait partout où le Front allemand craquait sous les coups de boutoir des forces soviétiques, lancées dans la course vers l'ouest et le Reich lui-même. Les rares survivants de la formation se battirent en Autriche dans les derniers jours de la guerre. Ils furent livrés aux Soviétiques par les Américains. Bien peu revinrent des camps de prisonniers.
La Division Wiking. Dans l'enfer blanc : 1941-1943.
Fayard, 1980, gr. in-8°, 360 pp, 32 pl. de photos hors texte, biblio, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
Au printemps 1940, alors que la guerre à l’Ouest vient seulement de commencer, les Allemands ouvrent des bureaux de recrutement à Copenhague et à Oslo, à La Haye et à Anvers. Au nom d'une idéologie “germanique”, inspirée par de très lointains souvenirs historiques, ils vont ouvrir les rangs de la Waffen SS. garde prétorienne du régime national-socialiste, à des volontaires danois, norvégiens, hollandais et flamands. Par la suite des engagés suédois, finlandais et même suisses seront réunis dans une formation militaire forte de près de vingt mille hommes : la division Wiking. A sa tête, un ancien officier des troupes d’assaut de la Première Guerre mondiale : Félix Steiner. La “division des huit nationalités” combattra sur le front de l’Est dès les premiers jours de l’offensive de juin 1941 jusqu’aux ultimes engagements de mai 1945. Dans ce premier volume, les volontaires germaniques franchissent les frontières de l’Union Soviétique, participent aux grandes batailles d'encerclement de l’Ukraine, prennent et perdent Rostov-sur-le-Don. C’est alors le terrible hiver sur le Mious. Au printemps 1942, l’offensive reprend vers le Caucase. Les grenadiers de la division Steiner vont se battre au pied des plus hauts sommets et tenter désespérément d’atteindre Bakou et les puits de pétrole de la mer Caspienne. L’échec de l’offensive du printemps 1942 annonce le désastre allemand de Stalingrad. La division Wiking doit se replier au cours d’une hallucinante retraite d’hiver, marquée par les combats les plus implacables contre l’ennemi et contre le froid glacial. Au printemps 1943, il ne reste plus que quelques survivants parmi les premiers volontaires, quand l’unité est reformée en Panzerdivision et gagne de nouveaux champs de bataille, toujours sur le front d’Ukraine.
Les Panzers de la Garde noire.
Presses de la Cité, 1985, gr. in-8°, 332 pp, 16 pl. de photos hors texte, 3 cartes, annexes, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Forte d'une simple compagnie en 1933, la garde personnelle d'Adolf Hitler, la "Leibstandarte", est devenue, une dizaine d'années plus tard, une Panzerdivision qui fut parmi les plus redoutables de la Waffen SS. Cette troupe d'élite, formée de jeunes soldats sélectionnés pour leur stature, leur fanatisme et leur courage, a combattu sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale. Commandée par le légendaire lansquenet bavarois "Sepp" Dietrich, elle a participé aux offensives les plus triomphales comme aux combats les plus désespérés. En Pologne, en Hollande, en Macédoine, en Grèce, en Ukraine, en Normandie, dans les Ardennes ou en Hongrie, les hommes de la Garde Noire du Führer ont toujours été à la pointe de l'armée allemande. A l'approche de la défaite, ses Panzers ont vainement tenté de forcer la décision, et le sacrifice des régiments de la "Leibstandarte" achève l'aventure militaire du IIIe Reich.
Les Samouraï.
Balland, 1972, in-8°, 387 pp, 56 pl. de gravures et photos hors texte, annexe (périodes historiques du Japon), biblio, reliure skivertex éditeur
Les Assistantes sociales au temps de Vichy. Du silence à l'oubli.
L'Harmattan, 1995, gr. in-8°, 172 pp, sources et biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Mémoires.
Presses de la Cité, 1965, in-8°, 309 pp, 24 pl. de photos hors texte, 7 cartes, cart. éditeur (lég. défraîchi), sans la jaquette, état correct
Douglas MacArthur (1880-1964) est un général américain. Il reçut la médaille d'honneur, ainsi que le commandement suprême des forces alliées dans le sud-ouest du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Il dirigea la défense de l'Australie et la reconquête de la Nouvelle-Guinée, des Philippines et de Bornéo. Il était prêt à envahir le Japon en novembre 1945, mais accepta à la place leur capitulation le 2 septembre 1945. Il fut responsable de l'occupation du Japon de 1945 à 1951. Il s'occupa également des forces des Nations unies défendant la Corée du Sud contre la Corée du Nord en 1951. MacArthur fut démis de ses fonctions par le président des États-Unis Harry S. Truman en avril 1951 au vu de ses préférences stratégiques durant la guerre de Corée. Il comptait attaquer la République populaire de Chine, puis la Corée du Nord avec des bombes atomiques avant d'entamer des négociations avec les Soviétiques. Le général MacArthur prit part à trois guerres majeures (la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée) et monta jusqu'au rang de général d'armée (cinq étoiles). Il devint ainsi l'une des cinq personnes ayant occupé cette position dans l'histoire des Etats-Unis. Il est toujours l'un des soldats les plus décorés dans l'histoire militaire des États-Unis. MacArthur reste l'une des figures les plus controversées de l'histoire militaire américaine. Certains l'admirent pour ses talents de stratège tandis que d'autres le critiquent pour certaines de ses actions, notamment son rôle lors du procès de Tokyo. Il permit à de nombreux accusés, dont des membres de la famille impériale, d'échapper à la justice du tribunal. Son face à face avec Truman en 1951 divisa également l'opinion à son sujet.
Enfer à Malte.
Le Livre Contemporain, 1958, in-8°, 341 pp, traduction et adaptation d'Anne Argela et Marcel Jullian (“The Heavens are Not Too High”), cart. éditeur, jaquette illustrée (lég. abîmée), bon état (Coll. Visages de l'aventure)
Roman inspiré par ses combats à Malte en 1942 par un ancien pilote de la Royal Canadian Air Force. — "Peu de récits de guerre ont su transmettre avec autant d'intensité la violence des combats dans le ciel de Malte au cours des mois critiques de l'été 1942,. C'était la bataille jusqu'au dernier Spitfire, jusqu'au dernier homme – et les rares qui ont connu la gloire plutôt que la mort trouvaient du réconfort dans ce qui leur tombait sous la main, en général du vin et des femmes. C'est un roman sombre mais vivant, peuplé de personnages de la R.A.F. qu'il n'est pas facile d'oublier ; et si, par endroits, il n'est pas destiné aux lecteurs délicats, il a l'impact de la vérité." (Manchester Evening News) — Située à un endroit stratégique de la Méditerranée entre la Sicile et la Tunisie, l’île de Malte a été déterminante pour les Britanniques lors du second conflit mondial. En 1941, Malte était un grain de sable dans le dispositif de ravitaillement de l’Axe : les Britanniques se renforçant sur l’île attaquaient avec efficacité les convois de ravitaillement ennemis. Le bombardement de l’île s’intensifia. Les Britanniques augmentèrent le nombre de chasseurs sur l’île, dont les pilotes de la RAF défendirent ardemment les installations. Le ravitaillement de Malte se faisait dans des conditions terribles, en particulier le carburant indispensable aux avions défendant l’île. On dénombra plus de 1700 raids aériens (plus de tonnes de bombes sont tombées sur cette île que pendant toute la bataille d’Angleterre)...
 Write to the booksellers
Write to the booksellers