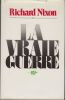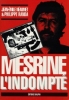Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
19th (2)
20th (4040)
21st (510)
-
Syndicate
ILAB (4563)
SLAM (4563)
Copains de Vol. Avec 15 Illustrations de Luc-Marie Bayle.
Editions du Survol, 1947, pt in-8°, 168 pp, broché, couv. illustrée, bon état
La Vraie Guerre.
Albin Michel/GLM, 1980, gr. in-8°, 364 pp, traduit de l'américain, cart. éditeur, jaquette, bon état
Richard Nixon, l'homme qui a traité avec Khrouchtchev du destin de la planète, qui a négocié avec Brejnev, qui est allé à Pékin tendre la main à Chou En-lai et changer ainsi le cours de l'Histoire, fait aujourd'hui une rentrée fracassante sur la scène internationale. Ce livre, par la vision qu'il donne de notre monde et le programme de « combat » qu'il contient, constitue un véritable manifeste, qui est aussi un cri du coeur. « Nous devons regarder en face l'impitoyable réalité », proclame Nixon. « La Troisième Guerre mondiale est commencée, et nous sommes en train de la perdre ! » Possédant à la fois un point de vue « incomparable » en tant qu'ancien président des Etats-Unis, et la liberté de s'exprimer qui est celle de tout citoyen privé, Richard Nixon nous présente un tableau magistral des blocs en présence, qui luttent pour la suprématie mondiale. Il explique leurs buts, leur stratégie, leur tactique ; il mesure leur puissance, détecte leurs faiblesses. Il analyse, avec justesse et subtilité, ce qui va et ce qui ne va pas dans les relations des Occidentaux avec les dirigeants soviétiques et ceux des pays satellites de l'URSS. Il évalue les implications de la situation internationale et de sa prévisible évolution dans les prochaines années, non seulement sur le plan militaire mais aussi au niveau économique et social, et en ce qui concerne les perspectives d'avenir de la société libérale. Et Nixon montre comment l'Occident peut sortir vainqueur de cette lutte. Par exemple en suscitant dans les pays du bloc opposé des dépendances économiques qu'iIs ne pourraient compromettre par, un aventurisme militaire... Extraordinaire témoignage de l'homme qui a côtoyé le plus grand nombre de chefs d'Etat et de gouvernement, ce livre capital de Richard Nixon nous exhorte à nous ressaisir avant qu'il ne soit trop tard, à rassembler nos forces pour assurer la survie du monde libre.
La Vraie Guerre.
Albin Michel, 1980, gr. in-8°, 364 pp, traduit de l'américain, broché, bon état
Richard Nixon, l'homme qui a traité avec Khrouchtchev du destin de la planète, qui a négocié avec Brejnev, qui est allé à Pékin tendre la main à Chou En-lai et changer ainsi le cours de l'Histoire, nous donne ici un véritable manifeste, par la vision qu'il donne de notre monde et le programme de « combat » qu'il contient. « Nous devons regarder en face l'impitoyable réalité », proclame Nixon. « La Troisième Guerre mondiale est commencée, et nous sommes en train de la perdre ! » Possédant un point de vue « incomparable » en tant qu'ancien président des Etats-Unis, Richard Nixon nous présente un tableau magistral des blocs en présence, qui luttent pour la suprématie mondiale. Il explique leurs buts, leur stratégie, leur tactique ; il mesure leur puissance, détecte leurs faiblesses. Il analyse, avec justesse et subtilité, ce qui va et ce qui ne va pas dans les relations des Occidentaux avec les dirigeants soviétiques et ceux des pays satellites de l'URSS...
La République libérale. Causeries sur quelques sujets actuels suivies d'un appendice contenant le texte de la loi de séparation, celui des encycliques pontificales, etc.
Plon, 1905, in-12, 425 pp, reliure demi-toile verte, dos lisse avec titres dorés et filets à froid (rel. de l'époque), bon état
Par Georges Noblemaire (1867-1923), polytechnicien, catholique sincère, mais d'un libéralisme avancé. Il sera député des Hautes-Alpes de 1919 à 1923. Dans cet ouvrage, il écrit dans la préface, à propos de la séparation : « Certes, je ne veux pas dire que dans les origines de cette guerre, tous les torts soient du même côté ; il est sage et libéral de reconnaître que certaines concessions, faites en temps utile, auraient pu retarder ou empêcher l'ouverture des hostilités. C'est ainsi que la doctrine républicaine implique et exige l'indépendance et la suprématie du pouvoir civil. A ce principe raisonnable et nécessaire, il aurait sans doute fallu adhérer sans restrictions ; pour notre part, nous le faisons, nous, sans la moindre réserve ». Et ailleurs : « Je persiste à redouter, comme un péril mortel, l'intransigeance aveugle de ces politiciens pseudo-catholiques qui n'ont jamais fait que du mal au catholicisme, sous prétexte d'en faire a la République et qui, en définitive, ne servent pas mieux leur religion que leur pays. Énergumènes de gauche et de droite, ils sont bien quelques milliers qui tiennent de la place et font du bruit comme myriades... ». — Table : La République Libérale. – Sur l'Armée. – Le Père, ou l'État ? – Le Devoir Social. – Sur la Presse. – Trois discours sur la Séparation des Églises et de l'État. – Appendices.
Une histoire politique de l'armée, 1919-1967.
Seuil, 1967, 2 vol. in-8°, 333 et 383 pp, brochés, état correct
Tome 1 : De Pétain à Pétain, 1919-1942 (par Jacques Nobécourt) ; Tome 2 : De de Gaulle à de Gaulle, 1940-1967 (par Jean Planchais). — "Ces deux volumes, qui témoignent de la compétence des auteurs et de la qualité de leur information, le premier plus essai psychologique, le second plus chronique historique, proposent non pas l'histoire, mais une histoire de l'armée française, non pas une synthèse définitive mais une observation et une explication de l'évolution de cette armée. C'est, en outre, une histoire politique, traitée essentiellement du point de vue des rapports entre pouvoirs civil et militaire, toutes considérations d'ordre tactique ou stratégique étant écartées. Trois remarques s'imposent plus particulièrement à la lecture de l'ouvrage : on est tout d'abord frappé par le nombre d'officiers hors série qui ont imposé depuis 1914 leur marque aux événements ; en second lieu, il apparaît que tous ont « fait de la politique », même ceux qui s'en défendaient ; enfin, on mesure à quel point l'influence politique de l'armée est avant tout celle des états-majors, c'est-à-dire celle d'une caste trop souvent attachée à « un nationalisme étroit ou à un ordre naïvement conservateur »." (Revue française de science politique, 1968)
La Vie quotidienne en France au temps du Front populaire, 1935-1938.
Hachette, 1977, in-8°, 306 pp, broché, couv. illustrée, bon état
Agé de vingt ans en 1936, Henri Noguères a vécu intensément les « 1000 jours »du Front populaire : d'abord comme dirigeant du Groupe de Paris des Etudiants socialistes, puis comme benjamin de la rédaction du Populaire. Il en deviendra le rédacteur en chef dix ans plus tard, au sortir de la guerre et de la Résistance. « Ceci explique, écrit-il, qu'il me soit facile d'évoquer, après quarante années écoulées, le Front populaire – mais impossible d'en parler sans passion... » — Le temps du Front populaire, en France, c'est une période de 1000 jours... 1000 jours d'un combat incessant opposant dans la rue, à l'usine, au bureau, les militants luttant pour « le pain, la paix, la liberté », aux nostalgiques du 6 février, dont certains déjà regardent avec envie du côté de l'Allemagne et de l'Italie. 1000 jours exaltants, dominés par l'explosion sociale de juin 1936, le vote d'un ensemble de réformes sans précédent dans l'histoire de la France, la conquête du droit aux loisirs et les étapes d'une véritable révolution culturelle. Mais 1000 jours décevants aussi – et parfois angoissants – marqués par le drame espagnol, le suicide de Roger Salengro, la fusillade de Clichy, les crimes et les provocations de « La Cagoule », l'action conjuguée de toutes les forces hostiles et la victoire, finalement, de la plus puissante d'entre elles : l'argent...
La Résurrection de Versailles. Souvenirs d'un conservateur, 1887-1920.
Perrin, Société des Amis de Versailles, 2002, in-8°, xix-250-(2) pp, présentés et annotés par Christophe Pincemaille, préface d'Olivier de Rohan, un portrait de Nolhac en frontispice, broché, couv. illustrée, bon état
Dans les années 1830, d'un palais d'habitation, Louis-Philippe avait fait de Versailles un musée dédié à toutes les gloires de la France. Pierre de Nolhac (1859-1936), nommé conservateur du château en 1887, tomba littéralement sous le charme. Il se fit historien des règnes de Louis XV et de Louis XVI et le biographe de Marie-Antoinette. Il multiplia les recherches sur la cour et les travaux des bâtiments du roi, qu'il regroupa en une série de dix ouvrages sous le titre général "Versailles et la cour de France". Ses travaux firent date, sa méthode école. Pendant trente ans, il oeuvra à sa résurrection et, en rétablissant un état historique, il lui restitua un semblant d'âme. Ses souvenirs fourmillent d'anecdotes sur des trésors oubliés, sur les restaurations ou les expositions qu'il organisa, sur la visite des souverains étrangers, sur la Grande Guerre...
La Haganah. L'armée secrète d'Israël.
Balland, 1972, in-8°, 327 pp, 44 pl. de photos et cartes hors texte, biblio, reliure skivertex éditeur, bon état
Le Fascisme dans son époque. 1. L'Action française.
Julliard, 1970, in-8°, 407 pp, traduit de l'allemand, cart. éditeur, sans la jaquette, bon état
Ernst Nolte est devenu célèbre, au début des années soixante, grâce à ce livre ambitieux et remarquable où il interprètait le fascisme comme un phénomène européen dont il analysait trois variantes principales – le régime de Mussolini en Italie, le national-socialisme allemand et l'Action française. La thèse de l'auteur, qui voit dans le maurrassisme la première forme du fascisme, a suscité des polémiques en son temps. — "Le fascisme fait l'objet de nombreuses définitions : réaction de classe contre la montée du marxisme, réflexe de peur chez la petite bourgoisie menacée de prolétarisation, fer de lance de l'impérialisme. A travers les trois tomes de son ouvrage, l'historien allemand Ernst Nolte ne se contente pas de donner une analyse historico-économique du phénomène. Il entreprend une étude philosophique éclairant l'essence commune aux doctrines de Maurras, Mussolini et Hitler. Ainsi dévoile-t-il chez eux l'angoisse de certains groupes humains refusant de laisser mettre en cause, par les mutations de la civilisation, le caractère prétendu absolu de leur personnalité et la volonté de sauver celle-ci en figeant l'homme dans un modèle intangible : tel l'Aryen opposé avantageusement au Juif. Mais le fasciste ne se manifeste pas seulement par le racisme ou la xénophobie. Sa haine de l'altérité s'étend à tous ceux dont l'appartenance à un groupe social, ethnique ou religieux autre que le sien, lui fait éprouver le tragique de sa propre relativité. On discerne sans peine un sentiment analogue dans l'Action française. Sans doute, ce mouvement essaya-t-il de substituer dans l'imagination ouvrière l'ennemi racial à l'ennemi de classe. La pensée de Maurras n'en dissimule pas moins une anxiété d'origine esthétique et métaphysique. Epris de la beauté classique, il redoute que la promotion des masses ne défigure la beauté fragile de « la déesse France », beauté inséparable selon lui des positions sociales existantes et qui doit être défendue contre les adversaires de sa pureté : esprit révolutionnaire menaçant la fortune des particuliers et donc celle du pays, « métèques » corrupteurs de l'Unité nationale, romantisme allemand troublant l'harmonie des siècles antiques..." (Jean-Claude Labracherie, revue Esprit, 1972)
Le Fascisme dans son époque. 3. Le National-socialisme.
Julliard, 1970, in-8°, 504 pp, traduit de l'allemand, cart. éditeur, sans la jaquette, bon état
Ernst Nolte est devenu célèbre, au début des années soixante, grâce à ce livre ambitieux et remarquable où il interprètait le fascisme comme un phénomène européen dont il analysait trois variantes principales – le régime de Mussolini en Italie, le national-socialisme allemand et l'Action française. La thèse de l'auteur, qui voit dans le maurrassisme la première forme du fascisme, a suscité des polémiques en son temps. — "Le fascisme fait l'objet de nombreuses définitions : réaction de classe contre la montée du marxisme, réflexe de peur chez la petite bourgoisie menacée de prolétarisation, fer de lance de l'impérialisme. A travers les trois tomes de son ouvrage, l'historien allemand Ernst Nolte ne se contente pas de donner une analyse historico-économique du phénomène. Il entreprend une étude philosophique éclairant l'essence commune aux doctrines de Maurras, Mussolini et Hitler. Ainsi dévoile-t-il chez eux l'angoisse de certains groupes humains refusant de laisser mettre en cause, par les mutations de la civilisation, le caractère prétendu absolu de leur personnalité et la volonté de sauver celle-ci en figeant l'homme dans un modèle intangible : tel l'Aryen opposé avantageusement au Juif. Mais le fasciste ne se manifeste pas seulement par le racisme ou la xénophobie. Sa haine de l'altérité s'étend à tous ceux dont l'appartenance à un groupe social, ethnique ou religieux autre que le sien, lui fait éprouver le tragique de sa propre relativité..." (Jean-Claude Labracherie, revue Esprit, 1972)
NORMAND (C.) et P. Caussat, J.-L Chiss, J. Médina, C. Puech, A. Radzinski.
Reference : 75578
(1978)
Avant Saussure : choix de textes, 1875-1924.
Bruxelles, Complexe, 1978, gr. in-8°, 216 pp, notes biographiques, biblio, index, broché, bon état
"... C’est en qualité d’historienne que Claudine Normand publie en 1978 (avec la collaboration de Pierre Caussat, Jean-Louis Chiss, Jacques Medina, Christian Puech et Annie Radzinski) un “Avant Saussure”. C’est un recueil de textes qui situe l’œuvre du maître de Genève dans son contexte historique, et offre, en supplément, quelques-uns des comptes rendus auxquels a donné lieu la publication, en 1916, du “Cours de linguistique générale”. De Meillet à Jespersen, de Vendryès à Bloomfield, de Séchehaye à Schuchardt, on repère, tant par les approbations que par les réserves, le rôle qu’allait prendre le Cours dans l’évolution ultérieure de la linguistique." (Michel Arrivé, « Hommage à Claudine Normand », Langages 1/2012)
Les Entreprises modernes. Le grand commerce de détail.
Perrin, 1920, in-12, xv-300 pp, préface de J. Noulens, reliure demi-chagrin acajou, dos à 5 nerfs soulignés à froid muet (rel. de l'époque), bon état
"... Toute entreprise, toute organisation nouvelle dont les modalités ont pour but la simplification des rouages économiques et l'aboutissement à une réduction des prix, devrait, si l’on en croit le bon sens, bénéficier de la protection des Pouvoirs publics. Telle est la pensée, de portée générale, qui se dégage, en somme, de l'ouvrage de M. Gilles Normand... Ce volume est intéressant par ses vues nouvelles et par sa documentation...Comme M. Gilles Normand le fait remarquer, les méthodes nouvelles à employer dans le commerce ne consistent pas seulement dans l’amélioration du sort du consommateur, mais aussi dans l'amélioration de celui des employés. Cette amélioration ne peut se faire que par la participation aux bénéfices et par la prime au travail, que certaines Entreprises Modernes ont mises en application..." (Extrait de la préface de Joseph Noulens)
Mémoires d'un Allemand.
Julliard, 1970, in-8°, 506 pp, traduit de l'allemand par Paul-Marie Flecher, cart. éditeur, jaquette, bon état
Seul volume paru en français des Mémoires de ce résistant de la première heure, dont les livres furent mis au pilon par les nazis. Ce volume va de son enfance jusqu'à la guerre. Après une enfance difficile dans un quartier ouvrier de Berlin et des débuts prometteurs d'universitaire et d'écrivain, Ernst Erich Noth (1909-1983) fuit la « peste brune » dès l'arrivée de Hitler à la Chancellerie du Reich. Ce sera le début d'une longue tribulation à travers l'Europe et le monde et la naissance d'un écrivain trilingue (allemand, français, anglais). Il commence par travailler dans plusieurs journaux littéraires parisiens sous le nom « Ernst Erich Noth », déjà utilisé en Allemagne, et publie plusieurs œuvres en langue française. Il s’installe ensuite dans le sud de la France, où il est rédacteur des Cahiers du Sud jusqu’en 1940. En mai 1939, les nazis lui retirent la nationalité allemande et inscrivent ses œuvres sur la liste noire. Entre 1939 et 1940, il est interné deux fois pour raisons politiques ; lors de l’Occupation allemande, il participe à la résistance pendant un an et, aidé par des Américains, réussit à s’enfuir aux Etats-Unis en 1941. Aux Etats-Unis, Noth dirige de 1942 à 1948 le programme de radio en langue allemande de la National Broadcasting Company. Il obtiendra la nationalité américaine en 1948, avec le nom officiel d’Ernst Erich Noth. De 1949 à 1959, il édite le journal littéraire Books abroad et est professeur de langues modernes et littérature dans plusieurs universités américaines. En 1963, il retourne en France, où il est éditeur littéraire et enseigne dans les universités d’universités d’Aix-en-Provence, Marseille et Paris. L’université de Francfort lui délivre en 1971 le titre de docteur refusé en 1933 et Noth y enseigne jusqu’en 1980 comme professeur honoraire.
Le général Saint-Hillier. De Bir Hakeim au putsch d'Alger.
Perrin, 2009, gr. in-8°, 368 pp, notes, sources, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Homme de tous les combats auprès de De Gaulle, Saint-Hillier livre, à travers ses carnets inédits et ses archives personnelles enfin révélés, l'histoire sans fard de la France libre à l'Indochine et l'Algérie. Bernard Saint-Hillier (1911-2004) ne fut pas le combattant le plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale. Il n'eut ni l'aura d'un Leclerc, ni les responsabilités d'un de Lattre. Mais ce guerrier de la première heure tint avec force détails, au jour le jour, un journal que, jusqu'à sa mort, il se refusa de communiquer à quiconque. A l'intérieur, se cache en effet la vraie histoire de la France libre que Saint-Hillier a traversée de bout en bout, lui, le légionnaire de la 13e demi-brigade devenu chef d'état-major de la mythique 1re DFL. Y apparaissent enfin les doutes, désespoirs et turpitudes gommés par la légende et qui permettent de mieux comprendre les rapports entre de Gaulle et les chefs militaires de la France libre, ainsi que les circonstances exactes des combats du Gabon, d'Erythrée, de Syrie, de Bir Hakeim, d'El-Alamein, d'Italie et de France. Grâce à l'autorisation de la famille, Jean-Christophe Notin est le premier à avoir eu le privilège de prendre connaissance de ces carnets, mais aussi de l'exceptionnelle documentation accumulée par le général tout au long de sa carrière. Car Bernard Saint-Hillier prit aussi une part active aux opérations d'après guerre, de l'expédition de Suez à l'Algérie. Au terme d'une longue enquête, l'auteur élucide ainsi le second mystère entourant le général : lui qui commandait alors la 10e division parachutiste, a-t-il été mêlé au putsch du 21 avril 1961 ? Autant que le portrait d'un homme, bien plus complexe qu'il ne le laissait paraître, c'est donc l'histoire incarnée de la France militaire des soixante dernières années que Jean-Christophe Notin relate ici.
Les Etats-Unis et le monde au XXe siècle.
Armand Colin, 1997, gr. in-8°, 352 pp, 10 cartes, biblio, index, broché, état correct
Cet ouvrage présente les principaux aspects de l'action des Etats-Unis dans le monde, depuis leurs débuts sur la scène internationale en 1898, jusqu'à leur victoire dans la guerre froide à la fin de 1991. Il fait le point sur les différents courants d'idées qui animent les acteurs de la politique extérieure américaine - hommes d'Etat et opinion publique - du moralisme d'un Wilson au réalisme d'un Nixon ou d'un Kissinger. En quoi consiste au juste l'impérialisme américain, si souvent dénoncé ? Quel a été le rôle du dollar dans l'économie mondiale ? Comment une sorte de domination culturelle des Etats-Unis a-t-elle pu s'imposer au monde ? Peut-on parler de pax américana ? Les Etats-Unis sont-ils déjà parvenus au sommet de leur puissance et sont-ils désormais confrontés à un inexorable déclin ? En s'appuyant sur les publications récentes de l'historiographie américaine, l'auteur tente de répondre à ces questions par l'examen des impératifs stratégiques et des motivations économiques qui ont conduit la grande démocratie américaine à s'intéresser au monde.
La France de 1940 à nos jours.
Nathan, 1984, gr. in-8°, 250 pp, 14 figures, biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Nathan Université)
Le XXe siècle.
Armand Colin, 1995, gr. in-8°, 534 pp, cartes, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. U), envoi a.s. à un confrère historien
Quand commence réellement le dernier siècle du deuxième millénaire ? Selon quels rythmes se déroule-t-il ? Quels acquis en retenir ? Le XXe siècle s'efface comme les époques antérieures, dans les crises et la généralisation d'un désordre plus ou moins violent... Le XXe siècle apparaît tragique et lumineux : génocides, ethnocides, totalitarismes... caractérisent une époque qui a eu aussi le triste privilège de connaître deux guerres mondiales dans un court laps de temps. Simultanément, l'homme réussit à voler, à explorer le fond des océans, à marcher sur la lune, à faire reculer la maladie... Plus que par le passé, les progrès de la science s'accompagnent d'interrogations croissantes. Et le doute envahit tous les champs du savoir. Cet ouvrage a pour ambition d'appréhender une histoire qui, comme le souligne Paul Veyne, est "faite de beaucoup d'accidentalité, avec quelques noyaux de nécessaire". L'analyse s'inscrit dans le temps long et dans celui, plus court, de la conjoncture. Elle ne se limite pas aux États, mais concerne les sociétés, leurs mentalités, et fait une place aux nouveaux acteurs de la vie contemporaine. Dans un souci de clarté, de nombreuses cartes de synthèse cherchent à offrir des clefs de compréhension des évolutions nationales et internationales.
Petit Atlas historique du XXe siècle.
Armand Colin, 2010, gr. in-8°, 221 pp, 5e édition revue et augmentée, nombreuses cartes, index, broché, couv. illustrée, bon état
La collection des Petits atlas historiques offre un panorama complet, clair et synthétique des grandes périodes de l'histoire, qui répond parfaitement aux attentes des étudiants et des amateurs. Cet atlas historique présente en 47 fiches une analyse essentielle du XXe siècle qui permet de comprendre les évolutions, les rapports conflictuels ou pacifiques entre les Etats, les dynamiques d'intégration et d'exclusion. L'ouvrage identifie les processus qui jalonne l'entrée dans le siècle, le "premier" et le "second" XXe siècle dominé par les superpuissances. Il éclaire les essors, les dépression les bouleversements politiques, économiques et idéologiques de la période. Chacune des fiches se structure autour d'une problématique soutenue par une représentation cartographique exceptionnelle.
Protestantismus und Antisemitismus in der Weimarer Republik.
Francfort et P., Campus Verlag, Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1994, in-8°, 228 pp, broché, bon état. Texte en allemand
11 études érudites par Rita R. Thalmann, Louis Dupeux, Alfred Wahl, Pascale Gruson, etc.
Chemin noir, chemin blanc. Récit d'une intégration.
Editions Henry/Les Ecrits du Nord, 2007, in-8°, 349 pp, broché, couv. illustrée, jaquette illustrée, bon état, envoi a.s.
"Joséphine Noworyta est d'origine polonaise. Jeune immigrée d'une famille ouvrière, elle a épousé en France un mineur de fond. Adulte et autodidacte, elle est devenue infirmière par son goût de l'étude et la force de sa vocation, avant de terminer sa carrière au rang de surveillante-chef du Centre Hospitalier de Lens. En écrivant ainsi le récit de ses joies et de ses peines, l'auteur se livre en exemple. Elle va plus loin que la plupart d'entre nous pour nous donner à lire de quoi inspirer nos propres vies. En cette année de célébration de la polonité, elle affirme devant qui en douterait encore la chance que représentent pour un pays les vagues successives d'une immigration qui nourrit la terre qui les accueille." (Raphaël Lluch, Maire-adjoint de Noyelles-sous-Lens) — "Dans la région, un habitant sur huit est d’origine polonaise. Cette forte présence est l’héritière d’une succession de flux migratoires remontant surtout au début du 20e siècle. L’intégration des Polonais en France ne s’est jamais faite au détriment de leur culture et l’histoire des Polonais du bassin minier du Nord et du Pas de Calais tient une place notable dans le patrimoine français et européen." (Jean-Marie Krajewski, Vice-président du Conseil Général du Pas-de-Calais)
Mesrine l'indompté.
Editions Didro, 2001, in-8°, 169 pp, 23 photos dans le texte et hors texte, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Visages de l'histoire)
Presque trente ans après sa mort, Jacques Mesrine demeure l'ennemi public n°1 le plus célèbre de France. De son enfance tumultueuse à ses années de célébrité, en passant par l'Algérie, ses rapports troubles avec l'OAS, ses évasions spectaculaires et ses braquages audacieux, Jean-Emile Néaumet et Philippe Randa ont reconstitué l'itinéraire exceptionnel de ce truand hors du commun. Pour ce faire, ils ont retrouvé plusieurs de ses complices, adversaires et relations qui, pour la première fois, ont accepté de parler. Des témoignages inédits qui permettent enfin de savoir qui était le véritable Jacques Mesrine...
La Troisième République, 1914-1940.
Armand Colin, 1965, in-12, 221 pp, biblio, broché, couv. lég. salie, bon état (Coll. Armand Colin), envoi a.s. à l'historien Lucien Genet
"Une synthèse claire, équilibrée, des recherches spécialisées sur l'histoire de la France depuis la guerre de mouvement de 1914 jusqu'au coup de force légal du 10 juillet 1940. Ce livre ne demeure pas strictement politique : le chapitre IV est consacré à la vie économique et à la société, le chapitre V à l'Outre-Mer. Il est néanmoins rythmé par les grands événements : La Grande Guerre, la liquidation de la première guerre (1919-1924), Retour à la normale ? (1924-1932), puis viennent l'ébranlement (1933-1936), le Front Populaire, la Chute..." (Revue du Nord, 1969)
La Guerre israélo-arabe.
France-Empire, 1957, in-12, 318 pp, une carte en frontispice, qqs croquis dans le texte, broché, jaquette illustrée, bon état
Dans le secret des princes.
Stock, 1986, in-8°, 341 pp, broché, couv. illustrée, bon état
Alexandre de Marenches a dirigé pendant près de onze ans les services secrets français sous les présidents Pompidou et Giscard d'Estaing.
Orpheline de la Shoah.
Presses de la Renaissance, 2005, in-8°, 238 pp, broché, couv. illustrée, bon état
L'auteure, née en 1940 dans une famille juive, raconte son enfance après la mort de ses parents en déportation, les orphelinats, une expérience ratée d'adoption aux États-Unis, sa dyslexie, son manque d'affection, ses débuts professionnels, la naissance de son fils, son travail de nurse, son témoignage pour la fondation Survivants de la Shoah de Steven Spielberg, sa découverte de la peinture, etc.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers