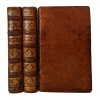-
Type
Book (2358)
Magazine (3)
-
Century
16th (2)
17th (28)
18th (98)
19th (409)
20th (1672)
21st (119)
-
Countries
France (2360)
Switzerland (1)
-
Syndicate
ILAB (2353)
SLAM (2353)
Le Tour du monde de l'amiral Anson (1740-1744). « Le Père de la Royal Navy ».
France-Empire, 1992, in-8°, 422 pp, un portrait de Georges Anson et une carte, broché, couv. illustrée, bon état
"Ce texte, précédé d'une très intéressante introduction de Christian Buchet reproduit presque in extenso la relation de voyage publiée à Amsterdam et Leipzig en 1749, qui connut de nombreuses éditions et des traductions en français, allemand, néerlandais et italien. Quelle aventure que cette circumnavigation qui vit disparaître cinq des six navires et périr plus des quatre cinquièmes de l'équipage ! Elle s'intègre dans l'opposition entre une Espagne qui vit alors des productions coloniales et une Angleterre qui souhaite contrecarrer ce régime de l'exclusif déjà battu en brèche par le traité d'Utrecht. L'Angleterre en réclama la révision et pour ce faire déclara la guerre. Le capitaine Anson avait pour mission notamment de s'emparer des principaux établissements espagnols de la côte pacifique de l'Amérique, tenter de soulever les populations locales et ruiner le commerce avec la métropole. Le récit, rédigé sour le contrôle d'Anson, est passionnant. Le passage du cap Horn et l'entrée dans le Pacifique, avec des bateaux en mauvais état, est des plus dramatiques. Le futur amiral sut faire face à toutes les situations, les plus imprévues et les plus dangereuses, en même temps qu'il prenait conscience de l'état d'impréparation de la Navy auquel il s'attaquerait dès son retour. Ouvrant la période des grandes navigations de la deuxième moitié du XVIIIe siècle au travers du Pacifique, dans un esprit scientifique et non de lucre, il prit conscience de géostratégique de certaines positions insulaires – ainsi des Malouines. Bon observateur des populations rencontrées, il influença la pensée des Lumières et nuança les jugements communément admis sur les Chinois." (Paule Brasseur, Revue française d'histoire d'outre-mer, 1994)
L'Amiral de Coligny et les guerres de religion au XVIe siècle.
P., Société générale de Librairie catholique, 1884, in-12, xiii-435 pp, biblio, reliure demi-basane violine, dos lisse avec titres dorés, fleurons et doubles filets à froid (rel. de l'époque), bon état. Edition originale
"... La thèse du nouvel historien de Coligny est la suivante : il s’agit pour lui de montrer dans le chef des protestants qu’il tient pour hypocrite d’austérité, – l’austérité est connue, en effet, et à louer, par ce temps de mignons et de cours galantes ; l’hypocrisie est à prouver – de montrer, dis-je, dans Coligny un traître à la patrie et au roi. Tout l’effort de l’écrivain porte donc sur la démonstration de ce fait que Coligny recevait des subsides de l’Angleterre, comme les Ligueurs, comme Condé et Turenne après eux en ont reçu de l’Espagne, comme les Vendéens en ont accepté plus tard encore de la même Angleterre. Eh bien ! le fait est exact. Voici donc Coligny, cet ambitieux Coligny, convaincu d’avoir trahi la France et la Royauté : la France, en acceptant l’or anglais pour soutenir la cause protestante ; la Royauté, en menant contre les armées royales les bandes huguenotes..." (Albert Savine, Les étapes d'un naturaliste : impressions et critiques, 1885)
L'Amiral de Coligny et les guerres de religion au XVIe siècle.
Victor Palmé, Société générale de librairie catholique 1884 1 vol. broché in-12, broché, XIII + 435 pp. Edition originale. Couverture défraîchie et poussiéreuse. Sinon exemplaire solide, intérieur en bon état.
La Maréchale de Luxembourg (1707-1787). Souvenirs, documents, témoignages.
P., Emile-Paul, 1924, in-8°, viii-255 pp, un portrait en frontispice sous serpente, broché, dos défraîchi, état correct (Etudes sur le dix-huitième siècle)
"... Ce qui nous importe, c'est bien la grande dame assagie, l'amie de Rousseau, et M. Buffenoir ne nous égare pas en nous parlant d'elle avec une émotion tantôt discrète et tantôt éloquente. Le livre est commode. Il réunit des renseignements dispersés et toujours longs à rassembler. Il n'est pas mal informé. M. Buffenoir connaît bien Rousseau et son temps. Il a eu le juste scrupule de consulter les originaux mêmes des textes importants, les lettres du Maréchal et de la Maréchale de Luxembourg qui sont à la bibliothèque de Neuchâtel. C'était l'essentiel..." (Daniel Mornet, Revue d'histoire littéraire de la France, 1926)
Correspondance inédite à laquelle ont été réunies les lettres publiées jusqu'à ce jour, recueillie et annotée par M. Henri Nadault de Buffon.
P., Hachette, 1860, 2 vol. in-8°, xxxvii-(3)-500 et 644-(3) pp, reliures pleine toile noire, titres et tomaison dorés au dos (rel. de bibliothèque de l'époque), C. de bibl. annulés, qqs rousseurs éparses, bon état. Peu courant
"Buffon avait beaucoup d’esprit, des aperçus heureux et un grand talent pour écrire." (Condorcet)
L'Economie dentellière en région parisienne au XVIIe siècle. (Thèse).
Pontoise, Société historique et archéologique de Pontoise, 1984, gr. in-8°, 390 pp, préface de PIerre Goubert, 13 illustrations sur 12 pl. hors texte, 8 cartes et 2 graphiques, 43 tableaux, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
"Nous savons désormais que ces campagnes du Nord de Paris s'adonnaient à la dentelle. Cette découverte, on la doit à Béatrix de Buffévent. Il a fallu avec une patience et une obstination inimaginables en retrouver les traces dans des papiers dispersés, liasses vénérables, poussiéreuses, humides, crasseuses, souvent illisibles mais d'une richesse inouïe. Le miracle, celui qui transforme l'érudite en historienne, c'est d'avoir saisi et revécu avec cette finesse et cette délicatesse de touche – et de sentiment – le monde des petites dentellières et des rnarchands de dentelle ruraux, de leur fenêtre entr'ouverte et de leurs veillées diligentes, jusqu'aux gros marchands parisiens de la rue Saint-Denis, qui redistribuaient ces fines productions villageoises jusqu'en Scandinavie, dans l'Empire, en Espagne et aux Indes. Le tout sans jamais perdre de vue que dentelliers et dentellières s'inscrivaient dans un village et une paroisse, qu'ils demeuraient de petits paysans polyculteurs et quelque peu éleveurs, tant il est vrai que toute spécialisation se trouvait alors extrêmement rare, y compris dans les campagnes, mêmes parisiennes. On ne saurait exprimer mieux la diversité nuancée d'un monde rural aussi actif qu'intelligent et « débrouillard », et parmi lequel on voit assez rarement apparaître ce personnage présent pourtant en d'autres lieux et d'autres temps : le Bonhomme Misère." (P. Goubert)
Le cardinal de Retz. Portrait.
Plon, 1954, in-12, vii-241 pp, un portrait en frontispice, broché, bon état
Le Chancelier Antoine Duprat.
Hachette, 1935, in-8°, 380 pp, 16 pl. de gravures hors texte, pièces justificatives, broché, bon état
Archevêque de Sens, précepteur de François Ier, le chancelier Duprat faisait engraisser des ânes qu'il présentait à sa table rôtis entiers. "Antoine Duprat naquit à Issoire en 1463. A Saint-Flour d'abord, à Issoire ensuite, les Duprat s'étaient enrichis dans le négoce, cumulant d'ailleurs avec leurs opérations professionnelles des magistratures ou des charges municipales, des offices seigneuriaux et royaux. Après de solides études juridiques, Antoine débuta dans la carrière officielle en qualité de lieutenant du bailliage de Montferrand. On le trouve en 1495 avocat général au parlement de Toulouse, en 1503 maître des requêtes de l'Hôtel, en 1507 président au parlement de Paris, en 1508 premier président. Dès 1515 la faveur de François Ier, et sans doute aussi de Louise de Savoie, lui fit franchir le pas qui séparait le plus haut échelon de la magistrature de la dignité de chancelier. Il devait la conserver pendant vingt ans jusqu'à sa mort, en 1535. Président de l'audience du sceau, « ministre » de la justice, inspirateur des ordonnances, un chancelier de l'ancienne monarchie jouissait à ce triple titre d'une autorité considérable. En fait, l'activité de Duprat dépassa de beaucoup le cadre des attributions normalement réservées à son office. Il fut diplomate et financier autant que chef suprême de la magistrature. Non pas qu'il ait cherché à appliquer une politique personnelle. L'originalité, la hardiesse et la hauteur des vues ne sont pas son fait. Il est fort loin d'avoir été un « premier ministre ». Serviteur dévoué du roi dans toutes les circonstances, il aiguilla sa vie en faisant coïncider avec ses ambitions personnelles, fortement accusées, les intérêts de son maître. Avec une conscience de grand laborieux et un sens pratique très développé, il s'appliqua constamment à corriger ce qu'il y avait d'excessif dans les oscillations de la politique royale, à en amortir les violences, à recoudre ce qu'elle avait parfois brutalement taillé. De ce travail de Pénélope, François Ier semble avoir été reconnaissant à son patient et fidèle collaborateur. (...) M. Albert Buisson a tracé un tableau fort intelligent des divers aspects de l'activité de Duprat." (Georges Tessier, Revue d'histoire de l'Eglise de France, 1936)
Richelieu.
Laffont, 1970-1975, 3 vol. gr. in-8°, 349, 378 et 540 pp, traduit de l'allemand par Henri Coursier, 36 planches hors texte, cartes, brochés, couv. illustrées à rabats, bon état
Complet en 3 volumes. — I. La prise du pouvoir ; II. L'affirmation du pouvoir et la guerre froide ; III. La politique d'hégémonie et la mort du Cardinal. — "Le premier volume d'une histoire de Richelieu qui doit en comprendre trois, est paru récemment en langue allemande à Munich. Son auteur, M. Carl J. Burckhardt, aujourd'hui professeur à l'Université de Genève, a débuté par la carrière diplomatique. Le principal intérêt de son livre est de mettre en pleine lumière l'action du ministre de Louis XIII qui marqua son passage aux affaires d'une si vigoureuse empreinte qu'il est indispensable de le bien connaître pour comprendre la suite de la politique française. Dans ce premier tome, l'auteur prend Richelieu au berceau et le conduit jusqu'à la fameuse Journée des Dupes du 10 novembre 1630, journée d'une importance capitale parce qu'obligé alors de choisir entre sa mère Marie de Médicis et son ministre, Louis XIII opte définitivement pour celui-ci. Sans doute d'autres orages s'élèveront, de nouvelles oppositions surgiront violentes, mais le souverain ne reviendra pas sur sa résolution du 10 novembre : soutenu par lui, le cardinal s'appliquera sans relâche à l'exécution de ses desseins politiques. En suivant dans le détail de sa vie le futur ministre, l'historien fait très bien comprendre comment il réussit à conquérir le pouvoir..." (A. Leman, Revue d'histoire de l'Eglise de France, 1936)
Richelieu. Tome I : La prise du pouvoir.
Laffont, 1970, gr. in-8°, 348 pp, traduit de l'allemand, 16 pl. de gravures hors texte, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
Tome I seul (sur 3) — "Le premier volume d'une histoire de Richelieu qui doit en comprendre trois, est paru récemment en langue allemande à Munich. Son auteur, M. Carl J. Burckhardt, aujourd'hui professeur à l'Université de Genève, a débuté par la carrière diplomatique. Le principal intérêt de son livre est de mettre en pleine lumière l'action du ministre de Louis XIII qui marqua son passage aux affaires d'une si vigoureuse empreinte qu'il est indispensable de le bien connaître pour comprendre la suite de la politique française. Dans ce premier tome, l'auteur prend Richelieu au berceau et le conduit jusqu'à la fameuse Journée des Dupes du 10 novembre 1630, journée d'une importance capitale parce qu'obligé alors de choisir entre sa mère Marie de Médicis et son ministre, Louis XIII opte définitivement pour celui-ci. Sans doute d'autres orages s'élèveront, de nouvelles oppositions surgiront violentes, mais le souverain ne reviendra pas sur sa résolution du 10 novembre : soutenu par lui, le cardinal s'appliquera sans relâche à l'exécution de ses desseins politiques. En suivant dans le détail de sa vie le futur ministre, l'historien fait très bien comprendre comment il réussit à conquérir le pouvoir..." (A. Leman, Revue d'histoire de l'Eglise de France, 1936)
Crise (La) morale des temps nouveaux. Préface de M. Alfred Croiset.
Paris, Bloud et Cie, 1908 ; in-8, broché ; (4), XI, 460, (4) pp. de catalogue de l’éditeur.
Edition originale avec mention fictive de 10e édition à la couverture. Exemplaire très correct, couverture légèrement défraichie avec petit manque en pied du dos, intérieur en bon état avec quelques rousseurs éparses.


Phone number : 06 60 22 21 35
Coligny. Texte par Robert Burnand. Illustrations de Jean Dulac.
Presses Universitaires de France 1923 1 vol. relié in-4, cartonnage percaline bleue de l'éditeur, titre doré sur le plat supérieur, 62 pp., compositions en couleurs in et hors-texte de Jean Dulac. Plusieurs petites taches sur le plat supérieur du cartonnage, quelques légères traces de frottement au dos. Sinon bon état. Peu courant.
Marc-Antoine Legrand, acteur et auteur comique, 1673-1728. (Thèse). Suivi de BERNARD (René). Le Bègue sur la scène française.
P., Droz, 1938 et 1945 2 vol. gr. in-8°, 199 et 42 pp, 10 pl. de gravures et portraits hors texte, biblio et index dans le premier ouvrage, 3 pl. hors texte, liste des œuvres et index dans le second, les 2 volumes reliés ensemble en un volume demi-toile bleu-nuit à coins, dos lisse avec titres dorés, bon état (Bibliothèque de la Société des historiens du théâtre, XII et XX)
"Legrand fut un acteur médiocre, un auteur plus médiocre encore. Mais il avait du métier, de la verve, et le talent de mettre les rieurs de son côté ; cela, conclut avec raison et mesure Mlle B., suffit à le rendre « digne d'un souvenir ». Elle a donc recueilli, avec la plus louable diligence et une fort prudente critique, ce qu'on savait de ce curieux homme ; son livre, pourvu d'une bibliographie et d'un index très soigneusement établis, est consciencieux et fort agréable à lire." (M. Fuchs, Revue d'Histoire littéraire de la France, 1938)
Discours à sa famille. Edition critique avec présentation et notes par Daniel-Henri Vincent et Christophe Blanquie. 1. Les Illustres malheureux. 2. Le bon usage des prospérités, suivi des Lettres au Roi.
Editions de l'Armançon, 2000, gr. in-8°, 308 pp, avant-propos de Yves Coirault, 8 planches hors texte, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
"Chez Bussy, on goûte le romancier, on estime l’épistolier, on apprécie le mémorialiste, mais on méconnaît les ultimes Discours. C’est que ces œuvres, soigneusement mûries, n’ont pas été publiées du vivant de l’auteur mais après sa mort, et dans une version fort éloignée de l’original. Pour dissiper le malentendu, il fallait revenir aux manuscrits : en comprenant pourquoi ses Discours pouvaient séduire les contemporains de Bussy, à commencer par Louis XIV, les lecteurs d’aujourd’hui peuvent désormais partager leur plaisir."
Les Mémoires de Messire Roger de Rabutin, comte de Bussy...
Paris Jean Annisson 1696 3 vol. Relié 3 vol. in-12, basane brune, dos à nerfs ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin brun, tranches mouchetées, 1 f. + 444, 432 et 418 pp. + table des noms propres (33 p.). Edition parue l'année de l'originale de ces célèbres mémoires qui portent sur la période 1616-1666. Reliure d'époque un peu manipulée (petit accroc au dos du premier volume).
La vie à Bordeaux au XVIIIe siècle.
Cairn, coll. "La vie au quotidien" 2007 1 vol. broché in-8, broché, 344-VIII pp. Comme neuf. Epuisé.
Journal de la Régence (1715-1723), par Jean Buvat, écrivain de la Bibliothèque du Roi. Publié pour la première fois, et d'après les manuscrits originaux. Précédé d'une introduction et accompagné de notes et d'un index alphabétique par Emile Campardon.
P., Henri Plon, 1865, 2 vol. in-8°, 528 et 559 pp, index, reliures demi-chagrin lie-de-vin, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres dorés (rel. de l'époque), qqs rares rousseurs, bon état
Edition originale de cette importante source pour l'histoire de la Régence, publiée avec une introduction et des notes par Emile Campardon. Ecrivain à la bibliothèque du roi, J. Buvat consigne les affaires politiques, les intrigues de la cour, les relations entre les nobles et les hommes de pouvoir, et des anecdotes relatives à l'actualité de l'époque. — "Longtemps, le Journal de la Régence a été distingué des autres chroniques contemporaines du fait du statut social de son auteur. Ce dernier, simple copiste à la Bibliothèque du Roi, se démarque en effet de ses collègues mémorialistes Barbier et Marais, tous deux avocats au Parlement. Cependant, la spécificité de son ouvrage tient surtout à la nature de son contenu qui ne correspond guère à la définition littéraire du journal. En effet, contrairement aux productions de Marais et de Barbier, le Journal de la Régence n'est pas un écrit intime, destiné tout au plus à un cercle restreint de familiers. Conçu comme un produit éditorial, il fut présenté par Buvat lui-même tantôt comme un « mélange », tantôt comme une « collection » visant à « rapporter tout ce qui s'est passé de plus considérable chaque jour ou à peu près ». S'interdisant toute appréciation personnelle sur les événements, ce dernier ne revendiqua d'ailleurs pas la qualité d'écrivain, mais celle, plus modeste, de « collecteur ». C'est ce rôle de second plan que s'attribue Buvat qui le distingue des autres chroniqueurs qui, eux, écrivirent au jour le jour pour exprimer et fixer les réflexions que leur inspiraient les « affaires du temps »..." (Patrice Peveri, Crime, histoire et sociétés, 1997)
Les Relations internationales en Europe, XVIIe-XVIIIe siècles.
PUF, 1992, gr. in-8°, xxiii-731 pp, biblio, index, broché, bon état (Coll. Thémis Histoire)
Cette étude s'interroge sur les origines et la nature des souverainetés européennes, sur les enjeux internationaux, elle aide à comprendre les grands événements européens. La Réforme fut la grande fracture du XVIe siècle et les rivalités internationales jouèrent de la passion religieuse qui fut débordée par les ambitions politiques et territoriales, la guerre était une donnée essentielle de ces époques.
Diderot, de l'athéisme à l'anticolonialisme.
Maspero, 1981, in-8°, 376 pp, notes bibliographiques, chronologie, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Fondations)
"En 1970, ce livre fit l'effet d'un pavé dans la mare. Son ton passionné tranchait sur les “mezza voce” de la critique universitaire. Celle-ci répondit à la provocation et ses réactions furent souvent polémiques. Plus de dix ans après, l'auteur persiste et signe. Il réédite son essai en y ajoutant une quarantaine de pages qui se contentent de rectifier quelques détails, d'actualiser certaines références. On retrouve donc la présentation d'ensemble de Diderot et l'étude de sa pensée politique à travers sa collaboration à l' “Histoire des deux Indes”. L'analyse de l'inachèvement fondamental de son œuvre ou du décalage entre esthétique avouée et esthétique pratiquée garde toute sa pertinence. La relecture menée de l' “Histoire des deux Indes” est souvent exemplaire. Les charges pamphlétaires, en particulier contre les universitaires, ne doivent pas masquer le sérieux de cette recherche." (Michel Delon, Dix-huitième Siècle, 1983)
L'abbé de L'Epée, instituteur gratuit des sourds et muets, 1712-1789.
Seghers, 1990, gr. in-8°, 352 pp, 8 pl. de gravures hors texte, généalogie, chronologie, index, broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s.
"« Nous dirons le vrai si possible, et si possible aussi le vrai des pieux mensonges », écrit Maryse Bézagu-Deluy, en ouverture de sa biographie de l'abbé de l'Epée (1712-1789), le fondateur mythique de la langue des signes, qui a contribué de façon définitive à la réintégration des sourds dans la société française de la fin du XVIIIe siècle. Ce qui fait l'intérêt de cette biographie ne peut vraiment apparaître dans ces quelques lignes, parce qu'il tient à l'attention scrupuleuse avec laquelle l'auteur fait comprendre l'esprit d'une époque à travers les incidents d'une existence somme toute banale. Il repose aussi sur le plaisir de l'enquête qu'elle sait nous communiquer, lorsqu'elle nous montre par exemple les couches successives de narrations mensongères qui constitue l'épisode « décisif » de la rencontre de l'abbé et des deux jumelles sourdes-muettes marquant le début de ses efforts d'éducateur vers 1759. Le parti-pris de ne pas magnifier le « père » des sourds-muets, mais d'en faire un homme de son époque conduit M. Bézagu-Deluy à privilégier deux axes : tout d'abord, la chronique de la famille de l'abbé sur trois générations pendant lesquelles les hommes passent du statut de maçon à celui d'architecte du roi. Cette histoire d'une ascension sociale se double d'un tableau du jansénisme dont les idées triomphent dans les milieux intellectuels du XVIIIe siècle..." (Sonia Branca-Rosoff, Histoire de l'éducation, 1992)
Entre fêtes et clochers. Profane et sacré dans l'Europe moderne, XVIIe-XVIIIe siècle.
Fayard, 2002, gr. in-8°, 348 pp, notes, index, broché, couv. illustrée, bon état
Ce livre s'attache à cerner, sur deux siècles, à partir de quelles démarches les pouvoirs, les autorités, les sujets, les fidèles construisirent ou remodelèrent leur approche du profane et du sacré, ce qu'ils entendaient à travers ces appellations et quels types d'objets elles pouvaient désigner pour chacune de ces instances. Il tente aussi de saisir les rapports qui se jouaient entre l'un et l'autre terme et de mesurer les changements intervenus dans des relations que l'on pensait être bien définies et encadrées. C'est donc moins une histoire des manifestations du sacré qu'une histoire sociale et culturelle de son organisation avec le profane. On peut dès lors interroger l'aptitude de ces deux notions à révéler le fonctionnement social des cultures d'Ancien Régime, leur capacité à traduire leurs complémentarités, leur capillarité, leurs affrontements plus subtils que cette confrontation manichéenne et sans merci entre deux fractions du monde ; l'une, dominante et savante, imposerait son outillage mental à une majorité populaire définitivement dépossédée de son identité. L'image d'une conception univoque de ces notions, renforcée par les signes communs de la révélation chrétienne, est tout aussi exagérée. Car elle n'effaçait pas ce que chacun pouvait éprouver du sacré comme expérience subjective d'un autre ordre que l'ordre naturel où se cantonnait le profane.
L'Evolution politique de l'Angleterre moderne, 1485-1660.
Albin Michel, 1960, fort in-8°, xxxvii-684 pp, 3 cartes dont une grande dépliante hors texte, 3 tableaux généalogiques dépliants hors texte, biblio, index, broché, bon état (Coll. L'Evolution de l'Humanité)
"A sa mort en 1944, Léon Cahen laissait inachevée une histoire de l'Angleterre aux XVIe et XVIIe siècles ; il fut demandé à M. B. de reprendre en main ce manuscrit. De cette collaboration est né le présent volume qui couvre une époque passionnante allant de Henri VIII à Cromwell. Les spécialistes de l'histoire des institutions ou des idées politiques trouveront ici une grande abondance de notations et de références." (Revue française de science politique, 1961)
L'Espagne de Figaro. Essai sur l'Espagne du XVIIIe siècle.
La Pensée universelle, 1981, in-8°, 255 pp, 16 pl. de gravures hors texte, broché, bon état
 Write to the booksellers
Write to the booksellers