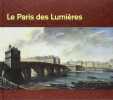-
Type
Book (2358)
Magazine (3)
-
Century
16th (2)
17th (28)
18th (98)
19th (409)
20th (1672)
21st (119)
-
Countries
France (2360)
Switzerland (1)
-
Syndicate
ILAB (2353)
SLAM (2353)
Philippe II.
Albin Michel, 1961, in-8°, 449 pp, broché, couv. illustrée, bon état, ex. du SP
"Le Philippe II de M. Ferrara est un maître-livre. L'auteur a puisé aux archives de Simancas et chez les contemporains de son personnage en particulier dans les rapports des ambassadeurs de Venise, les éléments essentiels de cette véritable résurrection d'un homme et d'une époque. Avec quel art, il sait peindre en pied le souverain qui, au siècle de la Réforme, de la contre-Réforme et des luttes religieuses en Allemagne et en France apparut comme le prince le plus puissant de l'Europe !"
Nouvelle introduction a la Pratique, contenant l'explication des termes de pratique, de droit et de coutumes ; avec les jurisdictions de France. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. Tomes I, III et IV seuls (sur 4).
P., Saugrain, 1764, 3 vol. in-12, xii-468 et 842 pp, pagination continue pour les tomes III et IV, reliures plein veau moucheté, dos à 5 nerfs, titres et caissons ornés, tranches rouges (rel. de l'époque), coins émoussés, bon état
Claude de Ferrière (1639-1715) fut un vulgarisateur de génie pour l'ancien droit français.
Les femmes poëtes au XVIe siècle. Etude Suivie de Mademoiselle de Gournay, Honoré d'Urfé, Le Maréchal de Montluc, Guillaume Budé, Pierre Ramus.
Didier et Cie, 1860, in-12, xvii-391 pp, nouvelle édition, notice sur la vie de L. J. Feugère par E. J. B. Rathery, reliure demi-chagrin carmin, dos à 4 nerfs soulignés à froid, caissons à froid, titres et fleurons dorés, encadrements à froid sur les plats (rel. de l'époque), plats lég. frottés, bon état
Jean-Louis Fargeon, parfumeur de Marie-Antoinette.
Perrin, 2004, in-8°, 230 pp, 16 pl. d'illustrations en couleurs hors texte, annexes, broché, couv. illustrée à rabats, bon état (Coll. Les métiers de Versailles)
"Tous les ans changent les goûts ; Tous les jours nouveaux parfums pour tout ; Soyez donc chimiste..." on croirait ces bouts rimés écrits sur mesure pour Jean-Louis Fargeon, "le" parfumeur du XVIIIe siècle. Cet enfant des Lumières, né à Montpellier en 1748, rêve du soleil de Versailles et des fastes de la Cour qu'il découvre en lisant le récit de l'arrivée en France, puis du mariage de l'archiduchesse Marie-Antoinette d'Autriche avec Louis, dauphin du royaume de France. A Montpellier capitale de la parfumerie française, il a acquis un savoir-faire ; à Paris, il en fera un art. Installé dans le quartier du Roule, sa boutique devient le temple des élégantes, son laboratoire le repaire des savants et curieux. Ce n'est qu'une étape : Fargeon pense à Versailles. Il peut compter sur Mme Du Barry – sa cliente – et doit se méfier de la jalousie tenace de Marie-Antoinette à l'égard de la favorite. Il parviendra néanmoins à rencontrer la jeune reine à son Trianon. Il a auprès d'elle un atout majeur : le goût du naturel et les odeurs qu'il lui prépare sont telles qu'elles les souhaite, adaptées à son goût et à ses humeurs. Parfumeur de Marie-Antoinette, Fargeon sera aussi celui des Enfants de France, jusqu'au coup de tonnerre de 1789. Républicain, il demeurera pourtant attaché à la famille royale jusqu'à la fuite de Varennes, jusqu'à la prison du Temple... et son propre procès.
Véritable Discours de la naissance et vie de monseigneur le Prince de Condé jusqu'à présent, à lui desdié par le sieur de Fiefbrun ; publié d'après le manuscrit de la Bibliothèque Impériale par E. Halphen ; suivi de lettres inédites de Henri II, prince de Condé.
P., Auguste Aubry, l'un des libraires de la Société des Bibliophiles François, 1861, pt in-8°, xxx-106 pp, notes, reliure demi-chagrin noir, dos à 4 nerfs pointillés soulignés de doubles filets dorés, titres dorés (rel. de l'époque), bon état. Edition originale tirée à 250 exemplaires seulement, celui-ci un des 221 ex. sur papier vergé
Intéressante relation écrite par un serviteur dévoué des Condé. A lire notamment pour les informations touchant au mariage de Henri Ier de Condé et aux voyages de son fils Henri II. Longue introduction de l'historien Eugène Halphen (1820-1912).
FIERRO (Alfred) et Jean-Pierre SARAZIN.
Reference : 126427
(2005)
ISBN : 9782286018610
Le Paris des Lumières d'après le plan de Turgot (1734-1739).
Éditions de la Réunion des musées nationaux/GLM, 2005, in-4° oblong (28,5 x 32,5), 144 pp, nombreuses illustrations en noir et en couleurs, index sélectif des noms de personnes et de lieux, reliure cartonnée illustrée de l'éditeur, bon état
Le Paris dessiné en 1734-1739 par Louis Bretez à la demande du prévôt Michel Étienne Turgot n'a pas encore tout à fait disparu... A partir de ce plan célèbre et des textes qui l'accompagnent dans ce livre, un effort d'imagination est toutefois nécessaire pour retrouver ce Paris de l'époque des Lumières qui faisait l'admiration de l'Europe. — Le Paris arpenté et croqué par le dessinateur Louis Bretez aux ordres du prévôt Michel Etienne Turgot n'a pas encore tout à fait disparu de notre paysage urbain. Cependant, dans maints endroits, un effort d'imagination est nécessaire pour restituer à partir des images et des commentaires l'ambiance des rues, les alignements des immeubles, les places et les parvis d'églises, les berges de la Seine. Face à la clôture des Universités Paris VI et VII, place Jussieu, est-il possible en fermant les yeux d'imaginer l'entrée de l'abbaye Saint-Victor ? Assis au pied de la fontaine des Innocents, a-t-on idée que l'on pénètre l'ancien domaine des morts de Paris du cimetière des Innocents ? Côté est de la place Saint-Germain des Prés, sur un banc du square Laurent Prache, on se souviendra qu'à cet emplacement s'élevait l'une des plus précieuses bibliothèques des XVIIe et XVIIIe siècles, où étudiaient et écrivaient les savants de l'époque. A l'inverse, une promenade au jardin des Plantes, une visite place des Vosges où dans les hôtels du Marais illustreront livre en main et sur place l'exactitude des dessins et la permanence de l'occupation des lieux. L'association judicieuse des extraits du plan de Paris de Turgot aux images contemporaines – gravures, dessins, tableaux -, aux photographies modernes et aux commentaires des auteurs permettront à tout un chacun d'aller à la rencontre, non pas de fantômes, mais de témoignages du passé. Cet ouvrage n'est pas le récit nostalgique de l'altération ou de la disparition des sites et des monuments anciens de Paris, mais l'histoire illustrée par plus de cent lieux caractéristiques, lieux de vie et lieux de mémoire.
Etat, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans leurs colonies américaines (vers 1640-vers 1780).
Armand Colin, 2018, gr. in-8°, 378 pp, qqs illustrations, biblio, broché, couv. illustrée, qqs soulignures rayon sur les 6 premières pages, bon état
Les trois premiers chapitres ont été confiés à deux auteurs, O. Chaline et E. Dziembowski, ayant croisé leurs lectures et leur expérience. Les structures de la vie politique sont également traitées, à l'échelle nationale mais aussi dans les provinces (M.-L. Legay) et dans les colonies (Fr.-J. Ruggiu et D. Chaunu). Quant à la guerre, si présente dans les rapports franco-anglais, elle est au cœur de l'évolution et des remises en cause de l'État et des pouvoirs ; sur terre comme sur mer, en Europe comme dans le reste du monde, elle demeure un élément essentiel d'affirmation de la puissance des États, qui parviennent avec plus ou moins de facilité à répondre à leur nécessité de financement par la mise en place d'un État militaro-fiscal. Cette construction de l'État engendre contestations et révoltes de formes variées et disjointes dans le temps, induisant une approche nationale – confiée à G. Aubert pour la France et J.-P. Poussou pour la Grande-Bretagne. Enfin, au temps de l'« éclatement de la foi », l'antagonisme apparent des choix religieux des deux États ne doit pas faire sous-estimer la convergence vers une politisation croissante des questions religieuses. Car si les oppositions violentes des années 1640 rappellent les guerres de religion du XVIe siècle, les actes de résistance évoluent vers des formes moins spectaculaires de remises en cause de l'autorité de l'État, fondées sur le droit et l'appel à l'opinion. (É. Suire)
Discours sur les Pensées de M. Pascal. Suivi du Discours sur Moïse et du Traité : Qu'il y a des démonstrations.., de la Préface de Port-Royal, et d'un fragment de la Vie de Pascal par Mme Périer. Introduction et notes de Victor Giraud.
P., Editions Bossard, 1922, pt in-8°, 205 pp, un portrait de Pascal gravé sur bois par Achille Ouvré en frontispice, numéroté sur papier vélin pur chiffon (Coll. des Chefs-d'œuvre méconnus)
La fin d'une race. Raoul de Coucy-Vervins, seigneur de Poilcourt.
P., Auguste Picard, 1914, gr. in-8°, vii-140 pp, pièces justificatives, index des noms, broché, bon état
"Dans cette notice, M. de Finfe de Bussy a raconté la vie d'un puîné des seigneurs de Vervins, cadets de la maison de Coucy. Ce personnage, Raoul de Coucy, né vers 1500, mort en 1562, servit d'abord les Guises, puis le roi et devint fauconnier de François Ier. L'auteur s'est attaché surtout à démontrer que Raoul de Coucy n'avait pas laissé de postérité légitime. Il pense que Louis de Coucy, fils de Raoul et auteur d'une branche qui a subsisté jusqu'au commencement du XIXe siècle, était un bâtard. Le principal des arguments invoqués en faveur de cette thèse se tire du fait que Louis n'a pas recueilli l'héritage paternel, qui est allé à des collatéraux. S'il a tenu, après Raoul, la seigneurie de Poilcourt, c'est en vertu d'une donation “propter nuptias”. Le raisonnement paraît convaincant. Il est vrai qu'un fils légitime pouvait être déshérité par son père ; mais l'exhérédation n'était permise que dans des cas exceptionnels." (Max Prinet, Bibliothèque de l'École des chartes, 1916)
Familles. Parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société.
Hachette, 1976, in-8°, 287 pp, tableaux statistiques, biblio, broché, bon état (Coll. Le temps et les hommes). Edition originale
"Les très nombreuses études de démographie historique ont fait progresser nos connaissances sur la société rurale du XVIIIe siècle, mais elles nous laissent un peu sur notre faim. C'est le grand mérite de J.-L. F. d'avoir recherché dans les ouvrages de l'époque (littéraires ou religieux) ce qu'était la vie des hommes et des femmes sur lesquels on possède à présent tant de statistiques. Quel sentiment nos ancêtres éprouvaient-ils vis-à-vis des autres membres de leur famille ? Qui considéraient-ils comme de leur sang ? Brantôme, Saint-Simon et, pour les familles bourgeoises, quelques rares journaux intimes nous renseignent sur ce point. Les sources sont moins sûres pour les masses rurales. Dans quelle mesure, un écrivain comme Rétif de la Bretonne, cédant à la tendance sentimentaliste de la fin du XVIIIe siècle, n'a-t-il pas enjolivé ses souvenirs de jeunesse en décrivant une société patriarcale qui n'avait guère existé ? L'analyse des dictionnaires de cas de conscience et des Manuels de confesseur met au contraire l'accent sur l'aspect négatif des sentiments. Il n'y est question que de jalousie et de haine entre proches. Mais le propos de cet ouvrage, qui fourmille d'idées et de suggestions, n'est pas seulement d'analyser les sentiments. Il veut surtout trouver des explications aux graphiques et aux statistiques patiemment élaborés par les démographes. Après bien d'autres, J.-L. F. recherche la cause de la baisse de la fécondité en France. Elle tiendrait surtout à l'amélioration de la condition féminine, c'est-à-dire, en quelque sorte, à la généralisation de la préciosité, déjà courante dans la haute société dès le XVIIe siècle. Le respect de la femme et l'importance qu'on accorda à sa vie à une époque où une femme sur 10 mourait en couches (estimation d'ailleurs un peu excessive) serait donc à l'origine de la révolution démographique..." (Jacques Houdaille, Population, 1976)
Les Amours paysannes. Amour et sexualité dans les campagnes de l'ancienne France (XVIe-XIXe siècle).
Gallimard/Julliard, 1975, in-12, 255 pp, 16 pl. d'illustrations hors texte, références, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Archives)
Bergeries, pastourelles, violences rustiques des vilains... Des amours paysannes d'autrefois nous ne connaissions que l'image déformée qu'en ont laissée nobles et bourgeois. Peut-on aller plus loin ? Peut-on faire parler ce monde rural muet et sans mémoire ? Jean-Louis Flandrin présente ici un essai d'ethnographie historique. Le folklore a fixé gestes et clichés ; la loi de l'Église et de l'État a marqué des interdits ; les archives judiciaires évoquent les contraintes sociales et leur transgression ; les comptages des démographes restituent le temps long des comportements collectifs. Confrontés, recoupés, ces témoignages partiels restituent, des obsessions adolescentes aux liaisons tragiques, du mariage aux déviances, les codes amoureux d'une société traditionnelle.
Le Sexe et l'Occident. Evolution des attitudes et des comportements.
Seuil, 1981, in-8°, 376 pp, notes, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. L'Univers historique). Edition originale
"C'est une idée très répandue, chez les Occidentaux d'aujourd'hui, que nous avons des difficultés particulières sur le plan sexuel, et qu'elles sont imputables à notre morale traditionnelle, d'essence chrétienne. Mais est-ce en reniant brutalement la morale de nos pères que nous surmonterons nos difficultés ? En réalité, nous ne sommes pas libres de refuser notre héritage. Et plus nous voulons l'ignorer, plus nous en sommes prisonniers. En rendant à ce passé ce qu'on en a censuré, en montrant les rapports qui existaient entre telle attitude ancienne envers la sexualité et tels autres traits, abolis ou vivaces, de la culture occidentale, l'Histoire devrait permettre de réapprécier notre système de valeurs, et par là de surmonter les difficultés présentes." (J.-L. F.) — "J.-P. Flandrin poursuit sa quête au travers des œuvres des clercs obnibulés par l'impureté." (Robert Fossier, Revue Historique, 1984)
Louis XV intime et les petites maîtresses.
Plon 1899 1 vol. relié in-8, bradel demi-percaline bleue, pièces de titre et fleuron doré au dos, 388 pp. Deuxième édition illustrée de 5 portraits dont un en frontispice. Papier légèrement jauni, sinon bon exemplaire en percaline d'époque.
Buffon. Histoire de ses travaux et de ses idées.
P., Hachette, 1850, in-12, vi-363-(1) pp, reliure pleine basane fauve, dos à 4 faux-nerfs pointillés orné de caissons dorés, titre doré, décor à froid et encadrement doré sur les plats, fer doré du lycée impérial d'Orléans au 1er plat, tranches marbrées (rel. de l'époque), une coupe frottée, bon état
Un chapitre entier est consacré aux éditions de Buffon.
Histoire des travaux de Georges Cuvier.
P., Garnier Frères, 1858, in-12, 295 pp, 3e édition augmentée et en partie refondue, reliure demi-chagrin vert, dos à 4 nerfs soulignés à froid, titres et fleurons dorés, encadrements à froid sur les plats, fer doré (couronne de feuilles encadrant "Université de France. Lycée impérial de Bonaparte"), bon état
Notice biographique sur Georges Cuvier, Zoologie, Anatomie comparée, Ossements fossiles, Application de l'anatomie à l'histoire naturelle générale, Du mot nature défini par M. Cuvier, Du mot nature défini par Buffon, Exposition critique de la philosophie de la nature par M. Cuvier, Liste des ouvrages de M. Cuvier, etc. — "M. Flourens fût membre de l’Académie des sciences, professeur au Muséum d’histoire naturelle, un des auteurs du Journal des savants et secrétaire perpétuel à l’Académie des sciences. En 1840, sa réputation parvenue à son apogée recevait sa consécration la plus glorieuse ; il fut élu membre de l’Académie française. L’appréciation que M. Flourens a donnée des travaux et des idées d’illustres savants a beaucoup contribué à sa popularité. Dans ses écrits sur l’Histoire des travaux de Georges Cuvier, sur l’Histoire des travaux et des idées de Buffon, M. Flourens se fait le vulgarisateur heureux des idées et des travaux de ces deux grands génies qui, comme il le dit, se complètent et se comprennent l’un par l’autre..." (Claude Bernard, Discours de réception à l’Académie française, 27 mai 1869) — "In his biographies of distinguished scientists Flourens tried to sum up their achievements, relating their work to what was done before and after along the same lines, in a clear, simple, elegant and engaging style. They were very popular, and some are masterpieces which served as models for other biographies". (DSB V, p. 45)
Mémoires de Fléchier sur les Grands-Jours d'Auvergne en 1665, annotés et augmentés d'un appendice par M. Chéruel et précédés d'une notice par M. Sainte-Beuve.
Hachette, 1856, in-8°, xlix-432 pp, un frontispice dépliant et une planche hors texte, 2 tableaux généalogiques, index, reliure demi-veau fauve, dos à 4 nerfs filetés et soulignés à froid, pièce de titre basane noire (rel. de l'époque), bon état
A l'hiver 1665, une commission juridique extraordinaire venue de Paris se transporte à Clermont. Il s'agit aux lendemains de la Fronde de rétablir l'ordre dans une région écartée et d'y affirmer l'autorité du pouvoir central. Un jeune abbé, réputé parmi les beaux esprits de Paris, se trouve par hasard faire partie de l'escorte des magistrats. C'est Esprit Fléchier (1632-1710), futur évêque de Nîmes. Le journal où il consigne les travaux de la cour des Grands-Jours d'Auvergne aurait pu être un catalogue sinistre de crimes et de malheurs, mais la fantaisie de Fléchier l'a transformé en un recueil d'anecdotes malicieuses et pittoresques. Dans ce témoignage exceptionnel, le portrait d'une province lointaine contraste avec la description d'un tribunal souverain qui prétend purger le pays de ses criminels invétérés. Le ton badin et précieux que Fléchier emploie pour rendre compte des épisodes les plus sordides confère à ce journal une double résonance : c'est à la fois un document littéraire original et l'illustration d'un moment majeur de l'histoire des institutions et de la société française au XVIIe siècle. — Ce récit "constitue un véritable réquisitoire contre la société de l'Ancien Régime" (Bourgeois & André 842).
Giovanni-Battista Piranesi. Essai de catalogue raisonné de son œuvre.
P., H. Laurens, 1964, in-4°, 74 pp, index, broché, bon état
Publié pour la première fois en 1918, cet ouvrage consacré à l’architecte-graveur Giovanni-Battista Piranesi (Mestre 1720 – Rome 1778) est plus qu’une biographie. Il s’agit d’une véritable étude de la société italienne et romaine au XVIIIe siècle qui, sur bien des points, fait encore autorité aujourd’hui. Fils d’un tailleur de pierre vénitien, Giovanni-Battista Piranesi reçut une formation d’architecte. Passionné par l’antiquité romaine, il accompagna, alors âgé de vingt ans, l’ambassadeur de Venise auprès du Saint-Siège à Rome. Il put alors satisfaire à loisir sa passion et parfaire sa formation auprès des maîtres romains. Lors de ce séjour, il s’initia à la gravure, art qu’il pratiqua sa vie durant, gravant des vues de Rome où les ruines antiques sont omniprésentes. Sa formation d’architecte et son œil passionné d’amateur d’antiquités offrent à notre regard ébahi une profusion d’œuvres qu’il publia dans plusieurs recueils. Ses talents d’architecte furent peu sollicités. C’est principalement la famille des Rezzonico, Vénitiens comme lui et dont fut issu le pape Clément XIII, qui lui permit d’exercer sa profession. Il fut notamment l’architecte de la restauration du prieuré des chevaliers de Malte à Rome et de son église, Sainte-Marie-Aventine. — "L'étude si complète consacrée par M. Focillon à l'œuvre un peu oubliée de Piranèse (1720-1778) intéresse non seulement l'histoire de l'art, mais celle de l'Italie au XVIIIe siècle." (Louis Bréhier)
La Révolte des Nu-Pieds et les révoltes normandes de 1639. (Thèse).
PUF, 1970, gr. in-8°, 368 pp, biblio, index, broché, couv. à rabats, bon état
"C'est tout le dossier de la révolte des Nu-Pieds, au sens large, que Mme Foisil a voulu reprendre, après beaucoup d'autres (évoqués dans une très utile et instructive « étude historiographique de la révolte » qui, avec l'étude des sources, constitue l'introduction du livre). Un tel propos se justifiait d'autant plus que l'auteur ne s'est pas contenté, comme ses devanciers, d'utiliser les seules sources publiées, mais s'est efforcé d'atteindre tous les documents possibles par une soigneuse investigation dans les dépôts d'archives et les bibliothèques. Ce livre sérieux, bien documenté et bien mené ajoute une pièce de valeur au dossier ouvert depuis plus de vingt ans sur les soulèvements populaires en France avant la Fronde." (François Lebrun, Annales de Bretagne, 1970)
Entre le Classicisme et le Romantisme. Etude sur l'esthétique et les esthéticiens du XVIIIe siècle.
P., Champion, 1969, gr. in-8°, 604 pp, biblio, index, broché, bon état
"C'est en français que M. W. Folkierski, professeur à l'université de Cracovie, a écrit ces 600 pages ; si un tel hommage à la « langue universelle » est aujourd'hui plus rare qu'il ne l'était au XVIIIe siècle, il faut pourtant le signaler. (...) Le sous-titre de l'ouvrage est plus exact que le titre même, qui est trompeur : il s'agit des théories esthétiques de la fin du XVIIe siècle et des trois premiers quarts du XVIIIe. Les 350 premières pages étudient le goût, le beau, la « belle nature », l'imitation, les rapports de la poésie et de la peinture, et le théâtre, et sont exposées les idées des esthéticiens français et anglais : Dubos, Batteux, Trublet, Crouzas, Voltaire, Condillac, Saint-Evremont, Fontenelle, Montesquieu, Fénelon, Lamotte, le P. Brumoy, Riccoboni, Murait ; Hutcheson, Burke, Home, Shaftesbury, J. Richardson, Harris et Webb ; une place particulièrement importante est faite à quelques-uns d'entre eux : Condillac, Shaftesbury, Burke. Ces divers écrivains ne sont pas examinés séparément l'un après l'autre ; leurs opinions sont reliées entre elles ou opposées les unes aux autres sous des rubriques qui énoncent le sujet des questions. La 2e partie est consacrée à Diderot, la 3e partie à Lessing. On a ainsi une vue des principaux problèmes qui ont préoccupé le XVIIIe siècle français, anglais et allemand." (S. Etienne, Revue belge de philologie et d'histoire, 1926)
Histoire de la comtesse de Savoie. Nouvelle édition, publiée avec notices et commentaires par Charles Buet.
Moutiers, Brides-les-Bains (Savoie), F. Ducloz, 1889, in-8°, 235 pp, 2 gravures, texte joliment encadré, impression en couleurs et or, broché, couverture rempliée, bon état. Edition originale, un des 500 exemplaires numérotés sur papier simili-japon (seul tirage)
Splendide ouvrage pour les bibliophiles. — "L'Histoire de la comtesse de Savoie est le meilleur des romans composé par Mme de Fontaines au commencement du dix-huitième siècle. On soupçonna Voltaire d'y avoir mis la main. En réalité, sa tragédie peu connue d'Artémise, jouée en 1720, offre même plan, même marche et mêmes détails. Mme de Fontaines a imité l'épisode de Genèvre et Ariodant, de l'Arioste, et emprunté à Mme de la Fayette le caractère de son héros Mendoce et de la comtesse, sans atteindre le charme délicat de la Princesse de Clèves. Ce petit volume était presque introuvable. M. Ch. Buet l'a fait réimprimer avec notices et commentaires, plus encore par amour de sa chère Savoie que par admiration littéraire. Cette édition très coquette, un peu trop bigarrée peut-être d'encres dorée, argentée, rouge, rose, bleue, verte et même noire, est dédiée à Sa Majesté Marguerite de Savoie, reine d'Italie. Elle a été tirée à cinq cents exemplaires. C'est une curiosité bibliographique." (Et. Cornut, Etudes religieuses, philosophiques, historiques et littéraires, 1890)
Mémoires de Messire Du Val, marquis de Fontenay-Mareuil, maréchal des camps et armées du Roy, conseiller d'Etat, nommé à l'ordre du Saint-Esprit, ambassadeur en Angleterre en 1626, et deux fois à Rome en 1641 et en 1647.
P., Foucault, 1826, 2 vol. in-8°, 564 et 376 pp, reliures demi-veau glacé caramel à coins, dos à 4 larges nerfs filetés, caissons à froid, pièces de titre et tomaison basane noire, roulette dorée en queue, tranches marbrées (rel. de l'époque), C. de bibl., étiquettes en queue, bon état (Coll. complète des Mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis le règne de Philippe-Auguste, jusqu'au commencement du dix-septième siècle ; avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage, par M. Petitot). Exemplaires trés bien reliés à l'époque
"Les mémoires du marquis de Fontenay-Mareuil ne sont pas, comme la plupart de ceux qui parurent au temps de la Fronde, une oeuvre personnelle où l'auteur ne parle que de lui-même et en bons termes, mais une oeuvre impersonnelle : c'est l'histoire de son temps. Et après avoir examiné les récits des adversaires de Richelieu et de Mazarin, il est indispensable de les contrôler en consultant les mémoires d'un partisan de ces ministres, froid et expérimenté, diplomate sans passion." (Bourgeois et André, II, 736)
Lettres galantes de Monsieur le chevalier d'Her***. Edition présentée, établie et annotée par Camille Guyon-Lecoq.
Desjonquères, 2002, in-8°, 204 pp, broché, bon état (Coll. XVIIe siècle)
Œuvre de jeunesse que Fontenelle remania jusqu'à la fin de sa vie, Les Lettres galantes de Monsieur le Chevalier d'Her*** ont le charme des œuvres inclassables. Recueil de lettres, " pot-pourri " où l'on peut humer l'esprit de Pétrone, transposition épistolaire et néanmoins romancée de saynètes qui rappellent la comédie moyenne, galerie de portraits ébauchés où l'on distingue, derrière les rideaux d'un théâtre imaginaire, l'ombre des Modernes de l'antiquité, ces lettres, plus qu'un anti-roman dans lequel Fontenelle se ferait, avant Diderot, parodiste du romanesque, semblent un " nouveau roman " dans lequel il appartient au lecteur de tracer son chemin pour suivre dans leurs détours les aventures d'un Chevalier aussi plein d'esprit que d'imagination. Sous les allures d'une galanterie qui se mue en libertinage mutin, c'est un style que Fontenelle invente, une écriture singulière qui transpose une parole en liberté, dont on retrouvera certains tours et bien des accents dans la prose du jeune Marivaux. Œuvre importante dans l'histoire du roman, ces Lettres galantes montrent de manière éclatante qu'au tournant des Lumières l'esprit de gaieté n'interdit pas la profondeur et qu'un Moderne comme Fontenelle ne jugea jamais que la raison dût nécessairement divorcer de la jubilation.
Mémoires du comte de Forbin, 1656-1733.
Mercure de France, 1993, in-8°, 628 pp, introduction et notes de Micheline Cuénin, un portrait, un tableau généalogique et 3 cartes hors texte, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Le Temps retrouvé)
Les Mémoires laissés par les marins de Louis XIV sont rares et d'un style assez technique. Ceux du comte de Forbin, trop longtemps occultés, se révèlent exceptionnels tant par l'étendue et la variété des aventures militaires qu'ils couvrent que par la plaisante vivacité de leur écriture. Nul n'a parcouru tant de mers, du Siam à la mer Blanche, nul n'a pu faire valoir, en tant d'opérations risquées, une pareille connaissance des flots et des hommes ; nul n'en a parlé avec plus d'agrément. Le franc-parler de cet officier trop intelligent lui valut d'être, jusqu'à ce jour, fort calomnié. Il est temps que ce texte passionnant, divertissant d'un bout à l'autre, contribue à lui rendre justice tout en nous régalant de plaisirs sans mélange. Cette édition est enrichie de notes substantielles et d'annexes nombreuses permettant une meilleure plongée dans ces glorieuses années. – "Forbin a servi sur mer de 1675 à 1707, le plus souvent sous les ordres de Jean Bart, de Tourville et de Duguay-Trouin. Il fit campagne sur les côtes du Portugal en 1679, aux Antilles en 1680 et se distingua aux bombardements d'Alger de 1682 et 1683. Il partit au Siam où il fut nommé gouverneur de Bangkok et amiral de la flotte siamoise par le roi de ce pays. Rentré en France il est fait prisonnier par les anglais. Après son évasion avec Jean Bart, il fait campagne en Mer du Nord et participe à l'affaire de Lagos en 1693. Puis les campagnent s'enchaînent, Constantinople, la campagne de Catalogne et le siège de Barcelone, l'Adriatique (1702) où il intercepte le commerce vénitien, bombarde Trieste et rançonne Fiume, le Levant pour chasser les corsaires de Flessingue (1703-1704). De 1706 à 1707 il combat les anglais et les hollandais puis il quitte la marine après l'échec de l'opération visant à remettre Charles-Edouard Stuart sur le trône d'Angleterre." (Bourgeois & André, Sources II, 883 / Taillemite, Dictionnaire des marins français)
Marins du Roy. Aventures du chevalier de Forbin, chef d'escadre.
Horizons de France, 1942, pt in-8°, 204 pp, un portrait gravé en frontispice, cartonnage éditeur
Un mousquetaire de la mer (1655-1688). ~ Le rival de Jean Bart (1688-1693). ~ La guerre au soleil (1699-1705). ~ Cap au Nord (1706-1707). ~ Dans les eaux britanniques (1707-1710).
Un Diplomate au dix-huitième siècle : Louis-Augustin Blondel. D'après des documents inédits tirés de la Bibliothèque Nationale, de celle de Dresde, des Archives des Affaires étrangères, etc.
Plon, 1914, in-8°, 397 pp, broché, qqs rousseurs éparses, bon état
Blondel (1696-1764) fut envoyé à Madrid en 1717, à Hanovre en 1719, à Turin en 1725, à Mayence et Mannheim en 1734, à Vienne en 1749, où il veilla à l'exécution des clauses du traité d'Aix-la-Chapelle (Frangulis, Dict. Diplomatique, p. 120).
 Write to the booksellers
Write to the booksellers