-
Type
Book (2343)
Magazine (3)
-
Latest
Last 3 days (1)
Last month (21)
-
Century
16th (1)
17th (28)
18th (99)
19th (407)
20th (1661)
21st (116)
-
Countries
France (2345)
Switzerland (1)
-
Syndicate
ILAB (2336)
SLAM (2336)
Journal d'une jeune femme de qualité (1764-1765). Traduit de l'anglais.
Zulma, 1991, in-8°, 186 pp, broché, bon état
Pastiche très réussi d'un journal intime du XVIIIe siècle, écrit en 1924 par Magdalen King-Hall, où une jeune irlandaise de 19 ans découvre Londres, Paris, la Suisse et Venise. Elle est reçue par Louis XV à Versailles, observe les signes avant-coureurs de la Révolution, rend visite à Voltaire à Ferney, etc.
Les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale.
Budapest, Akademiai Kiado et P., Editions du CNRS, 1984, gr. in-8°, 412 pp, 2 cartes hors texte, reliure pleine toile éditeur, jaquette, bon état
Actes du Cinquième Colloque de Màtrafüred (Hongrie), 24-28 octobre 1981, avec une quarantaine de participants de douze pays. Il était centré sur deux sujets : l'homme des Lumières ; l'enseignement à cette époque dans cette aire culturelle : 29 études érudites en français (Georges Gusdorf, Louis Trénard, Hervé Hasquin, etc). En conclusion, Bêla Kopeczi estime que "pour la plupart d'entre nous, c'est le franc-maçon qui peut être considéré comme l'incarnation de l'homme des Lumières dans la période considérée" (p. 411).
Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe siècle allemand. Schwenckfeld, Séb. Franck, Weigel, Paracelse.
Paris Association Marc Bloch, Cahiers des Annales 1955 1 vol. Broché in-8, broché, X + 116 pp. Dos légèrement passé, sinon bon état.
Luther, sa vie et son œuvre.
P., Sandoz et Thuillier, 1883-1884, 3 vol. in-8°, xii-536,viii-506 et ii-464 pp, reliures demi-chagrin havane, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres et tomaisons dorés, têtes dorées (rel. de l'époque), rousseurs comme toujours, bon état
Tome I : 1483-1521 – Tome II : 1521-1530. – Tome III : 1530-1546. — "Félix Kuhn fut un doctrinaire luthérien orthodoxe de la Confession d'Augsbourg s'opposant aux tendances libérales des réformés pendant le synode constitutif de 1872 qui est à l'origine de l'Eglise Evangélique Luthérienne de France. Il collabora à la "Revue Chrétienne" et avec le Pasteur Mettétal fut rédacteur et fondateur du journal "Le Témoignage". Il laisse des travaux importants, son "Luther, sa vie et son oeuvre" reste un ouvrage estimé..." (“Les Protestants, Dictionnaire du monde religieux de la France”, 1993)
Théorie économique du système féodal. Pour un modèle de l'économie polonaise, 16e-18e siècles.
P. et La Haye, Mouton, 1970, gr. in-8°, xii-173 pp, préface de Fernand Braudel, traduit du polonais, édition revue et augmentée, notes, broché, couv. illustrée, qqs annotations stylo, état correct
"C'est un livre bien intéressant et curieux que nous offre l'historien polonais Witold Kula, dans une traduction revisée et même augmentée par l'auteur. Kula nous apporte d'abord une excellente étude sur l'histoire économique et sociale de la Pologne moderne. Reposant sur une attentive et érudite recherche en matière de prix, ce livre veut aussi nous donner un modèle de l'économie féodale. (...) Pour construire son modèle, Witold Kula a regroupé de manière extrêmement suggestive tous les éléments dont on peut disposer sur l'histoire économique de la Pologne du XVIe au XVIIIe siècle, utilisant aussi bien les bilans de domaines seigneuriaux que le mouvement des prix, n'hésitant pas, fort judicieusement d'ailleurs, à utiliser des traités économiques du XVIIIe siècle aussi bien que des romans. Il montre, dans une série de démonstrations fort intéressantes, que si le domaine, du point de vue du seigneur, est rentable, le déficit n'en existe pas moins à l'issue d'une analyse comptable tenant compte du coût du travail. Il suggère également les liens qui peuvent exister entre domaine seigneurial et exploitation paysanne en régime de corvée. Il recherche les corrélations entre récolte et commercialisation en comparant l'élasticité de la récolte et de la vente dans une réserve de la région de Poznan et les liens entre récolte et prix élargissant avec beaucoup de sagacité les premiers résultats obtenus avant lui par C. E. Labrousse." (François G. Dreyfus, Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 1973).
La Vie quotidienne sous la Régence.
Hachette, 1960, in-8°, 301 pp, biblio, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
La Vie quotidienne sous Louis XV.
Hachette, 1961, in-8°, 348 pp, notes, biblio, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
Versailles ; Paris ; La magistrature ; Les moeurs parisiennes ; L'armée ; La justice ; Paris et les provinces ; Le village. — "M. Charles Kunstler est un érudit dont on a plaisir à lire les livres." (Le Monde, 5 décembre 1953)
La Vie quotidienne sous Louis XV.
Hachette, 1953 in-8°, 348 pp, notes, biblio, reliure demi-chagrin havane, dos à 4 nerfs soulignés à froid, auteur et titre dorés, couv. illustrée conservée, bon état. Bel exemplaire
Versailles ; Paris ; La magistrature ; Les moeurs parisiennes ; L'armée ; La justice ; Paris et les provinces ; Le village. — "M. Charles Kunstler est un érudit dont on a plaisir à lire les livres." (Le Monde, 5 décembre 1953)
La Vie quotidienne sous Louis XVI.
Hachette, 1965, in-8°, 348 pp, biblio, cart. éditeur, jaquette illustrée, 4 feuillets mal coupés, bon état
"C'est d'après les mémoires, les récits des voyageurs, notamment des étrangers, et les ouvrages antérieurs que M. Charles Kunstler a décrit la vie des Français au temps de Louis XVI. La province est rapidement passée en revue dans la premiere moitié de l'ouvrage ; vient ensuite Versailles, brièvement expedié ; la vie a Paris est surtout abondamment décrite." (Georges Lefebvre, Revue Historique)
Louis XV.
Paris Montaigne, Fernaud Aubier, coll. "Les amours des rois de France" 1933 1 vol. relié in-12, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couvertures conservées, 223 pp. Documents mis en ordre et annotés par Guy de La Batut. Le dos de la reliure porte par erreur J. Mazé en nom d'auteur. Très bon exemplaire.
Inventaire des arrêts du Conseil du Roi, janvier-février 1740.
P., Sirey, 1940 gr. in-8°, 266 pp, index, broché, bon état
"Cet inventaire porte sur 179 arrêts rendus en présence du roi et 272 rendus hors de sa présence, d'après les textes de la série E des Archives Nationales, et est complété par le recours à quelques autres recueils. Dans son Introduction, l'auteur souligne l'intérêt de quelques-uns des documents inventoriés (particulièrement en ce qui concerne la fabrique des étoffes et la succession de John Law) et a cru utile, étant donné que plusieurs des arrêts considérés ont été rendus sur avis des députés du Commerce, d'étudier l'histoire et le fonctionnement du Conseil et du Bureau du Commerce. Un double index permet de retrouver les arrêts intéressants." (Revue Historique, 1943)
L'Instrument périodique. La fonction de la presse au XVIIIe siècle.
Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1985, in-8°, 178 pp, 4 pl. de documents hors texte, broché, couv. illustrée, bon état
Fonctions culturelles du périodique littéraire ((Claude Labrosse). - Forme et discours d'un journal révolutionnaire : les Révolutions de Paris en 1789 (Pierre Rétat).
Sisyphes chrétiens. La longue patience des évêques bâtisseurs du Royaume de Naples (1590-1760).
Seyssel, Champ Vallon, 1999, gr. in-8°, 252 pp, 5 illustrations, une carte, broché, bon état
Histoire de la vie et actions de Louis de Bourbon, prince de Condé.
Cologne Pierre Marteau 1694 1 vol. relié 2 tomes reliés en 1 vol. in-12, pleine basane fauve, dos à nerfs orné de fleurons dorés, roulette sur les coupes, tranches mouchetées, 312 et 235 pp. Nouvelle édition de cette biographie parue l'année précédente sous le titre Mémoires pour servir à l'histoire de Louis de Bourbon, prince de Condé. Plaisante reliure d'époque.
Les Caractères de Théophraste, traduits du grec avec les Caractères ou moeurs de ce siècle. Précédés d'une notice de Sainte-Beuve.
P., Garnier Frères, s.d. (1873), in-12, xxviii-452 pp, reliure demi-basane brune époque, dos lisse orné de filets dorés, bon état
Les Etats provinciaux de l'ancienne France et la question des Etats provinciaux aux XVIIe et XVIIIe siècles. L'Assemblée provinciale du Berri sous Louis XVI. (Thèse).
P., Rousseau, 1909, gr. in-8°, 604 pp, biblio, reliure demi-percaline bleue, dos lisse avec titres dorés et filets à froid (rel. de l'époque), manque les pages de faux-titre et de titre, bon état, envoi a.s.
Une étude des travaux de l'Assemblée provinciale du Berry instituée en 1778 sur l'initiative de Necker, à titre d'expérimentation, et qui subsista avec des vicissitudes diverses jusqu'à la Révolution. Cette tentative éphémère de décentralisation et de réforme administrative se manifesta par la création en 1778 d'un certain nombre d'Assemblées provinciales organisées sur le modèle des anciens États provinciaux. L'Assemblée du Berri fut la seule qui réussit, avec celle de la Haute-Guyenne, à se maintenir quelque temps. L'ouvrage analyse toutes les propositions de réforme qui furent soumises à l'Assemblée au cours des cinq sessions qu'elle tint, et dont quelques-unes seulement aboutirent.
Le Libertinage au XVIIe siècle. IV. Les Recueils collectifs de poésies libres et satiriques publiés depuis 1600 jusqu'à la mort de Théophile (1626).
P., Edouard Champion, 1914, in-4°, xvi-597-(6) pp, index des noms cités, broché, bon état. Très rare édition originale dédiée à Pierre Louÿs, tiré à 305 ex. numérotés seulement (n° 222)
Édition originale de cette monumentale bibliographie par l’érudit bibliographe français Fr. Lachèvre (1855-1943), spécialiste du libertinage au XVIIe s. Contient une biographie et bio-bibliographie des auteurs de recueils imprimés ou mss, une table des anonymes et une table des noms cités.
Les Liaisons dangereuses, ou lettres recueillies dans une société et publiées pour l'instruction de quelques autres. Edition présentée par Roger Vailland et illustrée de 15 gravures de Monnet, Mlle Gérard et Fragonard fils pour l'édition de Londres, 1796.
Club des Libraires de France, 1959, in-8°, 515 pp, 15 gravures hors texte, tirage numéroté sur vélin blanc, reliure pleine toile verte repoussée aux motifs floraux en partie insolée, rhodoïd, signet, bon état
Les Progrès du commerce.
Amsterdam et P., chez Augustin-Martin Lottin, 1760, in-12, xii-336 pp, reliure plein veau raciné, dos lisse à caissons ornés, pièce de titre basane brune, coupes filetées (rel. de l'époque), annotations crayon sur les gardes, bon état. Edition originale. Rare
Par Honoré Lacombe de Prezel (1725-1790), cette histoire du commerce contient quelques principes économiques. Deux parties dans cet ouvrage : la première est consacrée au commerce dans l'Antiquité et à l'époque contemporaine ; la seconde concerne les diverses branches de la production, les banques et les manufactures.
L'éducation politique de Louis XIV.
Hachette, 1923, pt in-8°, (8)-358 pp, seconde édition, reliure demi-percaline bleue, dos lisse, pièce de titre basane noire, couv. conservées (rel. de l'époque), bon état
"On connaît l'excellent ouvrage de M. Lacour-Gayet, qui ne se borne pas à étudier l'éducation politique du Grand Roi, mais qui contient aussi les plus précieuses indications sur les idées politiques du XVIIe siècle. Le livre II est particulièrement intéressant : il comprend d'excellents chapitres sur le droit divin des rois, sur la doctrine du pouvoir absolu dans la seconde moitié du siècle, et il montre que c'est le principe de l'autorité souveraine – quelle que soit la forme du gouvernement – qui s'est imposée à tous les penseurs, à Spinoza comme à Hobbes, jusqu'au moment où l'on commence à réagir contre l'absolutisme." (H. Sée, Annales de Bretagne, 1924)
Jésuites. Une multibiographie. 1. Les conquérants.
Seuil, 1991, fort in-8°, 511 pp, 32 pl. de gravures hors texte, biblio, chronologie et index, broché, bon état
De la fondation de l'ordre par Ignace de Loyola en 1540 à sa suppression en 1773 par le pape Clément XIV, Jean Lacouture propose ici, avec “Les Conquérants”, le premier volet d'un diptyque multicolore que complétera l'évocation des “Revenants” de 1814 à nos jours. En quatorze séquences, il retrace les principaux épisodes de cette histoire prodigieuse et fait surtout revivre les acteurs d'une croisade inlassablement recommencée "pour une plus grande gloire de Dieu".
LACOUTURE (Jean) et Marie-Christine d'ARAGON.
Reference : 22623
(1980)
ISBN : 2-85956-150-1
Julie de Lespinasse. Mourir d'amour.
Ramsay, 1980, gr. in-8°, 319 pp, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Bâtarde, sans beauté et sans fortune, domestique à seize ans des enfants de son père, dame de compagnie de la femme la plus illustre de Paris, le destin de Julie de Lespinasse semblait tout tracé... Mais elle était le charme même. Elle ouvre un salon, et c'est le succès : d'Alembert, Condorcet, Marmontel, La Rochefoucauld, Turgot, La Harpe, Grimm, viennent y refaire le monde. Elle est la muse de l'Encyclopédie ; celle qu'il faut séduire pour entrer à l'Académie française ; elle a la gloire, le pouvoir, tout le monde l'aime. Et pourtant, seule la passion l'anime. Julie est aimée du bon d'Alembert, mais elle aime le marquis de Mora trop amoureux, trop beau, trop jeune, trop parfait. Elle le trahit pour le comte de Guibert, trop volage, trop séduisant, lequel en aime une autre et en épouse une troisième.
Histoire de France pendant le dix-huitième siècle.
P., Buisson, 1812, 5 vol. in-8° (sur 6), iv-398, 423, 403, 404 et 355 pp, 3e édition revue et corrigée, reliures plein veau naturel marbré, dos lisses très ornés, pièces de titre chagrin carmin, coupes guillochées, tranches citron (rel. de l'époque), traces de mouillure ancienne au tome 1, qqs coiffes arasées, bon état. Bon exemplaire, proprement relié à l'époque. Manque le 6e et dernier volume
Des dernières années su règne de Louis XIV à la guerre d'Amérique (1785). — "L'«Histoire de France pendant le dix-huitième siècle», écrite avec autant de goût que d'impartialité, parut pour la première fois en 1808" (Quérard IV, 374)
XVIIIe siècle. Lettres, Sciences et Arts. France 1700-1789. Ouvrage illustré de 16 chromolithographies et de 250 gravures sur bois (dont 20 tirées hors texte) d'après Watteau, Vanloo, Largillière, Boucher, Lancret, Greuze, Chardin, Desportes, Oudry, Vernet, La Tour, Les Saint-Aubin, Gravelot, Cochin, Eisen, Moreau, Marillier, Debucourt, etc.
P., Firmin-Didot, 1878, in-4°, xii-560 pp, 16 chromolithographies hors texte en couleurs, 250 gravures sur bois dans le texte et à pleine page, reliure demi-chagrin rouge, plats de percaline rouge et dos ornés d'entrelacs et guirlandes dorés avec en médaillon le titre au 1er plat et l'éditeur au second, tranches dorées (reliure très décorative de l'éditeur), exemplaire sans aucune rousseurs, bon état (Vicaire, IV, 854)
LA FARE (Marquis de) et Duc de SAINT-SIMON.
Reference : 113620
(2010)
ISBN : 9782357550452
Le marquis & le duc. Mémoires et réflexions sur les principaux événements du règne de Louis XIV, et sur le caractère de ceux qui y ont eu la principale part suivis de Matériaux pour servir à un mémoire sur l'occurrence présente. Introduction et notes de Jean-Louis Leutrat.
Alain Baudry & Cie, 2010, gr. in-8°, 291 pp, biblio, index, broché, couv. à rabats, bon état
Tout oppose le marquis de La Fare et le duc de Saint-Simon : les hommes étaient de complexion différente, l'un bon vivant et l'autre réservé, la taille de leurs ouvrages étant inversement proportionnelle à leur corpulence. Les mettre face à face ne vise pas à les placer sur un pied d'égalité ; l'intérêt de la rencontre de deux textes aussi dissemblables est de nous amener à nous interroger sur l'activité de mémorialiste au Grand Siècle. L'un nous parle de campagnes militaires, et des conséquences que peuvent avoir sur elles les intrigues de la Cour, alors que l'autre placé au coeur du cyclone, non loin de l'âtre royal, explore avec minutie les méandres de l'étiquette. Le changement de perspective est loin d'être inintéressant. En outre, les Mémoires et Réflexions de La Fare qui n'ont pas été réédités depuis 1884, redonnent des couleurs à des figures que l'Histoire a momifiées.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers

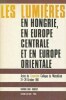
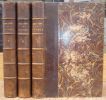



![Louis XV.. LA BATUT (Guy de la)].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/VIG/116998_1_thumb.jpg)

![Histoire de la vie et actions de Louis de Bourbon, prince de Condé. . LA BRUNE (Jean de)].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/VIG/73886_1_thumb.jpg)
![Histoire de la vie et actions de Louis de Bourbon, prince de Condé. . LA BRUNE (Jean de)].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/VIG/73886_2_thumb.jpg)
![Histoire de la vie et actions de Louis de Bourbon, prince de Condé. . LA BRUNE (Jean de)].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/VIG/73886_3_thumb.jpg)




