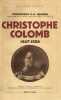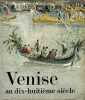-
Type
Book (2343)
Magazine (3)
-
Latest
Last month (21)
Last week (1)
-
Century
16th (1)
17th (28)
18th (99)
19th (407)
20th (1661)
21st (116)
-
Countries
France (2345)
Switzerland (1)
-
Syndicate
ILAB (2336)
SLAM (2336)
Système social, ou Principes naturels de la morale et de la politique. Avec un examen de l'influence du gouvernement sur les moeurs.
Londres [Amsterdam, M.M. Rey], 1773, 3 tomes en un vol. in-8°, viii-viii-218-(2),(4)-174-(2) et (8)-166-(1) pp, reliure demi-veau naturel, dos à nerfs, pièce de titre maroquin rouge (reliure de l'époque), tranches rouges, bon exemplaire, malgré de nombreuses soulignures au crayon rouge (très propres) faites par un historien spécialiste d'Holbach. Edition originale complète des 3 parties reliées en 1 volume : Principes naturels de la morale ; Principes naturels de la politique ; De l'influence du gouvernement sur les moeurs
PREMIERE EDITION de cet ouvrage qui figure parmi les ouvrages saisis chez la veuve Stikdorff en juin 1773, qui fut mis à l'index en août 1775. En 1822, il sera de nouveau en butte aux rigueurs policières (Vercruysse, 1773 A4). D’Holbach (1723-1789) publia cet essai trois ans après le "Système de la nature", qui avait créé une vive polémique, l'auteur défendant des propos athées et matérialistes. Il insiste à nouveau ici sur le fondement naturel de la morale, qu'il détache ainsi de tout principe religieux. Pour d'Holbach "la morale convenable à l'homme, doit être fondée sur la nature de l'homme ; il faut qu'elle lui apprenne ce qu'il est, le but qu'il se propose, & les moyens d'y parvenir".
Christophe Colomb (1447-1506).
Payot, 1935, in-8°, 334 pp, traduit de l'allemand, broché, couv. illustrée, bon état (Bibliothèque Historique)
A peu d'êtres il était réservé d'opérer dans le destin de leurs semblables des transformations aussi profondes et d'une portée aussi illimitée qu'à Christophe Colomb, qui découvrit un monde nouveau et détermina la plus fabuleuse migration de tous les temps. Esprit inquiet et bizarre, à la fois aventurier et mystique, le grand navigateur génois était déjà une énigme pour ses contemporains. Était-ce un saint ? Un savant ? Un marin ignorant mais hardi ? Un marchand d'esclaves avide de gains ? Enfin, il est un aspect peu connu du génie de Colomb que Heinrich H. Houben met ici en valeur, c'est le grand talent littéraire de ce marin. Colomb se révèle un poète et le premier en date des peintres de la nature exotique.
Carrière et oeuvre d'un homme de lettres sous le règne de Louis XIV : Eustache Le Noble (1643-1711). (Thèse).
Université de Paris IV, 1987, 3 vol. in-4°, 758 pp, fac-similés, biblio, index, broché, bon état. Thèse pour le Doctorat d'Etat sous la direction du professeur Yves Coirault.
Galerie de portraits du dix-huitième siècle. Sixième édition considérablement augmentée. Deuxième série : Princesses de comédie et déesses d'opéra.
P., Hachette, 1858, in-12, viii-280 pp, reliure demi-basane noire époque, dos lisse orné de filets dorés, qqs rousseurs éparses, bon état
Le Roi Voltaire. Sa généalogie - sa jeunesse - ses femmes - sa cour - ses ministres - son peuple - ses conquêtes - son Dieu - sa dynastie.
P., Dentu, 1878, in-12, xxiv-251 pp, page de titre en rouge et noir, lettrines, bandeaux, culs-de-lampes, texte encadré d'un filet noir, reliure plein cuir souple havane, dos lisse avec titres et doubles filets à froid, filet à froid encadrant les plats (rel. de l'époque), bon état
Le roi Voltaire : sa généalogie, sa jeunesse, ses maîtresses, son sacre, sa cour, son peuple, ses ministres, ses victoires et conquêtes, sa mort, son Dieu, ses œuvres, sa dynastie, la comédie voltairienne.
Michel de Castelnau, ambassadeur en Angleterre (1575-1585).
Paris (Saint-Cloud, Imp. de Mme Vve Belin), 1856, in-8°, ix-143 pp, broché, couv. imprimée, bon état, envoi a.s.
Michel de Castelnau, sieur de Mauvissière, de qui l’on a de si intéressants Mémoires, et qui joua un rôle si important dans la diplomatie de ce temps-là par ses négociations et ses ambassades.
La Torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècle. Son application, ses partisans et ses adversaires, son abolition. Etude historique.
S.l. [Bruxelles, Académie Royale de Belgique], s.d. (1897), in-4°, 176 pp, pièces justificatives, index, modeste cartonnage souple d'attente, bon état
La place de la torture et le fonctionnement de l’instruction judiciaire dans les Pays-Bas autrichiens et l’ancien pays de Liège pendant la dernière partie de l’ancien régime. L'auteur expose dans un premier chapitre la législation en vigueur depuis les ordonnances de Philippe II. Il étudie ensuite le mouvement qui se produisit dans les esprits au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle contre la cruauté des peines en général, et spécialement contre la torture... — "Travail approfondi, d'après les documents en grande partie inédits, très complet et du plus haut intérêt. « Le travail de M. Hubert, à dit M. Duvivier à l'Académie, présente un grand intérêt : il est riche de faits, il expose avec netteté et exactitude la législation sur la torture, le rôle que jouait celle-ci dans l'instruction judiciaire, le mouvement de l'opinion en faveur de son abolition, les résistances que rencontra cette suppression. » C'est à Joseph II qu'est due, pendant la vie de sa mère, Marie-Thérèse, l'abolition de la torture dans les états héréditaires de l'Autriche. Dans les Pays-Bas catholiques, la réforme fut plus difficile, rencontrant une vive opposition dans tous les conseils de justice. Il fallut louvoyer. Le gouvernement commença par décider que l'application à la torture ne pourrait désormais avoir lieu que moyennant son autorisation spéciale après communication des procédures. Et dans chaque cas particulier, il refusait l'autorisation demandée. En 1781, le Conseil de Flandre insiste pour être autorisé à appliquer à la torture le prêtre Bauwens... Une longue procédure s'engage : « On arrache rarement, dit le Conseil de Flandre, aux scélérats endurcis au crime par une longue habitude, tel que celui-ci, des confessions autrement que par la réalité et la violence des tourments. » Le gouvernement finit par écrire qu'il n'autorisera plus la torture. Et malgré tout le mécontentement et les aigres observations des conseils de justice. l'empereur Joseph II prononce la complète abolition de la torture par l'article 63 du décret du 3 avril 1787. L'on continua cependant à torturer les accusés en 1790, 1791 et jusqu'en 1794, car la Révolution brabançonne amena l'abrogation des réformes de Joseph II..." (La Belgique judiciaire, 1897) — Extrait du tome 55 des Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers de l'Académie Royale (de Belgique).
Honoré Fragonard l'anatomiste, 1732–1799. Les écorchés au XVIIIe siècle.
Chez l'Auteur, 1990, in-4°, xiv-(19)-71-(37) pp, texte dactylographié, 20 photos originales en couleurs, un portrait, annexes, biblio, broché, bon état (Mémoire de maîtrise d'histoire, sous la direction de Michel Serres, Université de Paris I)
Préambule : Les préparations anatomiques du XVIIe et XVIIIe siècles. – Annexes Préambule. – Vie d'Honoré Fragonard : l'enfance et les années de jeunesse 1732-1759, directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort 1765-1771, l'oeuvre anatomique, le renvoi, l'après-Alfort 1771-1792, ses productions, la Révolution 1792-1794, la Commission temporaire des arts, l'Ecole de santé de Paris 1794-1799. – Son oeuvre. – Annexes Fragonard.
Marie-Antoinette, l'impossible bonheur.
Lausanne, Edita, 1970, pt in-4°, 244 pp, texte sur deux colonnes, très nombreuses illustrations et fac-similés en noir et en couleurs dans le texte et à pleine page, certaines contrecollées, reliure pleine toile bleu roi avec trois fleurs de lys au 1er plat de l'éditeur, jaquette illustrée, pt trace d'humidité ancienne au 2e plat, bon état
"Il s'agit moins, dans ce beau livre, de grande histoire que d'histoire des mœurs. Certes, celle-ci est inséparable de celle-là. Et le regretté Philippe Huisman comme Mme Marguerite Jallut ont intimement lié l'une et l'autre. Il reste que les deux auteurs, en se penchant sur le destin douloureux de la dernière reine de France, ont eu surtout pour objectif d'interroger la fin de ce siècle de la « douceur de vivre » que Marie-Antoinette incarna si exactement. Aussi bien, suit-on ici, à travers les quatre saisons de sa courte existence, l'évolution du goût de l'archiduchesse d'Autriche, devenue dauphine, puis reine du plus beau des royaumes qui allait ignominieusement la rejeter et la sacrifier. L'ouvrage témoigne d'un grand raffinement matériel, qui est à l'image du règne qu'il évoque avec ime attention et un soin dignes de tous les éloges. Par son abondante illustration qui est à peu près exclusivement en couleurs, il présente plus que l'essentiel de l'histoire de l'art français à partir du déclin du règne de Louis XV jusqu'à l'explosion révolutionnaire. L'analyse d'un « style de vie » – celui de la cour, mais aussi celui de la ville. Les fêtes de Versailles, mais aussi les fêtes de Paris. Les transformations du palais, sous l'influence de la reine, la décoration de Trianon, les puérilités du Hameau où cette reine enfant s'amusait à jouer à la fermière. Et puis, dans la capitale, le Salon, l'attrait qu'il exerçait alors sur le public parisien (cent mille visiteurs en un mois...), le tournant caractéristique qui s'y dessine entre 1781 et 1785, l'apparition des thèmes guerriers et héroïques qui se mêlent aux thèmes badins et sentimentaux, « l'amour de la vie et de tous ses fruits, [dissimulant] pour quelques mois encore la dangereuse, la malsaine, l'affreuse séduction de la mort. » Oui, « ce terrible complexe suicidaire n'atteint pas seulement les êtres, il peut aussi atteindre les peuples ou une classe sociale tout entière. » Voilà ce qu'ont à juste titre souligné les auteurs au cours de leur livre brillant et amer. Une des ultimes images reproduit le visage pathétique de l'« Autrichienne » conduite au supplice, telle que la vit le régicide Louis David d'une des fenêtres de Paris ensanglanté. Un chef-d'œuvre atroce. Mieux que tout autre, il symbolise l'« impossible bonheur » de Marie-Antoinette." (Yvan Christ, Revue des Deux Mondes, 1970)
Marie Stuart, 1542-1587.
P., Dominique Wapler, 1948, in-8°, 374 pp, un portrait en frontispice, un tableau généalogique dépliant hors texte, biblio, broché, bon état. Edition originale, un des 60 ex. numérotés sur Alfa mousse Navarre
Réunion de 3 ouvrages : 1. Monsieur de Voltaire peint par lui-même ou Lettres de cet écrivain, dans lesquelles on verra l'histoire de sa vie, de ses ouvrages, de ses querelles, de ses correspondances, & les principaux traits de son caractère, avec un grand nombre d'anecdotes, de remarques et de jugements littéraires. Première et seconde partie. A Lausanne, par la Compagnie des Librairies, 1767, iv-212 et 70 pp. – 2. Exposé succinct de la contestation qui s'est élevée entre M. Hume et M. Rousseau, avec les pièces justificatives. A Londres, 1766, xiv-127 pp. – 3. VOLTAIRE. Le Docteur Pansophe, ou Lettres de Monsieur de Voltaire. A Londres, 1766, 46 pp [contenant la Lettre de monsieur de Voltaire à monsieur Hume et la Justification de J.J. Rousseau dans la contestation qui lui est survenue avec M. Hume].
Lausanne et Londres, 1766-1767, in-12, reliure plein veau marbré, dos lisse, triple filets et caissons dorés ornés, pièce de titre basane bordeaux, tranches rouges (rel. de l'époque), dos et plats frottés, coiffes abîmées, état correct
Intéressant recueil réunissant deux des principaux ouvrages publiés autour de la rupture de Hume et de Rousseau. Ce dernier, poursuivi par la censure sur le continent, était venu s'installer en Angleterre à l'invitation du célèbre philosophe écossais mais la discorde n'avait pas tardé à naître entre les deux hommes. – 1. Edition restée inconnue à Bengesco, de cette compilation des lettres publiée du vivant de l’auteur, due sans doute à Angliviel de la Beaumelle, et qui selon Grimm "a fait mourir de rire, et qu'on ne prend pas plus mauvaise opinion de l'homme illustre pour lequel le compilateur non illustre a voulu témoigner de l'aversion". – 2. Edition originale, publiée en français par Suard d'après le manuscrit anglais de Hume. L'édition anglaise "retraduite" du français, parut quelques mois plus tard. Cet ouvrage de Hume contient la version du philosophe écossais sur sa brouille avec Rousseau. Le 9 janvier 1766, par un temps glacial, deux des intellectuels les plus importants du siècle s’embarquent ensemble à Calais pour l’Angleterre : Jean-Jacques Rousseau et David Hume. Le philosophe écossais a décidé de prendre Jean-Jacques, persécuté, sous sa protection. Depuis plus de trois ans Rousseau est en effet en exil, après que son Émile ait été par jugement lacéré et brûlé sur les marches du Palais de Justice de Paris. David Hume n’a alors en France presque que des amis, Jean-Jacques presque que des ennemis. Le 21 mai de l’année suivante, hagard, au bord de la folie, Rousseau fuit l’Angleterre après une folle querelle, venimeuse, acharnée, avec le « bon David ». Que s’est-il passé ? Tout Paris bruit des éclats de la querelle. Hume décide, sous la pression des philosophes français, de rédiger un compte-rendu de cette pénible affaire, intitulé Exposé succinct de la contestation qui s’est élevée entre M. Hume et M. Rousseau, avec les pièces justificatives. Il paraît à Paris au cours de l’automne 1766. D’Alembert en a supervisé la traduction. Deux mois plus tard, il est publié en Anglais à Londres, prétendument « traduit du français ». Entre les deux éditions, Hume a rajouté des notes, en a supprimé d’autres. Au-delà de l’anecdote, qui a son importance, ce petit livre éclaire la vie quotidienne et le comportement de deux des génies de ce XVIIIe siècle européen qui en compta beaucoup. S’attacher profondément à leurs œuvres nourrit la curiosité envers les hommes qui les ont créées. Lorsqu’il s’agit de Hume et de Rousseau, rien à leur sujet ne peut nous être indifférent. – 3. Edition originale. Ayant appris la rupture survenue entre Rousseau et son protecteur, le grand philosophe écossais David Hume, Voltaire écrit à ce dernier le 24 octobre 1766 pour lui relater ses propres démêlés avec le Citoyen de Genève. Le pamphlet se termine sur une Lettre de M. de Voltaire au docteur Jean-Jacques Pansophe, texte dont Voltaire nia la paternité, inventaire cumulé des exemples démonstratifs de l’absence de bonne foi, de bon sens et de modestie chez Jean-Jacques... Bien que Voltaire ait toujours nié être l'auteur du pamphlet, ses contemporains furent unanimes à le lui attribuer, de même que les bibliographes.
Une reine, Catherine de Médicis.
Club du Livre d'Histoire, 1956, in-8°, 395 pp, 12 pl. de gravures hors texte (4 doubles), biblio, tiré sur Bouffant Prioux, numéroté, reliure demi-basane carmin de l'éditeur, dos à 3 faux-nerfs, titres dorés, sous emboîtage cartonné papier fantaisie, bon état
Une biographie, assez peu connue, qui rend justice à cette grande reine de France, mère de trois rois, et régente du royaume pendant trois années.
Bourgeois et gentilshommes. La réussite sociale en France au XVIe siècle.
Flammarion, 1982, in-8°, 297 pp, traduit de l'américain, index, broché, couv. à rabats, bon état
"Les polémiques sur la Révolution française et leurs simplifications abusives ont figé en un modèle durable l'image abstraite de deux « élites »: la « noblesse» fondée sur la naissance, et la « bourgeoisie » définie par la richesse acquise. Cette conception est manifestement dépassée. La réalité est infiniment plus complexe et plus ductile, car la mobilité sociale fut très souple et dynamique dans la France du XVIe siècle." (Lectures n° 14, juillet-août 1983)
Les Amours de Catherine de Bourbon, soeur du Roi, et du Comte de Soissons. Souvenirs du règne de Henri IV.
P., Georges Hurtrel, Artiste-Editeur, 1882, in-12, 218 pp, un frontispice et 9 pl. de gravures sous serpente hors texte (dont 8 en deux tons), vignettes, lettrines et culs-de-lampe, broché, couv. rempliée crème imprimée en bleu, sous chemise de percaline rouge décorée de fers spéciaux dorés de l'éditeur (avec rubans de fermeture), tirage à 1000 exemplaires numérotés à la main et signés par l'auteur, bon état
Illustrations réalisées par M. Adolphe Lalauze, aquafortiste ; MM. Riester, A. Lalauze, Uzès, Georges Hurtrel, dessinateurs et MM. F. Méaulle et Gillot, graveurs.
Memoirs of the Life of Colonel Hutchinson, Governor of Nottingham Castle and Town, Representative of the County of Nottingham in the Long Parliament, and of the Town of Nottingham in the First Parliament of Charles II, etc. With original anecdotes of many of the Most Distinguished of his contemporaries, and a Summary Review of Public affairs: Written by his Widow Lucy... Now first published from the original manuscript by the Rev. Julius Hutchinson. To which is prefixed The Life of Mrs. Hutchinson, Written by Herself, a Fragment. Third Edition.
London: printed for Longman, Hurst, Rees, and Orme, by T. Bensley, 1810, 2 vol. in-8°, xxviii-348 et 384 pp, 3e édition, portraits gravés du colonel Hutchinson et de Mrs Lucy Hutchinson en frontispices, un tableau généalogique dépliant, un fac-similé et un plan repliés, une gravure hors texte, reliures plein veau glacé fauve, dos à 5 nerfs soulignés à froid, fleurons dorés et à froid, roulettes dorées, pièces de titre et de tomaison basane noire, triples filets dorés et large filet à froid encadrant les plats (rel. de l'époque), bon état. Exemplaire bien relié. Texte en anglais
"The Life of John Hutchinson of Owthorpe in the Country of Nottinghamshire", composée par Lucy Hutchinson entre 1664 et 1667, rapporte le destin tragique du Colonel Hutchinson qui mourut en captivité le 11 septembre 1664. Signataire de l’arrêt de mort du roi Charles Ier et soupçonné d’avoir participé à un complot contre Charles II, celui-ci fut arrêté en octobre 1663 sans avoir jamais été jugé. S’il s’écoula presque cent quarante ans entre l’écriture et la publication de « The Life », c’est qu’il était impensable pour la famille Hutchinson d’autoriser la publication de la Vie d’un régicide au temps de la monarchie restaurée. À la fin du XVIIIe siècle, alors que des récits du même genre avaient été publiés, la famille Hutchinson refusa à l’antiquaire Mark Noble, qui écrivait The Lives of the English Regicides (1798), le droit de consulter le manuscrit. Une demande similaire de l’historienne Catharine Macaulay (1731-1791) fut rejetée. Ainsi, même si l’existence de cette Vie de John Hutchinson était connue, il semble qu’elle ait peu circulé avant sa publication en 1806 par Julius Hutchinson, qui avait hérité des écrits de son aïeule. Ce volume, publié sous le titre “Memoirs of the Life of Colonel Hutchinson”, rassemble en fait plusieurs pièces : un fragment autobiographique (« The Life of Mrs. Hutchinson Written by Herself. A Fragment »), la dédicace aux enfants (« To My Children »), la Vie du Colonel (« The Life of John Hutchinson »), l’inscription qui figure sur le Monument du Colonel Hutchinson à Owthorpe, et quelques vers tirés du volume aujourd’hui perdu où Lucy Hutchinson avait consigné sa Vie. Dans sa préface, Julius Hutchinson présente les “Memoirs” comme « l’histoire de l’une des époques les plus remarquables des annales britanniques. »
L'affaire Fouquet.
Editions R.-A. Corrêa, 1937, in-8°, 232 pp, un portrait de Fouquet en frontispice, annexes : Fouquet devant la Chambre de justice, broché, couv. illustrée, papier jauni, état correct, envoi a.s. à J.-L. Vaudoyer
HÉNIN (Etienne-Félix d'Hénin de Cuvillers).
Reference : 114214
(2009)
ISBN : 9782356760128
Mémoire concernant le système de paix et de guerre que les Puissances européennes pratiquent à l’égard des Régences barbaresques. Traduit de l'italien par le Chev. d'Hénin, Officier au Rég. des Dragons de Languedoc, Secrétaire d'Ambassade de France à Venise.
Editions Bouchène, 2009, in-8°, 108 pp, présentation par Alain Blondy (26 pp), un portrait de d'Hénin et une gravure, généalogie simplifiée de d'Hénin, broché, bon état. Réédition de l'édition de 1788
L’ouvrage publié par d’Hénin connut deux éditions : la première en 1787 et la seconde en 1788, même si toutes deux portent la première date. Si entre les deux éditions le corps de l’ouvrage n’est aucunement différent, la deuxième porte la mention « traduit de l’italien ». Or Hénin est péremptoire lorsque, dans son « avertissement de l’édition italienne », il écarte comme superfétatoire toute recherche sur l’auteur italien du texte. Il se camoufle derrière l’autorité du célèbre « antiquaire » napolitain, le marquis Galliani, dont le frère, l’abbé Ferdinando, avait eu son heure de gloire comme secrétaire d’ambassade à Paris. Il semble que s’il y eût jamais un texte italien de cet ouvrage, il soit resté à l’état de manuscrit car rien, dans la production littéraire de l’époque ne correspond véritablement au sujet abordé par d’Hénin. En revanche, un document rédigé dans les années 1783-1784 par un négociant vénitien, Marino Doxarà qui, accompagné du patricien Andrea Maria Querini avait été chargé d’une mission auprès du bey de Tunis, a pu être connu d’Hénin qui dit crûment qu’il « n’est pas nécessaire de chercher de quelle main ce Mémoire » lui est venu. En effet, Hénin ne semble pas faire là oeuvre de dilettante. Ce travail, traduction d’un manuscrit ou mémoire rédigé par lui-même à partir de données locales, répond à une attente du ministère des Affaires étrangères. C’était d’ailleurs une tradition que n’abandonnèrent pas les relations extérieures de la Révolution, que de confier à des secrétaires d’ambassade la rédaction de brochures ou de livres, souvent anonymes et censés avoir été publiés à l’étranger, pour dire officieusement ce que le gouvernement pensait et préparer ainsi l’esprit public que l’on n’appelait pas encore l’opinion.
Catherine de Médicis.
Fayard, 1940, in-12, 731 pp, sources et biblio, broché, bon état (Coll. Les Grandes Etudes historiques)
Remarquable étude, avec une très ample bibliographie. — "Une œuvre, non d'un simple vulgarisateur de seconde main, mais d'un historien méthodique. M. Héritier a voulu écrire, non une biographie stricte comme feu J.-H. Mariéjol, ni une histoire du temps de Catherine de Médicis, mais une « synthèse » de la vie et des actions de son personnage, qu'il s'est efforcé de replacer dans son siècle et qu'il s'interdit d'expliquer à l'aide d'autre chose que les idées, la mentalité de ce siècle. En fait, les 731 pages de cette « svnthèse » contiennent bien des analyses, ou des contributions analytiques. On ne s'en plaindra pas, car ces morceaux sont sérieux, généralement bien informés, même lorsqu'il s'agit des relations du gouvernement de Paris avec Elizabeth d'Angleterre et du projet de mariage de François, duc d'Anjou, même lorsqu'il s'agit de l'affaire de Portugal et des négociations compliquées menées par Catherine avec son gendre de l'Escorial. Il a annexé à son travail une copieuse Orientation bibliographique (39 pages). Cette « orientation » est en réalité un aperçu fort ample sur l'ensemble des sources et de la bibliographie concernant non seulement Catherine de Médicis, mais bien l'histoire générale et particulière de toute la période française 1560-1589. On y relèvera peu de lacunes. Le volume est de lecture attachante. Une Catherine de Médicis femme, mère et « gouvernante », un peu systématique, très vivante cependant, se dessine clairement devant l'esprit du lecteur. M. Héritier atteint donc son objet et son gros ouvrage se classera certainement à un bon rang dans la collection à laquelle il l'a donné." (H. Drouot, Revue d'histoire de l'Église de France, 1941) — "Par une singulière coïncidence le livre de M. Jean Héritier, qui évoque la période du plus grand déchirement français – les guerres de Religion – jusqu’en 1940, parut précisément en 1940 et fut presque aussitôt épuisé. Son livre apparaît comme un tableau fort complet, disposé dans les perspectives les plus variées autour d’un portrait très approfondi : celui du personnage central, qui anime et domine toute la peinture. Que ce personnage soit une femme contribue sans doute à donner à ce récit, d’une stricte rigueur historique, son caractère émouvant, pathétique. La formule consacrée n’est certes pas de complaisance ici : cela se lit comme un roman, et le plus passionnant des romans. Nulle femme pourtant ne fut moins romanesque que Catherine de Médicis, au sens où on l’entend des héroïnes féminines, puisque son biographe peut dire d’elle qu’elle n’avait jamais eu d’aventure amoureuse. Sa seule passion de femme, mais violente et de grandes conséquences politiques, fut le sentiment maternel. Il faut noter aussi un attachement conjugal réel, solide, mais trop dénoué ; le destin fit de Catherine non une épouse, mais une mère royale, et plus véritablement : un roi..." (Yves Florenne, Le Monde diplomatique, 1960)
Catherine de Médicis.
Fayard, 1940, in-12, 731 pp, sources et biblio, reliure demi-toile chagrinée chocolat, dos lisse avec titres dorés et filets à froid, couv. conservées (rel. de l'époque), bon état (Coll. Les Grandes études historiques). Edition originale imprimée sur alfa
Remarquable étude, avec une très ample bibliographie. — "Une œuvre, non d'un simple vulgarisateur de seconde main, mais d'un historien méthodique. M. Héritier a voulu écrire, non une biographie stricte comme feu J.-H. Mariéjol, ni une histoire du temps de Catherine de Médicis, mais une « synthèse » de la vie et des actions de son personnage, qu'il s'est efforcé de replacer dans son siècle et qu'il s'interdit d'expliquer à l'aide d'autre chose que les idées, la mentalité de ce siècle. En fait, les 731 pages de cette « synthèse » contiennent bien des analyses, ou des contributions analytiques. On ne s'en plaindra pas, car ces morceaux sont sérieux, généralement bien informés, même lorsqu'il s'agit des relations du gouvernement de Paris avec Elizabeth d'Angleterre et du projet de mariage de François, duc d'Anjou, même lorsqu'il s'agit de l'affaire de Portugal et des négociations compliquées menées par Catherine avec son gendre de l'Escorial. Il a annexé à son travail une copieuse Orientation bibliographique (39 pages). Cette « orientation » est en réalité un aperçu fort ample sur l'ensemble des sources et de la bibliographie concernant non seulement Catherine de Médicis, mais bien l'histoire générale et particulière de toute la période française 1560-1589. On y relèvera peu de lacunes. Le volume est de lecture attachante. Une Catherine de Médicis femme, mère et « gouvernante », un peu systématique, très vivante cependant, se dessine clairement devant l'esprit du lecteur. M. Héritier atteint donc son objet et son gros ouvrage se classera certainement à un bon rang dans la collection à laquelle il l'a donné." (H. Drouot, Revue d'histoire de l'Église de France, 1941) — "Par une singulière coïncidence le livre de M. Jean Héritier, qui évoque la période du plus grand déchirement français – les guerres de Religion – jusqu’en 1940, parut précisément en 1940 et fut presque aussitôt épuisé. Son livre apparaît comme un tableau fort complet, disposé dans les perspectives les plus variées autour d’un portrait très approfondi : celui du personnage central, qui anime et domine toute la peinture. Que ce personnage soit une femme contribue sans doute à donner à ce récit, d’une stricte rigueur historique, son caractère émouvant, pathétique. La formule consacrée n’est certes pas de complaisance ici : cela se lit comme un roman, et le plus passionnant des romans. Nulle femme pourtant ne fut moins romanesque que Catherine de Médicis, au sens où on l’entend des héroïnes féminines, puisque son biographe peut dire d’elle qu’elle n’avait jamais eu d’aventure amoureuse. Sa seule passion de femme, mais violente et de grandes conséquences politiques, fut le sentiment maternel. Il faut noter aussi un attachement conjugal réel, solide, mais trop dénoué ; le destin fit de Catherine non une épouse, mais une mère royale, et plus véritablement : un roi..." (Yves Florenne, Le Monde diplomatique, 1960)
Les femmes des Tuileries : Les dernières années de Louis XV (1768-1774). Nouvelle édition.
Paris Dentu 1883 1 vol. relié in-12, demi-chagrin vert sapin, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couvertures conservées, XCIX + 182 pp. "Les femmes de Versailles" mentionné sur le faux-titre. Rousseurs éparses, sinon bon exemplaire.
Les femmes de Versailles : La Cour de Louis XV.
Paris Dentu 1882 1 vol. relié in-12, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couvertures conservées, 312 pp. Très bon exemplaire.
Henri IV : Les clés d'un règne. Précédé de Les trente derniers jours d'Henri IV.
Orthez, Editions Gascogne, La République, L'Eclair, 2010, gr. in-8°, 302 pp, qqs gravures et portraits, chronologie, biblio, broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s. de Thierry Issartel
Henri IV est sans nul doute le roi le plus populaire dans le coeur des Français. A l'heure de la commémoration du 400e anniversaire de son assassinat, il convenait de revenir sur un destin exceptionnel. Cet ouvrage collectif a l'ambition d'apporter un éclairage neuf sur une période qui a contribué à façonner notre modernité, au-delà des anecdotes plus ou moins légendaires circulant sur le "bon roi Henri". A partir de la narration des trente derniers jours de la vie du monarque, cet ouvrage se propose, dans une synthèse accessible à tous, de donner au lecteur les clés du règne d'Henri IV. Historiens, experts, journalistes, les plus grands spécialistes ont écrit ces textes initialement parus dans les quotidiens “La République des Pyrénées” et “L'Eclair”. Sous une forme revue et augmentée, ils sont aujourd'hui réunis pour constituer un ouvrage de référence particulièrement original.
IVANOFF (Nicolas), Roseline Bacou, Michel Laclotte, Pierre Rosenberg.
Reference : 25407
(1971)
Venise au dix-huitième siècle. Peintures, dessins et gravures des collections françaises.
P., Réunion des Musées Nationaux, 1971, pt in-4° (24 x 21), 209 pp, introduction de Gaston Palewski, une étude de Nicolas Ivanoff sur “La France et Venise au XVIIIe siècle, relations artistiques”, suivies de 332 descriptions d'œuvres avec notices, dont environ 250 reproduites en noir, 4 planches en couleurs, biblio, broché, couv. illustrée en couleurs, bon état
Ce catalogue raisonné a été édité à l'occasion de l'exposition “Venise au dix-huitième siècle. Peintures, dessins et gravures des collections françaises” présentée au musée de l'Orangerie des Tuileries, à Paris, du 21 septembre au 29 novembre 1971. Un vaste panorama des artistes et des œuvres.
Souvarov, 1730-1800.
Payot, 1935, in-8°, 352 pp, broché, couv. illustrée d'un portrait gravé de Souvarov, bon état (Coll. Bibliothèque historique)
"L'excellente Bibliothèque historique de la maison d'édition Payot, où la Russie tient déjà une place importante, s'accroît d'une unité nouvelle qui contribuera heureusement à intéresser le grand public à une des périodes les plus curieuses de l'histoire russe en mettant en lumière la figure d'un grand soldat : Souvarov (1730-1800), par Jean Jacoby." (A. Mazon, Revue des Études Slaves, 1935)
Bayard.
GLM/Fayard, 1987, in-8°, 396 pp, 8 pl. de gravures hors texte, 3 cartes, biblio, index, reliure éditeur, jaquette illustrée, bon état
Personnage légendaire, Bayard, modeste gentilhomme provincial, est d'abord un témoin de son époque. Contemporain de Léonard de Vinci, de Luther et de Christophe Colomb, il a vécu dans une Europe en pleine transformation à l'heure où se mettent en place les organes de l'Etat moderne et où la vieille gentilhommerie voit s'amenuiser les bases de son pouvoir. Bayard et ses compagnons sont ainsi au contact de deux mondes. Par sa naissance, par son éducation, par ses premières campagnes, le bon chevalier est encore tout pénétré d'un idéal humain fait de bravoure individuelle, du respect des règles du combat, de vertus chrétiennes. En même temps, bon gré mal gré, il participe au nouvel art de la guerre qui s'esquisse : il accepte de se mettre à la tête de gens de pied, sait utiliser l'artillerie et il lui arrive de ruser pour tromper l'ennemi. Et, symboliquement, c'est une balle d'arquebuse tirée par un simple soldat qui l'abat, chevalier terrassé par l'arme de l'avenir. Car Bayard est en son temps un personnage anachronique. C'est ce qui le rend si attachant et parfois si émouvant. Le génie de ses premiers biographes qui ont fait de lui l'exemple du "gentil chevalier", conforme en tous points à un idéal nobiliaire, a permis à tout un groupe social de se reconnaître en lui au moment même où son destin historique s'achevait. Et sans doute est-ce parce qu'il apparaissait comme le héros d'un monde révolu que sa mémoire a traversé les siècles.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers