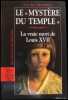Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (21)
19th (199)
20th (831)
21st (41)
-
Syndicate
ILAB (1103)
SLAM (1103)
La dernière lettre. Prisons et condamnés de la Révolution, 1793-1794.
Laffont, 1984, gr. in-8°, 285 pp, préface de Michel Vovelle, 8 pl. de gravures hors texte, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné place de la Révolution : la Terreur s’installe en France, féroce, implacable avec la loi des suspects du 17 septembre. Pendant plusieurs mois, Paris va vivre au rythme sinistre des charrettes qui se succèdent place de la Révolution ou place du Trône Renversé. Ceux qui sont ainsi conduits à l’échafaud n’ont souvent été jugés que quelques heures plus tôt par le Tribunal révolutionnaire. La dernière lettre est celle qu’ils trouvaient la force d’écrire à leurs proches dans ces derniers instants, mais qui était automatiquement interceptée par la bureaucratie révolutionnaire et n’atteignait jamais son destinataire. Éparpillées dans diverses séries des Archives nationales, ces lettres constituent un document exceptionnel aussi bien sur la vie quotidienne dans les prisons de la Terreur que sur la sensibilité collective de tous ces hommes et de toutes ces femmes face à la mort. À travers leurs lignes percent tour à tour résignation, courage, rancoeur, désespoir, peur : nous avons là une véritable palette des sentiments. L’émotion est derrière chaque phrase, chaque mot.
Un pasteur du temps des Lumières : Benjamin-Sigismond Frossard (1754-1830).
Honoré Champion, 2000 gr. in-8°, 427 pp, préface de Daniel Robert, annexes, biblio, index, reliure cartonnée de l'éditeur, bon état (Coll. Vie des Huguenots)
Benjamin-Sigismond Frossard (1754-1830), par sa formation à la prestigieuse académie de Genève, par ses goûts, ses tendances philosophiques et ses engagements politiques, est véritablement un « homme des Lumières ». Sa carrière comporte plusieurs points forts. À Lyon, où il est pasteur depuis 1777, il se fait de nombreuses relations : Brissot, les Roland – mais il est aussi membre de la prestigieuse Société royale d'Agriculture. L'université d'Oxford lui décerne le Doctorat honoris causa. Il publie en 1789 “La Cause des esclaves nègres”, qui reste, en langue française, l'ouvrage le plus important et le plus complet contre la traite et l'esclavage. À Lyon, il joue, la Révolution venue, un rôle non négligeable dans l'administration de la ville, puis du département, en particulier pour réorganiser l'instruction publique. En 1802, à Paris, il est un des rédacteurs du mémoire dont l'administration impériale fera la base de la loi de 1802 organisant les cultes réformés. En 1809, il est chargé de créer, de toutes pièces, la Faculté protestante de théologie à Montauban décidée par l'Empereur et, nommé doyen, il s'acquitte de cette mission en dépit de nombreuses difficultés. Le protestantisme français lui doit beaucoup. Outre La Cause des esclaves, il a laissé de nombreux écrits et des traductions (Hugh Blair, Wilberforce) ainsi que ses cours à Montauban (celui de morale évangélique reflète ses tendances philosophiques), dont il est rendu compte. Robert Blanc, qui nous donne cette première biographie de B.-S. Frossard, dont il est le descendant direct, a pu notamment disposer d'un fonds important d'archives familiales. Préface du professeur Daniel Robert, professeur émérite à l'École des Sciences sociales.
Le « Mystère du Temple ». La vraie mort de Louis XVII.
Claire Vigne Editrice, 1996, in-8°, 364 pp, 16 pl. de portraits, gravures, plans et fac-similés hors texte, annexes, broché, couv. illustrée, bon état
Le 8 juin 1795, l'enfant Louis XVII, entré au Temple en août 1792, meurt d'une tuberculose. Pour certains il s'agit d'une tromperie : celui-ci se serait évadé bien avant la date de sa mort officielle et l'enfant mort dans les bras de son gardien n'aurait été qu'un enfant substitué. Pour l'auteur, ces "arguments évasionnistes" ne sont pas crédibles. Louis XVII est bien mort au Temple, à l'âge de dix ans. Les témoins de sa mort, de sa maladie, les reconnaissances extérieures et intérieures ne constituent pas les seules preuves : le résultat des fouilles réalisées au cimetière de Sainte-Marguerite et l'analyse scientifique de la dépouille du prétendu dauphin, Karl Wilhelm Naudorff, réapparu sous la Restauration, confirment ses certitudes : le dossier Louis XVII devrait donc être classé. Véritable investigation, l'ouvrage retrace avec précision les diverses étapes de cette affaire et nous invite à découvrir les dessous d'une histoire passionnante mais très controversée.
BLOIT (Michel) et Pascal PAYEN-APPENZELLER.
Reference : 35820
(1989)
ISBN : 9782865831364
Les Mystères de Paris en l'an 1789. Les grandes et petites affaires qui ont marqué l'année, extraites des archives inédites des commissaires de police.
P., Sylvie Messinger, 1989, gr. in-8°, 237 pp, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s.
Écouter la voix de la Révolution, entrer en conversation avec nos pères, voilà ce que nous permet ce livre qui ne ressemble à aucun autre. Les archives des commissaires-enquêteurs au Châtelet de Paris ont été systématiquement exploitées par Michel Bloit et Pascal Payen-Appenzeller. Ils se sont intéressés à 1789, l’année du passage, et ont étudié les affaires publiques ou privées, importantes ou sans grande portée apparente, qui montrent comment le vent de l’histoire souffle dans les rues, les maisons, et sur la vie des communautés et des individus. À côté des révélations concernant les émeutes du faubourg Saint-Antoine, vous découvrirez les suites, macabres ou insolites, de la journée du 14 juillet, vous y verrez la démocratie à l’œuvre, à Paris et en banlieue. Une galerie de caractères, de la saveur dans le langage et dans les gestes, un livre goûteux qui montre la Révolution à la fois dans ses aspects les plus concrets et les plus symboliques à travers une série d’enquêtes en forme de nouvelles, Les Mystères de Paris en l’an 1789 vous invitent au spectacle de l’histoire. — Pascal Payen-Appenzeller a été le collaborateur de Jacques Hillairet pour le Dictionnaire historique des rues de Paris.
Récits d'une tante. Mémoires de la comtesse de Boigne née d'Osmond (1781-1866), publiés d'après le manuscrit original par Charles Nicoullaud. Tomes I, II et III.
Plon, 1907, 3 vol. in-8°, xxxv-505, 434 et 448 pp, 2 portraits de la comtesse de Boigne en frontispices, pièces justificatives, reliures demi-percaline verte, dos lisses, pièces de titre basane havane, fleuron et double filet doré en queue (rel. de l'époque), dos lég. frottés, bon état (Tulard, 173 ; Bertier, 131)
Tomes 1, 2 et 3 seuls (sur 4) : Tome 1 : 1781-1814 ; Tome 2 : 1815-1819 ; Tome 3 : 1820-1830. Fragments. — Manque le dernier tome qui concerne la période 1831-1866. — «Seul le tome 1 intéresse l’Empire. Il est particulièrement riche en anecdotes sur l’opposition royaliste. » (Tulard, 173) — «Commencés en 1835 et tenus ensuite au jour le jour, ces mémoires intéressent la Restauration pour les vol. 2 et 3. Trait d’union entre la société impériale et les milieux liés à l’émigration, la comtesse de Boigne a joué un rôle non négligeable en 1814. Elle a ensuite suivi son père, ambassadeur, à Turin et à Londres, avant de se fixer définitivement en France. Après la Révolution de Juillet, elle a mis toute son influence au service du nouveau régime. Du fait de sa liaison intime avec Pasquier, elle a pu connaître bien des choses.» (Bertier, 131).
Récits d'une tante. Mémoires de la comtesse de Boigne née d'Osmond, publiés intégralement d'après le manuscrit original par Charles Nicoullaud.
Plon, 1908, 4 vol. in-8°, xxxv-505, 434, 448 et 547 pp, 3 portraits en frontispice, un fac-similé recto-verso, pièces justificatives, index, reliures demi-basane noire, dos à 4 nerfs soulignés à froid, titres, tomaisons et fleurons dorés (rel. de l'époque), dos lég. abîmés, mque la partie sup. du dos du tome 1, sinon bon état
Complet. Tome 1 : 1781-1814 ; Tome 2 : 1815-1819 ; Tome 3 : 1820-1830 ; Tome 4 : 1831-1866. Fragments. «Seul le tome I intéresse l’Empire. Il est particulièrement riche en anecdotes sur l’opposition royaliste (portraits de Mme Récamier, de Mme de Chevreuse, d'Alexis de Noailles, de Chateaubriand). Quelques détails peu connus sur le mécontentement suscité par les gardes d'honneur et la conscription. Mais on ne perdra pas de vue qu'il s'agit de l'œuvre d'un adversaire de l'Empire.» (Tulard, 173). Texte également capital pour l'Emigration (Fierro, 169), et, d'une façon générale, pour la Restauration : «Commencés en 1835 et tenus ensuite au jour le jour, ces mémoires intéressent la Restauration pour les vol. 2 et 3. Trait d’union entre la société impériale et les milieux liés à l’émigration, la comtesse de Boigne a joué un rôle non négligeable en 1814. Elle a ensuite suivi son père, ambassadeur, à Turin et à Londres, avant de se fixer définitivement en France. Après la Révolution de Juillet, elle a mis toute son influence au service du nouveau régime. Du fait de sa liaison intime avec Pasquier, elle a pu connaître bien des choses.» (Bertier, 131).
Le dernier avocat général au Parlement de Bretagne, Hippolyte Loz de Beaucours, 1746-1830.
Peyronnet, 1955, in-8°, 302 pp, 5 pl. de portraits et 2 tableaux généalogiques dépliants hors texte, index, broché, bon état
"Le général de Boisboissel a fort bien fait de mettre en lumière la figure de son aïeul. Loz de Beaucours appartenait à une famille d'ancienne noblesse, possédant la seigneurie de ce nom en Bothoa, dans la partie « continentale » de l'évèché de Cornouaille, relevant du comté de Quintin et dont le manoir était une modeste habitation comptant seulement deux pièces, vastes sans doute, par étage. Entré au Parlement avec l'achat d'une charge de conseiller, en 1775, à vingt-neuf ans, il devint, quatre ans après, avocat général, à la place de Duparc-Porée, et le demeura jusqu'à la fin de l'institution. Les archives copieuses qu'il a laissées (il aimait écrire), nous éclairent sur ses opinions. C'était un magistrat libéral, membre de la Chambre de Lecture Rennaise, partisan de l'égalité devant l'impôt et de concessions au Tiers dans la distribution des places. Paisible par nature, modéré par raison, il ne fut pas écouté et émigra. Le Comte d'Artois le dissuada de s'engager dans la conjuration de la Rouerie. Rentré dès 1801, il paya sa hâte de six mois de prison à Sainte-Pélagie, mais ayant donné à l'Empereur ses deux fils, dont l'un servit à l'armée, et l'autre dans la diplomatie, il fut nommé Conseiller à la Cour d'Appel de Rennes en 1811 et remplit ces fonctions, sauf l'intervalle des Cent-Jours, jusqu'à sa retraite en 1823 (il avait soixante dix-sept ans). Il est mort à Rennes peu de jours avant la chute de la monarchie légitime à laquelle l'attachaient ses préférences. Dans les abondants papiers qu'il a occasionnés ou griffonnés, l'auteur a trouvé les éléments d'une étude qui fait apparaître avec les traits du personnage, l'atmosphère qui l'enveloppait. Les vicissitudes subies par ses domaines tant de la part des chouans que des administrateurs révolutionnaires n'en forment pas le moins curieux chapitre..." (B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, Annales de Bretagne, 1956)
BOIS (Piere-André), Roland KREBS et Jean MOES (dir.).
Reference : 122703
(1997)
ISBN : 9783906758145
Les lettres françaises dans les revues allemandes du XVIIIe siècle – Die französische Literatur in den deutschen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts.
Peter Lang SA, 1997, in-8°, 388 pp, notes, index des noms, index des périodiques, broché, bon état. 21 études érudites (14 en français et 7 en allemand)
On trouvera dans ce volume les communications présentées du 23 au 25 mars 1995 à Reims durant le Colloque International organisé par le Centre d'étude des périodiques de langue allemande de Metz. L'objet de la rencontre était d'analyser l'image que les périodiques allemands du XVIIIe siècle ont proposée des lettres françaises. Les revues – dont le développement à l'époque des Lumières est remarquable – ont abordé, à partir d'innombrables comptes rendus et commentaires, dans le cadre général d'un discours de légitimation, toutes les grandes questions que posaient pour la jeune littérature allemande le poids et la fonction de la culture française en Europe. On trouvera donc toutes les attitudes possibles dans les diverses études de cas ici proposées : de l'acceptation des transferts jusqu'à une stratégie de refus et de démarcation. En fait, l'évolution du discours des revues sur la littérature française suit fidèlement celle de la littérature allemande elle-même de la Frühaufklärung au Romantisme et en traduit la situation et les besoins. Par ailleurs, à travers les opinions sur les auteurs français s'expriment bien souvent des jugements sur la nation voisine et sa culture, qui ont leur place dans l'histoire générale des relations franco-allemandes.
François Chabot, membre de la Convention (1756-1794).
P., Emile-Paul, 1908, in-8°, xii-356 pp, 2e édition, 2 portraits réalisés au physionotrace reproduits en héliogravure, index des noms de personnes, broché, couv. lég. salie, bon état
"... Son rôle dans les grands événements de 1792 parait assez secondaire. Il est, bien entendu, régicide, mais il n'a pas trempé dans les massacres de septembre. En 1793 la Convention, encore girondine au début, l'envoie en mission avec beaucoup d'autres montagnards, éloignés de Paris sous ce prétexte, dans les départements du Tarn et de l'Aveyron. Chabot y déploie une activité turbulente et brouillonne. (...) Quelle curieuse figure, laide au moral, mais non pas repoussante, humaine par ses faiblesses, inspirant un juste mépris, mais aussi une involontaire pitié, que ce prêtre manqué, ce joyeux drille, ami des femmes et du vin, savourant tous les plaisirs de la vie , puis mettant bientôt, les bouchées doubles, comme s'il pressentait que la fête ne peut durer, résigné à la fortune quand elle est venue, avouant ses fautes, à ses ennemis, laissant enfin, dans son testament politique, l'impression d'un bon diable, d'un valet de l'ancienne comédie, amusant et coquin, pas méchant de son naturel, qui vole à l'office et ne s'étonne ni ne se plaint, s'étant fait prendre, d'être pendu !" (Albert Meynier, Annales du Midi, 1909)
BONCHAMPS (Marie-Marguerite-Renée de Scépeaux, Marquise de) et LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louise-Victorine de Donnissan, Marquise de Lescure, puis de).
Reference : 118927
(1823)
Mémoires de Madame la marquise de Bonchamps rédigés par Mme la comtesse de Genlis, suivis des Mémoires de Mme la marquise de La Rochejaquelein écrits par elle-même et rédigés par M. de Barante.
P., Baudouin Frères, 1823, in-8°, viii-112-512 pp, reliure demi-basane havane, dos lisse avec filets dorés, pièces de titre et d'auteur basane noire, tranches mouchetées (rel. de l'époque), qqs rares rousseurs, dos lég. frotté, bon état (Coll. des Mémoires relatifs à la Révolution française)
"Bonchamps fut un des héros de la Vendée militaire. Sa femme l'a suivi dans ses campagnes et a confié ses souvenirs à Mme de Genlis qui les a mis en forme." (Fierro, 175) — "Epouse d'un des grands chefs de la Vendée, la marquise de La Rochejaquelein a laissé des mémoires traitant essentiellement de la grande insurrection royaliste dans l'Ouest entre 1792 et 1795. Ces mémoires ont soulevé de nombreuses discussions, les deux premières éditions ayant porté la mention "rédigés par M. de Barante". Il semble que Barante, alors sous-préfet à Bressuire, n'ait rédigé qu'une faible partie du texte." (Fierro, 830)
Mémoire à consulter et consultation pour M. Louis-Philippe-Joseph d'Orléans.
HOURY, 1790, in-8°, Veuve d'Houry 1790, 79p., petit in-8, broché (couvertures muettes).
La fin des Académies royales de peinture et de sculpture et d'architecture.
Paris, 1937, in-8°, 54 pp, notes bibliographiques, broché, bon état (Extrait des Procès-Verbaux de l'Académie des Beaux-Arts publiés pour la Société de l'histoire de l'Art français). On joint une lettre a.s. de l'auteur à en-tête de l'Institut de France - Académie des Beaux-Arts
L’Académie royale de peinture et de sculpture fut une institution d’État chargée de réguler et d’enseigner la peinture et la sculpture en France durant l’Ancien Régime. Fondée en 1648, elle fut dissoute en 1793.
La vérité sur Louis XVII. Souvenirs inédits de la comtesse d'Apchier, précédés d'une introduction sur Louis XVII.
P., Dorbon-Ainé, s.d. (1912), gr. in-8°, 344 pp, 2 pl. de gravures hors texte, broché, bon état, envoi a.s. de l'auteur à Madame Dorbon : "Hommage du dernier fidèle du dernier roi"
Apocryphe. "Il s'agit d'une oeuvre d'imagination... que l'on doit à la plume de J. de Bonnefon. C'est un témoignage en faveur de Richemont, mort au château de Vaurenard qui appartenait à la comtesse d'Apchier." (Parois, 124)
La Carmagnole des muses. L'homme de lettres et l'artiste dans la Révolution.
Armand Colin, 1988, gr. in-8°, 425 pp, 79 illustrations, notes, repères chronologiques, index, broché, couv. illustrée, bon état
"L'équipe de J.-Cl. Bonnet récidive après une originale “Mort de Marat”, voici maintenant, plus ambitieuse dans son objet mais similaire dans sa démarche, cette belle Carmagnole des muses. Dix-sept signatures permettent de répondre à une interrogation plus vaste : comment la Révolution a-t-elle touché l'homme de lettres et l'artiste ? La multiplicité des points de vue et l'accumulation des compétences sont ici bienvenues pour surmonter les inévitables obstacles dont le principal est constitué par l'obsessionnelle dichotomie : Révolution destructrice - Révolution "conservatrice". (...) Les contributions sont regroupées autour de cinq pôles d'intérêt : institutions culturelles, destin de l'art, puissance du verbe, violence et identité, les oeuvres de la Révolution. Ces contributions attendues, solides et subtiles, constituent l'ossature obligée de l'ouvrage. (...) Mais ce qui fait tout autant la spécificité d'un tel recueil, par-delà la pluralité des approches, est la qualité de l'écriture et la justesse générale du ton..." (Claude Langlois, Annales ESC, 1989)
Madame de Beaumarchais, d'après sa correspondance inédite.
Calmann-Lévy, s.d. (1890), in-8°, iv-428 pp, un fac-similé dépliant hors texte, broché, qqs rousseurs éparses, bon état
La Fin de deux légendes : l'affaire Léonard ; le baron de Batz.
P., Daragon, 1909, in-8°, 220 pp, un frontispice gravé (en triple état) et 4 fac-similé d'écriture, broché, bon état (Coll. Les Enigmes de l'Histoire). Edition originale sur papier du Japon, exemplaire non justifié (les ouvrages publiés dans cette série n'ont été tirés qu'à 755 ex. numérotés, 5 ex. sur Japon et 750 sur papier d'Ecosse)
"Ce volume renferme deux études critiques de M. Bord, dirigées toutes deux contre l'auteur du “Drame de Varennes” et de la “Conspiration du baron de Batz”, M. Gustave Lenôtre. Assaut certes à armes courtoises, où l'on admire volontiers le jeu serré des deux adversaires et leurs promptes ripostes; mais l'arbitre impartial et compétent penchera certainement, dans l'une et l'autre cause, à se prononcer pour les conclusions de M. Bord, c'est-à-dire à proclamer l'innocence de Léonard Autié, le coiffeur de la reine, soupçonné de trahison, voire même de vol, lors de la fuite de Varennes, et à hausser les épaules à l'audition des gasconnades impertinentes de ce baron plus ou moins authentique, aventurier plus que héros, et dont la légende a fait le champion de la royauté pendant la Terreur." (Revue Historique, 1909)
La Fin de deux légendes : l'affaire Léonard ; le baron de Batz.
P., Daragon, 1909, in-8°, 220 pp, un frontispice gravé et 4 fac-similé d'écriture, broché, bon état (Coll. Les Enigmes de l'Histoire). Edition originale, tirage limité à 755 exemplaires numérotés et signés par l'Editeur, celui-ci un des 750 ex. sur papier d'Ecosse
"Ce volume renferme deux études critiques de M. Bord, dirigées toutes deux contre l'auteur du “Drame de Varennes” et de la “Conspiration du baron de Batz”, M. Gustave Lenôtre. Assaut certes à armes courtoises, où l'on admire volontiers le jeu serré des deux adversaires et leurs promptes ripostes ; mais l'arbitre impartial et compétent penchera certainement, dans l'une et l'autre cause, à se prononcer pour les conclusions de M. Bord, c'est-à-dire à proclamer l'innocence de Léonard Autié, le coiffeur de la reine, soupçonné de trahison, voire même de vol, lors de la fuite de Varennes, et à hausser les épaules à l'audition des gasconnades impertinentes de ce baron plus ou moins authentique, aventurier plus que héros, et dont la légende a fait le champion de la royauté pendant la Terreur." (Revue Historique, 1909)
La Vie quotidienne en Vendée pendant la Révolution.
France Loisirs/Hachette, 1993, in-8°, 258 pp, une carte, biblio, reliure de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état
La guerre de Vendée – que l'on confond à tort avec la Chouannerie bretonne et normande – fut un phénomène d'une ampleur et d'un caractère insoupçonnés. Mouvement essentiellement populaire et, en dépit des apparences, profondément démocratique puisque ses chefs furent choisis, sinon élus, pour leurs mérites et non pour leur naissance aristocratique. Guerre qui ne cesse de hanter l'imagination par sa violence et ses singularités et qui fut d'abord religieuse, quoique superficiellement liée à la cause royaliste. Qu'était en 1789 ce qu'on appelle par la suite la « Vendée militaire » ? Quelles étaient ses ressources en hommes et en subsistances, ses activités, ses mœurs et sa pensée ? Comment accueillit-elle les principes révolutionnaires et quels étaient, à l'aube de la Révolution, le rôle et l'influence des nobles et des prêtres ? Comment de paysans sans expérience purent-ils vaincre les armées de la Convention et les refouler du Bocage vendéen, avant de succomber sous les coups des Mayençais de Kléber ? Quelle était, au milieu des triomphes et des vicissitudes, la vie quotidienne de ces soldats en sabots et de leurs familles ? Cet ouvrage répond à ces différentes questions à partir d'anecdotes vérifiées, de documents irrécusables.
La Montansier. De Versailles au Palais-Royal, une femme d'affaires.
Perrin, 1993 in-8°, 342 pp, annexes, sources, index, broché, couv. illustrée, bon état
Comment Marguerite Brunet, née en 1730 à Bayonne d'un père forgeron et promise à la vie galante, devient-elle la flamboyante Montansier, protégée et encouragée par Mme du Barry, Marie-Antoinette, le duc d'Orléans, Danton, Barras, Napoléon puis Louis XVIII ? Pour s'être consacrée à la passion de son siècle, le théâtre, non comme actrice mais en véritable chef d'entreprise, elle sera directrice des spectacles "à la suite de la cour", et détiendra pendant trente ans le monopole des représentations de la Bretagne à la Champagne et de la Picardie jusqu'à la Touraine. Elle forme les grands comédiens de son temps, lance des auteurs, fait bâtir des salles de spectacle en province, à Versailles et à Paris, véritables rivales de la Comédie Française et de l'Opéra. Mais les événements se précipitent. Pour sauver son empire financier et artistique, la Montansier monte les entreprises les plus folles. Arrêtée en 1793, elle est sauvée par Thermidor et rebondit encore, faisant parler d'elle jusqu'à sa mort en 1820 à l'âge de quatre-vingt-dix ans. L'exceptionnelle ascension de Marguerite de Montansier est celle d'une femme intrigante et ambitieuse, libre et généreuse, l'une des toutes premières femmes d'affaires.
Mademoiselle Mars, l'Inimitable.
Perrin, 1987, in-8°, 414 pp, 16 pl. de gravures hors texte, un fac-similé, biblio, broché, couverture illustrée d'un portrait de la comédienne, bon état (Coll. Terres des Femmes)
On l'a surnommée "le diamant de la Comédie Française". La Révolution, le Directoire et le Consulat, l'Empire, les deux Restaurations et la Monarchie de Juillet l'ont vu étinceler. Son histoire est aussi celle du théâtre et des moeurs sous tous ces régimes. — "Son père naturel, Jacques-Marie Boutet, dit Monvel, était un comédien célèbre. Sa mère, d'abord "ambulante" au Palais-Royal, s'était ensuite essayée au théâtre ; lorsque Monvel l'eut abandonné, elle l'avait remplacé par un comique : Valville. Françoise, Marie, Hyppolyte Boutet semblait donc prédestinée à faire carrière sur les planches. De fait, la sienne fut on ne peut plus brillante, à la Comédie-Française et durant plus de quarante ans : il s'agit de Mademoiselle Mars. Longtemps vouée aux "ingénuités", elle était aisément passée aux emplois de grande coquette ; son coup d'éventail, inventé pour une "sortie" de Célimène, était si réussi qu'il devint une tradition. Une élégance innée, des matières très Ancien Régime, sa bonne éducation renforçaient une grâce et un naturel que n'en finissaient pas de louer les critiques. Napoléon voyait, en elle, "la première actrice de l'Europe", et d'innombrables admirateurs étaient sous le charme d'une voix exquise de douceur et de "moelleux", qu'elle avait conquise sur la raucité originelle de son organe vocal. Du caractère : on connait ses démêlés avec Victor Hugo, à propos du fameux hémistiche d'Hernani. "Mauvaise camarade et honnête homme", a-t-on dit. Dure, assurément, lorsque sa carrière était en jeu, Mademoiselle Mars était "une amoureuse", souvent meurtrie par ses amants, peu nombreux, parmi lesquels on doit désormais compter le baron Gérard, grâce au flair et à la méticulosité de sa biographe. Attachée passionnément à faire revivre une comédienne dont elle se sent proche parce qu'elle a repris à peu près tous ses rôles, et dans ce même Théâtre-Français qui avait vu Mademoiselle Mars triomphante sous le Directoire, le Consulat, l'Empire, les deux Restaurations et la monarchie de Juillet, Micheline Boudet met également en scène tous les grands acteurs de l'époque, Mlle Contat, Talma, Mlle George, ainsi qu'une foule d'écrivains, peintres, hommes politiques qui furent les amis de l' "inimitable". Un très beau et très vivant travail d'historienne." (Le Monde, 10 avril 1987)
Mouvement provincial en 1789. Biographie des députés de l'Anjou depuis l'Assemblée Constituante jusqu'en 1815.
P., Didier, 1865, 2 vol. in-8°, vii-534 et 538 pp, reliure demi-basane brune, dos à 4 faux nerfs soulignés à froid, roulette en tête et en queue, mouillures claires, rousseurs éparses, bon exemplaire
Etudes sur les représentants de l'Anjou à la Constituante, à la Législative, à la Convention etc., parmi lesquels Volney, La Revellière-Lépeaux, le duc de Praslin, Choudieu, Delaunay jeune, le général d'Autichamp.
Les Toges du pouvoir, ou la Révolution de droit antique, 1789-1799. (Thèse).
Toulouse, Association des Publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail, Editions Eché, 1986, gr. in-8°, xlviii-548 pp, préfaces de Jacques Godechot et Romuald Szramkiewicz, 41 illustrations, biblio, notes, annexes, index, broché, couv. illustrée, bon état
"Les hommes de la Révolution ont aimé à parer leurs héros et leurs allégories de 'togae' et de 'pallia' : par une abondante iconographie, J. B. met sous les yeux de son lecteur ce phénomène de la réminiscence antique, qu'il étudie dans "Les toges du pouvoir", ouvrage issu d'une thèse d'Etat soutenue en 1984 (Paris-I, directeur : R. Szramkiewics). Sa double formation d'historien et de juriste l'amène à développer sa recherche selon deux axes : il se livre dans un premier temps à une analyse historique des allusions à l'antiquité dans le discours révolutionnaire, puis examine dans une seconde partie ce que doit la législation révolutionnaire au droit antique. Chacune des deux études se fonde sur des textes précis de la période 1789 à 1799 : pour la première, J.B. a dépouillé les Archives parlementaires et le Moniteur, pour la seconde, il se réfère aux projets et textes de constitutions et de lois..." (Agnès Moreau, Mots. Les langages du politique, 1988) — "On ne peut comprendre la Révolution française si on ignore l'influence que l'Antiquité eut sur elle. Le livre de Jacques Bouineau comble heureusement une lacune de l'historiographie française." (Jacques Godechot) — "La première réponse sérieuse à une question passionnante ; la République romaine de l'Antiquité a-t-elle été un modèle de la Révolution française ?" (Maurice Duverger)
Condorcet, le Philosophe dans la Révolution.
Hachette, 1962, in-8°, 320 pp, préface de Louis de Villefosse, biblio, index, cart. éditeur, rhodoïd, bon état, envoi a.s. On joint une coupure de presse du “Monde” sur le livre (par Maurice Vaussard)
"Biographie agréable à lire et utile : Condorcet, qui, comme le dit G.G. Granger dans un ouvrage récent (“La mathématique sociale du marquis de Condorcet”), est « le représentant le plus attardé mais peut-être le plus parfait de l'encyclopédisme », n'a guère été étudié depuis la thèse de Léon Cahen en 1904 ; la présentation de J. B., destinée au grand public, met l'accent sur les aspects « actuels » de l'œuvre de Condorcet, intellectuel « engagé »." (Revue française de science politique, 1963)
Les Vincennois sous la Révolution. Miettes d'histoire recueillies sur les registres des délibérations municipales 1787-1793.
Editions du Donjon, 1961, gr. in-8°, 150-(5) pp, préface d'Antoine Quinson, 40 reproductions photographiques des textes originaux, un plan de Vincennes de 1778 en dépliant hors texte, cart. éditeur, jaquette papier noir avec "Miettes d'histoire" en rouge au 1er plat, bon état
Une étude historique consacrée aux Vincennois sous la Révolution française. A côté du château vivaient des cultivateurs, des vignerons, des petits commerçants, toute une population qui allait donner naissance à un petit village qui en 1787 seulement serait érigé en paroisse indépendante. Cette nouvelle cité réunissait deux agglomérations jusque là distinctes : la Basse cour et le Pissote...
Histoire de France pendant la dernière année de la Restauration, par un ancien magistrat.
P., Desenne, 1839, 2 vol. in-8°, xlv-(3)-350 et 375 pp, nombreuses pièces justificatives pp. 201-359 du tome II, reliures demi-veau glacé vert, dos ornés en long, titre et tomaisons dorés (rel. de l'époque), bon état. Bel exemplaire finement relié et sans rousseurs. Rare (Barbier II, 670 d)
La révolution de Juillet 1830 vue par un témoin impartial et sûr, le magistrat Boullée (1795-1870) : "... Des agitateurs d'un ordre plus élevé avaient employé la nuit (du 26 au 27 juillet) à ameuter le peuple des faubourgs et à distribuer des écrits incendiaires ... Plusieurs imprimeurs avaient renvoyé leurs ouvriers, en déclarant l'impossibilité de leur procurer du travail. Quelques chefs d'industrie, qui étaient en même temps députés, les imitèrent : par exemple Audry de Puyraveau, très hostile aux Bourbons, Ternaux quoique plus modéré. Plusieurs fabricants ne se contentèrent pas de renvoyer leurs ouvriers : ils les excitèrent par des paroles révolutionnaires contre le gouvernement. De là un accroissement rapide et formidable de l'insurrection naissante : les rues de la capitale se remplirent d'une multitude d'hommes robustes, exaspérés par la misère et le désespoir, et dont la plupart avaient exercé le métier des armes..." — "Travail plein de conscience, riche de faits, de recherches, et auquel nous devons de précieux renseignements." (Vaulabelle, Histoire des deux restaurations)
 Write to the booksellers
Write to the booksellers