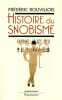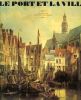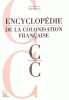Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
17th (3)
18th (13)
19th (252)
20th (2116)
21st (264)
-
Syndicate
ILAB (2656)
SLAM (2656)
Lettres sur la botanique.
Club des Libraires de France, 1962, pt in-8°, xxxv-305 pp, 8 planches hors texte de reproductions contrecollées en couleurs, reliure toile blanche à rayures brunes de l'éditeur décorée d'une vignette (silhouette de Rousseau), rhodoïd, ex. tiré sur vélin blanc et numéroté, bon état
Les lettres botaniques de Jean-Jacques Rousseau adressées à Madame Delessert, à la duchesse de Portland, à MM. Liotard, du Peyrou, Clappier, Gouan, de La Tourette, de Malesherbes et Linné, présentées par Bernard Gagnebin, suivies du “Fragment de dictionnaire des termes en usage en botanique” préfacé et annoté par Ernest J. Bonnot, avec huit pages d'herbier reproduites en couleurs. — "Philosophe, éducateur, politicien, compositeur, ... promeneur solitaire, J.-J. Rousseau était aussi botaniste. Sa vie durant et avec un entrain et une activité variables, il s'adonna à cette étude de la nature qui le détournait de ses angoisses et de ses obsessions. Il était en relation avec d'excellents naturalistes de son époque, tels Gouan, de La Tourette, et même avec Linné : la correspondance qu'il entretint avec eux montre que ses connaissances scientifiques étaient loin d'être négligeables. A d'autres correspondants, amateurs ou simples curieux de la nature comme sa cousine Mme Delessert de Lyon, la duchesse de Portland, M. Du Peyrou, le Dr Pierre Clappier, etc., il adressait des plantes et parfois même de véritables cours de botanique très bien menés et fort concrets, qui font l'objet de ses lettres. On trouve aussi dans celles-ci des relations d'excursions (comme celle, d'ailleurs peu agréable, qu'il fit au Mont-Pilat !). Les pages d'introduction de B. Gagnebin, spécialiste de Rousseau, sont la biographie souvent émouvante de Jean-Jacques botaniste. Cet homme universel avait aussi le projet de publier un “Dictionnaire de Botanique”, mais cette œuvre se limita aux termes les plus courants. Les définitions y sont données avec un sens critique que beaucoup de scientifiques actuels seront étonnés de découvrir sous la plume d'un littéraire. Qu'on lise, par exemple, sa longue définition de la « Fleur » ; elle est remarquable de rigueur et de précision. Les commentaires (par notre sociétaire E.-J. Bonnot, membre du Groupe de Roanne) ont pour but de montrer comment, depuis le XVIIIe siècle, les mots définis par Rousseau ont vécu : bien peu nous sont parvenus avec leur sens d'alors ; beaucoup se sont spécialisés et sont l'image de faits plus clairs, plus précis, ayant bénéficié de techniques nouvelles d'observation ; beaucoup sont tombés en désuétude mais certains ont fait fortune parce qu'ils représentaient des données fondamentales pour la compréhension du monde végétal ; d'autres encore se sont conservés intacts grâce à l'utilisation qu'on en a faite dans la nomenclature binominale. L'ouvrage, très bien présenté, est agrémenté de photographies hors texte de planches de l'Herbier de Rousseau : Daucus carota, Alchemilla alpina, etc., Mousses diverses (Mnium undulatum, Hypnum splendens...). Bref, c'est un aspect du travail et de la personnalité du philosophe qui méritait d'être connu, car il constitue une page non dénuée de charme et d'intérêt dans l'histoire des sciences de la Nature !" (Publications de la Société Linnéenne de Lyon, 1963)
Histoire des Transports.
Fayard, 1961, in-12, 561 pp, notes, index des noms cités, broché, couv. à rabats, bon état (Coll. Les Grandes études historiques) (Prix Thérouanne de l'Académie française 1962)
Ouvrage d'une lecture toujours très plaisante. L'éditeur promet un livre "complet, documenté, passionnant à lire" et termine par : "C'est un voyage merveilleux qui vous est proposé ; à cheval, en voiture, en bateau, en train, en auto, en avion... Embarquez-vous ! On part..." — Table : Des ombres de la Préhistoire sortent la roue et la barque ; Gloire et agonie de la voie romaine ; Trente siècles de navigation ; Routes et canaux au Grand Siècle ; Révolution industrielle et révolution des transports ; Histoire de la voile ; La vapeur conquiert l'Occident ; Le chemin de fer tentaculaire ; La route avant le moteur ; Avènement du moteur ; La troisième dimension (l'aviation).
Histoire des doctrines démographiques illustrée par les textes.
Nathan, 1979, in-8°, 253 pp, biblio, broché, bon état
"Il y a deux démographies distinctes. L'une, la plus développée à notre époque s'intéresse à la mesure des phénomènes, elle regroupe l'analyse et les méthodes pour ordonner les statistiques anciennes ou actuelles. L'autre est plus soucieuse de comprendre l'influence réciproque de la population, de l'économie et des structures sociales. La première démographie pourrait s'appeler démométrie, et la seconde démologie. A. Roussel retrace l'histoire de cette dernière à travers un choix judicieux de textes qu'il introduit par d'intéressants commentaires. Il a retrouvé les passages où les auteurs anciens parlent de population et les cite assez longuement pour qu'on en aperçoive la complexité..." (Population, 1981)
Nos Grandes Ecoles militaires et civiles.
Panazol, Editions Lavauzelle, 2002, 2 vol. in-8°, vii-525 pp, pagination continue, illustrés de 169 gravures sur bois, dessinées par A. Ferdinandus, Jeanniot, Lemaistre, Fr. Régamey et P. Renouard, reliures demi-basane acajou mouchetée de l'éditeur, dos à 4 faux-nerfs, bon état. Réimpression de l'édition de 1888
Neuf grandes écoles : l'Ecole Navale, l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, l'Ecole Polytechnique, l'Ecole Centrale des arts et manufactures ; l'Ecole des Beaux-Arts, l'Ecole de Médecine, l'Ecole de Droit, l'Ecole Normale supérieure, l'Ecole Forestière. L'ouvrage se présente sous forme de lettres qu'auraient pu s'écrire des élèves issus de ces écoles ; Navale, Saint-Cyr et Polytechnique tenant le haut du pavé.
Les Souverains devant la justice de Louis XVI à Napoléon III.
Albin Michel, 1946, in-8°, 404 pp, notes, reliure demi-chagrin noir à coins, dos à 4 nerfs filetés, titres dorés (rel. de l'époque), bon état
Toute action judiciaire portée contre un souverain ou sa dynastie possède une dimension potentiellement déligitimante. Le règlement public de querelles successorales devant les tribunaux peut ainsi contribuer à discréditer une maison royale. Un ouvrage très attachant. — Table : Introduction. – Les Jugements concernant les Souverains dans l'espace et dans le temps. – Le Procès de Louis XVI. – Le Procès de Marie Antoinette. – L'Affaire du Chevalier Desgraviers. – Le Procès touchant le testament de Napoléon Ier. – Le futur Napoléon III devant la Justice. – Les Procès relatifs aux biens des d'Orléans et à la Succession du Roi Louis Philippe. – Une leçon d'histoire au Prétoire. La loyauté du Prince Eugène, Vice-Roi d'Italie, discutée devant la Justice. – La Succession du Roi Jérôme devant la Justice. L'affaire Paterson.
L'Eternelle Sacrifiée. Préface, notes et commentaires de Daniel Armogathe et Maïté Albistur.
Syros, 1979, in-12, 112 pp, 2 pl. de photos hors texte, broché, bon état (Coll. Mémoire des femmes)
Dans cette conférence célèbre intitulée « l'Eternelle Sacrifiée » prononcée le 28 janvier 1906 à l'université populaire de Lille, Nelly Roussel (1878-1922), grande féministe bourgeoise du début du XXe siècle, faisait de l'union ou du mariage sans amour de la pure et simple prostitution. Elle précisait en effet : « La jeune bourgeoise qui se marie, ou plutôt se laisse marier, pour "se faire une situation" avec un monsieur qu'elle connaît à peine, qu'elle n'aimera jamais peut-être ; l'ouvrière qui prend un amant parce que son maigre salaire ne lui permet pas de vivre seule ; et la malheureuse, qui, pour manger le soir même, raccroche dans la rue le premier passant… accomplissent toutes trois à peu près le même geste, auquel nos lois et nos mœurs les condamnent presque inévitablement: elles livrent leur corps à un homme en échange du pain quotidien ! » Révoltée par ce fait comme bon nombre de féministes de l'époque, Nelly Roussel propose, pour sortir de cette situation, une émancipation générale des femmes, d'un point de vue juridique d'abord (supprimer les dispositions les plus aberrantes du code civil de 1804 qui font de la femme mariée une mineure au regard du droit et de la société), au travail ensuite (autonomie financière, accès à toutes les professions et égalité des salaires), dans la vie politique enfin (obtention, entre autre chose, du droit de vote) ; mais elle souligne également la nécessité de transformer profondément et durablement la nature même de l'union contractée entre un homme et une femme pour en briser l'irréductible caractère inégalitaire. (Christelle Taraud). Copieuse préface (20 pp) et copieuses notes.
ROUSSELOT (Paul, ancien professeur de philosophie, inspecteur d’académie).
Reference : 28641
(1883)
Histoire de l'éducation des femmes en France.
P., Didier et Cie, s.d. (1883), 2 vol. in-12, 441 et 466 pp, cartonnages bradels toile carmin décorés de l'éditeur, dos lisses avec titres dorés et décor à froid, qqs rousseurs, bon état (ouvrage couronné par l'Académie française)
"Cette substantielle étude, bien que fondée sur une connaissance très précise des documents et des faits, n’est point exclusivement une œuvre d’érudition, mais plutôt de philosophie. En étudiant époque par époque, non pas seulement ce qu’ont écrit sur l’éducation féminine tous les pédagogues de profession, mais encore ce qu’ont dit et pensé des femmes, de leur nature, de leur destinée, les hommes d’Etat, les théologiens, les philosophes, les historiens, les moralistes, les poètes, y compris les femmes elles-mêmes, « qui ont bien voix au chapitre dans leur propre cause », M. Rousselot nous semble s’être proposé d’apporter ses éléments de solution à l’un de ces redoutables problèmes que notre dix-neuvième siècle a du moins le mérite de poser : celui du vrai rôle de la femme dans les sociétés modernes. Il faut lire les deux volumes de M. Rousselot, le premier commençant avec la civilisation chrétienne, pour s’arrêter à Fénelon et au traité de l'Éducation des filles, le second comprenant le reste du dix-septième siècle, le dix-huitième, où l’auteur distingue comme deux courants contraires dans l’éducation des filles : l’éducation de couvent, l’éducation monastique, et l’esprit séculier de nos sociétés contemporaines, qui se dégage de plus en plus à partir de la Révolution..." (Revue pédagogique, 1883)
De la réforme de l'ortografe. Raport prézanté au 11e congrès des instituteurs au nom de la Sosiété de Réforme Ortografique.
Firmin-Didot, s.d. (v. 1887), gr. in-8°, 47 pp, broché, couv. lég. salie, état correct. Rare
Histoire du snobisme.
Flammarion, 2008 gr. in-8°, 410 pp, 16 pl. de gravures en noir et en couleurs, notes, index, broché, couv. illustrée à rabats, bon état (Coll. Au fil de l'histoire)
Février 1914 : une grande enquête est lancée pour déterminer le sujet le plus "parisien" du moment. Alsace-Lorraine, tensions avec l'Allemagne, poudrière des Balkans ? Erreur. La réponse est : Bergson. Les élégantes qui se pressent aux cours du philosophe s'arrachent d'ailleurs la dernière robe du grand couturier Worth, joliment appelée "M. Bergson a promis de venir..." Chers snobs, que le Collège de France préoccupe davantage que la guerre qui menace. Bergsoniens à la Belle Epoque, ils ont été amateurs de loirs au miel dans l'Antiquité, bourgeois gentilhommes ou précieuses ridicules au Grand Siècle, Incroyables ou Merveilleuses sous le Directoire, fashionables sous la Restauration... mais il leur a fallu attendre le milieu du XIXe siècle pour connaître la consécration, grâce au livre du romancier anglais Thackeray, “Le Livre des snobs”, acte de baptême du snobisme. Dûment nommés, nos snobs s'habillent à l'anglaise et courtisent les clubs chic, convoitent l'onction du titre de noblesse ou de la particule, s'émerveillent de la mise du comte d'Orsay, de Boni de Castellane, d'Oscar Wilde ou du prince de Galles. Après la Grande Guerre, la séduction du grand monde finit par se tarir. Fleurit alors un snobisme nouveau, aujourd'hui plus vivace que jamais : il faut être dans le vent, ou mourir ! Goûter l'art cubiste puis abstrait, quand la foule en est aux impressionnistes ; s'affoler de la cuisine dite nouvelle pour, quand elle vieillit, célébrer les élucubrations chimiques de chefs inspirés... Ridicules, les snobs ? Avant de leur jeter la pierre, faites votre examen de conscience, en méditant le propos du maître en snobisme que fut Robert de Montesquiou : "il faudrait manquer d'esprit pour ne pas être snob"...
Le décor animé du caravansérail de Karatay en Anatolie.
P., Geuthner, 1972, in-4°, 27 pp, 17 illustrations en noir dans le texte. Extrait de la revue Syria. Très bon état
Histoire de la société et des institutions françaises depuis 1789.
P., Imprimerie Nationale, 1981, in-4°, 156 pp, texte dactylographié, broché, pt déchirure recollée au coin du 1er plat, sinon bon état
Publié par le Ministère de l'économie et des finances, Direction du personnel et des services généraux, Centre de formation professionnelle et de perfectionnement.
The Spirit of English History.
London, Jonathan Cape, 1944, pt in-8°, 150 pp, seconde impression, 6 cartes, index, reliure pleine percaline rose de l'éditeur, dos lisse avec titres dorés uniformément passé, sans la jaquette, bon état. Texte en anglais
"Le jeune oxfordien A. L. Rowse, auteur de solides travaux sur l'époque d'Élizabeth et de brillantes oeuvres littéraires où revit le passé de son pays de Cornouailles, a consacré un volume fort bien écrit à l'« esprit » de l'histoire anglaise." (Paul Vaucher, Revue historique, 1947)
Histoire des colonies françaises et des établissements français en Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie, depuis leur fondation jusqu'à nos jours.
Tours, Ad. Mame et Cie, 1855, in-12, 188 pp, une gravure sous serpente en frontispice, cartonnage romantique doré de l'éditeur, décor à froid sur les plats, une vignette en couleurs au 1er plat, cartonnage un peu défraîchi, rousseurs éparses, sinon bon état
Le Port et la Ville. Une histoire culturelle maritime.
P., Editions Maritimes et d'Outre-Mer, 1981, in-4° carré, 231 pp, traduit de l'allemand, 186 illustrations en noir et en couleurs, biblio, index, reliure pleine toile décorée de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état
Carrefour important des rencontres humaines dans toutes les régions du globe que baignent les mers : le port. Cela s'applique tant au port de pêche qu'au port de haute mer surdimensionné. C'est là que se produit, outre le commerce et l'échange de marchandises, le brassage permanent des moeurs entre les nations les plus diverses. Ce livre traite de cette influence qu'exercent les ports sur la civilisation et le mode de vie des peuples à chaque période historique. Les ports jouent aussi le rôle d'importantes bases de départ vers de nouvelles découvertes dans des disciplines telles que la géographie, l'océanographie, la biologie marine, l'ethnographie et l'archéologie sous-marine...
Le Costume. I. L'Antiquité et le Moyen Age. – II. La Renaissance, Le style Louis XIII. – III. Epoques Louis XIV et Louis XV. – IV. Epoques Louis XVI et Directoire. – V. Consulat, Premier Empire, Louis Philippe, Napoléon III.
Flammarion et Librairie R. Ducher, s.d., 5 vol. gr. in-8°, 64, 64, 64, 64 et 64 pp, plus de 600 illustrations, photos et dessins, brochés, bon état (Coll. Les Arts décoratifs)
Complet. – Dans le domaine du costume historique, c'est un manuel qui fait partie des classiques. La première édition date de 1931. Malgré le fait qu'il couvre toute l'histoire du costume, des origines à nos jours, il reste très pratique pour saisir les modes du XVIe et XVIIe siècles. Sa dimension synthétique en fait une excellente base de connaissance sur le costume. Ici, les 4 premiers fascicules sont des rééditions Flammarion (parues entre 1973 et 1981), le cinquième est une des premières éditions (Librairie d'art R. Ducher, 1931 ou un peu plus tard).
Encyclopédie de la colonisation française. A-B.
Les Indes savantes, 2017, in-4°, 511 pp, texte sur 3 colonnes, broché, bon état
L'Encyclopédie est prévue en 4 volumes. Elle couvre dans le temps une large période allant des Croisades à la décolonisation de la deuxième moitié du XXe siècle. Pays et régions, institutions, explorations, esclavage, post-colonialisme, religions, etc. sont traités dans des notices allant de 2 à 10 pages. Le premier volume comprend plus de 600 notices, rédigées par une soixantaine d'auteurs, tous spécialistes reconnus dans leur domaine. — "L’école historique française étudiant la période esclavagiste, puis l’ère coloniale, est riche de nombreux travaux, en particulier depuis les tout premiers temps des indépendances. Un demi-siècle plus tard, il n’est pas de territoire naguère dominé par la France qui n’ait été couvert par une – ou, la plupart du temps, plusieurs – étude(s) de haute qualité. Il existe par ailleurs bien des ouvrages de synthèse couvrant tout l’ancien Empire. Mais il était temps de, regrouper dans une synthèse unique ces travaux. Le projet « Encyclopédie de la Colonisation française » est vaste, avec plus de 2.000 entrées à ce jour, de Abandon à Zouave(s). Il n’a – évidemment et heureusement – pas la prétention de se substituer à cette riche bibliographie qui existe, mais plutôt de mettre en perspective cette immense somme. Il s’agit de la rédaction, par une équipe de chercheurs, d’un ouvrage de très grandes dimensions, par entrées thématiques : – Lieux (Algérie, Maroc, Indochine, Haute-Volta, Tchad...) ; – Peuples (Arabes, Berbères, Sénégalais, Khmers, Annamites, Somalis...) ; – Événements (Bataille de Sidi-Brahim, Affaire Voulet-Chanoine, Révolte kanak de 1878, Décret Crémieux, Bataille d’Alger...) ; – Grandes périodes (Croisades, Esclavage, Colonisation...) ou sous-périodes (Révolution, Premier Empire, Second Empire, Front populaire...) ; – Grands groupes humains (Soldats français aux colonies, Soldats colonisés, Intellectuels français...) ; – Familles politiques (Libéraux, Communistes, Radicaux, Socialistes...) ; – Mots ou expressions-concepts (Barbares & barbarie, Sauvages et sauvagerie, Nostalgérie...) ; – Quelques titres d’ouvrages majeurs (De la colonisation chez les peuples modernes, Voyage au Congo, Discours sur le colonialisme, Damnés de la terre, Barrage contre le Pacifique, Batouala...) ; – Mots des dominés passés dans la langue des dominants (Salamalec, Cagnat, Gourbi, Congaye...) ; – Mots nouveaux directement issus de l’histoire coloniale (Pieds Noirs, Caldoches, Békés...) ; – Mots dévalorisants et/ou racistes (bicots, bougnoules, nhaqués...) ; – Formules (Périssent les colonies plutôt qu’un principe, C’est vous le nègre ?, Plus un homme, plus un sou... L’entrée par noms propres d’individus n’a pas été retenue car cela aurait pris des proportions plus gigantesques encore. Dans certains cas, cependant, lorsqu’un acteur historique a donné naissance à un nom commun, il a été retenu. On pense par exemple à Gaullisme & Gaullistes. Il y a également des entrées Mendésisme, Schœlchérisme... Le principe est de faire suivre chaque entrée d’une courte définition, puis de textes l’illustrant (le plus souvent possible, contemporains des événements), le tout évidemment accompagné d’un appareil scientifique (commentaires, paragraphes explicatifs de transition, références des documents cités, bibliographie...) À ce jour, plus d’une centaine d’auteurs ont rédigé des notices."
Encyclopédie de la colonisation française. C-C.
Les Indes savantes, 2017, in-4°, 517 pp, texte sur 3 colonnes, broché, trace de pli au 1er plat, bon état
L'Encyclopédie est prévue en 4 volumes. Elle couvre dans le temps une large période allant des Croisades à la décolonisation de la deuxième moitié du XXe siècle. Pays et régions, institutions, explorations, esclavage, post-colonialisme, religions, etc. sont traités dans des notices allant de 2 à 10 pages. Le premier volume comprend plus de 600 notices, rédigées par une soixantaine d'auteurs, tous spécialistes reconnus dans leur domaine. — "L’école historique française étudiant la période esclavagiste, puis l’ère coloniale, est riche de nombreux travaux, en particulier depuis les tout premiers temps des indépendances. Un demi-siècle plus tard, il n’est pas de territoire naguère dominé par la France qui n’ait été couvert par une – ou, la plupart du temps, plusieurs – étude(s) de haute qualité. Il existe par ailleurs bien des ouvrages de synthèse couvrant tout l’ancien Empire. Mais il était temps de, regrouper dans une synthèse unique ces travaux. Le projet « Encyclopédie de la Colonisation française » est vaste, avec plus de 2.000 entrées à ce jour, de Abandon à Zouave(s). Il n’a – évidemment et heureusement – pas la prétention de se substituer à cette riche bibliographie qui existe, mais plutôt de mettre en perspective cette immense somme. Il s’agit de la rédaction, par une équipe de chercheurs, d’un ouvrage de très grandes dimensions, par entrées thématiques : – Lieux (Algérie, Maroc, Indochine, Haute-Volta, Tchad...) ; – Peuples (Arabes, Berbères, Sénégalais, Khmers, Annamites, Somalis...) ; – Événements (Bataille de Sidi-Brahim, Affaire Voulet-Chanoine, Révolte kanak de 1878, Décret Crémieux, Bataille d’Alger...) ; – Grandes périodes (Croisades, Esclavage, Colonisation...) ou sous-périodes (Révolution, Premier Empire, Second Empire, Front populaire...) ; – Grands groupes humains (Soldats français aux colonies, Soldats colonisés, Intellectuels français...) ; – Familles politiques (Libéraux, Communistes, Radicaux, Socialistes...) ; – Mots ou expressions-concepts (Barbares & barbarie, Sauvages et sauvagerie, Nostalgérie...) ; – Quelques titres d’ouvrages majeurs (De la colonisation chez les peuples modernes, Voyage au Congo, Discours sur le colonialisme, Damnés de la terre, Barrage contre le Pacifique, Batouala...) ; – Mots des dominés passés dans la langue des dominants (Salamalec, Cagnat, Gourbi, Congaye...) ; – Mots nouveaux directement issus de l’histoire coloniale (Pieds Noirs, Caldoches, Békés...) ; – Mots dévalorisants et/ou racistes (bicots, bougnoules, nhaqués...) ; – Formules (Périssent les colonies plutôt qu’un principe, C’est vous le nègre ?, Plus un homme, plus un sou... L’entrée par noms propres d’individus n’a pas été retenue car cela aurait pris des proportions plus gigantesques encore. Dans certains cas, cependant, lorsqu’un acteur historique a donné naissance à un nom commun, il a été retenu. On pense par exemple à Gaullisme & Gaullistes. Il y a également des entrées Mendésisme, Schœlchérisme... Le principe est de faire suivre chaque entrée d’une courte définition, puis de textes l’illustrant (le plus souvent possible, contemporains des événements), le tout évidemment accompagné d’un appareil scientifique (commentaires, paragraphes explicatifs de transition, références des documents cités, bibliographie...) À ce jour, plus d’une centaine d’auteurs ont rédigé des notices."
Les Bijoux... Ce monde rayonnant de métal et de pierre.
Fayard, 1971, gr. in-8°, 190 pp, 24 pl. de photos hors texte, dont 8 en couleurs, sources, index, reliure toile éditeur, jaquette illustrée (lég. abîmée), bon état
"Jusqu'à présent, le bijou avait surtout fait l'objet d'albums qui en retraçaient l'histoire soit à travers les siècles, soit à une époque donnée. Cet ouvrage est le premier à traiter de sa signification et de son rôle, tant dans le présent et l'avenir que dans le passé. Dégageant à travers les civilisations anciennes le sens sacral du bijou, l'auteur décèle, dans les tendances nouvelles de la joaillerie, un surprenant retour aux sources. En témoigne le goût de la jeune génération pour des bijoux qui ne soient plus seulement des parures, mais des ornements symboliques, rituels, et parfois érotiques. Dessinatrice de bijoux, de grand talent, Roseline Ruther a mis à profit son expérience pour nous faire entrer dans les salons mais aussi les ateliers et coulisses de ce monde fermé, encore artisanal, où certaines techniques n'ont pas bougé depuis 4.000 ans. En même temps qu'un historique passionnant, son livre nous offre un véritable reportage sur la bijouterie-joaillerie moderne..." — Table : Préface. 1. Le bijou à l'état pur. 2. Le vêtement de bijoux. 3. Création et construction d'un bijou. 4. Le masque simple. 5. La Femme absolue et les bijoux. 6. Le "Temps" en joaillerie. 7. Du diamant et des pierres nobles. 8. Cette désacralisation, cette dépoétisation. 9. Le retour. Sources. Index.
Histoire économique de la Pologne avant les partages.
Champion, 1927, in-8°, xii-268 pp, biblio, couv. lég. abîmée
Le Moyen Age ; L'ère moderne.
Les Arts du Moyen-Orient ancien.
PUF, 1962 pt in-8°, viii-184 pp, 40 pl. d'illustrations hors texte, dont 8 en couleurs, 3 cartes et 10 figures, biblio, cart. illustré de l'éditeur, bon état (Coll. Les Neuf Muses)
"On mesure de mieux en mieux aujourd'hui ce que les arts de la Grèce, surtout prédorienne et archaïque, ont dû à ceux du Moyen-Orient... Mme Rutten s'est assigné pour tâche de retracer l'évolution de l'art d'abord du IIIe millénaire à la conquête d'Alexandre en Mésopotamie et en Iran, puis chez les Hourrites et les Hittites et, enfin, chez les Cananéens et en Chypre. L'illustration, bien choisie, a été conçue de manière à éclairer le texte." (L'Antiquité Classique, 1963)
Les nuisances idéologiques.
Calmann-Lévy, 1972, in-8°, 342 pp, broché, couv. à rabats, bon état (Coll. Liberté de l'Esprit, dirigée par Raymond Aron)
Les idéologies virulentes, et non en déclin comme on le dit parfois, sont aux mythes ce que les drogues de synthèse sont aux produits biologiques. Plus agissantes, elles sont aussi plus dangereuses. Entre les mains des Machiavels, elles sont des armes, déguisées en pseudosciences. En tant qu’épidémies idéologiques, elles se répandent par un mécanisme quasi automatique d’auto-intoxication et d’auto-intimidation, très différent de la contagion simple qui fait des épidémies psychologiques et les modes. Toute société est discordante. L’individu submergé d’informations « n’y comprend rien », mais il veut « raisonner ». Aussi, il aspire à des antivaleurs ou à des solutions simplistes. Les démagogues utilisent cette énergie mentale. Le présent ouvrage étudie les idéologies racistes, antiracistes, et, nationalistes ; le « virilisme », le culte de la jeunesse, le « sexualisme » ; les idéologies de « regonflage », dans les religions qui ont perdu leur foi millénaire ; les idéologies de la société post-industrielle, de la technologie, du Mac Luhanisme de l’éducation permanente, du Millénium culturaliste, de la culpabilité universelle, etc. Auprès des « démagogues de l’esprit », les démagogues politiques paraissent relativement honnêtes : ils trompent pour conquérir le pouvoir, tandis que les « démagogues de l’esprit » corrompent, simplement pour se faire une réputation. Peut-on concevoir des antidotes aux poisons idéologiques ? Une commission des fraudes pour les aliments intellectuels, un freinage des fabrications idéologiques sont des utopies. La société pourrait du moins ne pas encourager, subventionner, vénérer, les fabricants. On peut souhaiter un système dualiste avec un secteur libre, voué au réalisme, et un secteur fonctionnarisé, dont les aspirations à la justice et à une nouvelle culture, seraient satisfaites par un salaire uniforme et sans doute spartiate. — "Dans cet ouvrage, Raymond Ruyer dénonce avec bonheur tous les messianismes, toutes les utopies déréalisantes, toutes les techniques d’ahurissement contemporaines. Dans les modes idéologiques, qu’elles soient religieuses, politiques, économiques, culturalistes, philosophiques, pédagogiques, ou qu’il s’agisse des « idéologies de l’amour et de la culpabilité universelle », il voit de véritables « épidémies ». Pour enrayer leur développement, il propose la création (problématique !) d’une commission des fraudes idéologiques. Mais, réaliste, il prédit que « le XXe siècle (et probablement aussi le suivant) sera, dans l’histoire, le siècle des troubles idéologiques »." (Alain de Benoist)
La Droite en France, de la Première Restauration à la Ve République.
Aubier, 1968, 2 vol. pt in-8°, 470 pp, troisième édition revue, augmentée et mise à jour, pagination continue, biblio, index, brochés, couv. illustrées, bon état (Coll. Historique)
I. 1815-1940 ; II. 1940-Juin 1968. — "Lorsque ce beau livre a été publié pour la première fois en 1954, il avait comme sous-titre : continuité et diversité d'une tradition politique. Diversité, parce que les recherches de René Rémond l'avaient conduit à constater que, lors même que, par exception, la droite française paraît s'unir devant les électeurs ou au Parlement, elle comporte en réalité trois courants bien distincts, relevant de trois traditions historiques à bien des égards opposées : celle du legitimisme, celle de l'orléanisme, celle du bonapartisme. Continuité, parce que, même une fois les anciennes fidélités dynastiques effacées par plusieurs décennies de régime républicain, ces trois courants pouvaient encore être repérés dans la vie politique française, en fonction de la persistance de certaines attitudes idéologiques, de la permanence de certaines assises géographiques, de la continuité de certaines traditions familiales. (...) La nouvelle édition de ce livre, indispensable à toute compréhension en profondeur de la vie politique française, prolonge jusqu'à nos jours l'analyse faite il y a dix ans, sans en modifier substantiellement l'orientation..." (François Goguel, Revue française de science politique, 1964)
 Write to the booksellers
Write to the booksellers