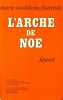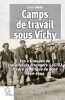Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
20th (1487)
21st (248)
-
Syndicate
ILAB (1740)
SLAM (1740)
Parade pour une armée défunte. Histoire de l'armée française de 1939 à 1962.
Issy-les-Moulineaux, Muller édition, 1997, gr. in-8°, 310 pp, préface de Michel Mohrt, cartes, broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s.
Louis de Fouquières entre à Saint-Cyr à dix-huit ans, en 1931. En deuxième année, il est sous les ordres du lieutenant Philippe de Hauteclocque, futur maréchal Leclerc. Après un an à l'École de Cavalerie de Saumur, il est affecté au 9e Dragons à Épernay, puis à sa demande, au Levant, au ler Spahis Marocains et au commandement du 13e escadron tcherkess. Ayant demandé son changement d'arme pour l'Armée de l'Air, il entre en école de pilotage en décembre 39. En juin 40, il réussit à passer en Afrique du Nord et voit les Américains débarquer en novembre 42. Il termine son entraînement dans le groupe 1/5 Champagne commandé par un as, Marin la Meslée. Après un an de Coastal Command en Méditerranée, le groupe est envoyé sur le front de l'Europe. Marin est tué au combat en 1945. Louis de Fouquières prend le commandement du groupe puis, fin 45, celui de la 3e escadre de chasse à Trèves. Sa carrière se poursuit aux états-majors des maréchaux Leclerc puis de Lattre, à l'École de Guerre, au Gouvernement Général de l'AOF et comme breveté d'état-major, à la tête du 3e bureau de l'État-major Général de l'Armée de l'air puis, comme commandant de la base de Creil. Après l'expédition de Suez de 1956, où il est l'adjoint du commandant en chef français, l'amiral Barjot, il quitte l'armée et crée un bureau d'éditions aéronautiques.
L'Arche de Noé.
Fayard, 1968, fort in-8°, 716 pp, 16 pl. de photos et 20 pl. de documents et fac-similés hors texte, cart. toilé de l'éditeur, jaquette, bon état. Edition originale sur papier courant (il n'a été tiré que 30 ex. en grand papier), enrichi d'un bel envoi a.s. “avec la fidèle sympathie du "Hérisson"” daté de Noël 1968
Le Réseau Alliance (1940-1945). Histoire de l'un des premiers et des plus importants services de renseignements sous l'Occupation, par celle qui participa à sa création et restera à la tête du réseau jusqu'à la fin de la guerre. Par la première femme à avoir eu les honneurs d'un enterrement aux Invalides.
L'Arche de Noé.
Fayard, 1968, fort in-8°, 716 pp, 16 pl. de photos et 20 pl. de documents et fac-similés hors texte, cart. toilé de l'éditeur lég. sali, sans la jaquette, intérieur propre, état correct. Edition originale sur papier courant
Le Réseau Alliance (1940-1945). Histoire de l'un des premiers et des plus importants services de renseignements sous l'Occupation, par celle qui participa à sa création et restera à la tête du réseau jusqu'à la fin de la guerre. Par la première femme à avoir eu les honneurs d'un enterrement aux Invalides.
Mes rencontres dans le siècle. Chroniques de guerre et de Résistance.
P., Académie littéraire de France et d'Outre-Mer, 1992, in-8°, 164 pp, 19 photos dans le texte, broché, couv. illustrée, bon état
Ecrits de captivité, 1940-1943.
P., Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1991, in-8°, xvi-176 pp, annexes, broché, couv. à rabats, bon état
«Tout ce que je publie ici a été écrit entre 1940 et 1943 au kommando ou au camp. On y trouvera tout ce que beaucoup ont sans doute ressenti sans savoir l'écrire... Le dernier chapitre a été écrit dans l'hiver 44-45, après la Libération de Paris. Il approfondit des thèmes développés déjà en captivité et s'efforce d'expliquer nos réactions, particulièrement en politique. » — "Ecrit dans un style remarquable, ce témoignage est poignant. En exemple, cette « chute » au moment de la libération de l'auteur, le 23 juin 1943 : « De cet instant inoubliable, de cette sortie du stalag, je ne garderai qu'un souvenir tragique. A côté du Feldwebel qui faisait le dernier appel, l'appel libérateur qui à chaque cri faisait franchir le portillon à un nouvel élu, je ne voyais pas les relevés, désorientés et un peu abattus par l'événement lui-même, mais la figure des camarades qui restaient » (p. 156). Ceux-là « ils voyaient la France, mais comme une terre promise où ils ne pénétreraient pas, eux » (Ibid.). Tous ces textes (sauf le dernier chapitre) ont été rédigés durant la captivité de l'auteur, mais ils relatent les événements depuis Munich, la « drôle de guerre », la guerre, puis les camps de prisonniers. P.F. insiste sur le fait que « les prisonniers étaient coupés de toute information valable sur la situation réelle des Français » (p. XIII), et pourtant son analyse de la « Révolution nationale vue de Roisdorf » (p. 94 et suiv.) n'est pas mauvaise. Il a la « chance » d'être affecté dans une ferme : « Au fond d'un verger, nous trouvons notre premier chantier, des haricots à rames, des choux de Bruxelles. Il nous faut sarcler, sarcler sans arrêt ; après une raie, une autre raie. L'outil est léger, mais devient peu à peu pesant » (p. 61). L'ouvrage n'est pas pesant et apporte une nouvelle pierre à la connaissance de notre vie politique, fût-elle vue d'Outre- Rhin." (Revue française de science politique, 1992)
Il était des femmes dans la Résistance.
Stock, 1978, in-8°, 484 pp, biblio, broché, bon état
"« Il était des femmes dans la Résistance », livre miroir où se réfléchissent les portraits de résistantes vivantes et mortes ; celui de l'auteur, une femme de 1978, celui de la petite fille qu'elle fut dans une famille presque entièrement exterminée par les nazis. Livre-document, car résultat d'une longue enquête où aucun des personnages ni des aventures ne sont imaginaires mais qui se lit comme un roman..."
La Luftwaffe attaque à l'Ouest (France 1939-1942).
Bayeux, Heimdal, 1991, in-4°, 96 pp, 211 photographies, 2 cartes, index, cart. illustré de l'éditeur, bon état
Dimanche 24 septembre 1939. L'Europe est de nouveau en guerre. La Pologne, envahie par les troupes allemandes depuis plus de trois semaines, est à la veille de capituler. A l'Ouest, les deux alliées, la Grande-Bretagne et la France, assistent impuissantes à son agonie. Seules une timide avancée française au-delà de la frontière vers Sarreguemines et de régulières incursions de l'armée de l'Air dans le ciel de l'Allemagne, témoignent de l'état de guerre à l'Ouest. Ce jour là, il est un peu plus de midi, lorsqu'une nouvelle fois dix Morane Saulnier MS 406 du groupe de chasse I/3, répartis en quatre patrouilles, pénètrent l'espace aérien ennemi vers Sarrebruck, pour accompagner un Mureaux 115 du groupe d'observation aérien 1/520. Quelques minutes se sont à peine écoulées que six Messerschmitt Bf 109D, appartenant au Jagdgruppe 152, interviennent déjà et s'attaquent à une section de quatre Morane emmenés par le capitaine Roger Gérard. Le combat aérien qui s'engage est d'une rare violence : sa machine étant trop sévèrement atteinte, Gérard est obligé de l'évacuer et saute en parachute; à son tour le sergent Garnier, blessé, doit rompre le combat. Suivi par ses adversaires, il est tué par une dernière rafale alors qu'il tente de se poser vers Ettling. Plus chanceux que son camarade, l'adjudant-chef Combette rejoint son terrain de Velaine malgré les vingt-huit impacts qui ont criblé son Morane...
La Nuit finira. Mémoires de Résistance, 1940-1945.
Laffont, 1973, fort gr. in-8°, 607 pp, 24 pl. de photos et documents hors texte, annexes, index des noms, broché, couv. illustrée, dos insolé, bon état (Coll. Vécu)
15 juillet 1940. Après s'être évadé, Henri Frenay arrive en zone libre. Pour tous, ou presque, la défaite de la France est irrémédiable. Pour lui, il en est sûr et il le veut, "la nuit finira". L'aventure de la Résistance commence. Personne avant lui n'a raconté comment a pu naître, se développer et agir un Mouvement de Résistance. Comment, à partir de la volonté d'un homme seul, les moyens ont été réunis, les méthodes arrêtées pour faire face à une situation sans précédent dans l'Histoire de la France ; pour créer cet organisme complexe que fut "Combat", ce mouvement que les historiens désignent comme ayant été le plus important, celui dont l'organisation servit de modèle aux autres. Difficultés, intrigues, conflits naissent à chaque pas entre Français de Londres et de l'intérieur, mais aussi entre Français et Alliés. Après trois ans de clandestinité, Henri Frenay devient ministre des Prisonniers, Déportés et Réfugiés dans le Gouvernement provisoire, d'abord à Alger puis à Paris. Tout en accomplissant sa nouvelle tâche, Henri Frenay pense que le rôle de la Résistance ne se terminera pas avec le dernier coup de canon. Parviendra-t-elle à édifier cette République "dure et pure" à laquelle ses chefs ont si passionnément aspiré ? Nous sommes conduits ainsi jusqu'en novembre 1945, date à laquelle le Gouvernement provisoire remet ses pouvoirs à l'Assemblée constituante et où Henri Frenay quitte la vie publique. La nuit finira, outre les nombreuses révélations qu'elle apporte, représente une contribution importante à l'histoire de la Résistance française. — « Une des plus puissantes figures de la Résistance. Auteur d'un premier appel à la lutte le 15 août 1940. Créateur du premier mouvement de Résistance, a donné immédiatement à son action une forme militaire. Créateur et organisateur de l'Armée Secrète. Chef de l'action militaire de la zone sud pour le compte des Mouvements unis pour la Résistance. A, par son dynamisme et sa volonté, fait naître tous les organismes de base de l'action future qui a permis la Libération. Combattant qui peut être considéré comme le promoteur de la lutte armée en territoire métropolitain. » Il suffit de lire ces lignes – le texte du décret en date du 20 septembre 1946, qui nommait Henri Fresnay chevalier de la Légion d'honneur – pour saisir l'importance du livre que nous publions aujourd'hui. Sur la Résistance, ses débuts, son développement, sur les difficultés, les intrigues, les conflits entre Français Libres de Londres et de l'intérieur, sur les réussites, les échecs et les trahisons, aucun témoignage de cette valeur n'a jamais été publié. Et sur le lendemain même de la victoire non plus, quand le rêve d'une République « dure et pure », né dans la clandestinité, se heurte à la réalité politique... (L'Editeur)
Le Capitalisme français, XIXe-XXe siècle. Blocages et dynamismes d'une croissance.
Fayard, 1987, gr. in-8°, 427 pp, index, broché, bon état, envoi a.s. de P. Fridenson, A. Straus et J. Bouvier à Ernest Labrousse
Reflets du nazisme.
Seuil, 1982, in-8°, 139 pp, broché, bon état
Depuis la fin des années soixante, pour bon nombre de cinéastes et de romanciers européens, le nazisme n'est plus ce qu'il était. Saul Friedländer décèle à travers leurs œuvres – sans qu'il y ait volonté apologétique – le renouveau d'une certaine fascination dont le ressort, hier comme aujourd'hui, est un réseau d'émotions contradictoires. Il découvre aussi une impossibilité totale à affronter l'inacceptable, d'où un recours à l'exorcisme, à l'inversion des signes et des situations dont le dernier avatar est la négation même de l'holocauste. L'exposition des fantasmes et le refoulement des faits, indissociablement liés, autorisent cette fascination qui, dès lors, peut tracer son chemin dans nos consciences. Sans porter de jugement de valeur, sans aucun discours moralisant, Saul Friedländer constate que les jeux ne sont plus interdits. Est-ce dire qu'ils ne sont plus dangereux ?
Les Tourangeaux sous l'Occupation. La vie quotidienne.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1997, in-8°, 318 pp, qqs photos dans le texte, biblio, broché, couv. illustrée, bon état. Peu courant
Histoire paradoxale de la IVe République.
Grasset, 1954, pt in-8°, 151 pp, broché, couv. illustrée, bon état
"André Frossard, figurez-vous, croit à la vertu de la Vérité. Le spectacle l'exaspère d'un pays comme le sien, qui, depuis quatorze ans, que ce fût sous Vichy ou après la Libération, a été nourri de simulacres, de mirages, de mensonges crus, et de faux bonshommes... Dans cette “Histoire paradoxale de la IVe République”, il ironise tant qu'il peut, car telle est sa nature, et il sait le faire supérieurement. Mais on sent trop, à chaque page, qu'il a surtout envie de mordre. De mordre au nom de tous les braves bougres de Français, de droite ou de gauche, qui ont "marché" d'excellente foi, et gratuitement, de 1940 à 1954, tandis que tels autres, dans les combinaisons successives, trouvaient bénéfice à admettre, très allégrement, que le noir fût blanc. Or, André Frossard (c'est une idée à lui) ne consent pas que le noir soit blanc, que le régime soit factice, les institutions de plâtre, les hommes de paille et les nez faux. Il prend les menteurs, dans tous les azimuts, et les corrige. Sévère mais injuste ? C'est toujours facile. Mais précisément, dans cette “Histoire paradoxale”, on ne découvrira rien qui ne soit de stricte justice, distributive. André Frossard, qui n'épargne personne, ne s'est guère demandé ce qu'après son livre il lui resterait d'amis, dans les secteurs du Pouvoir, ni dans les diverses appartenances. Tant pis. Il porte plainte en faux et en usage de faux. Contre tous ceux de tous les bords, qui ont trompé le monde. Son Histoire sera un drôle de pavé dans la mare grenouillante. Et aussi une première et cinglante revanche des Français qui, tout de même, n'acceptent pas de se taire." (André Guérin) — "Dans ce petit essai mordant, André Frossard estime que Paul Reynaud « avait conduit sa courte guerre de 1940 dans toutes les règles de l'art politique, menant sa campagne militaire comme une campagne électorale, et ne cessant, d'un bout à l'autre de la catastrophe, de manifester le souci très parlementaire d'attacher à la défaite un autre nom que le sien. Postillon trop léger pour l'attelage national en furie, il eut le bonheur – et le coup d'oeil – de sauter juste à temps, au moment où la voiture allait verser »." (Nadine Fresco) — Sur les cadres de Vichy issus de la droite, André Frossard reconnaît qu' « un personnel entièrement nouveau, c'est-à-dire datant à peine de la première Restauration, ou, dans la meilleure hypothèse, de la seconde, prit à tâche d'informer les Français que la vérité politique était à droite... C'était une révolution d'antiquaires en costume du temps... Il fallait la bêtise légendaire de l'homme de droite pour entamer une révolution en pays occupé ».
J'avais huit ans dans le ghetto de Varsovie.
Tallandier, 2011, pt in-8°, 247 pp, 4 pl. de photos hors texte, broché, couv. illustrée, bon état
Régine Frydman est une enfant du ghetto de Varsovie qui a, par miracle, échappé à la mort. Elle a huit ans en 1940 quand les Allemands décident d'enfermer 450.000 Juifs dans une enclave de cinq hectares, où ils vont être parqués et broyés à mort en l'espace de trois ans. Régine n'aurait pas survécu si son père Abram Apelkir n'avait pas bravé le danger, risqué sa vie en sortant du ghetto pour trouver de la nourriture, caché sa famille chez des amis polonais en plein centre-ville et à la campagne, et même chez des religieuses. Régine Frydman mêle son récit à celui de son père. A deux, ils livrent un témoignage bouleversant des terribles événements dont ils ont été les témoins, les cadavres qui s'entassent sur les trottoirs, les descentes éclairs de la police allemande, les fusillades dans la rue, les enfants qui se battent pour un quignon de pain, les marches dans la neige pour échapper aux rafles et à la déportation, et enfin la joie de retrouver la liberté grâce aux troupes russes. Un document rare.
Ecrit sous la potence.
P., Pierre Seghers, 1948, in-12, 192 pp, traduit du tchèque, préface de Ladislav Stoll, introduction de Gusta Fucikova, une photo de l'auteur hors texte, broché, bon état (Coll. La Terre vivante)
Julius Fucik (1903-1943) était un journaliste communiste arrêté puis interrogé et torturé par les nazis. Avant d'être exécuté, il écrivit ce témoignage sur des feuilles de papier à cigarette que deux gardes aidèrent à faire sortir de la prison. Le livre traite de la période de son arrestation et parle de son espoir d'un avenir communiste, meilleur. Après la guerre, le régime communiste l'utilisa comme texte emblématique de la résistance du PC pendant la guerre.
Reportáž psaná na oprátce.
Prague, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953, in-12, 148-(4) pp, conception graphique : František Muzika, reliure décorée de l'éditeur, dos, coiffes et coupes frottés, bon état. Texte en tchèque
"Sous l'occupation hitlérienne, Julius Fucík est au premier rang de la lutte communiste clandestine ; lorsque le premier Comité central clandestin tombe dans les filets de la Gestapo, Fucík est l'un des organisateurs du nouveau centre qui se reconstitue. Il est arrêté à son tour par les nazis le 24 avril 1942, longuement soumis à la torture, gardé en prison à Pankrác (Prague) jusqu'en juin 1943, transféré en Allemagne, condamné à mort et exécuté à Berlin le 8 septembre 1943. Grâce à la complicité d'un gardien, Fucík avait pu trouver les moyens d'écrire durant sa longue incarcération à Pankrac. Les feuillets qu'il réussissait à griffonner étaient acheminés presque au jour le jour et transmis aux camarades. Ils seront publiés après la libération sous le titre “Écrit sous la potence”. Leur inévitable décousu empêche d'y voir un livre à proprement parler ; leur teneur inconditionnellement stalinienne semble déjà, après trente ans, appartenir à un autre âge. Et pourtant “Écrit sous la potence” demeure un des textes les plus héroïques et les plus lourds d'humanité du XXe siècle — un de ceux par lesquels les martyrs révolutionnaires et athées d'aujourd'hui donnent la réplique aux premiers martyrs chrétiens." (Jean Massin, Encyclopédia Universalis)
A la guerre. Psychologie et comportements pendant la Seconde Guerre mondiale.
Seuil, 1992, in-8°, 449 pp, 12 pl. de photos hors texte, index, broché, bon état
Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes.
Reference : 1381
(1995)
Le Grand Livre des témoins.
Ramsay/FNDIRP, 1995, gr. in-8°, 350 pp, préface de Marie-Claude Vaillant-Couturier, postface de Lucie Aubrac, lexique, sources, broché, couv. illustrée, bon état
"Le monde était fermé pour eux. Le monde entier se réduisait à ce petit espace qui se terminait par des fils de fer barbelés, chargés d'un courant à haute tension. Au-delà, il y avait l'inconnu ou la mort." Soumis à des épreuves d'une incroyable inhumanité, revenus des prisons et des camps nazis, des déportés témoignent. René Moreau, Marie-Elisa Cohen, Yves Eyot, Aimé Bonifas, Léon Hoëbeke, Julien Unger, Pelagia Lewinska, Emile Pralong, Jeanne Niel, Julienne Jarles, Henri Verde, Charles Gelbhart, Sonia Apelgot, Suzanne Birnbaum, François Wetterwald, Roger Agresti, Charles Papiernik, René Wolfin, André Chauvenet... Leurs paroles, précieux recueil, s'enchaînent et se complètent sans qu'aucun commentaire extérieur ne vienne les interrompre. Elles rappellent que l'inconcevable s'est produit : Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, Mauthausen, Dachau...
Sursis pour l'orchestre. Témoignage recueilli par Marcelle Routier.
Stock/Opera Mundi, 1982, in-8°, 396 pp, cartonnage toile grise de l'éditeur, jaquette illustrée (traces de scotch au dos de la jaquette), bon état
Au camp d'Auschwitz, il y avait un orchestre de femmes dirigé par Alma Rose, la nièce de Gustav Mahler. Fania Fenelon a fait partie de cet orchestre ; elle en est une des rares survivantes. C'est cette histoire, un des épisodes les plus étranges de l'Holocauste, qu'elle évoque dans ce livre : qu'on imagine le sinistre Docteur Mengele veillant entre deux expériences à ce que l'orchestre accueille en musique les trains acheminant un nouveau convoi de déportés ; ou le commandant du camp pleurant en écoutant la Rêverie de Schuman après avoir envoyé encore un contingent de prisonniers vers les chambres à gaz. Pour faire revivre ce cauchemar, Fania Fenelon a su trouver le ton qu'il fallait : une force sobre qui n'exclut pas une infinie compassion pour ses compagnes d'infortune, un humour aussi qui sans doute lui a permis de survivre.
Sursis pour l'orchestre. Témoignage recueilli par Marcelle Routier.
Stock, 1976, in-8°, 397 pp, broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s.
Au camp d'Auschwitz, il y avait un orchestre de femmes dirigé par Alma Rose, la nièce de Gustav Mahler. Fania Fenelon a fait partie de cet orchestre ; elle en est une des rares survivantes. C'est cette histoire, un des épisodes les plus étranges de l'Holocauste, qu'elle évoque dans ce livre : qu'on imagine le sinistre Docteur Mengele veillant entre deux expériences à ce que l'orchestre accueille en musique les trains acheminant un nouveau convoi de déportés ; ou le commandant du camp pleurant en écoutant la Rêverie de Schuman après avoir envoyé encore un contingent de prisonniers vers les chambres à gaz. Pour faire revivre ce cauchemar, Fania Fenelon a su trouver le ton qu'il fallait : une force sobre qui n'exclut pas une infinie compassion pour ses compagnes d'infortune, un humour aussi qui sans doute lui a permis de survivre.
Deux du Stalag XII.
P., Barré-Dayez, 1977, pt in-8°, 287 pp, dessins de l'auteur hors texte, broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s. (“Pour ..., ces pages plus documentaires que romanesques, qui nous ramènent aux années sombres...”)
“Anciens médecins des « Lazarets » et des Kommandos relevant des Stalags de 39-45 ; et vous, anciens « Gefangs » et travailleurs de la culture, de l'industrie, des services publics, des bureaux ou du petit commerce du « grand Reich », ce document, que nous devons à Paul-Hubert Février, est VOTRE roman ; il est aussi une page d'Histoire, de NOTRE Histoire.” (André Soubiran)
Derniers jours de l'Europe. Un voyage diplomatique en 1939.
Fribourg et P., Egloff, LUF, 1946, in-8°, 252 pp, index, broché, bon état
Par le ministre des affaires étrangères de Roumanie entre le 23 décembre 1938 et le 31 mai 1940. — Entre avril et mai 1939, le diplomate roumain entreprend une tournée politique dans les pays occidentaux et balkaniques : à Varsovie, à Berlin, à Bruxelles, à Londres, à Paris, à Rome et au Vatican. En juin, il part en Yougoslavie, en Grèce, en Turquie, et en Bulgarie. Toutes ses impressions sont publiées dans son livre “Derniers jours de l'Europe”, paru en 1946. — "M. Gafenco, ministre des affaires étrangères de Roumanie en 1939, puis ministre de son pays à Moscou jusqu'au déclenchement des hostilités germano-soviétiques, est venu par la suite dans notre pays où, comme tant d'autres, il a trouvé abri. Il a déjà publié chez nous « Préliminaires de la guerre à l'est », qui contient bien les meilleures pages que l'on connaisse sur les causes exactes du conflit qui devait mettre aux prises Berlin et Moscou. « Derniers jours de l'Europe » est apparemment d'un autre genre. On pourrait n'y voir – si l'on ne sentait partout sous-jacente une pensée très ferme – que le simple récit des voyages que le ministre roumain des affaires étrangères fit, au printemps 1939, dans les différentes capitales européennes, en mission officielle pour le compte de son gouvernement. La plume alerte de l'écrivain, son style direct et le ton attachant qu'il sait prendre contribuent en effet à donner d'abord à ces pages des qualités toutes narratives. On partage avec M. Gafenco les inquiétudes du colonel Beck qui, recevant son interlocuteur dans son vagon-salon, se rend compte enfin, sans vouloir encore regarder en face toute ta réalité, de la faillite de sa politique d'amitié avec le Reich. On suit l'auteur en Allemagne et l'on se complait aux fresques saisissantes qu'il brosse d 'Hitler et de Gœring. On passe alors outre-Manche où l'on aperçoit l'Angleterre de ces hommes de bonne foi que furent Chamberlain et Halifax s'éveiller lentement après Prague, à la vérité. Toujours à la suite de M. Gafenco, l'on revient en France, où l'auteur note le trouble des esprits et souligne à quel point, pour le Quai-d'Orsay d'alors, Munich n 'a pas été un point d'aboutissement, contrairement à une légende tenace, mais bien un répit forcé qu'il aurait fallu mettre à profit militairement et diplomatiquement. On se rend en Italie où l'écrivain nous montre un « duce » incertain, flottant, hésitant qui, ayant perdu toute maîtrise de soi, ne peut devenir finalement qu'une marionnette aux mains des Allemands. Et l'on termine par un tour dans les Balkans. Tout cela vaudrait déjà pour le seul apport historique, pour la valeur de témoignage que le livre représente. Mais, comme nous le disions, il y a bien davantage encore dans cet ouvrage. En se penchant sur cette Europe, qui, quelques mois plus tard, allait subir la plus grave des catastrophes, M. Gafenco saisissait déjà avec exactitude les causes du drame. D'abord , il constatait qu'il n'existait plus de réaction morale authentique et profonde, sur notre continent, contre « l'hitlérisme absurde et sacrilège ». Et cette absence de réaction se traduisait non seulement par le fait qu'à la force allemande on laissait libre champ, mais surtout par le fait qu'on donnait libre cours à l'idée chère à tous les impérialismes, celle des « partages d'influence ». Le principe du partage, écrit M. Gafenco, pénétrait la politique européenne. Expliquons-nous. Une paix n'est viable que si elle permet à chaque Etat d'exister normalement, selon ses aspirations propres. Dès que les grands envisagent de l'établir, au moyen de compromis entre eux, par des « sphères d'influence » arbitrairement délimitées, alors il y a tôt ou tard menace de rupture, risque de déséquilibre. C'est très exactement ce qui s'est produit en 1939. Hitler a cru, à Munich, que les nations occidentales lui laissaient les mains libres à l'est. Quant il a vu que ce n 'était pas le cas, ce fut la guerre, à l'ouest aussi. Pareillement, le pacte germano-russe était axé sur le principe erroné d'un partage d'influence en Europe orientale et balkanique. Il ne pouvait être viable longtemps... Comprend-on maintenant la haute leçon – actuelle – qui se dégage du livre de M. Gafenco ? Si les quatre aujourd'hui ont la sagesse de laisser se refaire une Europe selon les normes traditionnelles, tout peut être sauvé. S'ils s'obtinent dans l'idée néfaste d'un partage en zones d'influences, alors tout est à craindre..." (René Braichet, Feuille d'Avis de Neuchâtel, 10 juillet 1946)
Camps de travail sous Vichy. Les « Groupes de travailleurs étrangers » (GTE) France et Afrique du Nord 1940-1944. (Thèse).
Les Indes savantes, 2023, gr. in-8°, 393 pp, cartes, annexes, biblio, sources, broché, couv. illustrée, bon état
Durant les « années noires », la France et ses colonies d’Afrique du Nord se couvrent de nombreux camps de travail, pour des chômeurs français, des soldats « coloniaux » et des réfugiés étrangers, tous gérés par un nouveau « Commissariat à la lutte contre le chômage » créé par le régime de Vichy. Des milliers d’étrangers – dont 30.000 Espagnols réfugiés politiques de la Guerre d’Espagne – sont incorporés par le régime de Vichy dans de nombreux « Groupes de travailleurs étrangers » (GTE) et forcés de travailler dans l’agriculture et dans l’industrie de la zone dite « libre ». Cette « xénophobie d’État » trouve son prolongement en Afrique française du Nord où plusieurs milliers de réfugiés étrangers et de communistes français déportés de la métropole sont également regroupés dans des GTE afin de réaliser un vieux rêve colonial : un chemin de fer à travers le désert, le « Transsaharien ». Dans le cadre de la Collaboration d’État, le régime de Vichy « livre » également 40.000 réfugiés espagnols à l’Organisation Todt (OT) qui construit pour l’armée allemande sur le littoral français cinq bases sous-marines et 8.000 bunkers du « Mur de l’Atlantique ». Dans une centaine de camps de travail peu connus, l’Organisation Todt emploie des milliers de travailleurs forcés français, espagnols, russes, « coloniaux » et juifs. Les camps les plus durs de l’OT sont ouverts dans les îles de la Manche où 800 travailleurs forcés trouvent la mort. Avec environ 10000 « guérilléros », les réfugiés espagnols évadés des GTE sont le plus important groupe d’étrangers dans la Résistance. Cette étude, basée sur de nombreuses archives, retrace pour la première fois cette histoire d’une « France des camps de travail ».
Un Prêtre député : le chanoine Polimann.
La Pensée universelle, 1973, in-8°, 220 pp, chronologie, broché, couv. illustrée, bon état
"« M. Polimann était, au moral comme au physique, tout d'un bloc. Il eut même des candeurs, on pourrait dire des naïvetés d'enfant. Mais sa loyauté, comme son patriotisme, fut toujours au-dessus de tout soupçon. Il ne sut pas, il ne voulut pas réviser, ni modifier ses positions initiales – positions prises en juillet 40 –, ne parut pas comprendre que l'Europe ne pouvait se faire aussi longtemps que la France était occupée comme elle l'était et l'Allemagne dominée par le nazisme ». Ainsi s'exprima Mgr Petit, son évêque, dans l'allocution prononcée lors des funérailles du chanoine le 11 février 1963. Tel nous apparaît « le prêtre député » dans la biographie que l'un de ses anciens élèves de l'école Saint-Jean-Baptiste de Bar-le-Duc qui lui vouait une affection fidèle a écrite avec une volonté certaine d'objectivité, en usant de documents dont beaucoup lui avaient été remis par son maître. L'abbé André Gaillemin présente le fils de paysans lorrains ; le jeune prêtre, officier valeureux de la Grande Guerre qui, en juin 1916, lieutenant, commandant une compagnie du 137e devant Verdun ; le directeur de l'école Saint-Jean-Baptiste attaché à ses élèves ; le prêtre qui se consacre aux oeuvres et spécialement à celles vouées au culte de Dieu et à celui de la patrie ; le député choisi par ses concitoyens ; l'orateur populaire des solennités religieuses et des cérémonies où était exalté l'héroïsme ; le chef de bataillon de 39-40 qui reprend l'épée et s'efforce de tenir jusqu'aux derniers instants dans la débandade de 40 ; le parlementaire, puis le « conseiller national » qui fait confiance au « vainqueur de Verdun » ; le directeur de la Croix meusienne qui stigmatise tout ce qui lui paraît contraire à la politique de Vichy, mais aussi le Barrèsien soucieux de protéger ses compatriotes inquiétés par l'occupant, les défendant, le cas échéant, contre la Gestapo ; après la Libération, le prisonnier condamné à la réclusion par la cour de justice de Nancy en décembre 1945, trouvant sa consolation dans la prière et la célébration de la messe ; puis, sa peine partiellement remise en juillet 1948, le curé de Dainville, l'humble paroisse de sa naissance où, retrouvant sa mère et les amis de son enfance, il accomplit sa tâche apostolique que la politique ne lui avait jamais fait oublier." (P. Marot, Revue d'histoire de l'Église de France, 1977)
GALIMAND (Lucien), ancien député. ex-officier des Forces Françaises Libres et de l'état-major F.F.I.
Reference : 26663
(1948)
Vive Pétain, Vive de Gaulle !
Editions de la Couronne, 1948, pt in-8°, 260 pp, broché, non coupé, bon état (Coll. Documents politiques). Peu courant
"Avec “Vive Pétain, Vive de Gaulle”, Lucien Galimand tente, "à l’occasion de quelques souvenirs précis, d’apporter [s]on témoignage dans un procès confus, celui de la France" (p. 239). Il décrit, de façon plus ou moins chronologique, "ce qu’il a vu, ressenti" (p. 7) durant les années de guerre et retrace son parcours qui le mène de Vichy à Londres. Engagé volontaire, le député de Dieppe assiste impuissant à la débâcle française en 1940. Il explique les raisons de la défaite par un mauvais armement, une mauvaise préparation et des mauvaises manoeuvres. Le parlementaire rejoint Vichy et participe aux séances de l’Assemblée nationale. Il prend part au vote accordant les pleins pouvoirs à Pétain. Démobilisé, Lucien Galimand regagne la Normandie... occupée par les Allemands et bombardée par les Britanniques. Il redoute alors le jugement de ses concitoyens : "Bien que je ne me sentisse aucune responsabilité personnelle dans la débâcle, j’avais l’impression de porter, puisque parlementaire, une petite part des responsabilités du régime" (p. 108). Rapidement, Galimand entre dans la Résistance. Arrêté, alors qu'il tentait de rejoindre la France libre via l'Espagne, il est interné au camp de Miranda de Ebro. Libéré, l'auteur gagne l’Angleterre et décrit ses missions au sein des services secrets." (Étienne Marie-Orléach, « Ecrits de Guerre et d’Occupation » EGO 1939-1945) — Par Lucien Galimand (1904-1982), député de la Seine-Inférieure de 1936 à 1942. – "Après la signature de l'armistice, Lucien Galimand entre dans la Résistance. Dès 1941, il organise l'infiltration d'agents dans les services du gouvernement de Vichy, ainsi que dans les services allemands. Recherché activement par la Gestapo, il quitte la France en novembre 1942. Après six mois de captivité en Espagne, il arrive en Angleterre et participe, auprès du colonel Passy, puis à l'état-major du général Koenig, à l'activité des organismes d'unification et de commandement de la Résistance. Il est notamment chargé d'établir les plans d'interruption des communications en vue du débarquement allié. Son activité pendant la guerre lui vaut d'être décoré de la Croix de Guerre 1939-1945 avec six citations, de la Médaille de la Résistance, de la Cross Member of British Empire et d'être promu officier de la Légion d'honneur. (...) Lucien Galimand a publié deux études historiques “Vive Pétain, vive de Gaulle” (1948) et “Origines et déviation du gaullisme” (1950)." (Dictionnaire des parlementaires français de 1940 à 1958)
André Clavé. Théâtre et résistances. Utopies et réalités. 1916-1981.
P., Association des amis d'André Clavé, 1998, gr. in-8°, 555 pp, préface de Jean-Noël Jeanneney, épilogue de Pierre Schaeffer, nombreuses illustrations et photos dans le texte, 32 pl. de documents et photos en noir et en couleurs hors texte, annexes (fac-similés), chronologie, index, broché, couv. illustrée à rabats, bon état, envoi a.s.
André Clavé, né à Bordeaux en 1916 décédé à Paris en 1981, est un acteur, metteur en scène et directeur de théâtre, et résistant français. Avant la guerre, il fonde en 1936 les Comédiens de la Roulotte avec François Darbon, Jean Desailly, rejoint par Jean Vilar en 1940. La troupe intègre le mouvement Jeune France et joue des pièces dans l'ouest de la France. Camarade de Pierre Sudreau à l'armée de l'air, il entre en septembre 1942 dans le réseau de résistance Brutus. Il prend sa succession après son arrestation par la Gestapo, avant d'être lui même arrêté avec André Boyer dans un café de la rue Saint-Honoré. Interrogé, il est incarcéré à la prison de Fresnes, puis interné au Camp de Royallieu (Oise), avant le camp de Buchenwald. Transféré au camp de Dora-Harzungen, il s'évade avec trois compagnons et erre en Allemagne pendant un mois. À l'avènement de la Quatrième République, Jeanne Laurent, charge André Clavé et sa compagnie de la Roulotte de faire des représentations itinérantes en Alsace et en Lorraine. Elle le nomme ensuite, le 4 mai 1947, à la direction du centre dramatique national de l'Est où il remplace Roland Piétri. Il y diffuse les principe de la décentralisation théâtrale, en faisant jouer répertoire classique, dramaturges étrangers et auteurs contemporains, et ce à travers cinq départements. Michel Saint-Denis le remplace à ce poste le 1er janvier 1952. En 1955, il participe auprès de Pierre Schaeffer au Studio-école de la Radiodiffusion française. Il a épousé Francine Galliard-Risler, décoratrice pour Charles Dullin avant d'intégrer le Centre dramatique de l'Est.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers