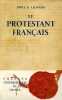-
Latest
Last 24h (3)
Last month (18)
Last week (4)
-
Century
17th (2)
18th (9)
19th (206)
20th (1736)
21st (233)
-
Syndicate
ILAB (2192)
SLAM (2192)
L'invention de l'humanité. Petite histoire universelle de la planète, des techniques et des idées.
Strasbourg, La Nuée Bleue, 1995, in-8°, 223 pp, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Histoire de l'Erotisme.
Jean-Jacques Pauvert, 1959, in-8° carré, 247 pp, nombreuses illustrations dans le texte, index, reliure éditeur demi-toile noire, dos lisse, titres dorés, rhodoïd, bon état (Bibliothèque Internationale d'Erotologie). Edition originale
LOEW (Jacques) et Michel MESLIN (dir.).
Reference : 69602
(1978)
ISBN : 9782213006499
Histoire de l'Eglise par elle-même.
Fayard, 1978, fort gr. in-8°, 679 pp, 15 cartes, biblio, glossaire; notices biographiques des auteurs cités, repères chronologiques, index, broché, couv. illustrée à rabats, bon état (Prix Halphen de l'Académie française 1979)
"Incroyant, converti, dominicain, le P. Loew s'est trouvé, en 1941, à la fondation d'Économie et Humanisme, et l'un des premiers prêtres-ouvriers. Ce livre est une anthologie de textes introduits par des spécialistes. Les vingt siècles chrétiens sont découpés classiquement en quatre périodes : ancienne (Michel Meslin), médiévale (Nicole Bériou), moderne (Guy Bédouelle), contemporaine (Pierre Pierrard), chacune ordonnée selon sept thèmes : l'Église-communauté, connaissance de Dieu, expérience chrétienne, culte et dévotions, Église et charité, missions chrétiennes, Église et État. Une cinquième période évoque l'Église de Vatican II et s'achève sur le Testament de Paul VI (Jacques Loew)..." (Emile Poulat, Archives des sciences sociales des religions, 1979)
Histoire de l'Eglise par elle-même.
Fayard, 1978, fort gr. in-8°, 679 pp, 15 cartes, biblio, glossaire; notices biographiques des auteurs cités, repères chronologiques, index, reliure toile éditeur, sans la jaquette, bon état (Prix Halphen de l'Académie française 1979)
"Incroyant, converti, dominicain, le P. Loew s'est trouvé, en 1941, à la fondation d'Économie et Humanisme, et l'un des premiers prêtres-ouvriers. Ce livre est une anthologie de textes introduits par des spécialistes. Les vingt siècles chrétiens sont découpés classiquement en quatre périodes : ancienne (Michel Meslin), médiévale (Nicole Bériou), moderne (Guy Bédouelle), contemporaine (Pierre Pierrard), chacune ordonnée selon sept thèmes : l'Église-communauté, connaissance de Dieu, expérience chrétienne, culte et dévotions, Église et charité, missions chrétiennes, Église et État. Une cinquième période évoque l'Église de Vatican II et s'achève sur le Testament de Paul VI (Jacques Loew)..." (Emile Poulat, Archives des sciences sociales des religions, 1979)
Traité complet de l'ondulation artificielle des cheveux.
P., Albert Brunet, 1909, gr. in-8°, xv-407 pp, une photo de l'auteur en frontispice, 236 dessins, portraits et gravures dans le texte, lettre-préface de Marcel, broché, bon état. Edition originale (et seule publiée), envoi a.s. Rare
"Toute femme a, dans le coeur, le secret désir d’avoir les cheveux frisés..." (Marcel) — A la fin du XIXe siècle, la profession de coiffeur est soumise à de nombreuses innovations liées à l'apparition de nouvelles techniques telles que l'ondulation Marcel (1872) ou l'utilisation du rasoir mécanique à lames interchangeables (1895). Le coiffeur Marcel Grateau, avec la mise au point d'un fer spécial portant son nom fut l'inventeur de l'ondulation au fer dite "naturelle" qui a perduré presqu'un demi-siècle et qui a fait la somptuosité des coiffures de la Belle Epoque. L'ondulation "naturelle" est constituée par la forme en vague des cheveux. Le fer Marcel est équipé d'une charnière ronde qui le rend plus résistant et mieux ajusté, d'une gouttière aux bords réguliers et non coupants. Le fer est utilisé gouttière en haut. Fortune faite, le désormais célèbre Marcel consacra quarante lignes d'explication sur sa méthode tenue jusque-là secrète, qu'il publia dans la “Coiffure française illustrée” de février 1897. E. Long, en revanche, consacra sa vie à écrire, démontrer et vulgariser « l'ondulation Marcel ».
Naissance de l’Europe
Armand Colin 1962, in-8 relié toile verte éditeur, 488 p. (manque la jaquette, sinon très bon exemplaire) Avec illustrations in et hors texte, cartes, index, chronologie et bibliographie. Rédigé par un professeur de Yale, cet excellent classique, sixième volume de la collection «Destins du Monde», va du V° au XIV° siècle.
Volcans ! Poésies récréatives, patriotiques et militaires. Oeuvres complètes.
Castres, Imp. Centrale, s.d. (v. 1900), in-12, 142 pp, broché, couv. muette, qqs pages mal coupées ou lég. salies, état correct. Rare
Rare recueil de poésies patriotiques publié à compte d'auteur par M. Loubet, retraité, à Cazères (Haute-Garonne).
The Itch for Play: Gamblers and Gambling in High Life and Low Life.
London, Jarrolds, 1962, in-8°, 256 pp, biblio, index, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état. Texte en anglais
Le Discours idéologique des architectes et urbanistes.
P., Copedith, 1972, gr. in-8°, 152 pp, notes, broché, bon état (Système économique urbain - Document de travail - Action concertée des recherches urbaines)
Le roman historique.
Payot, 1972, in-8°, viii-407 pp, préface de Claude-Edmonde Magny, index, broché, décharges de scotch sur les gardes, bon état
Un homme, une œuvre, un genre littéraire ne surgissent jamais ex nihilo, ils sont au contraire toujours préparés, conditionnés par un certain contexte historico-culturel. Cette idée, développée par Georges Lukacs dans Théorie du roman, a révolutionné les perspectives littéraires traditionnelles. Il l'applique ici au roman historique, genre né au début du XIXe siècle, qu'il étudie à travers les oeuvres de Balzac, Flaubert, Zola, Mann, Scott, ou encore Tolstoï. Georges Lukacs (1885-1971) a eu une influence déterminante sur des philosophes tels que Karl Mannheim et Martin Heidegger. Souvent considéré, avec L'Âme et les Formes (1911), comme l'un des pères de l'existentialisme, il est aussi, avec Théorie du roman (1920), celui de l'analyse structurale de la création littéraire.
Le feu de Prométhée. Réflexions sur l'origine de l'esprit.
Mazarine, 1984, gr. in-8°, 222 pp, traduit de l'anglais, 30 illustrations, la plupart à pleine page, notes, broché, couv. illustrée à rabats, qqs rares marques au crayon en marge, bon état
Comment l'esprit est-il venu à l'homme ? Pourquoi parmi les millions d'espèces qui sont apparues, puis se sont éteintes, les êtres humains sont-ils les seuls à avoir franchi la dernière étape, celle qui les a conduits à l'acquisition d'une intelligence élevée et d'une culture avancée ? Est-ce une étincelle divine qui a libéré l'homme des contraintes purement génétiques ? L'esprit est-il indépendant du corps, de sorte que la culture serait un phénomène séparé de l'évolution organique ? Non, c'est le contraire, répondent les auteurs de ce livre lumineux et provocant : l'apparition soudaine de l'esprit humain est due au déclenchement d'un mécanisme qui, tout en obéissant aux lois physiques, appartient exclusivement à l'homme. Ce “feu de Prométhée” (ainsi désigné par allusion à la métaphore antique qui dépeint l'origine de l'esprit), c'est la “co-évolution des gènes et de la culture”, un processus intéractif par lequel les uns et l'autre se transforment mutuellement. Animé par une véritable passion de convaincre, les auteurs édifient leur argumentation de façon impressionnante, en se fondant sur des exemples et des études empruntés à l'éventail tout entier des sciences biologiques et sociales. Pas à pas, ils amènent le lecteur à envisager, sinon à accepter, une théorie révolutionnaire de la transmission culturelle largement inspirée de la sociobiologie, dont Edward Wilson est le pionnier. Appelé certainement à susciter des controverses passionnées, mais aussi de nouvelles recherches,“Le feu de Prométhée” est un livre de vulgarisation au meilleur sens du terme : il explique et convainc tout à la fois, et remet en questio , ce faisant, bien des idées reçues.
Le rêve de Compostelle. Vers la restauration d'une Europe chrétienne ?
Centurion, 1989, in-8°, 366 pp,
La Médecine anecdotique, historique, littéraire. Recueil à l'usage des médecins, chirurgiens et apothicaires érudits, curieux et chercheurs.
P., Chez Jules Rousset, 1906, gr. in-8°, v-380 pp, 25 estampes, gravures, dessins et fac-similés, cart. papier crème à la bradel sur les plats duquel on a collé fort proprement les plats de couvertures originaux, très bon état
Volume II seul (sur 3) de ces recueils remplis d'anecdotes amusantes touchant la médecine et entrepris sous la direction du Docteur Minime, pseudonyme de Lutaud, et originellement parus en fascicules. Ce volume contient la réimpression complète et annotée de la Déclaration des abuz et tromperies que font les apothicaires, par Lisset Benancio, d'après l'unique édition princeps que possède la Bibliothèque nationale (Tours, 1553), la Vie de la Prostituée à Venise (12 planches gravées), etc, etc.
La Médecine anecdotique, historique, littéraire. Recueil à l'usage des médecins, chirurgiens et apothicaires érudits, curieux et chercheurs.
P., Jules Rousset, 1901, gr. in-8°, (2)-v-380 pp, 25 estampes, gravures, dessins et fac-similés, broché, couv. lég. salie, bon état
Second volume seul (sur 3) de ces recueils remplis d'anecdotes amusantes touchant la médecine et entrepris sous la direction du Docteur Minime, pseudonyme de Lutaud, et originellement parus en fascicules. Ce volume contient la réimpression complète et annotée de la Déclaration des abuz et tromperies que font les apothicaires, par Lisset Benancio, d'après l'unique édition princeps que possède la Bibliothèque nationale (Tours, 1553), la Vie de la Prostituée à Venise (12 planches gravées), etc, etc.
Le Carolingien. Bulletin trimestriel de l'Association amicale des anciens élèves du lycée Charlemagne.
Paris, 1949-1954, 12 fascicules in-8°, 12 à 48 pp chacun, brochés, couv. illustrées, bon état. Peu courant
Numéros 56 (décembre 1949), 57 (mars 1950), 62 à 71 (juin 1952 à janvier 1955). Le Carolingien a été fondé en 1928. Le numéro 71 (janvier 1955) est celui du Cent Cinquantenaire du Lycée. Avec des articles sur le château du Raincy, les logis parisiens de Victor Hugo, François Arago, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, la bataille des Thermopyles (480), Blaise Pascal dans le 4e arrondissement, un Aperçu historique sur le lycée Charlemagne, des Souvenirs carolingiens (1918-1923), etc.
Middletown. A Study in American Culture.
New York, Harcourt, Brace and Company, s.d. (1945), in-8°, x-(2)-550 pp, foreword by Clark Wissler, tables, index, reliure toile éditeur, bon état. Texte en anglais
Une expérience de sociologie concrète faite avant la guerre aux Etats-Unis. Les auteurs ont voulu réunir le maximum d'éléments indispensables à la connaissance sociologique d'une ville. – Pionniers de l’enquête sociologique, Robert et Helen Lynd, avant d’engager leur recherche au long cours à Muncie (Indiana), consultent Clark Wissler, anthropologue du Muséum d’histoire naturelle. Il leur fournit leur principal outil d’investigation, la liste des catégories standard constitutive de son « schéma culturel universel », qui deviennent « six activités principales» : établir une maison, élever des enfants, se vêtir et se nourrir, se trouver des loisirs, s’adonner à la prière et agir dans la communauté. Middletown est une recherche originale. Elle recourt à des entretiens intensifs sur un échantillon représentatif d’habitants de la ville et elle tranche avec la prégnance des jugements normatifs (bien qu’elle assume aussi une visée didactique) et la pauvreté des données empiriques (en ce qu’elle recourt aussi à des descriptions ethnographiques) de beaucoup d’enquêtes sociales de l’époque. Elle est saluée par E. Sapir et M. Herskovitz comme un exercice anthropologique. Les Lynd ont passé dix huit mois sur place, de janvier 1924 à juin 1925, rencontrant aussi bien des informateurs clefs, parce que bien placés dans des organisations ou membres des élites de la ville, que discutant à bâtons rompus avec des amis, avec les chauffeurs de tramways ou avec les membres du Rotary Club. Ils décrivent les cercles de sociabilité informelle (voisinage, associations) comme les institutions d’intégration sociale (Églises, écoles, entreprises). D’une certaine façon, les Lynd préfigurent l’ethnographie critique qui se développera à partir des années soixante.
Le Protestant français.
PUF, 1953, in-8°, 316 pp, 2 cartes dépliantes, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
"Voici, je crois bien, le plus important ouvrage que ce Bulletin ait eu à signaler dans son domaine propre, depuis ceux des regrettés John Viénot, Jacques Pannier et Charles Bost. En outre c'est, sur le protestantisme, le premier essai de synthèse qui tienne compte des changements survenus depuis une cinquantaine d'années dans les méthodes historiques au contact de la sociologie. M. Léonard, chartiste, nous donne aujourd'hui, réclamée par M. Lucien Febvre au nom du public souvent embarrassé devant le mystère huguenot, une étude sur « le Protestant français » qui essaie de dégager une unité morale (plutôt que dogmatique ou politique) de cette prodigieuse diversité qu'est le protestantisme..." (Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme français, 1953)
Le Protestant français.
PUF, 1953, in-8°, 316 pp, 2 cartes dépliantes, biblio, broché, couv. illustrée, dos recollé, trace de mouillure ancienne sur les 12 derniers feuillets, état correct
"Voici, je crois bien, le plus important ouvrage que ce Bulletin ait eu à signaler dans son domaine propre, depuis ceux des regrettés John Viénot, Jacques Pannier et Charles Bost. M. Léonard, chartiste, nous donne aujourd'hui, réclamée par M. Lucien Febvre au nom du public souvent embarrassé devant le mystère huguenot, une étude sur « le Protestant français » qui essaie de dégager une unité morale (plutôt que dogmatique ou politique) de cette prodigieuse diversité qu'est le protestantisme..." (Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme français, 1953)
Grandeur et misère de l'individualisme français.
P.-Genève, La Palatine, 1957-1962, 3 vol. in-8°, 334, 288 et 286 pp, brochés, bon état
I. Des origines à la Fronde ; II. De Louis XIV à la Révolution ; III. De la 1ère République à la Ve. — "Le duc de L. M. retrace, d'une façon plus élégante que méthodique, les grands traits de l'histoire française depuis les Gallo-Romains jusqu'à Louis XIV." — "Du début du régime de Louis XIV jusqu'à la Révolution française, l'auteur cherche à étudier le passage de l' « individualisme de tempérament » à l' « individualisme anarchique » puis à l' « individualisme de doctrine »" — "Le duc de L. M. s'attache à montrer à la fois le rôle des individus dans l'histoire française depuis 1789 et le frein ou le contrepoids que leur apporte l'individualisme régnant dans la collectivité nationale. Il aime mettre en valeur les qualités, identiques ou complémentaires, d'hommes d'horizons politiques ou idéologiques différents : M. de Charette et Hoche, Jaurès et A. de Mun ... On admirera, sous la plume de cet académicien, des hardiesses de style qui ailleurs seraient tenues pour solécismes. On appréciera également la fermeté de ses jugements politiques : M. Guy Mollet est loué d'avoir agi « en véritable chef de gouvernement» en décidant l'expédition de Suez, qui fut presque « une immense victoire diplomatique »". (Revue française de science politique, 1958, 1960 et 1963)
Anthropologie structurale.
Plon, 1971, in-8°, 452 pp, 23 illustrations dans le texte et 13 illustrations hors texte, biblio, index, cart. bleu de l'éditeur, titres dorés au dos, sans la jaquette, bon état
Ecrits entre 1945 et 1957, les textes rassemblés dans ce volume et devenus difficilement accessibles jettent les fondations de l'anthropologie structurale à laquelle le nom de l'auteur est lié. L'introduction dissipe un malentendu initial en montrant que l'ethnologie et l'histoire, même dite événementielle, loin de s'opposer, doivent se prêter un appui mutuel ; ce que, depuis, les succès de l'anthropologie historique ont amplement attesté. L'étude des sociétés amérindiennes, objet de la deuxième partie, le confirme. L'analyse structurale de leurs coutumes, et de leurs institutions anticipe des découvertes archéologiques récentes, d'où ressort que les peuples amazoniens ne furent pas les primitifs qu'on croyait voir en eux. Dans une première partie, l'auteur avait aussi fait voir par des exemples concrets comment ses réflexions sur les rapports de l'anthropologie avec la linguistique et la psychologie l'ont conduit à poser les principes de l'analyse structurale des mythes, qui allait occuper une grande place dans ses travaux. Une troisième partie élargit cette perspective pour y inclure l'art. Enfin une quatrième partie, d'esprit plus méthodologique, envisage la place de l'anthropologie dans l'ensemble des sciences sociales et les problèmes posés par son enseignement. A côté des aspects de la réalité sociale si complexes que l'observateur doit se contenter de les décrire, et que l'anthropologie structurale ne songe pas à nier, on constate ainsi qu'il en existe d'autres où la comparaison permet de dégager des relations invariantes. En s'attachant surtout à eux, on espère mieux comprnedre l'homme et introduire dans son étude un peu plus de rigueur. — "Recueil comprenant dix-sept textes (articles, rapports de congrès, etc.). dont deux inédits, groupés sous cinq rubriques : langage et parenté, organisation sociale, magie et religion, art, problèmes de méthode et d'enseignement. Le plus important, celui qui éclaire le plus systématiquement la pensée de l'auteur, étudie « La notion de structure en ethnologie »."(Revue française de science politique, 1958) — "Fort de ses expériences (et c'est ce qui lui permet de s'attaquer à certains purs théoriciens) et par ses articles publiés entre 1944 et 1956, et ici rassemblés, L.-S. nous insuffle sans relâche, que l'ethnologie est une science, aux méthodes d'analyse rigoureuses dont l'objectivité est nuancée par l'apport personnel de l'ethnologue. L'ethnologue d'ailleurs ne cherchera pas tant à percer le comportement de chaque société qu'à voir la façon dont elles diffèrent les unes des autres. Science paradoxale s'il en est, car son cadre théorique doit s'ajuster à des techniques d'observations sur lesquelles il est très en avance. Là est le défi et c'est à l'anthropologie moderne à le relever. L'étude des rapports de l'ethnologie avec l'histoire, la linguistique, la sociologie la psychanalyse, la démographie, etc., et les concepts propres à l'anthropologie sociale permettent à l'auteur de mettre en place sa méthode structurale. Notons sa magistrale étude sur la magie, les réflexions que lui suggèrent les rapports entre ethnologie et marxisme, et la place qu'il accorde à la démographie qualitative. Tout cela sans jamais perdre de vue le rôle primordial des liens de parenté. Car les systèmes de parenté, les règles de mariage et de filiation forment un ensemble coordonné dont le rôle est de maintenir « la permanence d'un groupe social », par l'enchevêtrement des relations consanguines et d'alliance." (Population, 1958)
Anthropologie structurale.
Plon, 1965, pt in-8°, ii-454 pp, 23 illustrations dans le texte et 13 illustrations sur 8 pl. hors texte, broché, pt tache sur la couv., traces de scotch sur les gardes, C. de bibl, bon état
Le Totémisme aujourd'hui.
PUF, 1962, in-12, 154 pp, biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Mythes et religions). Édition originale
Premier ouvrage de Claude Lévi-Strauss, Le totémisme aujourd'hui a marqué un tournant, silencieux mais décisif, dans l'ethnologie. Non seulement le concept de totémisme y a été déconstruit, mais l'approche évolutionniste s'est effacée au profit d'un nouveau paradigme structuraliste. Claude Lévi-Strauss évalue la pertinence du concept de totémisme pour désigner des groupes sociaux mettant en place une dynamique précise de continuité entre l'homme et la nature. Son postulat est le suivant : le totémisme est une illusion. Le terme de « totémisme » est une fabrication des ethnologues dans le but de déplacer ces phénomènes – aussi fascinants que dérangeants – hors de leur propre société. L'anthropologue ne s'en tient pas là : il veut comprendre les raisons de cette chimère. Revenant sur l'ensemble des recherches menées sur ce sujet, et étudiant les mêmes tribus aborigènes australiennes qui ont servi à élaborer ces théories, il redéfinit les contours de la notion de totémisme, la confronte aux phénomènes qu'il observe, pour finalement la dissoudre. En signant la fin du totémisme et des théories animalistes, il marque l'avènement du paradigme structuraliste dans l'étude des sociétés humaines et des rapports entre individus. — "Un ouvrage capital en dépit de son faible volume." (Jean Guiart, Revue de l'histoire des religions) — Avec Le totémisme aujourd’hui (1962), Lévi-Strauss pensait refermer la page d’un des plus fameux débats de l’anthropologie et de l’anthropologie des religions, sur une catégorie conceptuelle dont la consistance et la portée transculturelle ont été âprement discutées. Déplaçant la question de l’universalité des attributs empiriques du culte vers l’analyse des propriétés structurelles de classification et d’organisation dualistes, le fondateur du structuralisme devait en même temps disqualifier le débat et dissoudre le concept de totémisme. (Lionel Obadia)
Mythologiques. 4, L'Homme nu.
Plon, 1971, gr. in-8°, 688 pp, 39 illustrations dans le texte, 4 pl. hors texte, importante bibliographie, index des mythes et index général, broché, couv. à rabats illustrée par Paul Delvaux, trace d'humidité ancienne sur la couv., bon état. Edition originale (achevé d'imprimer du 10 septembre 1971)
Ce quatrième et dernier volume des Mythologiques s'attache à des mythes de la côte nord-ouest de l'Amérique. Quand, pour les Indiens d'Amérique tropicale, le passage de la nature à la culture est symbolisé par l'introduction de la cuisine, au nord du continent, il est marqué par l'invention des parures et des vêtements et, de là, par celle des échanges commerciaux. Autrement dit, le nu occupe ici la position qu'occupait le cru dans les mythes de l'Amériques du Sud...
Panorama de l'Ethnologie (1950-1952).
Gallimard, revue Diogène, 1953, gr. in-8°, 28 pp, (sur 144), broché, pt taches sur la couv. et les 4 premiers feuillets, bon état (Revue Diogène n° 2)
On trouve dans le même numéro : L'Avenir du Prolétariat (Colin Clark) ; Piero della Francesca, G. Seurat, J. Gris (Lionello Venturi) ; L'Origine de l'Homme (Paul Rivet) ; Naissance de l'Empire médiéval (Heinrich Fichtenau) ; Valeurs et limites de l'explication religieuse en géographie humaine (Pierre Deffontaines) ; L'Indianisme en 1952 (Louis Renou).
Le Roman “gothique” anglais, 1764-1824. (Thèse).
Toulouse, Association des Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines, 1968, fort gr. in-8°, xv-750 pp, notes, importante biblio, 4 index, broché, couv. camin avec titres en noir à rabats, bon état. Edition originale rare
Ruines d'abbayes ou de châteaux, souterrains inquiétants et chastes héroïnes appartiennent aux images léguées par le roman anglais de la fin du XVIIIe siècle, ressuscité par le surréalisme. Avant la parution du livre de Maurice Lévy, ancien directeur de la maison française d'Oxford, professeur de littérature anglaise à l'université de Toulouse-Le-Mirail, il n'existait pas de synthèse française sur ce mouvement littéraire représenté par Ann Radcliffe, Horace Walpole et Matthew Gregory Lewis. Avec ces auteurs qui plaçaient la littérature sous le signe du « gothique », l'Angleterre moderne rêvait devant les vestiges du passé, exprimant ainsi son désir de retrouver la vraie « demeure de l'intimité absolue ». Les nombreux avatars de ce genre, en particulier aux Etats-Unis, ne peuvent en faire oublier les origines et le sens premier : dire la « précarité, l'abîme et le manque, cette réalité gothique qu'est la vie ». — "Bien avant de convertir les amateurs par son élégante érudition, cet ouvrage savant avait servi de référence obligée à tous ceux qui, souvent sous l'impulsion de son auteur, étaient entrés à leur tour dans ce sombre univers. Et l'anglicisme français en particulier, gagné à la séduction de la littérature fantastique, porte l'empreinte de Maurice Lévy et de son travail inaugural sur le genre "gothique." (...) Une étude qui emmène le lecteur dans les méandres d'une "carte du tendre" du roman noir – énorme corpus en effet dont les titres s'égrènent sur une soixantaine de pages, sans compter une quinzaine de pages de traductions françaises. (...) Tout le débat si florissant sur la littérature fantastique, d'outre Manche en particulier, devra se ressourcer à un moment ou un autre dans le livre toujours actuel de Maurice Lévy." (Max Duperray, XVII-XVIII. Revue de la Société d'études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles, 1995)
 Write to the booksellers
Write to the booksellers