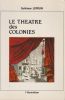-
Latest
Last 24h (1)
Last 3 days (2)
Last month (18)
Last week (4)
-
Century
17th (2)
18th (9)
19th (206)
20th (1736)
21st (233)
-
Syndicate
ILAB (2192)
SLAM (2192)
Femmes asiatiques en France. Places familiales, placements professionnels et déplacement sociaux.
Les Indes savantes, 2009, in-8°, 316 pp, biblio, broché, bon état
"Les femmes venues d'Asie en France viennent d'horizons géographiques et culturels très différents (Chine, Corée, Vietnam, Laos, Cambodge, Philippines...). Les raisons de leur venue tiennent souvent aux événements historiques qui ont secoué ces pays, et dans ce cas, leur voyage s'est souvent fait dans des conditions dramatiques : réfugiées des guerres de la péninsule Indochinoise, du génocide Khmer rouge, boat-people... Elles sont maintenant de plus en plus liées à la pauvreté, à l'immigration économique. Dans tous les cas, cette immigration vers la France et l'intégration sont difficiles à cause de la langue, de l'abandon de la famille, et surtout de la place de la femme dans les sociétés asiatiques traditionnelles : la soumission exigée dans les sociétés confucianistes est notamment fort mal adaptée à la société occidentale individualiste et égalitaire, notamment pour s'affirmer dans la recherche d'une autonomie professionnelle. L'ouvrage s'intéresse également aux métisses, et aux Asiatiques de deuxième génération, nées en France."
Le roman du Gulf-Stream.
Plon, 1956, in-8°, 402 pp, 9 illustrations, 3 cartes, 26 illustrations hors texte, reliure souple éditeur, jaquette illustrée, qqs rousseurs sur les gardes, bon état
L'Afrique fantôme.
Gallimard, 1981, in-8°, 533 pp, mention de 5e édition, achevé d'imprimer en avril 1951, 31 planches de photographies de la Mission Dakar-Djibouti et une carte hors texte, broché, couverture illustrée bleu-clair renforcée avec du scotch, 2 feuillets lég. salis, papier lég. jauni, bon état
En 1930, alors que, surréaliste dissident, il travaillait à la revue "Documents", Michel Leiris fut invité par son collègue l'ethnographe Marcel Griaule à se joindre à l'équipe qu'il formait pour un voyage de près de deux ans à travers l'Afrique noire. Ecrivain, Michel Leiris était appelé non seulement à s'initier à la recherche ethnographique mais à se faire l'historiographe de la mission, et le parti qu'il prit à cet égard fut, au lieu de sacrifier au pittoresque du classique récit de voyage, de tenir scrupuleusement un carnet de route. Ce parti cadrait avec les vues du grand sociologue Marcel Mauss recommandant aux chercheurs la tenue de tels carnets en marge de leurs enquêtes sur le terrain. Mais, tour personnel donné à cette pratique, le carnet de Michel Leiris glissa vite vers le "journal intime", comme s'il était allé de soi que, s'il se borne à des notations extérieures et se tait sur ce qu'il est lui-même, l'observateur fausse le jeu en masquant un élément capital de la situation concrète. Au demeurant, celui pour qui ce voyage représentait une enthousiasmante diversion à une vie littéraire dont il s'accommodait mal n'avait-il pas à rendre compte d'une expérience cruciale : sa confrontation tant avec une science toute neuve pour lui qu'avec ce monde africain qu'il ne connaissait guère que par sa légende ? Ainsi s'est édifié "L'Afrique fantôme", qui consiste essentiellement en la reproduction des notes narratives ou impressionnistes que l'auteur avait prises au jour le jour, non moins attentif à ce qui se déroulait dans sa tête et dans son coeur qu'à ce qui, extraordinairement divers et par des voies diverses elles aussi (appréhension directe, information pure ou participation vivante), l'atteignait du dehors.
L'Aluminium, le manganèse, le baryum, le strontium, le calcium et le magnésium.
P., J.-B. Baillière, 1894, in-12, 360 pp, + catalogue, introduction par Urbain Le Verrier, 37 figures dans le texte (dont une gravure sur double page de l'usine de Froges), reliure percaline crème de l'éditeur, titres en noir au 1er plat et au dos, bon état (Coll. Encyclopédie industrielle)
La peur du « rouge » en France. Des partageux aux gauchistes.
Belin, 2003, in-8°, 303 pp, biblio, index, broché, couv. illustrée, trace de mouillure angulaire ancienne sur les premiers feuillets, bon état
La peur sociale provoque les "effrois", les émeutes et les "folles commotions" des populations révoltées dès le Moyen Age. Elle est la peur de ceux qui sapent les colonnes de la société, comme les partageux du premier XIXe siècle, avides de redistribution des richesses et de substitution du socialisme au capitalisme. Aux environs de 1840, en effet, la Révolution industrielle prend son essor, un prolétariat en naît et, avec lui, se nouent les tensions sociales, liées à toute croissance économique brutale. La politique aime les couleurs, mais le bourgeois vomit le "rouge", fier de son travail. Après la phobie des attentats anarchistes de la fin du XIXe siècle, l'homme du XXe siècle a eu bien davantage de craintes politiques et sociales, d'abord multipliées par les affiches du "moujik hirsute" de 1919, qui concrétise la hantise des "rouges", version bolcheviks cette fois-ci. Il a connu – pas forcément éprouvé – la hantise de la Guerre froide, du "camp communiste", de l'Armée rouge, des "gauchistes" et des "étés chauds" Qui a réellement "profité" de cette peur ? Les "rouges" ont-ils été manipulés ? Et la "cible" n'a-t-elle pas totalement changé avec la drogue, les banlieues "à risque", le terrorisme ?
Histoire des institutions scolaires, 1789-1989.
Fernand Nathan, 1994, in-8°, 238 pp, broché, qqs soulignures au stylo rouge et au crayon, bon état (Coll. Repères pédagogiques)
"L'idée d'Education nationale émerge à la fin du XVIIIe siècle. Il a donc fallu deux siècles pour que les institutions scolaires se mettent en place grâce à Lakanal, Napoléon, Carnot, Guizot, Falloux, Ferry, Haby, Savary, Jospin... Deux siècles de péripéties et de rebondissements passionnants qu'il est bon de se remettre en mémoire à un moment où cette grande dame qu'est l'Education nationale vit un tournant de son histoire."
Célébration de l'Œuf.
Le Jas, Robert Morel, 1968, in-12 carré, (48) pp, un dessin d'Odette Ducarre en frontispice, non paginé, reliure pleine toile vert pomme éditeur, large signet en tissu, édition originale, après 1000 exemplaires marqués H.C., couv. lég salie, bon état
Répertoire des documents nécrologiques français. Publié sous la direction de Pierre Marot.
P., Imprimerie Nationale, Klinscksieck, Académies des Inscriptions et Belles Lettres, 1980-1992, 4 vol. in-4°, viii-1517, 150, 58 pp, pagination continue pour les tomes 1 et 2, 16 pl. hors texte, index, brochés, bon état (Collection Recueil des historiens de la France. Obituaires). Tomes 1 et 2, Supplément et Deuxième supplément.
L'Eglise dans les temps modernes.
Bloud et Gay, 1928, in-12, 199 pp, biblio, broché, bon état (Coll. Bibliothèque catholique des sciences religieuses). Edition originale, ex. numéroté sur vélin alfa Ruysdael
La Renaissance (1447-1517) ; La révolution protestante (1517-1563) ; La restauration catholique (1563-1648) ; Les origines et les progrès de l'incrédulité moderne (1648-1789).
Histoire du chapeau féminin. Modes de Paris.
Editions Charles Massin, 2000, in-4°, 157 pp, très nombreuses illustrations, photos, croquis en noir et en couleurs, et un plan de Paris en pages de garde présentant les rues des boutiques mentionnées dans le texte, reliure cartonnée de l'éditeur, jaquette illustrée, manque la page de titre, bon état
Modes... une enseigne méconnue aujourd'hui, une enseigne qui pendant plus de 150 ans, a brillé de tout son éclat, offrant aux passants, dans les rues de Paris, le spectacle de vitrines magiques ; une enseigne a laquelle œuvrait une artiste, la modiste, dont le geste délicat a été immortalise par les plus grands peintres... A l'enseigne de "Modes" midinettes et grandes dames perdaient la tête... pour la parer à grands frais de plumes et de fleurs... Moins exubérantes, les "Modes" d'aujourd'hui n'ont rien perdu de leur charme, les talents s'étant adaptés à l'évolution de la société. — Sommaire : Naissance et évolution du chapeau. Le chapeau dans la vie (rôle des chapeaux, convenances, rivalités coiffeurs et modistes, etc.). Le métier (modistes, ateliers, boutiques, fournisseurs). Annexes : la confection amateur, les chapeaux d'enfants, lexique. — Nicole Le Maux, collectionneuse, a réuni quelque 500 chapeaux de 1780 à nos jours. Ces pièces authentiques lui ont permis une approche immédiate de l'évolution capricieuse des modes et de l'ineffable savoir-faire modiste. Elles fournissent une grande partie de l'iconographie originale de cet ouvrage.
Encyclopédie des Religions.
P., Bayard, 1997, 2 forts vol. in-4°, xxi-2469 pp, pagination continue, très nombreuses cartes et illustrations, texte sur deux colonnes, 4 index (noms, grands textes, mythes, thématique), reliures toile gris clair de l'éditeur sous jaquettes illustrées, bon état. A l'état de neuf (prix neuf en 1997 : 151 euros)
Existences d'artistes. De Molière à Victor Hugo.
Grasset, 1949, in-12, 342 pp, 8 gravures hors texte, broché, couv. illustrée, papier lég. jauni, bon état (Coll. La petite Histoire, 11)
"Les “Existences d'artistes”, de G. Lenotre (Grasset), sont un choix de ses chroniques relatives à la vie privée de quelques grands hommes des arts ou des lettres. Ces pages n'ont pas perdu leur fraîcheur, et permettent d'espérer que plusieurs recueils posthumes pourront être encore édités du plus amusant des historiens." (André Thérive, “Le Temps”, 10 janvier 1941)
Recherches historiques sur la médecine des Chinois. Thèse présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris le 31 août 1813.
Sans lieu ni nom, s.d., in-4°, 104 pp, broché, dos toilé, bon état. Réédition en fac-similé (photocopie)
F.-A. Lepage (1788-1875) s'intéressa surtout à la sphygmologie ; l'étude du pouls, et l'étudia dans la médecine chinoise. Le diagnostic des maladies par le pouls était le pont le plus solide entre la médecine européenne et la médecine chinoise, puisque aux deux extrémités de l'Eurasie, le diagnostic et le pronostic se faisaient par la prise du pouls. — "En comparant avec attention tout ce que les voyageurs nous ont appris sur la médecine des Chinois, on ne voit partout que la répétition des principes les plus ridicules et des théories les plus obscures ; et l'on est fâché de ne trouver que de loin en loin quelques-unes de ces choses qui paraissent dictées par l'expérience ou la raison. Mais, lorsqu'on entreprend d'exposer l'état et les progrès d'une science chez un peuple, on n'est point maître d'augmenter l'intérêt à volonté, et l'on doit, si l'on ne veut point manquer le but, se restreindre dans les bornes de la vérité, et dire les choses comme on les voit, et non point comme on voudrait les voir." — "Au reste, si les systèmes de médecine imaginés par les Chinois peuvent plutôt amuser par leur bizarrerie que présenter un intérêt réel, nous trouverons par la suite dans quelques pratiques particulières à ces peuples, ainsi que dans la considération de leur climat et de leur manière de vivre, relativement à leur influence sur la santé, la matière de quelques discussions assez intéressantes."
Les Formes de l'expérience. Une autre histoire sociale.
Albin Michel, 2013, pt in-8°, 380 pp, préface d'Eric Brian, broché, couv. illustrée, bon état
Publié en 1995, “Les Formes de l'expérience. Une autre histoire sociale” a marqué une étape importante dans la réflexion des héritiers de l'école des Annales. Issus d'un travail collectif, les textes du recueil questionnaient à la fois les objets de la recherche en histoire et les implications du travail des historiens. Il s'agissait en particulier de s'interroger sur la réception par ceux-ci de catégories et d'objets issus des autres sciences sociales : acteurs, normes, pratiques, institutions, etc., et d'en évaluer l'impact sur l'évolution d'une discipline marquée par sa tradition et ouverte à la réflexion sur le monde contemporain. A distance, ce recueil qui a fait débat garde sa pertinence. Il témoigne du caractère essentiellement collectif de toute grande enquête historique. Il rappelle enfin l'ampleur du travail d'animation de la recherche alors accompli par Bernard Lepetit, dont l'oeuvre inachevée reste l'une des meilleures introductions à l'histoire intellectuelle des trois dernières décennies.
Le Théâtre des Colonies. Scénographie, acteurs et discours de l'imaginaire dans les expositions 1855-1937.
L'Harmattan, 1986, gr. in-8°, 308 pp, 84 planches de gravures et photos hors texte, biblio, annexes, broché, couv. illustrée, bon état
Le Théâtre des Colonies étudie le face à face singulier où furent placés durant près de 40 ans (1894-1931), à travers les expositions coloniales, le peuple français et les pays d'outre-mer dans leur cadre reconstitué et sous le mobile euphorisant de la "Grande Patrie". Dans cette fête du regard où selon le voeu du poète, " les parfums, les couleurs et les sons se répondent ", sont mises en abîme les cultures les plus différentes et mis en scène les fantasmes les plus étonnants. Ici, artistes en renom ou artisans plus modestes concourent à créer un espace où se mêlent réalité et fiction, commerce et cirque, plastique et sensualité. Moment fort de l'exaltation collective, parangon de l'idéologie patriotique, l'exposition coloniale, temple de l'éphémère, est aussi une pourvoyeuse de mythes durables dont nous pouvons suivre la trace jusqu'à nos jours. L'auteur reconstitue l'itinéraire de l'impossible fusion, depuis le voyage initiatique des premiers orientalistes, jusqu'au réveil de la mauvaise conscience et le retour du refoulé politique. Une plongée esthétique et ethnographique dans le temps où se croisent visages et paysages exotiques, où le même qui entend incorporer l'autre dans la contemplation de son essence, s'aliène dans les vagues troubles de son ressentiment. — "Les expositions coloniales, qui apparaissent et se multiplient pendant la colonisation et disparaissent avec les indépendances, participent d’une tendance générale liée au développement économique du monde occidental qui accompagne et suit la révolution industrielle. La première exposition universelle a lieu en 1851 à Londres, les premières expositions coloniales en 1883 à Amsterdam. Les expositions coloniales sont précédées, dans leur recherche de l’exotisme, par le mouvement intellectuel orientaliste dont elles peuvent apparaître comme la version populaire, peu à peu distordue, d’où ce nom de théâtre – qui confine parfois au spectacle de cirque – que lui donne Sylviane Leprun, qui tente d’analyser le fonctionnement de ce spectacle, de sa mise en forme, et les ressorts politiques et imaginaires dont il procède. Les expositions coloniales relèvent politiquement d’une stratégie de propagande, exaltant le rêve de confraternité coloniale. L’imaginaire y est de moins en moins sollicité et se heurte de plus en plus, à travers les glissements des reconstitutions à une modélisation rigide et à des représentations stéréotypées qui barrent la route à son exercice véritable. Ainsi le village « noir », « indigène » ou « sénégalais », qui s’inscrit dans toutes les expositions agricoles et industrielles, qui se devaient toutes de comporter une section coloniale, se vide de toute information véritable, stimulant l’exercice du rêve et de la pensée. (...) Ce qui est finement analysé dans cet ouvrage, par cette approche spécifique de la scénographie, c’est le projet du colonisateur qui ne peut s’exprimer, à son insu peut-être, qu’en vidant de son contenu ce qu’il veut s’approprier ; affirmer que ce qu’il montre, c’est la France, en lui apportant les retouches plus vraies que nature, est une manière de la nier dans sa réalité propre. Ce « terrorisme du vérisme » va à l’encontre du but recherché. Cette scénographie du vrai est le pire des mensonges. On a ici un élément important de réflexion sur le discours muséographique qui ne peut être que traduction, évocation, langage qui implique par définition une distance entre signifiant et signifié..." (Annie Dupuis, Gradhiva, 1991)
Histoire des Français, XIXe-XXe siècles. 1. Un peuple et son pays. – 2. La société. – 3. Les citoyens et la démocratie.
Armand Colin, 1983-1984, 3 vol. pt in-4°, 587, 623 et 523 pp, 96 planches en couleurs hors texte, nombreuses illustrations en noir dans le texte et à pleine page, biblio, index, reliures toile chocolat de l'éditeur, titres en blanc aux 1er plats et aux dos, sans les jaquettes, bon état
Tome 1 : Un peuple et son pays, par Colin Lucas, Yves Lequin, Maurice Garden et Henri Morsel ; tome 2 : La société, par Ronald Hubscher, Louis Bergeron, Yves Lequin et Henri Morsel ; tome 3 : Les citoyens et la démocratie, par Jean-Luc Pinol, Yves Lequin et Pascal Ory. — "Le deuxième tome, consacré à la société, constitue le cœur de l'ouvrage ambitieux dessiné par Yves Lequin ; deux volumes l'encadrent, l'un propose un tableau de la France et de sa population, l'autre une longue analyse de la vie politique. Pour l'essentiel, trois milieux font, dans le deuxième tome, l'objet d'un excellent chapitre d'histoire sociale : la paysannerie, confiée à Ronald Hubscher, le patronat de l'industrie et du négoce, disséqué par Louis Bergeron, le prolétariat ouvrier, minutieusement étudié par le directeur de l'ouvrage. Chacun des trois auteurs a consacré de longues années et la quasi-totalité de sa recherche au sujet qu'il traite ; ce qui nous vaut des exposés informés, clairs et rigoureux. Ronald Hubscher, au fil d'un discours linéaire parfaitement maîtrisé, dessine un modèle d'ethnohistoire ; sa démarche novatrice le conduit en outre à consacrer autant de pages passionnantes à l'imaginaire social qu'à la la description des conditions ; un tel parti constitue, pour l'heure, une exception et mérite d'être souligné. Avec Louis Bergeron commence l'impressionnante démolition des idées reçues qui constitue l'un des charmes majeurs de l'ouvrage. Fort de son immense érudition, l'auteur de la deuxième partie montre qu'il n'existe pas de coupure franche entre patronat de l'Ancien Régime et patronat de la révolution industrielle, entre capitalisme mobilier et capitalisme immobilier, entre industrie et propriété foncière, aux intérêts trop souvent jugés antagonistes. Immergé dans le milieu des notables, le patron se trouve soumis à des modèles culturels qui l'amènent à se laisser tenter par le prestige du service de l'Etat, les délices de la vie de château ou, plus simplement, par les plaisirs sages de l'otium cum dignitate des Romains. Admirables de pénétration, les portraits du grand négociant, du fabricant, du « Monsieur du Sentier », du commissionnaire. Louis Bergeron souligne que la présence du nouveau patronat, doté d'une formation scientifique de haut niveau, se révèle plus massive dans les industries anciennes, en perpétuelle évolution technique, que dans des industries nouvelles, souvent enracinées dans l'artisanat. Yves Lequin, à son tour, participe à ce jeu de massacre des poncifs. L'image des foules usinières du XIXe siècle est trompeuse, l'industrialisation doucereuse, aux conséquences obliques fait que la grande usine demeure une anomalie dont le travailleur lui-même surmonte difficilement l'étrangeté. Parfois, la mise au point, solidement étayée, frise la provocation : « la paupérisation [...] est déjà à mettre au rang des vieilles lunes métaphysiques » (p. 410) ; le prolétariat de la Belle Epoque souffre avant tout de se voir dépossédé de ses savoir-faire et, par conséquent, d'une partie de ses pouvoirs traditionnels ; et, sans doute, de se sentir victime d'un véritable bouclage à l'intérieur de sa condition. A la fin du siècle, tandis que s'estompe le spectre de la misère profonde, l'ouvrier se sent condamné à un nouveau mode de résignation. Un des grands mérites du livre est, en effet, de faire une large place à l'histoire de la mobilité sociale..." (Alain Corbin, Annales ESC, 1985)
La Mosaïque France. Histoire des étrangers et de l'immigration en France.
Larousse, 1988, pt in-4°, 479 pp, préface de Pierre Goubert, nombreuses illustrations dans le texte et hors texte en noir et en couleurs, 13 cartes et schémas, biblio, index, reliure simili-cuir éditeur, jaquette illustrée, bon état (Coll. Mentalités : vécus et représentations)
Par Noël Coulet, Maurice Garden, Jean Gaudemet, Yves Lequin, Frances Malino, Jean-Pierre Poly, Jean-Pierre Poussou, Pierre Riché, Dominique Schnapper, Georges Tapinos. — "Indéniablement, l'immigration est en passe de devenir un élément légitime de la mémoire nationale. En témoigne le beau livre publié sous la direction de Y. Lequin, avec la collaboration de plusieurs des meilleurs spécialistes de la question, qui propose une histoire du phénomène des origines à nos jours, agrémentée d'un grand nombre d'illustrations, gravures, cartes, tableaux." (Gérard Noiriel, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 1989) — "De La mosaïque France, commençons par dire qu'elle est bien composée : elle s'ouvre, après une préface généreuse de Pierre Goubert, par un inventaire d'idées générales sur l'étranger, son image et son statut. Elle se clôt par un double essai de démographie actuelle et prospective et de philosophie de l'histoire de l'étrangeté. Une vision globale, indispensable à l'intelligence de l'histoire de l'immigration en elle-même, est ainsi proposée. De ce beau livre, poursuivons le commentaire en saluant l'ampleur des investigations historiques qu'il suggère plus qu'il ne les accomplit vraiment ; c'est que l'histoire longue des migrations qui ont irrigué la France reste à faire, et ce n'est pas un mince mérite que de l'avoir inaugurée par une recherche obstinée des mouvements de fond qui l'ont caractérisée, peut-on dire, dès les origines : extraordinaire diversité des flux et des provenances, vivacité des « petites patries » ainsi constituées, mais non moindre permanence des réactions xénophobes qui, depuis le bas Moyen-Age, ont dans la figure du Juif et celle du Maure deux représentations de prédilection. L'histoire des communautés juives en France fait à elle seule l'objet de développements nombreux : à très juste raison. L'époque contemporaine (1815-1945), dont Yves Lequin et Dominique Schnapper se sont réservés le traitement, est l'illustration d'un exercice pleinement réussi d'application de l'analyse historique à l'intelligence de durables phénomènes de société..." (André-Clément Decouflé, Revue européenne de migrations internationales, 1990)
Mythes et réalités transatlantiques. Dynamique des systèmes de représentation dans la littérature. Séminaires et actes du colloque international tenu à Talence les 8 et 9 décembre 1995.
Talence, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 1997, gr. in-8°, 465 pp, broché, couv. illustrée, bon état
38 études érudites. — Les auteurs de cet ouvrage, fruit d’une réflexion collective, s’attachent à rendre compte du dynamisme des échanges en même temps que de la plasticité des écarts entre les deux piliers de la culture transatlantique. Depuis la Renaissance, la circulation entre Ancien et Nouveau Monde a été globalement porteuse d’un enrichissement décisif de la pensée et, dans l’optique littéraire qui nous retient, de l’imaginaire.
Postes d'Europe, XVIIIe-XXIe siècle. Jalons d'une histoire comparée / Post Offices of Europe 18th-21st Century: A Comparative History.
P., Comité pour l'Histoire de La Poste, 2007, gr. in-8°, 488-486 pp, 2 pl. en couleurs hors texte, qqs illustrations dans le texte, broché, couv. illustrée à rabats, bon état. Texte bilingue français et anglais
Cet ouvrage est l’un des seuls sur le sujet. Les organisations postales se sont développées selon des modèles distincts. Cela tient à l’adaptabilité des Postes vis-à-vis de leurs tutelles comme à leur plasticité vis-à-vis des milieux qu’elles desservent. Ces différences et cette plasticité, pour une mission identique en réseau, expliquent la multiplicité de modèles et complexifient une approche en histoire comparée. — Embryon des premiers moyens de communication, le cursus publicus, que l’Empire romain a érigé pour relier ses territoires conquis, peut être considéré comme l’ancêtre de l’institution postale. Le réseau postal constitue une très ancienne organisation commune à l’espace européen. Du XVIIIe siècle à nos jours, l’exemple du réseau postal français semble dégager trois temps successifs. D’abord, il y eut celui de la consolidation du système de transport alors en construction ; ensuite, ce fut l’essor de sa capacité de traitement d’un trafic croissant (renforcement des moyens humains et matériels) ; enfin, ce fut le temps de la diversification des actions et de la modernisation technique. Qu’observe-t-on pour les autres États européens ? A-t-il existé des similitudes dans la construction des réseaux et dans leur organisation ? En définitive, comment les Postes européennes ont-elles coopéré malgré leurs différences et leurs spécificités ? Tenu en juin 2004, ce colloque a constitué la première manifestation scientifique européenne de cette importance, regroupant des chercheurs de toutes disciplines des sciences humaines et sociales. Ils ont abordé les questionnements et les problématiques spécifiques aux organisations et au réseau, privilégiant la comparaison au sein de l’Europe.
Histoire des rois de France d'Henri IV à Charles X.
Editions Ventadour, 1956, in-8°, 263 pp, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Maîtres de la musique.
Bruxelles, Club international du Livre, s.d. (1965), in-8°, 298 pp, 4 illustrations en 2 couleurs, biblio, reliure skivertex bordeaux de l'éditeur, dos lisse avec titres et filets dorés, un fer doré représentant un clavecin au 1er plat, gardes illustrée des portraits dessinés des compositeurs, bon état. Ouvrage tiré à 3000 ex. tous numérotés (ex. n° 1620)
"Mettre en lumière douze compositeurs parmi les plus connus et les plus aimés, tel est le but de ce volume." (Préface). — Table : François Couperin (1668-1733) ; César Franck (1822-1890) ; Johannes Brahms (1833-1897) ; Camille Saint-Saëns (1835-1921) ; Georges Bizet (1838-1875) ; Moussorgski (1839-1881) ; Tchaïkovski (1840-1893) ; Jules Massenet (1842-1912) ; Edward Grieg (1843-1907) ; Isaac Albeniz (1860-1909) ; Giacomo Puccini (1858-1924) ; Gabriel Fauré (1845-1924).
La Grande histoire du cigare.
Flammarion, 1989, in-4° carré, 200 pp, très nombreuses illustrations en noir et en couleurs, dans le texte et à pleine page, reliure toile ocre de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état. Edition originale
Ce livre est un véritable hymne au cigare, source d'un plaisir éphémère et fruit d'un travail patient et méticuleux, d'une longue expérience et de la passion des hommes. Le cigare, synonyme de plaisir raffiné, connaît aujourd'hui un nouvel âge d'or. Ecrit à sa gloire, ce livre retrace l'histoire d'un mythe, raconte à travers les siècles l'épopée du cigare ainsi que les passions et les interdits qu'il a suscités. Des secrets de sa genèse à l'art de le déguster, les auteurs nous initient aux mystères du cigare ; la fabrication reste entièrement manuelle et chaque étape joue un rôle primordial. Ainsi, de même que le tri des raisins à la vendange est indispensable à la réussite d'un grand cru, la sélection des feuilles de tabac à la cueillette est un gage de qualité pour un Havane. La richesse de l'iconographie restitue l'ambiance des plantations, met en lumière les paysages fantastiques formés par les toiles blanches des "tapados" sous lesquelles reposent les feuilles, fait revivre les fabriques du XIXe siècle, immortalise les plus célèbres fumeurs, de Freud à Orson Welles...
Cérémonie tenue à la Bibliothèque nationale de France le 8 juin 1994, en la salle Labrouste (salle de lecture) en l’honneur de l’élection d’Emmanuel Le Roy Ladurie à l’Académie des sciences morales et politiques.
Fayard, 1995, in-8° étroit, 92 pp, broché, couv. rempliée, bon état, exemplaire de la bibliothèque d'Emmanuel Le Roy Ladurie, avec son cachet
Allocutions de Jean Favier, Georges Duby, Georges Le Rider, Jean-Sébastien Dupuit, Patrice Higonnet, Jacqueline Sanson, Alain Peyrefitte, Pierre Chaunu, et remerciements d’Emmanuel Le Roy Ladurie.
Le Territoire de l'historien.
Gallimard, 1973, in-8°, 542 pp, broché, couv. à rabats, bon état (Coll. Bibliothèque des Histoires)
"L'ouvrage ne souffre d'aucune monotonie, malgré son niveau hautement scientifique. Il offre l'image même de la vie. Les contributions qu'il réunit appartiennent à des genres assez divers : on y rencontre de simples comptes rendus (ex. « Clio en enfer », p. 408, à propos des sorcières) mais surtout des recherches originales. On s'étonne un peu que cet ensemble fort cohérent s'achève sur un problème de « cuisine » intérieure, propre aux historiens (discussion sur la nécessité de la thèse, sur son volume, etc.). D'autant que la matière de l'ouvrage est, par ailleurs, très correctement répartie en quatre séries : 1. Rôle (nouveau) du quantitatif et de l'ordinateur en histoire. 2. Histoire rurale, de la fin du Moyen Age à 1800. 3. Démographie historique. 4. Le climat et son rôle dans l'histoire des hommes. On devine la richesse de semblables recherches. Et l'on peut être assuré que l'intérêt du lecteur ne faiblirait jamais." (Jean Lhomme, Revue économique, 1976) — Dix années de recherches, personnelles ou collectives, de l'historien Emmanuel Le Roy Ladurie sont présentées ou condensées dans ce livre. L'auteur commence par expliciter la méthode quantitative afin de mieux l'appliquer à des domaines très divers : histoire des métaux précieux d'Amérique, stature des conscrits du bon vieux temps, etc. En même temps, il considère les mouvements d'ensemble de l'historiographie française la plus récente parmi lesquels s'inscrit son aventure personnelle. Plusieurs enquêtes ponctuelles, à base d'ethnologie historique, s'attaquent à des problèmes tels que l'événement, la coutume, le folklore, la sorcellerie, la mort et la contraception. Le recueil s'achève sur une vision fraîche et renouvelée de la météorologie des siècles obscurs, avec leurs fluctuations climatiques. Dans cette œuvre qui se veut à la fois charnelle et savante, descriptive et méthodologique, l'auteur a eu le souci constant de traiter les faits sociaux comme des choses, et d'insérer l'homme, éventuellement quantifié, dans un environnement géo-historique, biologique, voire purement physique. (L'Editeur)
Le Territoire de l'historien, II.
Gallimard, 1978, in-8°, 449 pp, broché, état correct (Coll. Bibliothèque des Histoires)
Si grande est aujourd'hui la vitesse apparente ou réelle du changement social qu'on a peine à se représenter la société d'autrefois qui changeait peu et lentement, et retrouvait, dans ses transformations mêmes, l'essentiel de ses acquis antérieurs. Ce second volume du Territoire de l'historien, solidement appuyé sur la mise en place d'une «histoire immobile», interroge et sollicite le lecteur sur les thèmes de «longue durée» que définit chacune des parties : le corps, les champs, les systèmes sociaux. Constances, permanences : elles concernent psychologiquement, par exemple, cette angoisse qui tourne autour d'un rite de castration symbolique tel que l'«aiguillette» ; elles caractérisent aussi, médicalement, l'encerclement de la planète par les bacilles, du XIVe au XVIIIe siècle, que décrit «l'unification microbienne du monde». De même, ordinateur en main, Le Roy Ladurie analyse de très près le véritable et durable fossé qui, de Louis XIV à Napoléon III, sépare, sous le nom de ligne Saint-Malo-Genève, la France sous-développée et donc physiquement rabougrie, celle du Sud, du Centre et de l'Ouest, et la France déjà modernisée du Nord-Est. Pour sortir de cette situation, des tentatives inégalement réussies se sont fait jour, qu'elles viennent des Bretons, des Occitans ou des Aveyronnais : elles sont ici longuement examinées. Le regard d'éternité précise que jette sur lui-même le villageois (bourguignon) d'autrefois, en la personne d'un grand écrivain, Rétif de La Bretonne, est aussi largement évoqué par l'historien que celui que pose Saint-Simon sur «le système de la cour» ou, sur le peuple dauphinois, le Balzac du Médecin de campagne. Un aperçu général de la crise complète enfin ces tableaux d'histoire immobile, la vraie crise historique, celle des Invasions barbares ou de la fin du Moyen Age, celle du XVIIe siècle ou... la nôtre : ainsi l'auteur raccroche-t-il au présent un passé souvent lointain, en même temps qu'il signale quelques-unes des voies vers lesquelles s'avance aujourd'hui l'histoire d'avant-garde.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers