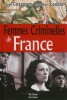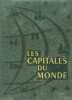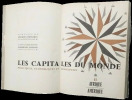Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
17th (3)
18th (13)
19th (252)
20th (2116)
21st (264)
-
Syndicate
ILAB (2656)
SLAM (2656)
L'avènement des loisirs, 1850-1960.
Aubier, 1995, gr. in-8°, 470 pp, 24 pl. d'illustrations en noir et en couleurs, notes, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état
Comment se sont créés les usages modernes du temps libre ? Comment le désir de voyage, la soif d'aventures et de sensations nouvelles, les divertissements de la foule, le besoin de quiétude et de découverte de soi se sont-ils combinés à l'accélération des rythmes de vie ? Telles sont les questions auxquelles entend répondre cet ouvrage conçu et coordonné par Alain Corbin, avec des contributions de Julia Csergo, Jean-Claude Farcy, Roy Porter, André Rauch, Jean-Claude Richez, Léon Strauss, Anne-Marie Thiesse, Gabriella Turnaturi et Georges Vigarello.
CORBIN (Alain), Noëlle GÉRÔME et Danielle TARTAKOWSKY (dir.).
Reference : 1439
(1994)
ISBN : 9782859442484
Les usages politiques des fêtes aux XIXe-XXe siècles. Actes du colloque organisé les 22 et 23 novembre 1990 à Paris.
Publications de la Sorbonne, 1994, gr. in-8°, 440 pp, biblio, broché, couv. illustrée, bon état. 30 études érudites
L'usage politique des fêtes. En mettant l'accent sur l'instrumentalisation, la formule choisie laisse supposer l'existence préalable, hors de la sphère du politique, d'un tissu d'émotions festives, d'une liesse collective, offerts à la conquête et à la captation. Cependant y eût-il jamais fête pure de toute politique ? Les auteurs se proposent d'étudier la gestion de la mémoire, le réseau des références historiques partagées dans la commémoration, la célébration, l'exaltation, la vindicte ou l'anathème. Ils analysent l'expression des valeurs qui fondent la portée pédagogique ou militante de l'événement, ainsi que sa dimension utopique. Ils tentent de repérer la genèse des emprunts, l'intensité des réaménagements, l'originalité des assemblages.
Temps cyclique et gnose ismaélienne.
Berg International, 1982, gr. in-8°, 208 pp, broché, couv. illustrée à rabats, qqs annotations et soulignures stylo, sinon bon état
"Ce volume regroupe le texte de trois conférences déjà anciennes (respectivement de 1952, 55 et 56), et rééditées à l’intention d’un public plus vaste. Le thème général en est la perception du temps dans la pensée gnostique iranienne (mazdéenne) et musulmane (ismaélienne). La question et ses implications sont bien sûr immenses. La philosophie et l’ethnologie contemporaines ont souligné combien la conception quantitative du temps, découpé en heures et en jours, n’est qu’une vision parmi d’autres dont se servent les humains pour se situer dans leur devenir, et que bien des peuples et des courants de pensée ont une approche beaucoup plus complexe de l’évaluation du changement. C’est à explorer les rythmes de certaines autres façons de vivre la durée, que s’est attaché ici Henry Corbin. (...) Au cours de ces développements d’une ampleur intellectuelle et d’un mouvement parfois magistraux, Henry Corbin donne au lecteur de pénétrer dans des mondes mentaux, intégrant « quelque chose comme une autre dimension encore », et cette impulsion même vers l’exploration des « formes de l’esprit » en Iran est aussi un des apports les plus féconds du livre." (Pierre Lory, Bulletin critique des Annales islamologiques, 1986)
Les Invalides de la Marine, une institution sociale sous Louis XIV. Son histoire, de Colbert à nos jours.
P., Société d'Editions géographiques, maritimes et coloniales, 1950, in-8°, 254 pp, broché, bon état
Sur l'assistance aux gens de mer. — "Expliquer les caractères originels, puis les enrichissements successifs, tant de la pension elle-même que de l'Etablissement des Invalides de la Marine, c'est définir l'attitude que les divers gouvernements de notre pays ont été amenés, par l'évolution des idées et des faits, à prendre envers les navigateurs de nos côtes. La petite histoire d'une Caisse dont l'existence est totalement ignorée de la masse des Français reflète ainsi de près l'histoire maritime, et par l'intermédiaire de celle-ci, l'histoire générale. Le sujet traité est à maints égards aride, presque hermétique ; il ne laisse pas cependant de présenter quelque attrait pour l'historien." (Préface)
Les Invalides de la Marine, une institution sociale sous Louis XIV. Son histoire, de Colbert à nos jours.
P., Société d'Editions géographiques, maritimes et coloniales, s.d., in-8°, 254 pp, broché, bon état. Réimpression de l'édition de 1950
Sur l'assistance aux gens de mer. — "Expliquer les caractères originels, puis les enrichissements successifs, tant de la pension elle-même que de l'Etablissement des Invalides de la Marine, c'est définir l'attitude que les divers gouvernements de notre pays ont été amenés, par l'évolution des idées et des faits, à prendre envers les navigateurs de nos côtes. La petite histoire d'une Caisse dont l'existence est totalement ignorée de la masse des Français reflète ainsi de près l'histoire maritime, et par l'intermédiaire de celle-ci, l'histoire générale. Le sujet traité est à maints égards aride, presque hermétique ; il ne laisse pas cependant de présenter quelque attrait pour l'historien." (Préface)
Notre outillage national.
P., Librairie Delagrave, 1917, in-4°, vii-(1)-214-(1) pp, 60 photographies dans le texte, cart. percaline rouge de l'éditeur avec 1er plat polychrome montrant cinq scènes d'activité industrielle (reproduction d'une pièce originale à Sèvres (voir p. 81), cerf-volant monté, construction navale, machine-outil), dos lisse avec titre et fleurons, tranches dorées (Schmitt, graveur), cartonnage lég. sali, bon état
Bel ouvrage didactique composé de nombreuses notices (illustrées de 60 photos) sur les poudreries, les manufactures d'allumettes (p. 41- 55), les manufactures de tabac (p. 57-75), les manufactures de Sèvres et des Gobelins, l'Imprimerie nationale, les télégraphes et téléphones, l'usine d'essais de Billancourt, les constructions navales, etc. Le cartonnage éditeur illustré de motifs en couleurs témoigne bien de la naïve fierté industrielle de l'époque.
Des garages et des hommes. Le siècle du réseau Renault.
Boulogne-Billancourt, Renault, Hervé Gros, 1998, in-4°, 127 pp, préface de Louis Schweitzer, 340 photos en noir et en couleurs, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état
Décembre 1898 : Renault vend ses 12 premières voitures et très vite, des dizaines d'entrepreneurs, artisans et mécaniciens qui à travers toute la France rêvent de l'automobile, s'associent à son aventure. C'est l'étonnante et émouvante épopée de ces hommes que ce livre fait ressurgir à l'aide de documents d'archives pour la plupart inédits. Ce livre est un hommage aux hommes qui ont participé à l'aventure du réseau Renault pendant un siècle.
La France et les Français outre-mer de la première Croisade à la fin du Second Empire.
Tallandier, 1990, fort in-8°, 514 pp, 11 cartes, tableau chronologique, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Du Mississippi au Mékong, de Terre-Neuve à l'île Bourbon, du Levant aux lagons océaniens, de l'Inde des comptoirs à l'Afrique Noire des explorateurs, pendant huit siècles, les Français ont découvert, combattu, commercé, construit, évangélisé, voyagé, conquis, exploité un peu partout dans le monde. Cette longue aventure de la présence française outre-mer, dont la colonisation ne représente qu'un des aspects, les auteurs de cet essai ont voulu la traiter comme une histoire chronologique. Les portraits des acteurs connus ou presque anonymes y alternent avec la relation des événements et l'exposé des politiques... — "Avant sa mort survenue brutalement en 1988, l'éminent spécialiste de l'histoire africaine qu'était Robert Cornevin avait entrepris et rédigé aux deux tiers cet ouvrage que son épouse et collaboratrice a achevé. A la fois précis et clair, de lecture agréable, il se veut le manuel détaillé qui permet de faire revivre l'action des Français outre-mer dans un récit méthodique et événementiel à jour des recherches récentes des historiens. Il était indispensable de faire le point, après une longue période de silence sur cette question que la décolonisation avait rendu tabou, mais en tenant compte des acquis des nombreuses thèses et études approfondies, souvent limitées dans l'espace et/ou le temps qui ont renouvelé profondément cette partie de notre histoire. Robert et Marianne Cornevin ont réussi la gageure de réaliser une telle synthèse, œuvre de vulgarisation intelligente, s'appuyant sur un solide appareil critique (notes, chronologie, bibliographie abondante) et onze cartes simples et claires. L'ouvrage est divisé en onze chapitres chronologiques d'inégale importance, mais qui traduisent bien les différentes étapes de notre histoire coloniale. Chaque chapitre comporte, en dehors de quelques paragraphes sur l'évolution générale (administration des colonies ou économie par exemple), plus ou moins développés selon la période, une revue systématique de chacun des territoires coloniaux de la France. Ces paragraphes de synthèse, bien présentés et bien placés, font que ce morcellement géographique n'est pas un handicap, tout en permettant à chacun de retrouver aisément, dans une table des matières liminaire très détaillée, la colonie qui l'intéresse personnellement en la situant dans l'évolution générale. Il est évidemment hors de question de résumer un tel ouvrage, qui est un excellent manuel, où notre action coloniale est présentée avec un évident souci d'objectivité sereine. Il met d'ailleurs à sa juste place le rôle des hommes, ministres comme Richelieu ou Colbert, explorateurs de Jacques Cartier à La Pérouse et à René Caillé. Ce volume se lit aisément et avec plaisir." (Jean Tarrade, Revue française d'histoire d'outre-mer, 1991)
La Contre-Révolution avant Maurras.
P., La Restauration nationale, 1987, in-8°, 126 pp, biblio, broché, bon état
Le terme de Contre-Révolution renvoie à d’innombrables personnages et a donné lieu à bien des études historiques, spécialement les guerres de l’Ouest. La pensée contre-révolutionnaire en revanche a été beaucoup moins traitée, et souvent de façon réductrice et caricaturale. Les penseurs qui menèrent par la plume la lutte contre les Lumières méritent pourtant d’être redécouverts et connus. C’est de cet héritage intellectuel dont il est question dans cet ouvrage. Son ambition n’est pas d’être exhaustif mais d’inviter à une lecture féconde pour peu qu’on s’intéresse à la bataille des idées qui finalement oriente l’histoire. Dès qu’il entreprit son action politique Maurras s’en revendiqua : « Ma besogne a consisté à tirer un seul mouvement de l’effort contre-révolutionnaire du XIXe siècle, je n’ai presque rien inventé… ». À vrai dire, le maître de l’Action française se montre ici trop modeste car son apport a été essentiel pour faire de cet héritage un effort intellectuel cohérent. N’empêche qu’il y a un devoir de reconnaissance à l’égard de ces penseurs et qu’on peut toujours faire son miel d’une pensée beaucoup plus riche qu’on ne l’a dit. — A. Chénier, Rivarol, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Auguste Comte, Sainte-Beuve, Blanc de Saint-Bonnet, Frédéric Le Play, Fustel de Coulanges, Hippolyte Taine, Ernest Renan, La Tour du Pin, Albert de Mun, Charles Maurras et la Contre-Révolution.
Histoire nationale et notions sommaires d'histoire générale depuis la mort de Louis XIV jusqu'en 1875.
G. Masson, 1887, in-12, iii-551 pp, reliure percaline bleue éditeur. Très bon état
Femmes criminelles de France.
Editions De Borée, 2012, gr. in-8°, 388 pp, très nombreuses photos, portraits et documents d'époque reproduits en noir et en couleurs, chronologies, biblio, reliure cartonnée illustrée de l'éditeur, bon état, envoi a.s. (nom du destinataire biffé)
De 1840 au milieu des années 1990, un panorama de la criminalité féminine française, de Marie Lafarge à Florence Rey en passant par les soeurs Papin, Marie Besnard ou encore Simone Weber. — Le crime au féminin est plus rare que le crime au masculin. Il représente une infime partie des crimes de sang jugés depuis plus d'un siècle et demi dans notre pays. Parfois, à l'issue de son procès, même si sa responsabilité a été démontrée, la criminelle est déclarée non coupable et sort libre du tribunal. Et avant l'abolition de la peine capitale en 1981, la criminelle était rarement condamnée à mort ; quand c'était le cas, la grâce lui était généralement accordée. Le crime au féminin n'est donc pas perçu de la même façon par la société que le crime au masculin. Serge Cosseron et Jean-Marc Loubier dressent ici le portrait de femmes criminelles qui, de la moitié du XIXe siècle aux années 1990, tuèrent par amour, par jalousie, par cupidité, par vengeance ou par désespoir, pour des raisons personnelles ou politiques, ou bien encore sur un coup de folie. S'appuyant sur des archives judiciaires, des récits, des témoignages, des rapports d'expertises médicales et psychiatriques, les auteurs font oeuvre d'historiens en explorant dans sa crudité et sa violence cet univers du crime qui ne cesse, aujourd'hui encore, de fasciner et d'intriguer. Nous croiserons donc des femmes dont les noms sont restés gravés dans les mémoires, telles Simone Weber, condamnée pour avoir dépecé son ex-amant, les soeurs Papin, auteurs d'un double meurtre morbide, Violette Nozière, la parricide des surréalistes, Marie Besnard, la Bonne Dame de Loudun, et beaucoup d'autres encore dont on avait jusque-là oublié les forfaits pourtant fort singuliers... — "Cet épais recueil en hard cover et papier glacé, qui pèse son kilo et demi, bénéficie d'une typo claire, d'un jeu sur les textes en rouge et surtout de reproductions de documents très bien choisis, rarement vus et parfaitement mis en page. De plus, les auteurs insèrent une chronologie résumée très lisible dans le corpus, ce qui replace très bien l'affaire dans son temps. Les affaires sont classés chronologiquement, ici de l'empoisonneuse Marie Lafarge, jugée en 1840, jusqu'à Florence Rey, la compagne d'Audry Maupin, dont le casse pour s'emparer d'armes en 1994, dériva en "virée infernale" qui fit cinq morts. Avec une écriture très maîtrisée, les auteurs évitent le rapport pur et dur et se permettent des développements motivants sur le avant, le pendant et le après. Les têtes d'affiche sont là : Hélène Jégabo, la serial killeuse bretonne condamnée en 1851 pour des dizaines d'empoisonnements, Gabrielle Bompard l'appât du huissier Gouffé, "l'ogresse" Jeanne Weber, Mme Steinheil, Henriette Caillaux qui révolvérisa le directeur du Figaro, les sœurs Papin, Violette Nozière, Violette Morris l'ignoble guestapiste, Pauline Dubuisson, Denise Labbé qui tua sa petite fille sur la demande de son amant, sans oublier "les modernes" dont le souvenir reste encore vif dans notre mémoire comme Valérie Subra, l'appât pour plusieurs hommes victimes de ses deux amis, Nathalie Ménigon d'Action Directe ou Simone Weber la mamie à la meuleuse. Les autres cas moins connus suscitent un intérêt supplémentaire. Comme Mme Caillaux, Mme Hugues, femme de député, révolvérisa en 1885 un homme de scandale. Ce détective privé fut tué dans les locaux du tribunal et le mari Clovis Hugues (qui avait lui-même abattu un homme en duel pour laver son honneur) sauta au cou de sa femme pour la féliciter après son tir. Rachel Galtié, entre 1902 et 1903 empoisonna mari, frère et grand-mère pour toucher des assurances-vie. L'alcoolique baronne de Couvrigny qui couchait avec son fils débile et ses bonnes, fit tuer son mari à coups de fusil. Drame de la misère malgré la particule. L'anarchiste Germaine Berton tua le patron des services de l'Action française tandis que Camille Tharault, femme battue, descendit le champion cycliste Henri Pellisier en 1935 au cours d'un repas entre amis. Même statut pour Yvonne Chevallier qui tue son ministre de mari en 1946. Depuis le film de Chabrol, on connaît le destin de l'avorteuse Marie-Louise Giraud décapitée en 1943 mais moins celui de Germaine Godefroy, dernière femme décapitée en France à Angers en 1949, pour le meurtre à la hachette de son charbonnier de mari. À l'heure de la débâcle en 1940, Cécile Housseau assassine son beau-fils handicapé et l'enterre. Elle sera confondue dix ans plus tard. Si certaines meurtrières furent acquittées (Mme Caillaux, Mme Hugues, Camille Tharault, Yvonne Chevalier) en raison de la mansuétude des tribunaux de l'époque pour leur honneur, Marie Besnard l'a été aussi pour l'accusation de ses treize empoisonnements. Légalement, elle n'est donc pas une criminelle et n'a donc pas sa place dans ce recueil. Ces affaires plus oubliées mais qui n'en ont pas moins provoqué un grand raffut médiatique, nous font prendre conscience combien les auteurs ont développé leur texte avec talent en distillant leurs informations dans des récits passionnants qui intègrent les données psychologiques et historiques. En bonus de l'ouvrage, ils ont ajouté trente-deux faits divers concernant des meurtrières racontés en un texte court et bien fait. On y retiendra le cas, en 1869, de la femme Delpech, baptisée "l'Ogresse de Montauban" accusée d'avoir tué plus de cinquante enfants dont sa fille. Quelque peu différent du cas de Jeanne Weber qui éprouvait une jouissance sexuelle à étouffer ses jeunes victimes, la femme Delpech prenait des enfants en nourrice et se débarrassait d'eux (après un biberon au vitriol et la tête plongée dans l'eau bouillante !) pour continuer à toucher l'argent des pensions de pauvres filles-mères peu regardantes sur le devenir du fruit de leur péché." (Michel Amelin, K-libre, 2012)
L'Europe de 1815 à nos jours. Une histoire et une chronologie commentée.
La Manufacture, 1991, fort gr. in-8°, 672 pp, texte sur 2 colonnes, nombreuses illustrations et cartes, 2 index, broché, bon état
Sous forme de chronologie commentée, cette histoire présente, de 1815 à nos jours, les phénomènes politiques, diplomatiques, sociaux et scientifiques les plus importants qui ont fait et parfois défait chacun des pays d'Europe. Par des commentaires replaçant les évènements les plus importants dans leur contexte national et international, cette chronologie commentée rompt avec l'exposé chronologique traditionnel. Un instrument de référence.
Les Chambres du Sud.
Gallimard, 1981, in-8°, 250 pp, broché, bon état, bande éditeur conservée (Prix Sainte-Beuve 1981), édition originale (il n’est pas annoncé de grand papier), envoi autographe signé de l'auteur daté de décembre 1994
Les débuts romanesques de Laurence Cossé. — Brune, la narratrice, et Beau, son cadet presque jumeau, vivent si liés, si semblables, si sauvages qu'ils se sont créé dès l'enfance un univers à part au sein de leur famille. Le domaine de la vallée du Rhône où ils grandissent est fait de deux bâtisses accolées : la Vieille Maison, où la vie, entre parents et frères et sœurs, va son cours, actif, apparemment sans mystère ; et la Grande Maison, romantique, immense, inoccupée, dont les deux enfants font leur vraie demeure, à l'écart du réel. Ils y dorment, ils y jouent, ils s'y saoulent de lecture et de rêve. De là ils défient le monde, le temps, le sérieux des adultes. L'adolescence vient tout déséquilibrer. Brune, envoyée en pension, se laisse dépérir. On la rend aux siens. Mais l'âge est passé pour elle des refus et des rêves. Elle prend conscience qu'il va lui falloir opter pour la vie, ou sinon appeler par son nom ce ralenti qu'elle tient désespérément depuis des années et s'arrêter à la mort, tellement plus naturelle à son sens que ce qu'il est convenu de nommer la vie. Un étranger de passage sera l'occasion, brutale, de ce choix. L'enfance est violence, mais la fin de l'enfance est drame. Voilà ce que nous dit ce roman, par petites phrases fiévreuses. Une passion qui crée un style et fait vibrer chaque mot.
Pages d'histoire et de guerre.
Plon, 1909, in-12, xl-277 pp, portrait de l'auteur en frontispice, couv. lég. abîmée
L'envers d'un grand homme (le duc de Savoie Victor-Amédée II) ; Le Mariage secret de Madame la duchesse de Berry ; Confession de Deutz; ; Un Prince allemand au service de la France (Bernard de Saxe-Weimar, 1604-1639) ; Mon oncle le général ; Douze ans d'émigration en Autriche ; 1870-1871 : pendant et après les coups de feu.
La Dépêche de Brest. Naissance et avatars d'un journal de province témoin de son temps.
Le Télégramme Editions, 1999, in-4°, 190 pp, 16 photos, 15 fac-similés dont 5 "unes", index, cart. éditeur illustré
Histoire de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Epinal. 125 ans au service de l'économie vosgienne.
Vagney, Gérard Louis, 1991, in-4°, 254 pp, gravures et photos en noir et en couleurs, sources et biblio, cart. éditeur illustré
Contes. Illustrations de Jacques Touchet.
P., L'édition d'Art H. Piazza, 1931, pt in-8°, 292-(4) pp, un frontispice et 17 illustrations bicolores de Jacques Touchet, introduction d'Edmond Pilon, broché, couv. illustrée rempliée, bon état (Coll. Contes de France et d'ailleurs). Exemplaire numéroté sur papier chiffon
Le Romantisme.
Genève, Albert Skira, 1961, in-12 carré (17 x 18), 138 pp, 58 reproductions contrecollées en couleurs, notes, biblio, index des noms, reliure toile écrue de l'éditeur, jaquette illustrée, étui carton, bon état (Coll. Le Goût de notre temps). Edition originale
"Nous présentons dans cet ouvrage le romantisme pictural. Cette révolution décisive de la sensibilité moderne, qui s'épanouit jusqu'au milieu du XIXe siècle, s'étend des brumes shakespeariennes de l'Ecosse aux luminosités de l'Algérie et du Maroc, somptueusement recréées par la palette de Delacroix, magicien de la couleur."
Le communisme.
MA Editions, 1987, gr. in-8°, 275 pp, index (Coll. Les grandes encyclopédies du monde de...)
La Médecine de l'Amérique précolombienne.
P., Editions Roger Dacosta, 1969, in-4°, 351 pp, appendice sur les Codices Mexicains par M. D. Grmek, 12 pl. en couleurs hors texte, 110 illustrations en noir, 14 culs-de-lampe, importante biblio, reliure pleine toile brune décorée de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état. Edition numérotée imprimée sur papier mat luxe
"Ce nouveau volume de la collection d'histoire de la médecine lancée par les Editions Dacosta se recommande par les mêmes qualités que ses prédécesseurs. Disons d'abord qu'il est présenté avec un goût et un soin qui ne sont plus tellement courants et qui en font un ouvrage de bibliophilie. Quant au fond, les médecines de l'Amérique ancienne sont, pour le non-spécialiste, un domaine d'accès aussi difficile que celles de l'Orient, et sont l'objet d'une littérature tout aussi abondante (18 pages de bibliographie dans le présent ouvrage). Le professeur Coury a vaillamment tenté la gageure d'en faire la synthèse. On lui saura gré de l'avoir brillamment gagnée. Si la période précolombienne prend fin stricto sensu le 12 octobre 1492, l'auteur la prolonge en la circonstance jusque vers le dernier tiers du XVIe siècle, c'est-à-dire jusqu'au lendemain de l'arrivée des conquistadores, auxquels sont dus une grande partie des renseignements que nous possédons. D'autre part, loin de se limiter au Pérou des Incas et au Mexique des Mayas et des Aztèques, il s'est employé à faire leur place – dans la mesure des éléments disponibles – à toutes les autres populations de l'Amérique, de l'Atlantique au Pacifique et de l'Alaska à la Terre de feu. Accompagnés de cartes, les deux premiers chapitres sont respectivement consacrés au tableau de l'histoire ethnographique du continent et à l'inventaire des sources. Puis, le professeur Coury aborde les caractères généraux de la médecine dans l'Amérique ancienne et s'attache à préciser l'importance respective de l'instinct et de l'empirisme d'une part, de la magie et de la religion d'autre part : notons que la prédominance des secondes sur les deux premiers n'excluait pas une efficacité telle que dès 1522, Cortès s'opposait à la venue de médecins européens comme inutiles ! Les chapitres suivants ont pour objet : l'anatomie et la physiologie, domaines dans lesquels les Précolombiens ne possédaient que des connaissances simplistes et très élémentaires ; la pathologie générale ; les maladies infectieuses et parasitaires, endémies et épidémies ; les difformités naturelles et déformations provoquées ; la chirurgie, où les Péruviens se sont distingués en matière de trépanation crânienne ; quelques spécialités, telle que la dermatologie, où l'on note souvent des traitements apparemment rationnels ; l'hygiène publique et l'hygiène individuelle, toutes deux assez poussées, avec cette spécialité de l'Amérique centrale et du Nord : les bains de vapeur ; la médecine et les différents âges de la vie ; la profession médicale. Le dernier chapitre – la pharmacopée et ses applications thérapeutiques – n'est pas le moins intéressant quand on sait l'exceptionnelle richesse de la pharmacopée précolombienne. Celle-ci reposait essentiellement sur le règne végétal. La pharmacopée minérale est très limitée, avec toutefois de judicieux emplois du bitume, du goudron et du soufre. Beaucoup plus étendue, la matière médicale animale relève essentiellement de la magie et de croyances sans fondement réel, comme en notre Moyen Age. Les drogues végétales utilisées par les Précolombiens suscitèrent l'engouement des premiers voyageurs et conquérants et alimentèrent dès le XVIe siècle une exportation considérable. Certaines se sont d'ailleurs révélées jusque de nos jours comme d'une efficacité extrême soit en elles-mêmes, soit par les produits qu'on en a extraits. Près du tiers des drogues végétales de nos pharmacopées sont originaires d'Amérique. Les formes thérapeutiques, très variées, ne différaient pas sensiblement de celles en usage sur le vieux continent. Le lavement semble avoir été assez répandu. En revanche, la posologie brille par son imprécision et son absence de rationalité. Après s'être essayé à reconstituer quelques traitements thérapeutiques, le professeur Coury dresse une magistrale synthèse des drogues les plus employées par les Précolombiens, en les classant selon leurs propriétés symptomatiques réelles ou présumées, en en appréciant, si possible, les vertus et en insistant sur les substances végétales particulièrement mises à profit par la médecine européenne. La place nous manque pour résumer ces pages. Elles resteront comme un précieux instrument de référence. Complété par une érudite étude du professeur Grmek sur l'iconogaphie médicale dans les manuscrits aztèques, cet ouvrage mérite de prendre place dans la bibliothèque non seulement de tout curieux d'histoire de la médecine, mais, je dirais, de tout « honnête homme »." (Pierre Julien, Revue d'histoire de la pharmacie, 1970)
Histoire générale de la philosophie depuis les temps les plus anciens jusqu'au XIXe siècle. Douzième édition revue par l'auteur et publiée par M. Barthélemy Saint-Hilaire.
P., Didier, Emile Perrin, 1884, in-8°, vi-613 pp, broché, index, qqs rares et pâles rousseurs
L'imitation des grands destins. La morale de l'exemple.
EPI, 1954, in-8°, 222 pp, 4e édition, index, tables chronologique et anecdotique, broché, imprimé sur papier Caron blanc "Chatelio", bon état
Un ouvrage sur la morale à l'exemple de grands personnages historiques français (de Abélard à Vincent de Paul). A noter in fine un chapitre sur la politesse. L'Académie des Sciences Morales et Politiques l'a couronné au titre de l'ouvrage "le plus apte à faire connaître et aimer la patrie et à faire reculer l'égoïsme et l'envie".
Les Capitales du monde, politiques, économiques et religieuses.
Editions Encyclopédiques Européennes, 1960, 3 vol. in-4°, 427, 329 et 317 pp, complet en 3 volumes, nombreuses photographies en noir et en couleurs, reliure percaline verte éditeur, rhodoïd. Très bon état
Tome 1. Europe. - Tome 2. Afrique, Amérique. - Tome 3. Océanie, Asie.
Le roman indien de langue anglaise.
P., Editions Karthala, 2004, in-8°, 318 pp, liste des romans cités, liste des romans traduits en français, broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s.
Depuis l'Indépendance de l'Inde (1947), les romanciers indiens de langue anglaise brossent une fresque littéraire qui suit l'évolution de la réalité et de l'imaginaire du sous-continent. L'œuvre de Rushdie – et, en particulier ses brillants “Enfants de Minuit” – reste le modèle de cette importante production dans la mesure où l'écrivain exilé a réussi à transformer son pays natal en une fabuleuse "patrie imaginaire" et à utiliser sans complexe l'anglais qui n'est, pour lui, qu' "une voix de l'Inde". Bien d'autres romanciers ont également choisi de s'expatrier, de façon temporaire ou définitive. Depuis Toronto ou Oxford, ces "enfants de Rushdie" traquent une indignité qui les hante en utilisant tous les moyens d'expression classiques du roman moderne (réalisme social chez Rohinton Mistry ou verve satirique chez Upamanyu Chatterjee), mais aussi les innovations du discours post-moderne (recours au fantasmagorique chez Vikram Chanda, perversion de l'histoire événementielle chez Shashi Tharoor et destruction du temps et de l'espace chez Amitav Ghosh)... Certains écrivains privilégient, par contre, une approche moins spectaculaire de la sensibilité indienne. Dans le sillage de l'œuvre de R.K. Narayan (qui brocardait malicieusement une "petite Inde" modeste), de nombreux romanciers (comme Amit Chauduri ou Anita Desai) travaillent, avec finesse, sur des situations modernes de grande intensité psychologique. Les romancières ont très vite pris la parole en proposant, d'abord, des récits d'émancipation précautionneuse, puis, peu à peu, des textes de plus en plus courageux qui restent cependant marqués par un contexte psychologique et social encore inhibant. Le récent Dieu des petits riens d'Arundhati Roy propose, par exemple, un monde au féminin où la dépendance débouche sur la transgression, en une dialectique à la fois poétique et tragique. L'histoire littéraire du roman indien de langue anglaise – que cet essai critique tente de retracer en présentant les œuvres d'une soixantaine d'auteurs – s'inscrit dans le vaste mouvement actuel de la littérature mondiale post-coloniale anglo-saxonne. Il y apparaît comme un modèle incontesté qui a réussi à s'imposer en intégrant les multiples différences de l'Inde plurielle.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers