-
Type
Artists book (1)
Autograph (35)
Book (8667)
Disk (1)
Drawings (1)
Engraving (3)
Magazine (47)
Manuscript (147)
Maps (6)
Old papers (63)
Photographs (3)
Posters (1)
-
Latest
Last 24h (3)
Last 3 days (1)
Last month (95)
Last week (16)
-
Language
Danish (1)
Dutch (1)
English (5)
French (8960)
German (1)
Italian (2)
Latin (4)
Portuguese (1)
-
Century
16th (41)
17th (93)
18th (380)
19th (1091)
20th (2018)
21st (95)
-
Countries
Belgium (1014)
Canada (36)
China (4)
Côte d'Ivoire (12)
France (7541)
Greece (2)
Italy (2)
Netherlands (4)
Switzerland (360)
-
Syndicate
ALAC (33)
CLAM (40)
CLAQ (16)
CNE (56)
ILAB (2604)
NVVA (284)
SLACES (284)
SLAM (2238)
SNCAO (2364)
MISSEL entièrement manuscrit et enluminé composé vers 1860.
Sans lieu ni date ni nom d'artiste vers 1860. In-8 papier fort monté sur onglet 5 feuillets blancs 38 feuillets non chiffrés (soit 76pp, la dernière ornée sans texte) 29 feuillets blancs. Plein maroquin grenat, dos lisse muet, encadrement courant sur le dos et les plats composé de filets guillochés, perlés et continus servant de base à une très large dentelle finement dorée, coupes filetées, grande dentelle dorée sur bordure intérieure, contreplats doublés de moire violet profond, tranches dorées frappées de fleurons, ainsi que des nom et prénoms "Thérèse, Madeleine, Gautier", reliure de l'époque. Le texte, en français, est entièrement calligraphié en beaux caractères gothiques, occupant environ 6cm en largeur et 9cm en hauteur, inscrits dans un encadrement richement orné d'environ 9cm (largeur) sur 12cm (hauteur). Quelques lettrines dorées (volutes, animaux, végétaux), majuscules dorées, certaines sur fond rouge, bleu ciel, vert. Les mots "Dieu", "Jésus", "Seigneur" sont en rouge. Les frises d'encadrement sur fond blanc, bleu nuit, vert, vieux rose, gris-bleu, bleu ciel, grenat, argent et or présentent un décor différent pour chaque page, très joliment et finement composé dans le goût des manuscrits enluminés médiévaux où, parmi des entrelacs de volutes et de végétaux, foisonnent petit peuple d'anges, dragons, bestiaire fantastique, ainsi que Dames parées, Chevalier à bannière, fleurs, animaux, papillons, insectes. Quelques autres décors sont à remarquer: chapelet, barque longeant une côte, paysage nocturne au bord d'un lac et la très romantique évocation d'une tombe sous le Lune, abritée par un saule. On admirera enfin de magnifiques guirlandes de fleurs (certaines sur fond doré) telles que roses, lilas, arum, fuchsia. Sans oublier une grande vignette au centre d'un fin décor de colonnettes dorées, représentant un ange à bannière grenat s'apprêtant à faire tinter une cloche céleste (lettres dorées du texte de la bannière un peu ternies). Nous joignons un signet de soie rouge vif à franges (18cm X 4cm) très gracieusement brodé de fleurettes et de 3 papillons multicolores. MAGNIFIQUE MISSEL MANUSCRIT AUX RICHES ENLUMINURES D'UNE GRANDE FINESSE AYANT CONSERVE TOUTES LEURS FRAICHES COULEURS DANS UNE RELIURE LUXUEUSE, DECORATIVE ET EN BEL ETAT.
Ce livre-bijou unique, portant sur les tranches les nom et prénoms de la personne à qui il était destiné, est particulièrement représentatif des présents offerts, sous le Second Empire, à l'occasion d'une Communion ou d'un mariage.
[Monogrammes].
S.l.n.d., , (vers 1890). Album in-8 oblong (18 x 27 cm) composé d'1 titre peint enluminé et 38 planches décorées de monogrammes et vignettes détourées, chagrin brun, dos muet à nerfs, filets à froid d'encadrement sur les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
Collection d'un amateur dont les initiales G. D. tracées en guise de lettrines ouvrent l'album, réunissant environ 770 monogrammes, initiales, armoiries et vignettes détourés, contrecollés et disposés sur 38 planches enluminées à la plume, au lavis etc. Les monogrammes d'une grande variété, armoriés ou surmontés d'une couronne, sont frappés en relief, en noir ou en couleurs, certains dorés. Chaque planche présente un décor colorié différent en forme d'étoile, de jeu de l'oie, de leporello, un éventail, une couronne, un pont, une oriflamme, ou représente une crypte, une salle de gymnastique ou un portrait ; 3 planches en fin de volume (clown, soleils et buste de Napoléon) n'ont pu être achevées.Certains monogrammes sont identifiés en regard de leur planche où l'on retrouve plusieurs grands noms de l'aristocratie XIXe dont le marquis de Motezemolo, Lord Maitland, la duchesse de Ferdinanda, le prince Ruffo Scilla lieutenant de Vaisseau, la duchesse de Castellane, Mme Lambrecht, la duchesse de Clermont-Tonnerre, le vicomte de Lastic de St Jols, la princesse Mercy d'Argentan, Mister Day, Marianne Cambray d'Igny, Raymond d'Ivernois, la baronne de Caziolis, le comte Clary, Bigot de la Robillardière, Pourtalès de Bussières, Talleyrand Périgord, Lord Maitland, Charles Levi, la duchesse de Bisaccia, Berthe Bochet, Mme Dolfus, la comtesse Waleska, Mme Thiers, la baronne de Rothschild, le comte de Choiseul, la comtesse Ratisbonne, la duchesse de Tarente Mcdonald, Rosellini, le prince Mustapha, la princesse Ypsilanti, Mme Delacroix, la comtesse de Jaucourt, le baron de Pibrac, Massena duc de Rivoli etc. Légers frottements, tache claire au plat supérieur, titre dérelié.
[Montpellier. Livres de comptes manuscrits de Favret (de) St Laurens établis de 1733 à 1741].
, , 1733-1741. Ensemble 4 cahiers manuscrits in-4 brochés.
Livre de la depence de Mr Favret St Laurens commancée le 1er may 1733. Années 1733. 1734 et 1735 jusques au mois de may. In-4 de 68 pp. [Verso du dernier feuillet : Livre de la recepte de Mr Favret St Laurens commancée le Premier may mille sept cents trante et trois. In-4 manuscrit de 5 pp.].J'ay commancé mon tabac a rapé que Lacam ma porté de Paris le 27eme xbre 1731 y compris celuy que j'avais il y a en tout pois de montpellier quinze livres et demy. Mr de Régnac maporte duex carotes tabac faisant pois de montpellier sept livres…Livre de la Depance que Mr Favret de St Laurens a faite depuis le Premier May mille sept cents trante et cinq. Années 1735. 1736. 1737 et 1738. In-4 broché de 78 pp. Titre de départ : Continuation de la depance commancé le Premier May 1733 qui se monte à la somme de deux mille huit cent neuf livres traise sols trois deniers cy [Verso du dernier feuillet : Livre de la recette que Mr Favret de St Laurens a faite commencée le premier may mille sept cents trente trois / jay arraché les deux feules quimanquent a ce registre parce que cestoit la recepte que jay couché pourt un caier qui est dans mon portefeuille]. Livre de la depance que jay faite qui a copmmencé le Premier janvier 1739. [Au verso du dernier feuillet : ce patot contient toutes les dépanses que jay faites depuis le 1er may 1733 et les années suivantes 1734 1735 1736 1737 et 1738.]Fin : La depance que jay faite depuis le premier janvier 1739 jusques au dernier décembre mille sept cents quarante et un se porta à la somme de deux mille neuf cents septante livres cin sols onze deniers. In-4 de (2)-48-(31) pp. Livre des réparations commencées en lannée 1742 continuées et finies en lannée 1744 au mois de septembre. In-4 de (14) ff.
Reference : 99047aaf
Morat / Murten. - Parchemin de 1610: Contrat de vente d’une maison en ville de Morat et de terres à un bourgeois de Berne.
1610, 56x53 cm, parchemin enroulé, belle lettre initiale calligraphiée, écriture de notaire très soignée du XVIIe s., légèrement froissé, sceau (de la ville de Morat) manque, bon état.
Jean Vessa du Chastel dessus (Ober-Burg près de Morat) vend, avec le consentement de sa femme, une maison à Châtel avec jardins, grenier et four contigus (mais sous réserve d’une grange sur ce terrain qu’il a vendu ailleurs et qui sera déplacée) ainsi qu’un grand nombre de prés, champs et bois dans les environs à Symon Würstemberguer, bourgeois et membre du Grand Conseil de Berne, pour la somme de 950 écus et d’un ,clert’ de vin d’une valeur de 36 écus. Date: 4 janvier 1610. Notaire: de Beaulieu. En bas de page, la confirmation de Persone Cramer, femme de Jean Vessa (ou Wissa) pour cette importante transaction de biens. Image disp.

(SLACES, NVVA)
Phone number : 41 (0)26 3223808
Reference : 1068.1aaf

(SLACES, NVVA)
Phone number : 41 (0)26 3223808
Reference : 1067.1aaf
Morges. - Document manuscrit sur parchemin, 1762. Vente de vignes. Jean Jacques Christian Bucher, capitaine, conseiller de Morges, vend à Daniel Dumont de Bussigny, habitant à Morges, environ 827 toises de vigne en deux parcelles au lieudit “aux Reneveires” à Morges pour 8030 florins et en outre 240 florins pour 6 bons chars de fumier de cheval voituré et porté dans ladite vigne et 66 chars de bonne terre pareillement voituré et porté, date du 27.3.1762, signé Sterky. En bas du document: Quittance pour le laud payé de Sigismond d’Erlach, baillif de Morges avec son sceau sous papier et la signature du receveur du baillage,
1762, 23 x 24,5 cm, charte de 27 lignes très lisible avec notice dorsale, fixé sur un carton brun de 30 x 43 cm (A3) dans une mappe en plastique.

(SLACES, NVVA)
Phone number : 41 (0)26 3223808
Reference : 1070.1aaf

(SLACES, NVVA)
Phone number : 41 (0)26 3223808
Reference : 1071.1aaf
Morges. - Document manuscrit sur parchemin, 1809. Vente de maison. Mélusine Pache, fille du citoyen Louis Gamaliel Pache de Morges et Bournens, vend au citoyen Abraham Mercier, négociant de Morges, une maison portant le no. 8, au-dessus de la grande Rue à Morges, avec une cour, tout le mobilier et les vases de cave, daté du 25.9.1809, signé Hugonet. En bas du document: autorisation de Louis Gamaliel pour sa fille de vendre la maison et quittance pour le laud payé.
1809, 21 x 36 cm, charte de 21 lignes avec notice dorsale, sceaux du ct. de Vaud dans le coin gauche supérieur et droit inférieur, fixé sur un carton brun de 30 x 43 cm (A3).

(SLACES, NVVA)
Phone number : 41 (0)26 3223808
Reference : 1386.1aaf
Morges. - Document manuscrit sur parchemin de 1646. Contrat de mariage du secrétaire du baillage de Morges entre Pierre Fenot, ministre du diaconat de Morges, et Aymée, fille de feu Claude de Montricher, en son vivant curial d’Aubonne, avec signature du notaire Forel. Il s’agit de l’exemplaire pour l’époux.
1646, 42.5 x 27.5 cm, charte avec belle écriture du 17e s., première ligne calligraphiée, pliée-

(SLACES, NVVA)
Phone number : 41 (0)26 3223808
Reference : 66866aaf
Murten / Morat. - Handgeschriebene Prozessakte des Distriktsgerichts Murten aus der Zeit der Helvetischen Republik.
1802, in-folio, 25 S. festes handgezogenes Papier mit Wasserzeichen, ‘f’, kein Einb., letzte 3 Seiten lose, äusserste Bl. weisen ein paar Risse auf.
In grosser und gepflegter deutscher Kurrentschrift verfasstes juristisches Dokument in deutscher Sprache betreffend einen Streit zwischen dem Bürger Johannes Werrot und dem Bürger Samuel Fasnacht, beide von Muntelier, um einen Weg im "Grand Praz" bei Murten. Der vorsitzende Richter ist Bürger Girard von Merlach. Auszüge aus dem Gerichtsprotokoll, sowie Augenscheine und ein Zeugnis werden zitiert und das Urteil zugunsten von Werrot bestätigt. Die Gegenpartei erhält das Recht, den Fall an das Kantonsgericht Freiburg weiterzuziehen. Das Dokument ist vom Gerichtsschreiber signiert und mit einem Papiersiegel "REPUB:HELVET:CANT:DE:FRIBOURG" versehen. 2 Seiten tragen den Titel "Freyheit - Gleichheit - Helvetische Republik - ein und untheilbar" und jede Seite mit einem Stempel der Helv. Republik gestempelt. Image disp.

(SLACES, NVVA)
Phone number : 41 (0)26 3223808
Reference : 968
Mélanges héraldiques. Recueils de textes et manuscrits.
1 2 volumes reliés pleine toile rouge, armoiries du Baron Alphonse de Rasse estampées à froid aux plats. 23 x 15,5 cm, paginations diverses. Éditeurs et lieux divers.
Premier volume : - GALESLOOT L., Pierre-Albert et Jean de Launay, hérauts d'armes du duché de Brabant. Histoire de leurs procès (1643-1687). Bruxelles, T.J.I Arnold, 1866. - Collège héraldique et équestre de Belgique. Bruxelles, Lambert Cramm et Cie, impr., 1840. - une lettre autographe signée de M. Chotin et datée du 9 avril 1872, probablement destinée au baron de Coston. - COSTON Baron de. Les Crouy-Chanel et leurs adulateurs. Réponse à M. Germain Sarrut. Paris, Dentu - Montélimar, Chabert, 1864. Envoi de l'auteur. - VAN MALDERGHEM Jean. La Bataille de Staveren, 26 septembre 1345. Noms et armoiries des chevaliers tués dans cette journée publiés pour la première fois. Bruxelles, impr. de P.-J. Leemans et Cie, 1869. - BRUN-LAVAINNE, Le Palais de Rihour. Lille, chez l'auteur, 1835. (rousseurs). Selon volume : - lettre manuscrite du Comte Duchastel sur l'ouvrage du procureur général Lameere. - Titres et noms. Discours prononcé par M. J. Lameere, procureur général, à l'audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1883. Gand, impr. C. Annoot-Braeckman, Ad. Hoste succ., 1883. - Extrait de l'Almanach royal officiel de 1883. Royaume de Belgique. Ministère des affaires étrangères. Noblesse. - Mémoire du Comte Alphonse van de Walle de Breyer [?] sur l'article 75 de la constitution belge. - ROQUE Louis de la, BARTHELEMY Edouard de. Catalogue des Gentilshommes de l'Isle de France, soissonnais, valois, vermandois qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux Assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux Etats Généraux de 1789. Paris, E. Dentu, Aug. Aubry, 1865. - VILLERS-GRANDCHAMPS Max. de. Notice sur la Maison de Moy ou Mouy et la Seigneurie de Chin. Mons, Dequesne-Masquillier, 1883. - FRESSANCOURT Gaston de. Les Maisons souveraines de l'Europe. Origine - Histoire - Généalogie - Onze tableaux généalogiques. Bruxelles, Librairie européenne C. Muquardt, 1876. Très bon état
[Mélanges philosophiques et littéraires. Manuscrit].
, , 1770 circa. Manuscrit in-12 (10 x 16 cm) de (57) ff. à 14 lignes par page, veau brun, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).
Recueil anonyme recopié d'une même main vers 1770 qui comprend Les Cxx qui parlent Conte (fabliau du Moyen-Âge qui connut plusieurs moutures principalement sous le titre Le Chevalier qui fist parler les cons pour aboutir aux Bijoux indiscrets de Diderot), un jugement sur Zaïre de Voltaire, de larges extraits des Remarques sur l'Histoire ainsi que Du fanatisme et l'article "Contradictions” du Dictionnaire Philosophique de Voltaire (première édition 1765), quelques chansons ("En passant par Nanterre revenant de Paris") et aphorismes, enfin un extrait du Mercure de France d'août 1741 intitulé "Quel chaos sur chaque théâtre".Précieux témoignage anonyme et manuscrit d'un lettré à l'âge des Lumières dominé par Voltaire.
Reference : 8474
mémoire pour des tapisseries de toile peinte.
Petit dossier (2 pièces) concernant la fabrication de toile peinte à Paris, faubourg St Antoine; également un mémoire pour décrasser les tapisseries de hautelisse… Très bon
Reference : 8473
mémoire pour un tremeau (sic)
Petit dossier (4 pièces) concernant la fabrication d'un trumeau par un certain Jean Marchant d'Avignon pour M. de Bonnot de La Placette à Bourg St Andiol. Une lettre est datée du 6 septembre 1734. Très bon
Mémoire sur la declaration de Sa Majesté concernant le commerce d'or et d'argent du 20 Janvier 1779.
, , 1779. Manuscrit in-folio broché de (24) pp. (2) f.bl.
Une défense du métier d'orfèvre sous Louis XVI. Commentaire anonyme de la déclaration royale du 20 Janvier 1779 sur le commerce de l'orfèvrerie. « En examinant ces placards on voit clairement que les vues du Prince ont été d'établir le degré de bonté intérieure de l'or et l'argent emploiés aux ouvrages d'orfèvrerie, de donner au public une garantie de la fidélité du titre, et pour cela on a pris toutes les précautions possibles, entre autres le Prince a défendu généralement à tous ceux nétans pas maître orfevre de vendre, et aucuns ouvrage d'or et d'argent pour en faire un commerce mais non obstant ces précautions plusieurs inconveniens se sont glissés dès que d'autres que les maitres orfevres se sont mellé de faire le commerce (…) En fin tout bien considéré, il est évident que ladite déclaration du 20 Janvier 1779, à tout égard est préjudiciable aux corps des orfevres et contraire au bien de l'état (…) ».
Mémoire sur l'armée prussienne
Intéressant mémoire rédigé en 1783, donnant les détails de l'organisation de l'armée prussienne. 70 pages manuscrites très lisibles. Broché Très bon s.l. s. n. 1783 70 pages in-4°, broché.
édition originale
[Nantes. Graduel. Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours. 1696]. Graduel pour toutes les Fêtes de La Vierge ensuitte le Propre des Saincts Apostres Martyrs Confesseurs et Vierges. À l'usage de La Chapelle Nostre Dame de Bon Secours à Nantes.
Nantes, , 1696. Grand in-folio manuscrit (56 x 37 cm) de (2)-220-(6) pp. sur parchemin, index, 8 portées par page à l’encre rouge soulignées par le texte latin à l’encre brune, nombreuses initiales peintes à l’encre rouge, bleue ou dorée, 5 lettrines enluminées, veau brun sur ais de bois, dos à sept nerfs, deux cabochons au centre et quatre pièces d’angle de cuivre, ornés, ciselés et cloués sur chaque plat, traces de fermoirs (reliure de l’époque).
Ce graduel sur parchemin, réalisé à la fin du XVIIe siècle pour la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours de Nantes, est un manuscrit liturgique d'une grande valeur historique. Sa confection est documentée par une inscription mentionnant les prévôts de la Vénérable Confrérie de Notre-Dame-de-Bon-Secours, Michel Thevenin et Julien Renard, sous la supervision desquels le manuscrit fut exécuté :« À Nantes ce présent livre dit Graduel a été fait par les soins de Messieurs Michel Thevenin et Julien Renard, étant alors Prévosts de la Vénérable Confrérie de Notre Dame de Bon Secours sur les Ponts. Escrit et notté par Estienne Sallé voiturier par eau d’Orléans 1696. »Description et contexte.Ce livre de chœur, destiné aux offices de la messe, rend hommage à Notre-Dame-de-Bon-Secours, une figure de dévotion importante à Nantes depuis le XVe siècle. Il contient, outre les graduels, des chants liturgiques comme les introïts et les communions. Les lettrines peintes marquent le début des textes des principales fêtes liturgiques, notamment celles dédiées au Christ, à la Vierge et aux Apôtres. La neuvaine en l’honneur de Notre-Dame-de-Bon-Secours, qui culminait le 21 novembre, constituait le point d’orgue de ce calendrier.Le manuscrit se distingue par ses ornements : deux titres richement encadrés à l’encre bleue, rouge et dorée, dont l’un, en latin, précise sa fonction :« Graduale Pro Omnibus Festivitatibus Beatae Mariae Virginis ad usum Sacelli Beatae Mariae Auxiliatricis. A Nantes, Ce présent livre a été donné par les Sieurs Prevosts de la Vénérable Confrérie de Nostre Dame de Bon Secours en l’an de grâce 1696. Ex scripturaire Stephani Sallé Nature Aurelianensis. »Le scribe Étienne Sallé.L’auteur de ce manuscrit, Étienne Sallé, était un voiturier par eau d’Orléans et un scribe professionnel. Une dédicace en vers, placée en fin d’ouvrage, souligne son rôle :« Ce livre fait par les soins de Messieurs les Prévôts / De cette Confrérie de Bon Secours la Dame / Vous la prierez pour eux par un zèle de flamme (…) POUR ÉTIENNE SALLÉ QUI A ÉCRIT CE LIVRE (…) 1696. »Outre ce graduel, Étienne Sallé est connu pour un journal manuscrit enluminé où il consigna, en 1710, des prières et hymnes religieux. Ce témoignage, publié en 1898 sous le titre Livre de Sallé, charpentier en bateaux et voiturier par eau, éclaire la vie d’un homme pieux marqué par des épreuves personnelles qu’il qualifia de « disgrâces ».La Confrérie et la chapelle/La Vénérable Confrérie de Notre-Dame-de-Bon-Secours, fondée au XIVe siècle par Charles de Blois, avait pour mission de soigner les malades et d’héberger les voyageurs pauvres dans son aumônerie située sur un bras de la Loire, près de Nantes. Elle disparut en 1768, et ses bâtiments furent vendus en 1790 avant leur démolition en 1846.La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, construite en 1443-1444 par les pêcheurs de l’île de la Saulzaie, fut intégralement reconstruite entre 1776 et 1780 dans un style classique. Bien que confisquée comme bien national en 1796, elle conserva jusqu’alors une activité religieuse, notamment grâce à des prêtres irlandais en exil. Malgré sa désaffectation, l’édifice garde des traces de son architecture originelle.Sous l’Ancien Régime, le sanctuaire jouissait d’un soutien royal : Louis XIII à Louis XVI favorisèrent son entretien, notamment par la restauration de la statue de Notre-Dame-de-Bon-Secours. Ce dynamisme cultuel est attesté par des indulgences plénières (1664) et des rapports mentionnant une « foule extraordinaire » lors des pèlerinages, comme en 1721.Conclusion.Le graduel de 1696 témoigne de l’importance du culte marial à Nantes et de la vitalité de la Confrérie de Notre-Dame-de-Bon-Secours à la fin du XVIIe siècle. Cet ouvrage illustre également l’artisanat liturgique et la piété qui animaient des figures comme Étienne Sallé, dont l’héritage religieux et culturel demeure un précieux témoin de son époque.Ex-libris manuscrits anciens « R.J. Uriner chapelain de Notre Dame, de Bon Secours de la Ville de Nantes et Ch[anoi]ne de l’église Royale et Collégiale de Notre Dame de Nantes, 1788 » (premier contreplat) ; « Guillaume Boleyn » (?) en regard du titre ; « François Pépin » et « Mathurin de la Valade » (colophon). Mors fendus, coiffes manquantes, quelques pâles mouillures et salissures marginales.Exceptionnel graduel manuscrit XVIIe conservé dans sa première reliure ornée, archive rare et précieuse pour l’histoire de Nantes.
[Nantes. Journée du 4 mai 1903. Les Pères Prémontrés au Tribunal. Cas du Lieutenant Alphonse de Burgat].
, , 1903. Ensemble correspondances et copies manuscrites, coupures de presse, photographies et cartes postales classées sous enveloppes.
Les archives personnelles d’Alphonse de Burgat, lieutenant chargé du maintien de l’ordre le 4 mai 1903 à Nantes lors de la convocation des Pères Prémontrés au tribunal, offrent un témoignage précieux sur l’un des épisodes marquants de la deuxième vague d’expulsions des congrégations religieuses en France sous la Troisième République.Contexte historique. Cette période est marquée par la politique anticléricale du gouvernement dirigé par Émile Combes. La loi du 4 décembre 1902 renforça les mesures contre les congrégations, prévoyant sanctions financières et pénales pour ceux qui refusaient de se conformer aux fermetures décrétées. À Nantes, cette politique provoqua de vives tensions, particulièrement dans le quartier Saint-Donatien, où les Pères Prémontrés, malgré le refus d’autorisation de leur association religieuse, résistèrent à leur expulsion.Le 4 mai 1903, face à un risque de troubles, le maire de Nantes, Émile Sarradin, sollicita l’intervention militaire pour maintenir l’ordre. Un demi-escadron de cavalerie fut déployé sur la place Louis XVI, sous la supervision du lieutenant de Burgat.L’« Affaire de Nantes » : un épisode controversé. Le lieutenant de Burgat, confronté à une demande verbale d’un commissaire de police d’effectuer une manœuvre sans réquisition écrite, invoqua la stricte observance des règlements militaires, en particulier la loi du 10 juillet 1791. Ce refus suscita un rapport controversé du commissaire de police, contredit par une enquête militaire. Malgré des preuves en sa faveur, de Burgat fut sanctionné le 16 mai 1903 par 30 jours d’arrêt de forteresse, une décision intervenue peu après le retour du général Dupuis à Nantes.Un officier rigoureux et méticuleux. Né en 1862 à Dracy-le-Fort, Alphonse de Burgat avait gravi les échelons militaires avec distinction. Après son engagement en 1880 au 7e dragons, il fut promu lieutenant en 1891 et capitaine en 1903, quelques semaines après les événements de Nantes. Chevalier de la Légion d’honneur en 1905, il servit brièvement lors de la Première Guerre mondiale avant de se retirer pour des raisons de santé. Il décéda en 1917.Burgat conserva soigneusement les pièces relatives à l’« Affaire de Nantes », classées en sept enveloppes chronologiques. Ces documents, qui comprennent des ordres officiels, des rapports, des photographies et des coupures de presse, reflètent sa volonté de préserver une trace détaillée de cet épisode controversé.Un inventaire révélateur. Parmi les documents recensés figurent :La réquisition du maire de Nantes et les ordres militaires liés au déploiement du 4 mai 1903.Des coupures de presse issues de l’Argus de la Presse, retraçant la couverture médiatique de l’affaire.Des photographies historiques, dont des clichés de la place Louis XVI et de la forteresse de Port-Louis, où Burgat purgea sa peine.Une brochure réglementaire sur le maintien de l’ordre, mise à jour en 1893.La correspondance personnelle reçue après sa promotion au grade de capitaine, témoignage de son ascension malgré les événements.Un témoignage sur les tensions entre civils et militaires. Les archives de Burgat éclairent les relations complexes entre autorités civiles et militaires dans la gestion des troubles sous la Troisième République. Elles mettent en lumière les dilemmes rencontrés par les officiers, souvent pris entre la rigueur des règlements et les injonctions politiques locales. Cet épisode illustre également les fractures idéologiques de l’époque, où la lutte contre les congrégations religieuses divisait profondément la société française.Enfin, par leur richesse documentaire, ces archives permettent d’appréhender les réalités quotidiennes du service militaire à une époque de profondes transformations politiques et sociales.
[Nantes. Marie-Julie Jahenny. Manuscrit]. J.M.J. Voyage à Blain. Diocèse de Nantes.
, Onze décembre, 1874. Manuscrit in-8 de 140 pp., demi-basane rouge, dos orné à nerfs (reliure de l'époque).
Un des premiers recueils consacré à la mystique et stigmatisée catholique Marie-Julie Jahenny appelée la Sainte de Blain, contemporain de ses premières visions, établi par le Frère Désiré et Mr Hamon autorisés en 1874 par l'évêque de Nantes « à se rendre à la Fraudaie voir Marie-Julie ».« Tout comme le "Secret" de La Salette, le cas de la "stigmatisée bretonne" Marie-Julie Jahenny (La Fraudaie, Blain 1850-1941) compte sans doute parmi les plus complexes de l'histoire du mysticisme chrétien de la période moderne. Habitante de la Fraudais près de Blain, la jeune Marie-Julie voit la Vierge, l’archange saint Michel et des saints à partir de 1873. Elle aurait connu 3000 extases et reçu des messages de Jésus - transcrits par des tiers, la voyante ne sachant pas écrire, portant les stigmates pendant 68 ans. Marie-Julie Jahenny devient célèbre dès les premières années des manifestations scientifiquement inexpliquées à Blain (dont l'inédit, comme plus tard chez Marthe Robin, Alexandrina da Costa ou Berthe Petit, ou la capacité de la voyante de révéler l'origine de reliques et d'autres objets sacrés sans qu'on lui précise leur provenance).Dans les années 1870 elle bénéficie d'un double appui, étant soutenue du côté spirituel par l'évêque de Nantes Mgr Félix Fournier (1803-1877) et du côté scientifique par le Dr Antoine Imbert-Gourbeyre, professeur à l'École de Médecine de Clermont-Ferrand entre 1852 et 1888. Avant de rencontrer Marie-Julie, Imbert-Gourbeyre s'intéresse déjà à possibilité de mobiliser le phénomène de la stigmatisation au profit de l'apologétique catholique contre les efforts de Jean-Martin Charcot à La Salpêtrière de réduire toute expérience religieuse à l'hystérie et la névrose obsessionnelle. Les deux volumes de son ouvrage Stigmatisation (1873) connaissent un grand succès auprès du public, mais en même temps des réserves de la part du Vatican en raison de son intérêt pour la stigmatisée italienne Palma Matarelli, subséquemment condamnée par le Pape Pie IX en 1875. Imbert-Gourbeyre visite Marie-Julie Jahenny à maintes reprises et conclut qu'il n'y a "pas de fraude à la Fraudais". En 1894 le médecin montferrandais inclut de nombreux détails concernant les phénomènes mystiques à Blain dans une nouvelle édition de ses travaux sous le titre La Stigmatisation, l'extase divine et les miracles de Lourdes: Réponse aux libres-penseurs. » (Prophéties pour notre Temps).Contient : lettre (copie) de Monseigneur Félix, évêque de Nantes, récit de l’extase auquel l’auteur et M. Hamon ont assisté, stigmates de Marie-Julie, récit de son enfance, extrait du journal Le Pèlerin à son propos, lettre (copie) de l’Abbé Durassier de l’évêché de Nantes, lettre imprimée de M. Hamon au Journal des Villes et Campagnes relatant la visite, chant et prière avec musique notée de Marie-Julie, litanies en l’honneur de Sainte Germaine Cousin, (gravures), notice sur Louise Lateau de Bois-d’Haine et extrait de la revue L’Univers du 21 février 1875, 8 lettres (copies) de l’Abbé David, vicaire de Blain et directeur de Marie-Julie Joint (photographie) : Maison de Marie-Julie Jahenny avec la mention manuscrite au dos: « Carte postale bénite chez Marie-Julie (sur ses genoux) par Notre-Seigneur et la très Sainte Vierge pendant l’extase du jeudi 18 mai 1935 ». Dos passé, plat insolé.
[Napoléon III. Berruyer (Rosalie). Manuscrit]. Les Mémoires d'une Bonapartiste, ou le Souvenir de mes voyages en Angleterre. Fait à mon domicile rue de la Reine n°10 Lyon le 25 août 1875. Rosalie Berruyer.
Lyon, , 1875. Manuscrit in-folio (36,5 x 23 cm) de (31) ff. à 29 lignes par page, 2 portraits photographiques contrecollés (7,3 x 11 cm), texte encadré d'un filet rouge, demi-chagrin vert Empire à coins, dos à nerfs orné d'abeilles, double filet doré d'encadrement sur les plats, dédicace en lettres dorées sur le plat supérieur "Au Prince Napoléon", tranches dorées (reliure de l'époque, étiquette "F. Perrin 1 rue Bourbon Lyon").
Précieux mémoires autographes d’une bonapartiste exaltée offerts à Napoléon III exilé en Angleterre «depuis la déplorable journée du 4 septembre(…) Que notre génération à venir sache bien que j’ai fait plus de deux cents lieues pour aller voir nos chers souverains en Angleterre, que j’y suis allée plusieurs fois, je ne leur dis pas le nombre sans compter ceux dont je garde le secret. J’ai assisté à la fête de l’Impératrice Eugénie le quinze novembre 1872. Sa Majesté et son Altesse m’ont fait l’honneur de venir à moi et m’ont reconnue avant que je les reconnaisse moi-même. J’ai assisté aux deux dernières messes auxquelles notre cher Empereur est allé, que je l’ai vu pour la dernière fois le dix huit novembre cinquante trois jours avant sa mort».Curieux manuscrit dressé comme une pièce votive, orné de deux autoportraits photographiques en pied de l'auteur, cuisinière grenobloise résidant à Lyon en 1875, pleine de dévotion pour l’Empereur Napoléon III à tel point que Rosalie Berruyer économisa pour retrouver la famille impériale en exil à Chislehurst, rapporter et publier son témoignage afin d'établir un "culte bonapartiste". « Je désire profondément que les enfants de Napoléon IV sachent qu'une femme de la classe pauvre a aimé leur père et leurs aïeuls de tout son coeur et de toute son âme et que c'est par la route du travail et des préventions qu'elle est allée les voir dans leurs jours de malheur : ce désir me tient bien au coeur et c'est à l'intention des futurs Princes de France que j'ai mis deux de mes portraits dans le manuscrit que j'ai dédié au Prince Louis Napoléon actuellement en exil. Puisse le maître des Nations, des Empereurs et des Peuples bénir les intentions de la plus humble de ses créatures. Je me recommande bien aussi à l'indulgence de mes lecteurs et à leur bonne volonté pour suppléer à tout ce qui manque à mon instruction car je n'ai point reçu d'autres enseignements que ceux que ma mère m'a donnés, elle ne savait que prier Dieu et travailler. » Exemplaire de présent qui porte l'inscription en lettres dorées "Au Prince Louis Napoléon" sur le premier plat, remis à l'empereur Napoléon III accompagné d'une lettre autographe de Rosalie Berruyer en guise de clé : Monseigneur, cet homme si fidèle à l'empereur je n'ai osé le nommer dans mon manuscrit, c'est pour cela j'y joint une feuille volante, c'est avec le plus grand de tous les bonheurs que j'ai l'honneur de dire à votre altesse impériale que j'ai acquis la certitude que Monsieur Faussemagne colonel de ligne vous a gardé sa fidélité et qu'il est bien plus attaché à votre personne qu'à votre titre. Monseigneur j'ai à peu près trouvé ces sentiments chez tous les anciens soldats avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler ; mais surtout chez les douze sapeurs du colonel Faussemagne à Monseigneur : combien votre existence fait des heureux et combien il y en a qui la recommande à Dieu chaque jour. Deux cachets humides couronnés de l'empereur en regard sur la première garde et le premier feuillet (OHR 2659, fer n°15).Le manuscrit fut publié en 1894 à Grenoble sous le titre (inchangé) Les Mémoires d'une Bonapartiste, ou le Souvenir de mes voyages en Angleterre - probablement tiré à très petit nombre : on recense 2 exemplaires à Grenoble (BM) et 1 à la British Library. Un exemplaire vendu en 2015 portait une note manuscrite signée de l'éditeur « Il n'a été tiré que dix exemplaires de cet ouvrage sur papier Hollande. Grenoble, le 10 août 1894 » (Vente Osenat L'Empire à Fontainebleau, 15 novembre 2015, n°56).
Reference : 96539aaf
Neuchâtel. - Document manuscrit. 13 février 1706. Décision concernant la mise en possession de l’héritage de Mme Caterine Rosselet femme de Louis Chaillet du Grand Conseil, pour ses frères David Rosselet et Ezabeau Rosselet femme de David François Rognon, du Conseil de la ville.
22.5 x 33.5 cm, sur 4 pages de deux feuilles pliées en deux.

(SLACES, NVVA)
Phone number : 41 (0)26 3223808
[Normandie. Jonquerets-de-Livet. Manuscrit]. Livre de la Confrairie du Saint Nom de Jésus érigée en la Paroisse de Notre Dame des Jonquerets contenant les status et noms des confrères et des frères et soeurs et associez à la ditte confrairie.
, , 1775-1792. In-folio manuscrit de (40) ff., vélin rigide, serrure, écoinçons, fermoir et serrure métalliques (reliure de l'époque).
S'ensuivent les constitutions, statuts et ordonnances de la Confrairie et Société de la Milice du Sacro Saint Nom de Jésus, datée, fondée et érigée en l'église paroissiale de Notre Dame des Jonquerets au diocèse d'Évreux sous l'autorité et permission de l'illustre et reverendissime Père en Dieu Messire François de Péricard par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique évêque d'Évreux ainsi qu'il est porté au livre de dévotion de ladite confrérie données à Évreux sous le grand sceau du Palais épiscopal le mercredi 4 du mois d'octobre 1654 signée P. de la Mare Lange avec paraphes. François de Péricard (1549-1639) fut Évêque d'Avranches (1588-1639). Statuts et ordonnances de la confrérie mentionnant les différentes obligations de ses membres, les célébrations, messes, prières, processions, les sommes devant être versées, les comportements à suivre en cas de blasphème, etc. Sont consignés à la suite les noms des treize frères servants de la confrérie suivis du catalogue alphabétique des personnes franches de la confrérie à partir de 1775. Fermoir détaché, feuillet de titre troué.Rare témoignage sur la vie d'une confrérie religieuse normande à la veille de la Révolution, conservé dans son vélin à serrure d'origine.
[Normandie. Lallemant de Maupas (Xavier Richard Félix abbé). Manuscrit]. Mémoire des députés du clergé et de la noblesse de la province de Normandie en forme d’observations sur la réponse des officiers du Bailliage de Rouen et des autres juridictions.
S.l.n.d. (Rouen, , 1770). Manuscrit in-4 (22 x 29 cm) à l'encre brune de (10)-251-(3) pp. à 28 lignes par page, veau fauve, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge, double filet doré d'encadrement sur les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
Mémoire de l'abbé Lallemant : Un plaidoyer pour les privilèges du clergé et de la noblesse en Normandie sous Louis XV.Le mémoire manuscrit signé par l’abbé Richard-Xavier-Félix Lallemant, notable ecclésiastique de Rouen, constitue un témoignage significatif des luttes d’influence entre les ordres sociaux sous le règne de Louis XV. Né en 1729 à Rouen, l’abbé Lallemant, également connu sous le nom de Lallemant de Maupas, était un érudit, prédicateur et traducteur. Vicaire général de l’évêque d’Avranches et membre de l’Académie de Rouen dès 1767, il consacra une partie de sa vie à défendre les prérogatives du clergé et de la noblesse face aux revendications croissantes des autres corps sociaux.Le contexte du mémoire. Sous Louis XV, les assemblées de notables à Rouen furent le théâtre de tensions croissantes entre la magistrature et les ordres privilégiés. Alors que les officiers du Bailliage de Rouen contestaient la suprématie traditionnelle du clergé et de la noblesse, ces derniers portèrent leur cause devant le Conseil du Roi. Pour répondre aux objections formulées par les officiers du Bailliage, l’abbé Lallemant rédigea ce mémoire, qui joua un rôle décisif dans l’issue de cette dispute.Le document permit au clergé et à la noblesse de maintenir leurs privilèges dans les assemblées municipales, comme en attestent les Lettres Patentes du 22 février 1770. Ces lettres confirmèrent leur préséance en matière de rang, de suffrages et de signatures, établissant un précédent juridique en faveur des ordres supérieurs, malgré l’édit de juillet 1766, auquel il fallut déroger pour parvenir à cette décision.Un plaidoyer inspiré par Montesquieu. L’analyse de Denis de Casablanca (Montesquieu, p. 527) souligne l’influence des idées de Montesquieu, et en particulier de L’Esprit des Lois, dans l’argumentation de l’abbé Lallemant. Celui-ci rattacha les prérogatives du clergé et de la noblesse aux principes fondamentaux de la monarchie française, insistant sur la nécessité des privilèges et l’importance de l’honneur, piliers du régime monarchique. Il opposa ces principes aux caractéristiques du despotisme, où les pouvoirs intermédiaires, incarnés notamment par la noblesse, n’existent pas.Un manuscrit non imprimé, mais conservé et étudié. Le mémoire ne fut jamais imprimé, mais plusieurs copies manuscrites furent réalisées à l’époque, dont une est conservée à la Bibliothèque Mazarine sous le titre : Prérogatives et dignité du clergé, de la noblesse et de la magistrature. Mémoire des députés du clergé et de la noblesse de la province de Normandie en forme d’observations sur la réponse des officiers du Bailliage de Rouen et des autres juridictions.L’abbé Lallemant : Une figure du clergé érudit. Outre ses activités politiques, Richard-Xavier-Félix Lallemant fut un auteur prolifique, traduisant notamment Les Fables de Phèdre en 1779. Exilé en Angleterre pendant la Révolution française, il retourna à Rouen après la réorganisation de l’Académie de Rouen, qu’il présida à nouveau avant sa mort en 1810.Le mémoire de l’abbé Lallemant demeure un exemple frappant des tensions sociales sous l’Ancien Régime et un témoignage de l’effort intellectuel pour défendre un ordre politique et social en voie de transformation. Cette controverse, bien que secondaire à l’époque, peut être vue comme un prélude aux bouleversements majeurs qui marqueront la fin du XVIIIe siècle.Gaston Lavalley, Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Municipale de Caen, 1880, n°88.
[Normandie. Manuscrit]. Petit office de la Ste Croix ou de Jésus souffrant par le T.V.P. Ignace de Gisors Prédicateur Capucin décédé au Couvent des RR.PP. Capucins de la Ville d'EU le dernier dimanche du mois de septembre en l'année 1657.
Sans lieu , , 1657. Manuscrit in-16 (10,3 x 13,5 cm) de (16) feuillets, vélin souple griffonné à l'encre du temps (reliure de l'époque).
Livre de prières manuscrit portatif établi par le prédicateur Ignace de Gisors décédé en 1657 au couvent des capucins de la ville d'Eu (Seine-Maritime). Ex-libris manuscrits anciens sur la première garde « Ce livre appartient à son maître (…) Jean Michel de (…) 1754 » et en lettres minuscules au verso du dernier feuillet.Ex-libris « E. M. Pelay Rothomag » du célèbre bibliophile rouennais Edouard-Mélite Pelay (1842-1921).
[Normandie. Manuscrit XVIIIe]. Oeuvres diverses de Pe. Hillaire né à Honfleur en 1736 le 14 avril et mort à Guignes-Rabutin le 15 aoust 1763.
Sans lieu ni date, , 1763 vers . In-12 de (7)-80 pp., maroquin rouge, triple filet doré et large dentelle à petits fers sur les plats, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin vert, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l'époque).
Recueil des oeuvres posthumes d'un natif de Honfleur mort à 27 ans de la petite vérole, doué pour la musique, les mathématiques et la poésie, qui réunit vingt-deux épîtres en vers adressées à sa mère, son frère et ses proches (Aminte, Hébert sur sa détention, le chevalier de Sulaville, Leromain, Piron de La Londe, etc.) précédées de la vie de l'auteur et suivies de trois fables : « Pierre Hillaire fils de Pierre Hillaire et de Madeleine Roussel montra dès sa plus tendre jeunesse un génie pénétrant ; il jouait aux dames à l'âge de quatre ans contre d'anciens joueurs et les gagnait. Il passa jusqu'à l'âge de treize ans auprès de son père et sa mère qui n'ayant pas une fortune considérable le destinèrent au commerce qui était leur profession. On l'envoya à Caen pour apprendre les langues étrangères et autres choses nécessaires à l'état qu'il devait embrasser. Il arriva par hasard que le maître qu'on lui choisit ayant fait quelques études dans sa jeunesse avait toujours conservé un goût pour la poésie faisant même d'assez mauvaises chansons. Il en parla à son élève et l'ayant trouvé assez bien disposé lui offrit de lui enseigner les règles de la versification. Le jeune y consentit et s'y livra tout entier. Il ne fut pas longtemps à s'apercevoir que son maître était un ignorant et se mit à lire nos meilleurs poètes avec avidité et développa par lui même les principes que l'autre ne savait que très imparfaitement. Deux ans s'écoulèrent dans ce train de vie, sa famille croyant qu'il devait savoir les choses pour lesquelles on l'avait envoyé le fit revenir. À son retour il apprit l'anglais langue très nécessaire à ceux qui exercent le négoce (…) il apprit aussi la musique, le violon et le violoncelle et ne fut pas longtemps sans faire des connaissances par le moyen desquelles il s'éleva à tous les plaisirs de son âge. Trois ans se passèrent encore (…) il fut à Caen où il resta jusque la fin de sa philosophie (…) il eut d'abord dessein de se faire médecin plutôt par raison que par goût ensuite avocat mais ayant trouvé quelques amis qui lui (montrèrent) l'entrée dans le Ponts et Chaussées il prit ce denier parti et fut à Paris (où) il resta une année après quoi ayant obtenu un contrôle il partit pour faire sa tournée et il est mort en route dans une auberge de Guignes Rabutin le 15 août 1763 de la petit vérole. Il était né à Honfleur le quatorze avril 1736 par conséquent il était âgé de 27 ans (…) ».Très bel exemplaire relié à l'époque en maroquin rouge à dentelle d'un manuscrit inédit du XVIIIe siècle d'une écriture fine qui ne contient que peu de ratures.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers


![[Monogrammes]..](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/44515_1_thumb.jpg)
![[Monogrammes]..](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/44515_2_thumb.jpg)
![[Monogrammes]..](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/44515_3_thumb.jpg)

![[Montpellier. Livres de comptes manuscrits de Favret (de) St Laurens établis de 1733 à 1741]..](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/4598_1_thumb.jpg)
![[Montpellier. Livres de comptes manuscrits de Favret (de) St Laurens établis de 1733 à 1741]..](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/4598_2_thumb.jpg)
![[Montpellier. Livres de comptes manuscrits de Favret (de) St Laurens établis de 1733 à 1741]..](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/4598_3_thumb.jpg)

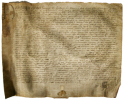



![[Mélanges philosophiques et littéraires. Manuscrit]. .](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/40534_1_thumb.jpg)
![[Mélanges philosophiques et littéraires. Manuscrit]. .](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/40534_2_thumb.jpg)
![[Mélanges philosophiques et littéraires. Manuscrit]. .](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/40534_3_thumb.jpg)
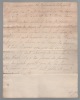





![[Nantes. Graduel. Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours. 1696]. Graduel pour toutes les Fêtes de La Vierge ensuitte le Propre des Saincts Apostres Martyrs ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/41766_1_thumb.jpg)
![[Nantes. Graduel. Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours. 1696]. Graduel pour toutes les Fêtes de La Vierge ensuitte le Propre des Saincts Apostres Martyrs ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/41766_2_thumb.jpg)
![[Nantes. Graduel. Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours. 1696]. Graduel pour toutes les Fêtes de La Vierge ensuitte le Propre des Saincts Apostres Martyrs ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/41766_3_thumb.jpg)
![[Nantes. Journée du 4 mai 1903. Les Pères Prémontrés au Tribunal. Cas du Lieutenant Alphonse de Burgat]..](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/15231_1_thumb.jpg)
![[Nantes. Journée du 4 mai 1903. Les Pères Prémontrés au Tribunal. Cas du Lieutenant Alphonse de Burgat]..](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/15231_2_thumb.jpg)
![[Nantes. Journée du 4 mai 1903. Les Pères Prémontrés au Tribunal. Cas du Lieutenant Alphonse de Burgat]..](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/15231_3_thumb.jpg)
![[Nantes. Marie-Julie Jahenny. Manuscrit]. J.M.J. Voyage à Blain. Diocèse de Nantes. .](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/43785_1_thumb.jpg)
![[Nantes. Marie-Julie Jahenny. Manuscrit]. J.M.J. Voyage à Blain. Diocèse de Nantes. .](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/43785_2_thumb.jpg)
![[Napoléon III. Berruyer (Rosalie). Manuscrit]. Les Mémoires d'une Bonapartiste, ou le Souvenir de mes voyages en Angleterre. Fait à mon domicile rue ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/41561_1_thumb.jpg)
![[Napoléon III. Berruyer (Rosalie). Manuscrit]. Les Mémoires d'une Bonapartiste, ou le Souvenir de mes voyages en Angleterre. Fait à mon domicile rue ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/41561_2_thumb.jpg)
![[Normandie. Jonquerets-de-Livet. Manuscrit]. Livre de la Confrairie du Saint Nom de Jésus érigée en la Paroisse de Notre Dame des Jonquerets contenant ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/44450_1_thumb.jpg)
![[Normandie. Jonquerets-de-Livet. Manuscrit]. Livre de la Confrairie du Saint Nom de Jésus érigée en la Paroisse de Notre Dame des Jonquerets contenant ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/44450_2_thumb.jpg)
![[Normandie. Lallemant de Maupas (Xavier Richard Félix abbé). Manuscrit]. Mémoire des députés du clergé et de la noblesse de la province de Normandie ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/41940_1_thumb.jpg)
![[Normandie. Manuscrit]. Petit office de la Ste Croix ou de Jésus souffrant par le T.V.P. Ignace de Gisors Prédicateur Capucin décédé au Couvent des ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/44526_1_thumb.jpg)
![[Normandie. Manuscrit]. Petit office de la Ste Croix ou de Jésus souffrant par le T.V.P. Ignace de Gisors Prédicateur Capucin décédé au Couvent des ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/44526_2_thumb.jpg)
![[Normandie. Manuscrit XVIIIe]. Oeuvres diverses de Pe. Hillaire né à Honfleur en 1736 le 14 avril et mort à Guignes-Rabutin le 15 aoust 1763..](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/43436_1_thumb.jpg)
![[Normandie. Manuscrit XVIIIe]. Oeuvres diverses de Pe. Hillaire né à Honfleur en 1736 le 14 avril et mort à Guignes-Rabutin le 15 aoust 1763..](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/43436_2_thumb.jpg)
![[Normandie. Manuscrit XVIIIe]. Oeuvres diverses de Pe. Hillaire né à Honfleur en 1736 le 14 avril et mort à Guignes-Rabutin le 15 aoust 1763..](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/43436_3_thumb.jpg)

