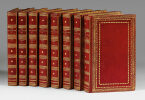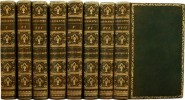Librairie Camille Sourget
93, Rue de Seine
75006 Paris
France
E-mail : contact@camillesourget.com
Phone number : 01 42 84 16 68Phone number : 06 13 04 40 72
Fax number : 01 42 84 15 54
-
Syndicate
ILAB (578)
SLAM (578)
Sensuit le labyriht de fortune et Sejour des trois nobles dames Composé par lacteur des Regnards traversans et loups ravissans surnomme le traverseur des Voyes périlleuses.[A la fin] : Cy finist le Labyrinthe de fortune et séjour des trois nobles dames... Nouvellement imprimé à Paris par Philippe le Noir libraire et relieur... demourant en la grant rue Saint Jacques a lenseigne de la Rose blanche couronnee. Rare première édition parisienne du Labyrinthe de Fortune
Précieux exemplaire cité par Tchemerzine, ayant appartenu au baron Seillière puis à Marcel Bénard, et ayant figuré à l’exposition Dix siècles de Livres français en 1949. Paris, Philippe le Noir, s.d. [c. 1526]. Petit in-4 gothique de (4) ff. prél. titre compris, (145) ff., 1 mm. de la marge bl. sup.du titre a été anciennement renforcé sans manque. Maroquin rouge, somptueux décor à la fanfare sur les plats, armes frappées or au centre, dos à nerfs richement orné, double filet or sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées sur marbrures. Reliure signée Belz-Niedrée. 187 x 132 mm.
Précieuse édition gothique de la plus grande rareté, la première parisienne, de ce poème allégorique composé par Jean Bouchet en l’honneur d’Artus Gouffier, seigneur de Boissy, duc de Roannais mort à Montpellier en mai 1519. Brunet, I, 1157 ; Tchemerzine, II, 34-35. Dédié à Madame Marguerite, sœur de François Ier, l’ouvrage s’ouvre sur un panégyrique de Gouffier, ancien gouverneur de François Ier, grand maître de France en 1514 et protecteur influent du poète. Sous le couvert d’une allégorie très raffinée Jean Bouchet brosse ensuite un tableau saisissant de cet étrange labyrinthe de fortune dans lequel puissants, fortunés et jouisseurs festoient allégrement avant d’être précipités dans d’âpres tourments. « Aultres estoient plains de ieux et de esbas De passetemps et de amoureux combas Aultres estoient plains de tables couvertes Ou lon veoit viandes descouvertes Et plusieurs mectz garnis de vins exquis Autant plus qu’il n’est es gens requis... Tous lesquels gens au son des instruments Prevoyent soulas et grans esbatemens... Rians chantans & prenans leurs plaisirs Et iouissans de leurs humains désirs... » Dans une fine analyse psychologique et sociale le procureur de Poitiers convie le lecteur à un tableau haut en couleurs des différents états de la société du temps. Remontant aux origines du monde Bouchet dresse ensuite un tableau des révolutions des empires et termine par « Le Dialogue des doctrines véritables », dispute en 26 rondeaux, sur l’utilité et l’abus des sciences. La vraie béatitude ne pourra être atteinte qu’avec l’appui des trois nobles dames : Foi, Espérance et Charité. Jean Bouchet (1476-1557), poète et historien poitevin, fut le dernier des grands rhétoriqueurs. C’est à Poitiers que son Labyrinthe de fortune vit le jour (1522, puis 1524) avant d’être imprimé à Paris par Philippe le Noir en 1526 (la présente édition). Très rare édition mal décrite par Tchemerzine qui cite pourtant le présent exemplaire (c’est d’ailleurs le seul qu’il cite) mais indique par erreur une figure au recto du dernier f. Le titre, imprimé en rouge et noir, est orné d’une grande lettrine et de la marque de Philippe le Noir. Très bel exemplaire, le seul cité par Tchemerzine, revêtu par Belz d’une somptueuse reliure à la fanfare ornée des armes du baron Seillière (1890, n°444). Des bibliothèques du baron Seillière (armes au centre des plats) et Marcel Bénard avec ex libris (cat. 1925, n°56). Le présent exemplaire a en outre figuré à l’exposition Dix siècles de Livres français (Lucerne, 1949, n°90) et il est le seul cité par Tchemerzine.
Sensuit le labyriht de fortune et Sejour des trois nobles dames Composé par lacteur des Regnards traversans et loups ravissans surnomme le traverseur des Voyes périlleuses. [A la fin] : Cy finist le Labyrinthe de fortune et séjour des trois nobles dames... Nouvellement imprimé à Paris par Philippe le Noir libraire et relieur... demourant en la grant rue Saint Jacques a lenseigne de la Rose blanche couronnee. Rare première édition parisienne du Labyrinthe de Fortune de Jean Bouchet.
Précieux exemplaire cité par Tchemerzine, ayant appartenu au baron Seillière puis à Marcel Bénard, et ayant figuré à l’exposition Dix siècles de Livres français en 1949. Paris, Philippe le Noir, s.d. [c. 1526]. Petit in-4 gothique de (4) ff. prél. titre compris, (145) ff., 1 mm. de la marge bl. sup.du titre a été anciennement renforcé sans manque. Maroquin rouge, somptueux décor à la fanfare sur les plats, armes frappées or au centre, dos à nerfs richement orné, double filet or sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées sur marbrures. Reliure signée Belz-Niedrée. 187 x 132 mm.
Précieuse édition gothique de la plus grande rareté, la première parisienne, de ce poème allégorique composé par Jean Bouchet en l’honneur d’Artus Gouffier, seigneur de Boissy, duc de Roannais mort à Montpellier en mai 1519. Brunet, I, 1157; Tchemerzine, II, 34-35. Dédié à Madame Marguerite, sœur de François Ier, l’ouvrage s’ouvre sur un panégyrique de Gouffier, ancien gouverneur de François Ier, grand maître de France en 1514 et protecteur influent du poète. Sous le couvert d’une allégorie très raffinée Jean Bouchet brosse ensuite un tableau saisissant de cet étrange labyrinthe de fortune dans lequel puissants, fortunés et jouisseurs festoient allégrement avant d’être précipités dans d’âpres tourments. «Aultres estoient plains de ieux et de esbas De passetemps et de amoureux combas Aultres estoient plains de tables couvertes Ou lon veoit viandes descouvertes Et plusieurs mectz garnis de vins exquis Autant plus qu’il n’est es gens requis... Tous lesquels gens au son des instruments Prevoyent soulas et grans esbatemens... Rians chantans & prenans leurs plaisirs Et iouissans de leurs humains désirs...» Dans une fine analyse psychologique et sociale le procureur de Poitiers convie le lecteur à un tableau haut en couleurs des différents états de la société du temps. Remontant aux origines du monde Bouchet dresse ensuite un tableau des révolutions des empires et termine par «Le Dialogue des doctrines véritables», dispute en 26 rondeaux, sur l’utilité et l’abus des sciences. La vraie béatitude ne pourra être atteinte qu’avec l’appui des trois nobles dames: Foi, Espérance et Charité. Jean Bouchet (1476-1557), poète et historien poitevin, fut le dernier des grands rhétoriqueurs. C’est à Poitiers que son Labyrinthe de fortune vit le jour (1522, puis 1524) avant d’être imprimé à Paris par Philippe le Noir en 1526 (la présente édition). Très rare édition mal décrite par Tchemerzine qui cite pourtant le présent exemplaire (c’est d’ailleurs le seul qu’il cite) mais indique par erreur une figure au recto du dernier f. Le titre, imprimé en rouge et noir, est orné d’une grande lettrine et de la marque de Philippe le Noir. Très bel exemplaire, le seul cité par Tchemerzine, revêtu par Belz d’une somptueuse reliure à la fanfare ornée des armes du baron Seillière (1890, n°444). Des bibliothèques du baron Seillière (armes au centre des plats) et Marcel Bénard avec ex libris (cat. 1925, n°56). Le présent exemplaire a en outre figuré à l’exposition Dix siècles de Livres français (Lucerne, 1949, n°90) et il est le seul cité par Tchemerzine.
Esope à la cour, Comédie héroïque. Esope à la cour de Boursault
Rare édition originale posthume d’Esope à la cour de Boursault, exemplaire très pur conservé dans sa reliure de l’époque. Paris, Damien Beugnié, 1702.In-12 de (10) ff. le premier blanc, 97 pp., (1) p.bl., (1) f. bl. Relié en pleine basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coupes décorées, tranches jaspées. Reliure de l’époque.160 x 90 mm.
Rare édition originale posthume de cette comédie de Boursault qui fut représentée pour la première fois après sa mort, en 1701. Bulletin Morgand et Fatout 6512 ; Catalogue Gui Pellion 482. « Boursault (1638-1701) est un de ces auteurs dramatiques qui, au XVIIe siècle, eurent de la vogue à défaut de gloire, et dont quelques productions sont encore estimées aujourd’hui. Lorsqu’il vint à Paris en 1651, il ne savait encore que le patois de sa province : quelques années après, il était devenu un écrivain assez remarquable pour qu’on le chargeât de composer un livre destiné à l’éducation du Dauphin. Boursault plaisait par les qualités du cœur aussi bien que par celles de l’esprit ; son caractère franc et ouvert lui fit beaucoup d’amis. Il fut lié avec la plupart des gens de lettres ses contemporains, si l’on en excepte Molière». Ésope à la cour est une comédie en 5 actes et en vers à l’esprit vif, au comique franc et au style naturel. S’il était un protégé du roi, l’auteur d’Esope à la cour dû retirer quelques passages de sa pièce qui contenaient des allusions injurieuses à l’égard de Louis XIV. « Esope à la cour, en cinq actes, fut représentée après la mort de Boursault, en 1701. Boursault l’avait écrite aussitôt après ‘Esope à la ville’, mais son sujet la fit interdire par la censure. Quand finalement l’autorisation de la faire représenter fut accordée, l’auteur était mort. Dans cette comédie, Esope a réussi à se faire admettre à la Cour, et naturellement, il trouve matière à exercer son ironie et sa sagesse à l’égard des innombrables côtés ridicules et des vices des courtisans. Montesquieu a déclaré qu’après avoir assisté à la représentation d’Esope à la Cour, il éprouvait le besoin de devenir un homme de bien. » (Dictionnaire des Œuvres, II, 684). Il y a en fait eu deux tirages différents en 1702, l’un à l’adresse de Damien Beugnié, l’autre à celle de la Veuve de Clément Gasse. « Cette œuvre, d’une haute portée, ne fut représentée que le 16 décembre 1701, après la mort de l’auteur, ce qui empêcha celui-ci d’y mettre la dernière main... » (V. Fournel, Les contemporains de Molière, p.95). L’œuvre est dédiée à Madame de Villequier, Françoise Angélique de la Mothe-Houdancourt, née en 1650 et mariée à Louis-Marie-Victor, Duc d'Aumont et Marquis de Villequier. Louis-Marie-Victor d'Aumont, l’un des plus zélés serviteurs de Louis XIV, se distingua dans la campagne de Flandre. La sœur de Madame de Villequier, Charlotte-Eléonore de la Mothe-Houdancourt était gouvernante de Louis XV. Les liens entre l’auteur et la marquise de Villequier sont évidents puisque Louis XIV avait proposé à Boursault de devenir sous-précepteur de son fils alors que la sœur de Madame de Villequier était la gouvernante de Louis XV. Enfin, Boursault évita à l’une de ses pièces d’être censurée en 1690 grâce à l’appui du Duc d’Aumont. Esope à la cour permit à son auteur de remettre la fable au goût du jour et d’élever quelques objections à la personne de Louis XIV. Bel exemplaire grand de marges de cette rare comédie, conservé dans sa pleine reliure de l’époque. Nos recherches nous ont permis de localiser des exemplaires de ce tirage dans 3 Institutions publiques françaises : à la B.n.F., à la Bibliothèque de Rennes et à celle de Paris Sorbonne. L’exemplaire conservé à la B.n.F. présente cependant une collation différente du notre et il ne comporte pas le très intéressant Privilège du Roy qui occupe 3 pages de notre exemplaire et où l’on apprend que c’est Michelle Milley, la veuve du Sieur Boursault, qui désira faire imprimer cette pièce après la mort de son mari. Ce Privilège, daté du 22 janvier 1702, nous apprend également que la veuve de Boursault a cédé son droit à la veuve de Clément Gasse et à Damien Beugnié, Libraires à Paris, le 1er février 1702.
La Metamorphose des yeux de Philis, changez en astres. Pastoralle. Représentée par la Troupe Royale, Et mise au Theatre, par M. Boursault. Rare édition originale de la pièce la plus rare du théâtre de Boursault
Edition originale de la pièce la plus rare de Boursault. Exemplaire de dédicace relié en maroquin bordeaux de l’époque armorié. Paris, N. Pepingué, 1665.In-12 de (2) ff., (10) ff., 46 pp., (2) ff.bl. Annotations manuscrites sur la garde blanche. Relié en plein maroquin bordeaux, plats richement ornés d’un double encadrement de filets et d’une roulette dorés, grandes initiales « C » entrelacées et couronnées aux angles au sein d’un motif de palmes dorées, grandes armes frappées or au centre, dos à nerfs richement orné, coupes décorées. Reliure de l’époque. 146 x 82 mm.
Rare édition originale de la pièce la plus rare du théâtre de Boursault, qui fut représentée sur le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne en 1665. Brunet, I, 1183. Pour cette comédie en trois actes et en vers, « l’auteur a puisé son sujet dans le poème de l’abbé de Cerisy. Pour se venger de la préférence que Philis accorde à Daphnis, Apollon empoisonne l’eau d’une fontaine où ces deux amans doivent aller boire. Daphnis y trouve la mort, et Philis, emportée par les vents, revoit son berger dans l’Olympe, où Jupiter les unit, et change en astres les yeux de la Bergère. Le caractère des deux amants offre un mélange de tendresse et de naïveté, de naturel et de sensibilité... » (Annales dramatiques ou Dictionnaire général des théâtres, p. 591) « Boursault (1638-1701) est un de ces auteurs dramatiques qui, au XVIIe siècle, eurent de la vogue à défaut de gloire, et dont quelques productions sont encore estimées aujourd’hui. Lorsqu’il vint à Paris en 1651, il ne savait encore que le patois de sa province : quelques années après, il était devenu un écrivain assez remarquable pour qu’on le chargeât de composer un livre destiné à l’éducation du Dauphin. Boursault plaisait par les qualités du cœur aussi bien que par celles de l’esprit ; son caractère franc et ouvert lui fit beaucoup d’amis. Il fut lié avec la plupart des gens de lettres ses contemporains, si l’on en excepte Molière ». Précieux et bel exemplaire de dédicace relié en maroquin bordeaux à fine dentelle de l’époque, aux armes et aux chiffres du marquis de Castelnau, le dédicataire de la pièce. Il provient de la célèbre collection Soleinne « Exemplaire de dédicace. – Cette pièce, dont Boileau s’est tant moqué, et qui est imitée d’un poème de Cerisey, parait être la plus rare du théâtre de Boursault ». (Collection Soleinne, I, n°1357). Jacques de Castelnau (1620-1658), marquis de Castelnau, petit-fils de Michel de Castelnau, est un aristocrate et militaire français du XVIIe siècle. Il se distingue pendant la guerre de Trente Ans en tant que lieutenant général des armées du roi en Flandres, et est élevé à la dignité de maréchal de France en 1658. Provenance : collection Soleinne.
Eloges poétiques. Edition originale des « Eloges poétiques » de Brébeuf
Conservée dans sa fine reliure de l’époque. Paris, Antoine de Sommaville, 1661.In-12 de (1) f.bl., (5) ff., 162 pp. Bandeaux, culs-de-lampe et nombreux petits fleurons gravés sur bois. Exemplaire rogné un peu court dans la marge latérale, à certaines pages au raz des manchettes. Relié en plein veau granité de l’époque, dos à nerfs richement orné, coupes décorées, tranches mouchetées. Reliure de l’époque. 145 x 81 mm.
Édition originale de ce beau recueil de panégyriques du célèbre poète normand Georges de Brébeuf. Brunet, I, 1215. Le présent ouvrage comporte des pièces poétiques circonstanciées : ‘Sur le mariage du Roy’, ‘A Monseigneur le Cardinal Mazarin. Panégyrique de la paix’, ‘Sur la maladie et la guérison de Monseigneur le Cardinal Mazarini’, ‘Histoire de la dernière campagne du Roy, en l'Année 1658’, ‘A Monseigneur Foucquet, procureur général au Parlement de Paris, Sur-Intendant des Finances et Ministre d'Etat’, ‘Pour la Reyne de Suede’... «C’est dans les ‘Eloges poétiques’ et dans les ‘Entretiens solitaires’ que Brébeuf montre le plus de qualités personnelles; c’est pour lui l’époque de la maturité, et si nous retrouvons dans ces poèmes les défauts déjà signalés, un goût trop marqué pour l’emphase, l’hyperbole, l’antithèse, jamais son inspiration n’a été plus forte, sa phrase plus vigoureuse, plus pleine et plus sonore, son vers mieux rythmé. Ces deux ouvrages offrent des caractères communs, qui les rapprochent l’un de l’autre et leur assurent une place à part dans l’œuvre de Brébeuf. Les ‘Eloges’ sont des panégyriques; ce genre, à la fois lyrique et épique, avait de quoi éveiller l’ardente imagination du poète; il célèbre les grands événements contemporains, la prodigieuse fortune et la gloire de Fouquet et de Mazarin, les exploits du roi et de son armée, les bienfaits de la paix que négocie le ministre; il prend ainsi sa part de la joie et de la prospérité du pays; mais toutes ces pièces et surtout celles qu’il adresse à l’évêque Auvry, à Fouquet ou à Mazarin, marquent aussi le désir de leur plaire, de se concilier leur bienveillance et d’obtenir un appui solide, sentiment qu’il concilie fort bien, comme nous le verrons, avec une admiration sincère pour les grands hommes et les grandes choses. Tous ces panégyriques ont été composés, semble-t-il, de 1653 à 1658.» (Essai sur la Vie et les Œuvres de Georges de Brébeuf, pp. 224 à 227). Georges de Brébeuf (Sainte-Suzanne-sur-Vire, Calvados, 1618 – Venoix, près de Caen, 1661) est un poète français descendant d’une illustre famille de la noblesse normande. «Son oncle, Jean de Brébeuf, missionnaire, fut martyrisé par les Iroquois en 1649. Après avoir fait ses études à Caen puis à Paris, Brébeuf, sans fortune, dut se consacrer à des tâches serviles; il fut pendant plusieurs années précepteur du futur maréchal de Bellefonds, puis il se fit poète à gages. A Rouen, il avait fait la connaissance de Pascal; à Paris, il se lia avec Conrart, Ménage, Chapelain, Mézeray et Corneille pour qui il eut toujours la plus vive admiration. Avec ‘LA Gageure’, recueil de cent cinquante épigrammes et madrigaux dirigés contre les femmes fardées, il se fit un grand succès dans les salons dont il fut un des favoris avec Balzac et Voiture [...]. Dans ses ‘Eloges poétiques’ (1661), Brébeuf a réuni des pièces écrites à la gloire de Fouquet, de Mazarin, du jeune roi, ou à l’occasion des victoires françaises, la bataille des Dunes en particulier. En 1660, Brébeuf avait quitté la cour et les salons et s’était retiré près de son frère, curé de Venoix.» (Dictionnaire des auteurs, I, 415). «Brébeuf avait le mérite rare en son temps d’écrire des vers beaux et énergiques.» (Dictionnaire des Œuvres, p. 436). «Georges de Brébeuf, ce poète normand qui a connu Pierre Corneille et sans doute subi son influence [...] ne mérite pas l’oubli où nous l’avons laissé tomber. Faguet, sui se plaisait à réhabiliter les poètes de ce temps, avait baptisé Brébeuf le Lamartine du XVIIe siècle» (H. Du Manoir, Maria, p. 56). Bel exemplaire très pur conservé dans sa reliure de l’époque. Provenance: ex libris manuscrit sur le titre.
Histoire du Palais Royal. Les Amours du roi Louis XIV et de Madame de la Vallière mettant en scène Madame de Montespan relatés par le Comte de Bussy-Rabutin
Edition originale absolument rarissime du roman libertin dont Louis XIV est le héros, qui défraya tant la chronique littéraire, politique et bibliophilique. Imprimé en Hollande vers 1667. Petit in-12 de 96 pages, titre compris, dernière page en 15 lignes. Plein maroquin rouge, triple filet doré autour des plats, dos à nerfs richement orné, filet or sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées. Reliure signée de Thibaron-Joly. 127 x 72 mm.
Edition originale absolument rarissime de ce roman libertin dont Louis XIV est le héros qui dÉéraya tant la chronique littéraire, politique et bibliophilique. Willems, 1770, Tchemerzine, II, 166. Willems dans sa bibliographie des Elzévier, rapporte cette savoureuse histoire : « Nous lisons dans une Lettre à Achille Jubinal, qui fait partie du Pêle-mêle philosophique et littéraire de F. Grille (Paris, 1850) : « Vous qui courez et dénichez les raretés, dites moi, je vous prie, si vous avez rencontré de par le monde un petit livre intitulé : Les Amours du Palais Royal, qui parut sous Louis XIV. MM. Brunet, Beuchot, Jacob et Quérard n’en parlent pas. Ce livre fut imprimé en Hollande ; un exemplaire en fut envoyé à Louvois qui le porta au Roi, le Roi le montra à Mme Henriette ; elle y était, avec lui, fort compromise. Elle en parla à l’évêque de Valence, Cosnac ; l’évêque disparut et s’en alla à La Haye ; au bout de huit jours il revint chargé de toute l’édition qu’il avait achetée pour la brûler. Trois exemplaires étaient restés, la princesse les eut entre les mains et les jeta au feu. Cependant on les vit ; il y en eut des copies, d’incomplètes copies sur lesquelles on fit une seconde édition, pleine de lacunes ». Grille n’indique pas où il a pris cette piquante anecdote, mais le fond en est exact, et les Mémoires de Dan. de Cosnac, publiées en 1852, sont venues la confirmer, au moins dans ses points principaux. » Barbier (Dictionnaire des anonymes) ignorait lui aussi l’existence de cette édition originale non datée, et citait les deux copies, datées 1667, la première, avec la dernière page en 15 lignes, la contrefaçon, avec la dernière page en 10 lignes. À Pâques 1659, le comte de Bussy-Rabutin prend part à une orgie au château de Roissy, où il médit outrageusement et scandaleusement sur les mœurs de la cour, sur le roi et sur la famille royale (décrit plus tard dans son œuvre « Histoire amoureuse des Gaules »). Il est alors condamné, trois mois plus tard, à un premier exil de la Cour de France par le jeune roi Louis XIV, dans le château familial de Bussy de son domaine bourguignon. En 1660, incorrigible, il écrit sans vouloir le publier son pamphlet satirique et calomnieux « Histoire amoureuse des Gaules », chronique sur les frasques de certaines personnes de la cour et sur les premières amours du jeune Louis XIV et de Marie Mancini (nièce du cardinal - premier ministre Jules Mazarin) qu'il tourne en ridicule, pour amuser sa maîtresse, la marquise de Montglas et quelques-uns de ses amis. L'intrigante marquise de la Baume fait alors secrètement copier l’œuvre, puis répandre sa publication en avril 1665 à Liège, à l'insu de l'auteur. L'œuvre scandaleuse parvient à la cour et au jeune roi qui fait arrêter l'auteur en 1666, le destitue de toutes ses charges et le fait enfermer treize mois à la Bastille (alors qu'il vient juste d'être élu à l'Académie française) avant de le faire exiler et disgracier à vie, pour la seconde fois, dans son château en Bourgogne, où ce dernier passera dix-sept années d'exil et la fin de sa vie. La rareté de cette originale est légendaire puisque la famille royale l’acheta en bloc pour la détruire et jusqu’à ce jour, un seul autre exemplaire était répertorié, celui de La Villestreux et L. de Montgermont relié par Lortic en maroquin rouge et cité par Willems et Tchemerzine. Magnifique exemplaire, à belles marges, reliÉ en maroquin rouge de Thibaron‑Joly.
Mémoires du vénitien J. Casanova de Seingalt , extraits de ses manuscrits originaux; publiés en Allemagne par G. de Schutz. [à partir du Tome VIII: “Et traduits par M. Aubert de Vitry, traducteur des Mémoire de Goëthe etc.”]. Exemplaire pur, sans rousseur, de la plus extrême rareté en pleine reliure de l’époque.
«The first French edition» imprimée de 1825 à 1829 is «quite rare». « Aventurier vénitien des plus célèbres, Balzac, Théophile Gautier, Roger de Beauvoir se sont inspirés de certains chapitres des Mémoires de Casanova, lesquels parurent en pleine effervescence romantique ». Carteret. Paris, Tournachon-Molin, 1825-1829. 14 volumes, [iv], xxviii, 246 + [iv], 310 + [iv], 272 + [iv], 288 + [iv], 250 + [iv], 258 + [iv], 237, (1) f. + [iv], xii, 278 + [iv] + 292 + [iv], 299 + [iv], 288 + [iv], 292 + [iv], 284 + [iv], 346 p. Reliés en pleine basane blonde racinée, roulette dorée en encadrement autour des plats, dos lisses ornés, roulette dorée sur les coupes, charnières et coiffes légèrement frottées. Reliure de l’époque. 166 x 93 mm.
“The first French edition” (J. Rives Childs) (1956). “Quite rare” (J. Rive Childs). Mémoires…. Publiés en Allemagne, et traduits par M. Aubert de Vitry, traducteur des Mémoires de Goethe, etc. avec une préface par de Vitry. “The German edition of the Memoirs had been received so favorably that a Paris editor decided to bring out this pirated edition. It is thus the first French edition. However, it is not the first French edition of the original French text but a translation of the Schütz edition and is therefore a translation of a translation.” (J. Rives Childs). Cette première édition française de 1825-1829 a une valeur identique à celle de l’édition française en 12 volumes imprimée de 1826 à 1838: «Brought 10000 francs at auction in Paris in 1945; 15000 in 1948; quoted at $ 150 in NY in 1945 pour l’édition de 1825-1829 contre 15500 Francs en 1946 pour l’édition Brockhaus de 1826-1838 et 100 à 150 $ en 1955.» Les Mémoires de Casanova sont écrits en français. G. de Schutz publie d'abord une version allemande. L'édition publiée à Paris chez Tournechon-Molin en 1825 est une traduction de la version allemande. « Aventurier vénitien des plus célèbres, Balzac, Théophile Gautier, Roger de Beauvoir se sont inspirés de certains chapitres des Mémoires de Casanova, lesquels parurent en pleine effervescence romantique ». Carteret. « Je considère les Mémoires de Casanova comme la véritable Encyclopédie du XVIIIesiècle ». Blaise Cendrars. « Casanova, cet esprit sans pareil, dont chaque mot est un trait et chaque pensée un livre ! » Le Prince de Ligne. Tour à tour aventurier, diplomate, escroc, Giacomo Casanova (1725-1798) a aussi été le seul prisonnier à s'évader de la prison des Plombs, à Venise. A d'autres moments de sa vie, il fait partie des intellectuels de l'époque, il est reçu dans les cours européennes. Devenu riche il mène une vie de folie et de désordre. Il est arrêté par l'Inquisition. Il s'évade et, arrivé à Paris en 1757, se met en rapport avec le maréchal de Richelieu, Crébillon, Voisenon, Fontenelle, Favart, Rousseau. A Genève en 1760, il se présente à Voltaire. À Londres, il rencontre le chevalier d'Éon et le roi Georges III, à Berlin, il fréquente Frédéric II puis, à Saint-Pétersbourg, il a plusieurs entrevues avec Catherine II. Dans ses Mémoires, Casanova dresse un tableau des mœurs de la France de Louis XV, de l’Italie et des cours de l’Europe en général. « We know from the Memoires that he was constantly writing and that his baggage comprised in considerable part his papers ». J. Rives Childs, Casanoviana, p. 108. On a dit que les Mémoires de Casanova étaient des Anticonfessions. « Je n'écris ni l'histoire d'un illustre, ni un roman. Digne ou indigne, ma vie est ma matière, ma matière est ma vie. L'ayant faite sans avoir jamais cru que l'envie de l'écrire me viendrait, elle peut avoir un caractère intéressant qu'elle n'aurait peut-être pas, si je l'avais faite avec l'intention de l'écrire dans mes vieux jours, et qui plus est de la publier ». « Lecteur attentif des œuvres autobiographiques de Saint Augustin, de Montaigne et du marquis d'Argent, Casanova connaît l'œuvre de Rousseau qu'il critique souvent mais sans pouvoir cacher une admiration mêlée d'envie. Il dira « Je ne donnerai pas à mon histoire le titre de Confessions car, depuis qu'un extravagant l'a souillé, je ne peux plus le souffrir. Mais elle sera une confession si jamais il en fut. On me dira qu'un livre qui alarme la vertu est mauvais. J'avoue que ceux dont la vertu préférée est la chasteté doivent s'abstenir de me lire... ». L'influence de l'ouvrage s'étend outremer. Un article publié dans la North American Review, datée de 1835, est consacré aux Mémoires de Casanova: « It presents a curious and not uninstructive picture of the state of society in Europe at the period immediately preceding the French Revolution ». L'auteur de l'article évoque l'arrestation de l'auteur par l'Inquisition pour en faire un élément de comparaison entre les politiques européenne et américaine « The constant repetition of similar cases of the violation of private right by the old governments of Europe was among the causes that operated most strongly in bringing on the revolutionary movements of the last century. We are not blind to the inconveniences, abuses and dangers of our political system, but it gives us a permanent national peace, instead of the wars that constantly desolate Europe ». (The North American Review, xli, p.46-69). En 1834, l’ouvrage est mis à l’index des livres interdits. « Vendus au grand jour ou sous le manteau, les Mémoires firent un tapage d'enfer, et partout l'on en parla, soit pour douter de leur authenticité, soit pour discuter la véracité des confessions amoureuses du Vénitien, soit pour s'en inspirer dans les milieux romantiques Balzac, Théophile Gautier, Gorge Sand, Roger de Beauvoir, Eugène Sue, avant Émile Zola et Pierre Louys puisèrent au gré de leur imagination dans le vaste réservoir d'aventures que Casanova mettait à leur disposition. C’est surtout à la suite de la «grande guerre», que le prix de n'importe quelle œuvre de Jacques Casanova devint inabordable et chimérique. L'édition Brockhaus oscillait par exemple entre 99 francs, reliée (vente P.-A. Chéramy), et 405 francs, brochée (même vente, vacation du lundi 21 avril 1913). En 1917, la vente J. P. (Bosse, expert), cette édition, en demi-reliure basane, tranches jaspées, trouvait acquéreur à 295 francs. N’espérez pas désormais obtenir un exemplaire moins d'un billet de mille ou de 1500 francs, quand l'occasion se présentera si elle se présente !...» (J. Pollio). Le dernier exemplaire référencé sur le marché français, relié en demi veau postérieur avec rousseurs, fut vendu 75000 Francs en mai 1996 (11500 € il y a 26 ans). « La plus grande acquisition patrimoniale » de la Bibliothèque nationale de France a été finalisée le 18 février 2010. Le Ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, a signé l'acte qui fait officiellement entrer à la B.n.F. les manuscrits des Mémoires de Casanova ; il s'agit d'un manuscrit de 3 700 pages non reliées déclaré « bien d'intérêt patrimonial majeur». L'objet excitait la convoitise des grandes bibliothèques et des collectionneurs du monde entier depuis les années 1960. Giacomo Girolano Casanova tour à tour financier, diplomate, escroc, joueur, mais toujours intellectuel éclairé à sa manière, entame la rédaction de ses mémoires dans un français parsemé de ratures et d'italianismes, aux alentours de 1789. Autant dire « au crépuscule de son existence comme au crépuscule du siècle » agité par les « tourments révolutionnaires », a signalé le ministre de la Culture. Il aura fallu trois ans et l'intervention d'un généreux mécène du milieu de la finance, ayant déboursé près de 7 millions d'euros, pour finaliser cette acquisition exceptionnelle. Lors de la cérémonie, le ministre de la Culture a rendu hommage à « l'un des grands auteurs de la littérature française du XVIIIe siècle » et à sa « liberté de ton et de propos qui se nourrit d'une vraie liberté de conduite ». Précieux exemplaire, pur et sans rousseur, de la plus extrême rareté en pleine reliure décorée de l’époque.
Dialogue treselegant intitule le Peregrin, traictant de lhonneste et pudique amour concilie par pure et sincere vertu, traduict de vulgais de Italien en langue frâcoyse par maistre Francoys Dassy conterouleur des Bris de la Masryne en Bretaigne, secretaire du roy de Navarre et de treshaulte et illustre dame madame Loyse, duchesse de Valentinois et nouvellement Imprime a Paris. Première édition française de ce grand roman d'amour
Un roman d'amour et d'aventures superbement illustré, très en vogue à la Renaissance. Paris, N. Couteau pour G. du Pré, 1527. In-4 de (8) ff., 169 ff. y compris 3 grand bois à pleine page, (1) f. pour la marque de l’imprimeur, nombreuses majuscules ornées. Relié en plein maroquin brun, plats entièrement ornés d'un triple encadrement de filets à froid, et d'une large roulette feuillagée à froid, écoinçons dorés aux angles, fleuron central losange frappé or, dos à nerfs orné de roulettes à froid et de fleurons dorés, double filet or sur les coupes, large roulette intérieure dorée, tranches dorées et ciselées. Laurent Claessens. 238 x 170 mm.
Première édition française de ce grand roman d'amour qui connut un énorme succès à la Renaissance. Fairfax Murray, I, n°79; Rothschild, II, 1744 ; Brunet, I, 1701-1702. C'est également un ouvrage de voyages puisqu'y figurent les descriptions du Mont Sinaï, l'Inde, la Macédoine, Chypre et la Corse... Ce grand roman d'amour en prose met en scène les aventures de deux amants appartenant à deux nobles familles de Ferrare, mortellement ennemies l'une de l'autre. Il fut rédigé et publié en italien à Parme alors que Jacomo Caviceo était vicaire de l'archevêque de Ferrare. Dédié à Lucrèce Borgia, ce célèbre roman est remarquable en ce qu'il est le tout premier à placer le récit dans la bouche même des personnages mis en scène. Ce roman commença à circuler, manuscrit, dans les cercles lettrés de la cour de François Ier, après avoir été traduit par François d'Assy. Cette première édition en français, imprimée en caractères gothiques, est ornée d'un titre en rouge et noir et de très nombreuses majuscules ornées. Elle comporte une superbe illustration formée de 3 grandes figures gravées sur bois à pleine page : l'une représente les amants, la seconde le pérégrin parvenant au monastère Sainte-Catherine sur le mont Sinaï sur la route de la Syrie, tandis que sur la troisième il arrive à Chypre, représentée sur la gravure. La marque de Galliot du Pré est imprimée au verso du dernier feuillet. Exemplaire à très grande marges, conservé dans une reliure d'inspiration renaissance de Claessens.
Sensuyve[n]t les ce[n]t nouvelles contenant cent hystoires nouveaulx qui sont moult plaisans a racompter en toutes bonnes compaignies par maniere de joyeusete. Le plus bel exemplaire cité par Brunet des « Cent Nouvelles Nouvelles ».
Orné de 40 gravures sur bois, imprimées en 1532. Lyon, Olivier Arnoullet, 12 juillet 1532. In-4 gothique de (136) ff. Maroquin bleu nuit, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs joliment orné avec chiffre doré répété dans les caissons, double filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Trautz-Bauzonnet, 1847. 191 x 132 mm.
Premier recueil de nouvelles de la littérature française. Le plus bel exemplaire cité et décrit par Brunet de cette rarissime édition de 1532 des «Cent nouvelles nouvelles». L'œuvre a été composée entre 1464 et 1467 à la cour de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Il en est le dédicataire et figure lui-même parmi les trente-cinq conteurs. Longtemps attribué à Antoine de La Sale, auteur de la cinquantième nouvelle, on admet aujourd'hui que les Cent Nouvelles nouvelles sont de la main d'un rédacteur unique et anonyme, qui serait ainsi le trente-sixième conteur, parmi les seigneurs bourguignons devisant. « Ce recueil, faussement attribué parfois à Antoine de la Sale, fut composé à la demande du duc de Bourgogne Philippe le Bon, vers 1462, par un écrivain de cour, peut-être Philippe Pot. Plusieurs seigneurs bourguignons pour se divertir racontent à tour de rôle de gaillardes histoires, avec abondance de ripailles, joutes amoureuses, feintes et jeux de mots, qui forment une suite au Décameron de Boccace et annoncent les contes du XVIe. Pourtant, derrière la gaîté d'apparence, on sent les inquiétudes d'un siècle qui finit mal : la loyauté chevaleresque a disparu, l'amour filial, le mariage, l'amitié même sont touchés par la dégradation des mœurs et l'avènement du mensonge. Le texte original fut plusieurs fois adapté, compilé, remis en forme au XVIe siècle.» (Bechtel). « Chef-d’œuvre de style et le premier ouvrage en prose, sans contredit, où la langue française montre cette clarté et cette facile élégance qui l'ont rendue la langue de l'Europe civilisée" (Viollet-le- Duc, Bibliographie des chansons, fabliaux, contes en vers et en prose, 1859, p. 144). « Un bel exemplaire en mar. v. a été vendu 465 fr. chez le pr. d'Essling; 14 liv. sterl. Utterson.» (Brunet, I, 1735). Précieuse et belle édition illustrée de 40 figures gravées sur bois dans le texte; quelques-unes sont répétées. Titre imprimé en rouge et noir, orné d’une grande figure: « Trois personnages, dont un tient un manuscrit, autour d’une table où se trouve un vase». Au dernier f. : Roi de France entouré de 6 personnages. Et 38 bois plus petits (dont des répétés) dans le texte. Nombreuses initiales ornées. Ces récits d'après boire où l'indécence est de mise s'inspirent de la tradition orale et d'un fonds commun aux fabliaux, aux Facéties du Pogge et au Décaméron. Les effets scabreux sont plus appuyés: maris benêts perpétuellement cocus, épouses rouées, truculences érotiques, feintes et jeux de mots sont rendus avec un art très vif du dialogue et de la mise en scène. Très bel exemplaire cité par Brunet et Bechtel relié en maroquin par Trautz au chiffre du Baron de Ruble provenant des bibliothèques de François-Victor Masséna, Prince d’Essling (cat. 1845, n°349: exemplaire alors relié par Duru); baron Alphonse de Ruble qui le fit relier de nouveau par Trautz-Bauzonnet (Paris, 1889, n°463); Emile Rossignol avec ex-libris; Bernard Clavreuil; Pierre Bergé. Bechtel ne mentionne qu’un seul exemplaire passé sur le marché au cours des quarante dernières années: l’exemplaire Edouard Vernon Utterson, relié au XIXe siècle par Niedrée avec 3 feuillets restaurés et le dernier feuillet refait, vendu 7 500 € en juin 1985, il y a 39 ans.
Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche.
« L’auteur d’‘Hamlet’ et celui de ‘Don Quichotte’ sont les deux plus grands poètes qu’aient produit les siècles modernes. Cervantès, plus encore que le doux William, exerça sur moi un charme indéfinissable. Je l’aime jusqu’aux larmes. » Heine. Amsterdam et Leipzig, Arkstée & Merkus, 1768. 6 volumes in-12. -Nouvelles de Michel de Cervantès. Amsterdam & Leipzig, Arkstée & Merkus, 1768. 2 volumes in-12. En tout 8 volumes in-12 de: I/ (6) ff., 370 pp., 1 faux titre gravé et 7 figures dont 1 portrait de l’auteur ; II/ (3) ff., 369 pp. et 3 figures ; III/ (4) ff., 371 pp. et 10 figures ; IV/ (4) ff., 453 pp. et 8 figures ; V/ (4) ff., 420 pp. et 4 figures ; VI/ (4) ff., 422 pp., (1) f. ; VII/ XLIV pp., 358 pp. et 6 figures ; VIII/ (2) ff., 396 pp. et 7 figures. Maroquin rouge, roulettes et filets dorés encadrant les plats, dos lisses finement ornés de filets lisses et aux pointillés formant faux-nerfs et de fleurons dorés, roulette dorée sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l'époque de Derôme le Jeune. 172 x 103 mm.
Séduisante édition des œuvres complètes de Cervantès, traduites en français par Filleau de Saint Martin. L’une des principales et des meilleures éditions du XVIIIe siècle. Picot, Livres du Baron de Rothschild, 1752 ; Cohen, Guide de l’amateur de livres à gravures, 217 et 221 ; Rahir, p. 360. « Deux hommes de lettres, Rabelais et Michel Cervantès, s’élevèrent, l’un en France et l’autre en Espagne, et ébranlèrent à la fois le pouvoir monacal et celui de la chevalerie. Pour renverser ces deux colonnes, ils n’employèrent d’autres armes que le ridicule, ce contraste naturel de la terreur humaine. » (Bernardin de Saint-Pierre). » (Jean Barbelon). Cette édition du « Don Quichotte » est illustrée de 31 estampes à pleine page par Fokke et Folkéma, d’un faux-titre gravé et de 6 vignettes de titre. Cette série de gravures prend sa source dans la suite des 31 estampes gravées, de format in-4, par Picard, Tanjé, Stokke et J. Van Schley d’après les dessins de Coypel, Boucher et Trémolière en 1746 et qui fixèrent pour un siècle environ l’iconographie de l’œuvre. Elles sont ici réinterprétées au format in-8. Les « Nouvelles » sont ornées d’un portrait d’après Kent et de 13 estampes dessinées et gravées par Folkéma. Dans le présent exemplaire le portrait de l’auteur a été relié en tête du premier volume. L’ensemble de ces 44 estampes forme l’œuvre la plus importante et la plus connue de l’artiste. « Né à Dokkum, en Frise, en 1692, Folkéma apprit la gravure de son père et s’établit à Amsterdam où il est mort en 1767. Son œuvre la plus connue est sa réduction in-8 des figures de Charles Coypel pour ‘Les Aventures de Don Quichotte’, exécutées avec Fokke pour l’édition de 1768 ». Portalis, Les Dessinateurs d’illustrations au XVIIIe siècle, pp. 214-215. L’exemplaire à très grandes marges, l’un des plus beaux connus, fut revêtu à l’époque par Derôme le Jeune d’un maroquin rouge particulièrement élégant. Il est cité par Brunet.
Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche. Oeuvres complètes de Cervantès
«L’auteur d’’Hamlet’ et celui de ‘Don Quichotte’ sont les deux plus grands poètes qu’aient produit les siècles modernes. Cervantès, plus encore que le doux William, exerça sur moi un charme indéfinissable. Je l’aime jusqu’aux larmes.» Heine. CERVANTES. Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche. Amsterdam et Leipzig, Arkstée & Merkus, 1768. 6 volumes in-12. -Nouvelles de Michel de Cervantès. Amsterdam & Leipzig, Arkstée & Merkus, 1768. 2 volumes in-12. En tout 8 volumes in-12 de: I/ (6) ff., 370 pp., 1 faux titre gravé et 6 figures; II/ (3) ff., 369 pp. et 3 figures; III/ (4) ff., 371 pp. et 10 figures; IV/ (4) ff., 453 pp. et 8 figures; V/ (4) ff., 420 pp. et 4 figures; VI/ (4) ff., 422 pp., (1) f.; VII/ XLIV pp., 358 pp., 1 portrait et 6 figures; VIII/ (2) ff., 396 pp. et 7 figures. Plein maroquin vert de l’époque, roulette dorée encadrant les plats, dos lisses finement ornés, filet aux pointillés sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. 172 x 105 mm.
Séduisante édition des œuvres complètes de Cervantès, traduites en français par Filleau de Saint Martin. Picot, Livres du Baron de Rothschild, 1752; Cohen, Guide de l’amateur de livres à gravures, 217 et 221; Rahir, p. 360. Cette édition du «Don Quichotte» est illustrée de 31 estampes à pleine page par Fokke et Folkéma, d’un faux-titre gravé et de 6 vignettes de titre. Cette série de gravures prend sa source dans la suite des 31 estampes gravées, de format in-4, par Picard, Tanjé, Stokke et J. Van Schley d’après les dessins de Coypel, Boucher et Trémolière en 1746 et qui fixèrent pour un siècle environ l’iconographie de l’œuvre. Elles sont ici réinterprétées au format in-8. Les «Nouvelles» sont ornées d’un portrait d’après Kent et de 13 estampes dessinées et gravées par Folkéma. L’ensemble de ces 44 estampes forme l’œuvre la plus importante et la plus connue de l’artiste. «Né à Dokkum, en Frise, en 1692, Folkéma apprit la gravure de son père et s’établit à Amsterdam où il est mort en 1767. Son œuvre la plus connue est sa réduction in-8 des figures de Charles Coypel pour ‘Les Aventures de Don Quichotte’, exécutées avec Fokke pour l’édition de 1768». Portalis, Les Dessinateurs d’illustrations au XVIIIe siècle, pp. 214-215. Précieux exemplaire revêtu à l’époque d’un éclatant maroquin vert aux dos particulièrement élégants.
Vida y Hechos del Ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra con muy bellas Estampas gravadas sobre los dibujos de Coypel, primer Pintor de el Rey de Françia. « Don Quixote de la Mancha », aux armes de la Princesse de Lamballe.
«Don Quichotte» relié pour la Princesse de Lamballe, l’amie intime et dévouée de la reine Marie-Antoinette, en éclatant maroquin vert de l’époque. En Haia por P. Gosse y A. Moetjens, 1744. 4 volumes in-12 en plein maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, armoiries dorées de la princesse de Lamballe au centre, dos à nerfs ornés, filet or sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées. Reliure armoriée de l’époque. 157 x 95 mm.
«Don Quichotte» relié spécialement pour la Princesse de Lamballe (1749-1792) l’amie intime de la reine Marie-Antoinette, vers l’année 1775, en maroquin vert avec une sélection de vingt figures d’après Coypel gravées par Folkema, Fukke et Tanje, les exemplaires ordinaires comptant un portrait et 24 figures. Don Quichotte, chef-d’œuvre de la littérature mondiale, fut écrit probablement entre 1598 et 1604. La première partie fut publiée en 1605. Dix ans plus tard, en 1615, parut une deuxième partie qui est en quelque sorte l'illustration, l'interprétation et la conclusion définitive de la première. Selon ce que Cervantès nous déclare lui-même dans le Prologue de la Ire partie, son but a été d'écrire un roman de chevalerie, capable de se détacher de tous les autres largement répandus à cette époque. « Le roman est issu, à l'origine, d'une inspiration polémique contre les livres de chevalerie dont il devait prendre tout simplement le contre-pied sous la forme d'une imitation ; mais il s'est transformé, petit à petit, en une représentation poétique et sincère d'un monde de plus en plus vaste et complexe, au sein duquel agit une force analogue à celle qui explique la vie individuelle et la vie universelle, l'histoire humaine et son devenir perpétuel. Pour Cervantès, cette force se manifeste essentiellement sous trois aspects, facettes d'un même prisme : d'un côté, la générosité et la grandeur morale de Don Quichotte ; de l'autre, le réalisme et l'égoïsme pratique de Sancho Pança ; mais ces deux modalités de l'action, apparemment inconciliables, profondément contradictoires, cèdent le pas devant le mystérieux attrait d'un idéal de beauté qui, s'il ne triomphe, du moins survit aux déceptions, donnant un constant démenti à l'affligeante réalité. Mais cet idéal, quel est-il ? La réponse ne peut être qu'obscure ; sinon que, profondément enraciné dans l'homme, le pouvoir lui a été donné de se dépasser; et plus particulièrement pour ce qui est de Cervantès, ce dépassement se réalise dans l'œuvre d'art où il trouve un champ d'action propre à l'exercice de son talent. En face de cet univers poétique que son imagination installe dans la réalité, Cervantès est amené à éprouver un sentiment de charité qui adhère, avec une indulgence bienveillante, à toutes les formes dans lesquelles l'amour se réalise : sorte d'inspiration d'un genre naturel qui entraîne l'ensemble des hommes dans son sillage. Et même au sein de sa hâte pleine d'angoisse, c'est vers une vie contemplative qu'il nous conduit. Ainsi grâce à ce sentiment de charité, tous entrent dans le sillage lumineux des aventures incroyables de Don Quichotte : l'œuvre entière est comme enveloppée d'un sourire immatériel et translucide, qui laisse percer secrètement une inépuisable richesse d’humanité et d’expériences réellement vécues. La magie de ce sourire, en conférant au récit un caractère inimitable, a assuré à Cervantès une renommée triomphale.» Précieux exemplaire revêtu de fraîches reliures en maroquin vert vers l’année 1775 aux armes de la princesse de Lamballe, l’une des provenances les plus rares et émouvantes de l’Ancien Régime. Ernest Quentin-Bauchart (Les Femmes bibliophiles de France – Paris 1886) ne cite que 6 ouvrages reliés aux armes de cette princesse et insiste sur leur très petit nombre et leur médiocre condition habituelle: « Marie-Thérèse de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, naquit à Turin le 8 septembre 1749. Elle était la quatrième fille de Louis-Victor de Savoie-Carignan et de Christine- Henriette de Hesse-Rhinfelds-Rothembourg, sa femme, grand'tante du roi de Sardaigne. Bientôt l’amitié la plus tendre unit la reine à la princesse. Nous n’en voulons d’autre preuve que cette lettre touchante, écrite par Marie-Antoinette à la mort de la princesse de Carignan: « J'ai appris avec une bien vive douleur, ma chère Lamballe, la mort de votre bonne mère à qui vous gardiez si grande tendresse et respect, j'ai pleuré de votre lettre, je connoissois toutes les vertus de la princesse de Carignan, ma douleur s'en augmente, c'est un poids trop fort à supporter pour vous et pour ceux qui vous aime, mon amie il me tarde de vous voir et de meler mes larmes avec les votres, car il nia pas de consolation pour un parreil désespoir et je ne peu que pleurée avec vous et prier Dieu. Nous parlions tout à l'heure de vous le roy et moi et nous déplorions la triste destinée qui poursuit une ange telle que vous si bien faitte pour appeler le bonheur autour delle et si digne de le gouter, mais votre touchante résignation est au-dessus de vos maux et l'amitié du bon M. de penthiévre et la notre vous reste, nous voudrions que cela put adoucir un peu lamertume de vos chagrins. Adieu ma chère Lamballe, je vous embrasse du meilleur de mon cœur comme je vous aimerai toute ma vie. Marie-Antoinette le roy entre et veut vous ajoutter quelques mots.» Un mot, un seul, Madame et chère cousine, mais un mot du fond du cœur. Vous savez combien nous vous aimons, que Dieu soit avec vous. Louis. Madame de Lamballe était en Allemagne quand elle apprit l’arrestation de la famille royale à Varennes. N’écoutant que les inspirations de son cœur, elle rentra à Paris le 14 novembre 1791, malgré les instances de la reine, qui la suppliait d’attendre: « Non, je vous le repette, ma chère Lamballe, ne revenez pas en ce moment ; mon amitié pour vous est trop alarmée, les affaires ne paraissent pas prendre une meilleure tournure malgré l'acceptation de la Constitution sur laquelle je comptois. Restez auprès du bon Monsieur de Penthièvre qui a tant besoin de vos soins ; si ce n’étoit pour lui il me seroit impossible de faire un pareil sacrifice, car je sens chaque jour augmenter mon amitié pour vous avec mes malheurs ; Dieu veuille que le temps ramenne les esprits ; mais les méchants répandent tant de calomnies atroces, que je compte plus sur mon courage que sur les évènemens. Adieu donc, ma chère Lamballe, sachez bien que de près comme de loin, je vous aime et que je suis sure de votre amitié.» Marie-Antoinette. La princesse, après avoir partagé pendant quelques jours, la captivité de la reine au Temple, fut enlevée la nuit et transférée à la Force. C'était son arrêt de mort. «Les livres de Madame de Lamballe sont en très petit nombre et leur condition est médiocre.» (Ernest Quentin Bauchart. Les femmes bibliophiles de France). Exceptionnel exemplaire, de toute rareté, du Don Quichotte de Madame de Lamballe conservé dans ses reliures armoriées en éclatant maroquin vert de l’époque.
Galatea Dividida en seys Libros compuesta por Miguel de Cervantes, Dirigida all Illustrissimo Senor Ascanio Colona Abad de Sancta Sofia. Seconde édition, rarissime, de "Galatea", la première œuvre de Cervantès.
Exemplaire conservé dans son vélin de l’époque. Paris, por Gilles Robinot, 1611. In-8 de (8) ff., 475 pp. (la dernière mal chiffrée 47). Vélin souple, titre manuscrit au dos. Reliure de l'époque. 160 x 107 mm.
[video width="1920" height="1080" mp4="https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2024/04/CERVANTES.mp4"][/video] Première édition de Galatea imprimée en dehors de la péninsule ibérique et seconde édition, très rare de la première œuvre de Cervantès, la seule que l’on puisse espérer trouver sur le marché. L’originale de 1585 est encore plus rare que la première de Don Quichotte, parue en 1605, Cervantès étant alors un écrivain inconnu. Galatée est un roman pastoral en prose et en vers. «L’imagination de Cervantès nous offre un monde de beauté idéale qui prend le nom et le visage de Galatée: mais c’est un monde dont l’essence secrète est l’amour, inclination naturelle qui nous exalte et nous entraîne. Les bergers Elicio et Erastro, tous deux épris de la «sin par Galatea», chantent à l’envi leur amour pour la belle pastourelle, gloire du Tage, laquelle, destinée par son père à épouser un riche berger portugais, se promet au contraire à Elicio, si ce dernier l’aide à se soustraire à la volonté paternelle. Platonisme emprunté à Léon l’Hébreu, élégances à la Bembo et à la Castiglione, prédilection pour la préciosité et la complication des sentiments sont les caractéristiques de Galatée, qui est encore tout imprégnée du goût baroque. Ce livre demeura cher à Cervantès; il lui donna une place à part dans le fameux examen de la bibliothèque de Don Quichotte et annonça même, dans la dédicace des Travaux de Persile et de Sigismonde au comte de Lemos, qu’il donnerait une suite; enfin, à son lit de mort, il se promettait encore de le terminer si un miracle lui conservait la vie.» Depuis le début des relevés de ventes publiques internationales (A.B.P.C.), il n’est passé aucun exemplaire de l’édition de 1585 sur le marché et seulement un exemplaire de la seconde édition en vélin de l’époque, vendu par Sotheby’s New York en 2000. Précieux exemplaire de l’œuvre préférée de l’auteur, conservé dans son vélin de l’époque.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers



















![Sensuyve[n]t les ce[n]t nouvelles contenant cent hystoires nouveaulx qui sont moult plaisans a racompter en toutes bonnes compaignies par maniere de ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/AGA/lcs-18464_thumb.jpg)
![Sensuyve[n]t les ce[n]t nouvelles contenant cent hystoires nouveaulx qui sont moult plaisans a racompter en toutes bonnes compaignies par maniere de ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/AGA/lcs-18464_1_thumb.jpg)
![Sensuyve[n]t les ce[n]t nouvelles contenant cent hystoires nouveaulx qui sont moult plaisans a racompter en toutes bonnes compaignies par maniere de ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/AGA/lcs-18464_2_thumb.jpg)