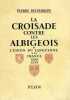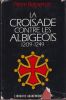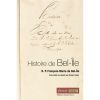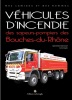Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (7)
19th (131)
20th (1326)
21st (116)
-
Syndicate
ILAB (1586)
SLAM (1586)
L'Anjou.
Grenoble, P., Arthaud, 1945, gr. in-8° carré, 290 pp, 238 illustrations en héliogravure dans le texte et à pleine page, une carte volante, broché, couv. rempliée illustrée par Louis Garin, bon état (Coll. Les Beaux Pays). Un des 1000 ex. numérotés sur papier vélin à la forme
"En regardant la date de parution de ce livre, le lecteur peut se demander s'il ne s'est pas trompé. Malgré les difficultés dans lesquelles se débat l'édition française, on trouve ici la beauté du papier, la netteté des caractères, la délicatesse des reproductions photographiques en sépia foncé... rien n'est changé à la tradition de présentation luxueuse de la maison Arthaud ! C. Baussan, un Angevin qui connaît et aime sa petite patrie, la divise, selon la coutume, en cinq pays, dans lesquels il pénètre par la Touraine (p. 35) : la vallée qui n'existe que par la Loire (p. 39-96) ; le Saumurois où la vigne est la reine (p. 97-144) ; le Baugeois, pays de la forêt (p. 191-222) ; le bocage segréen (p. 223-252) ; les Mauges, cette Vendée angevine (p. 253-288) sur lesquelles règne, paisible, Angers, avec son château et sa cathédrale (p. 145-190). Description soignée, utile à l'archéologue, à l'amateur d'histoire locale comme au géographe ou au touriste, ce livre permet aussi bien d'apprendre à connaître la région que de retrouver d'agréables souvenirs de voyage. L'illustration mérite une mention spéciale : les photos sont remarquablement choisies et exécutées ; citons en particulier le moulin d'Anjou (p. 21), la statue du roi René, par David d'Angers (p. 29), les vues de Fontevrault (p. 42-43), les eaux calmes du Thouet (p. 123), la paix lumineuse du cloître Saint-Jean (p. 185), le château du Lude au bord du Loir (p. 190-220)..." (L'information géographique, 1946)
Montceau-les-Mines : un "laboratoire social" au XIXe siècle.
Avallon, Editions de Civry, 1981, in-8°, 316 pp, 76 gravures, portraits et cartes, broché, couv. illustrée à rabats, qqs rares marques au stylo, bon état
"Intéressante monographie. Après un historique de l'exploitation minière, le livre est surtout une chronique pittoresque et animée des temps forts de la saga locale : les exploits de la « bande noire », les grandes grèves de 1899 et 1901. Figure dominante, celle de Léonce Chagot, gérant de la Compagnie des mines, premier maire de la nouvelle commune, constructeur et maître de « Chagotville ». Il est situé dans la mouvance du christianisme social..." (Emile Goichot, Archives de sciences sociales des religions, 1982) — "Proche du Creusot, la ville de Montceau-les-Mines a toujours vécu dans l'ombre de sa célèbre voisine, et la dynastie des Chagot, qui y régna longtemps, a été éclipsée par la puissante famille des Schneider. Le livre que le docteur Beaubernard consacre à l'histoire des premières années de cette ville industrielle mal connue, dépasse largement le cadre strictement régional qu'il s'est fixé et prend valeur nationale, dans la mesure où nous assistons à la naissance d'une grande entreprise capitaliste et parallèlement à celle d'une cité ouvrière. Au XIXe siècle, Montceau-les-Mines fut un laboratoire social, comme le souligne le titre, à la fois pour le patronat et pour la classe ouvrière. D'un côté, le patronat s'y livre à une certaine expérimentation ; les fondateurs lancent l'entreprise capitaliste et pratiquent un paternalisme teinté de christianisme social, la génération des technocrates-productivistes arrive ensuite, qui quadrille la population pour la mieux mettre au travail. De l'autre côté, la classe ouvrière commence à se constituer en un groupe homogène et à réagir contre les attitudes patronales successives, avec la Bande noire, anarchiste, puis en fondant un syndicat qui anime des grèves longues et dures. La classe ouvrière montcellienne ne se forme que peu à peu. D'origine agricole, les premières générations de mineurs le demeurent un certain temps, combinant les deux activités : « Le mineur reste un cultivateur et s'absente sans vergogne pour les travaux des champs. » Paysan, l'ouvrier l'est aussi par son mode de vie, qui ne s'adapte que lentement aux mœurs de la société industrielle qui s'imposent dans sa région. « La population de Blanzy était une population essentiellement cosmopolite et flottante. Le monde des mineurs... était alors un monde qui incessamment se renouvellait et se déplaçait. » Comme dans beaucoup de bassins miniers, la main-d'œuvre de Montceau est instable et le patronat a du mal à enraciner et à former une classe ouvrière sur laquelle elle puisse compter pour assurer une production régulière. Mais petit à petit les mineurs deviennent un groupe social particulier, ils s'écartent de plus en plus de leurs origines rurales et de la totale dépendance, économique et morale, dans laquelle ils vivaient vis-à-vis de la compagnie. Après une période de gestation et de soumission, pendant laquelle les révoltes seront exceptionnelles, la classe ouvrière va réagir à la pression qu'exerce sur elle la compagnie. La Bande noire, qui fut responsable, entre 1882 et 1885, dans la région de Montceau, d'un certain nombre d'attentats dirigés contre les ingénieurs, les notables, les mouchards et les églises, est une société secrète d'inspiration anarchiste, qui regroupe une centaine de personnes dont beaucoup de mineurs. Décapitée, c'est dans sa mouvance que naît le syndicat, qui prend la relève dans la lutte contre la compagnie. Deux grandes grèves marquent ce tournant, 1899 et 1901. Celle de 1901 laisse de nombreuses familles dans une misère totale ; le syndicat se trouve incapable de leur venir en aide. Montceau portera longtemps les marques de cette défaite. Le livre de Beaubernard s'arrête au lendemain de la grève en 1901... Si l'auteur nous présente assez minutieusement les différents membres de la dynastie Chagot, nous n'apprenons pas grand-chose concernant les mentalités, les conditions de vie et de travail des ouvriers du bassin. Cet ouvrage n'en demeure pas moins riche d'informations sur une communauté méconnue. Signalons enfin la très importante iconographie sur Montceau-les-Mines et ses habitants, dont la variété constitue un des grands attraits de ce livre." (Diana Cooper-Richet, Esprit, 1983)
L'administration des intendants d'Orléans de 1686 à 1713. Jean de Creil, André Jubert de Bouville, Yves de la Bourdonnaye. Une province sous Louis XIV. (Thèse).
Genève, Mégariotis, 1978, in-8°, xviii-460 pp, un portrait d'André Jubert de Bouville en frontispice, sources, index, reliure simili-cuir havane de l'éditeur, bon état (réimpression de l'édition d'Orléans, 1911)
"L'Orléanais était une province que sa composition géographique faisait participer de régions bien diverses. S'étendant sur l'Orléanais lui-même, le Bressois, le Dunois, le Vendômois, le Chartrain, elle comprenait, d'autre part, toute une partie du Giennois et pénétrait même dans l'Yonne et le Nivernais. Elle présente par suite des aspects, des territoires, des ressources et des intérêts les plus variés. Retracer l'activité multiple des hommes qui se trouvèrent à la tête de l'administration d'une telle province, tel était l'objet que M. de Beaucorps s'était proposé et qu'il a pleinement atteint. Son étude est très claire et très nettement divisée. Une première partie retrace la formation de l'intendance et en donne une description bien complète. Puis l'auteur nous présente les personnages qui l'administrèrent durant la période qu'il s'est proposé de retracer, les situant avec suffisamment de détails pour que leur physionomie nous devienne bien connue. Il entre ensuite dans le détail de leur administration, examinant successivement les divers points sur lesquels dut s'exercer leur autorité : impositions, taxes, capitation, aides, gabelles, monnaies, administration communale, travaux publics, affaires militaires, justice, police, affaires religieuses, commerce des blés, assistance. Certains de ces chapitres sont particulièrement intéressants, tel celui qui concerne les protestants ; l'Orléanais fut, en somme, assez favorable à la Réforme, et les détails fournis sur la révocation de l'Édit de Nantes présentent un curieux intérêt. Certains autres consacrés aux affaires militaires, à une époque où la guerre sévissait partout sans interruption, aux récoltes de blé et aux disettes seront consultés avec fruit. Tout ce qui concerne les canaux d'Orléans a été très clairement exposé. (...) Cet important ouvrage apporte une très utile contribution à l'histoire administrative et économique de l'ancienne France." (Léon Mirot, Bibliothèque de l'école des chartes, 1913)
Coutumes de Beauvaisis. Texte critique publié avec une introduction, un glossaire et une table analytique par Am. Salmon. Suivi d'un commentaire historique et juridique par Georges Hubrecht.
Picard, 1970-1974, 3 vol. in-8°, xlv-512, 553 et 280 pp, glossaire, table analytique, biblio, brochés, bon état. Réimpression de l'édition Salmon de 1899-1900 (2 volumes), suivie d'un Commentaire historique et juridique par Georges Hubrecht (280 pp)
La meilleure édition du coutumier français le plus complet et le mieux conçu du XIIIe siècle, précieux au surplus pour les aperçus qu'il donne sur la société de l'époque, où Philippe de Beaumanoir expose non seulement le droit du Bauvaisis, mais aussi les principes fondamentaux du droit privé de son temps. Une première édition avait été établie par Thaumas de la Thaumassière en 1690, une seconde par le comte Beugnot en 1842. — "A l'occasion de la réimpression des Coutumes de Beauvaisis de Ph. de Beaumanoir, éditées en 1899-1900 par A. Salmon (Paris. A. et J. Picard, 1970, 2 vol.), M. G. Hubrecht y ajoute un tome III. En fait, il s'agit plutôt d'un résumé de l'œuvre de B., qui à ce titre pourra rendre des services à ceux auxquels le français du XIIIe siècle n'est pas familier. La lecture de l'ouvrage de M. H. facilitera, pour beaucoup, l'approche de l'œuvre de Beaumanoir." (Ph. Godding, Revue belge de philologie et d'histoire)
Notes sur la prise du château de Rouen par Ricarville en 1432.
Rouen, Imprimerie de A. Péron, s.d. (1857), in-8°, 38 pp, broché, couv. muette (couv. défraîchie, manques au dos)
Extrait du Précis de l'Académie Impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, année 1855-1856.
L'église bénédictine de La Charité-sur-Loire, « fille ainée de Cluny ». Etude archéologique. Ornée d'un dessin de Camille Cipra, de nombreuses reproductions photographiques et de deux plans de l'Église et du Prieuré.
La Charité-sur-Loire, Delayance, 1929, in-8°, 301 pp, 16 pl. de photos et 2 plans dépliants hors texte, 7 dessins en culs-de-lampe (bestiaire de l'abside), broché, imprimé sur beau papier, bon état
"L'ancienne abbatiale de la Charité est encore aujourd'hui, malgré de cruelles mutilations et le déplorable lotissement de ses parties ruinées, un monument de premier ordre qui méritait l'étude approfondie que vient de lui consacrer M. le Dr P. Beaussart." (Jean Vallery-Radot, Revue d'histoire de l'Église de France, 1930)
Le Livre des Droiz et des Commandemens d'office de justice, publié d'après le manuscrit inédit de la bibliothèque de l'Arsenal par C. J. Beautemps-Beaupré.
P., Durand, 1865, 2 vol. gr. in-8°, 430 et 415 pp, table alphabétique et analytique des matières, reliures demi-basane naturelle, dos lisses, titres dorés (rel. de l'époque), dos lég. frottés, qqs rousseurs, bon état
Recueil de la jurisprudence des cours du Poitou dans la seconde moitié du XIVe siècle.
Gavray-Hambye. Histoire et Monuments d'un canton bas-normand.
Coutances, Editions OCEP, 1975, gr. in-8°, 171 pp, préface de Lucien Musset, 12 pl. de gravures et photos hors texte, broché, couv. illustrée, bon état (Etudes et documents d'histoire de Basse-Normandie)
"Voici, dans la série déjà étoffée des publications de l'OCEP, à Coutances, un travail paru depuis peu, présenté sous une couverture judicieusement ornée d'une photographie de pavé médiéval à sujet monastique. Judicieusement, car si l'importance du coin de terre étudié a pu jadis tenir dans le château de Gavray, c'est de nos jours l'abbaye d'Hambye qui en assure le renom. Au fil des pages, on apprend des choses fort évocatrices, par exemple sur l'usure rapide des familles nobles, sur le déclin de l'abbaye, en partie lié aux incertitudes politiques des Paisnel, etc. Le chapitre IV, consacré au château, est plein d'intérêt. L'inventaire des vivres et du matériel, vers 1370, mériterait de passer dans une collection régionale de textes documentaires. Enfin, quand il se penche sur la forêt de Gavray, l'auteur suscite vivement notre intérêt. Qu'un massif forestier, même délabré, passe à l'époque moderne et sans qu'on sache bien comment de 1 000 à 170 ha, en une génération, suggère un réseau de connivences locales. C'est dire les mérites du travail de M. Beck." (Paul Crepillon, Annales de Normandie, 1977)
L'Abbaye d'Henin-Lietard. Introduction historique. Chartes et documents (XIIe-XVIe s.).
P., Lethielleux, 1965, gr. in-8°, 144 pp, 2 cartes, index, broché, bon état (Bibliothèque d'histoire et d'archéologie chrétiennes)
"Il faut souligner le mérite de Dom Becquet qui, sans être rebuté par l'indigence des documents, a établi un recueil de chartes et une esquisse historique de cette abbaye. C'est vers 1040 qu'un chapitre de douze chanoines fut établi, avec l'accord de l'évêque de Cambrai, par Robert II de Béthune dans l'église Saint-Martin d'Hénin. Hénin, dépendance de l'ancien fisc royal d'Harnes, située à égale distance de Douai et de Lens, relevait alors des comtes de Boulogne mais passa bientôt sous le contrôle plus direct de la branche aînée de la dynastie, les comtes de Flandre. En 1123, le comte Charles le Bon confirma la libération de tout pouvoir séculier de l'église d'Hénin... Des aumônes enrichirent le temporel de l'abbaye, qui, dès la fin du XIIe siècle, avait acquis l'essentiel de ses droits. Elle ne manqua pas de les faire confirmer par l'archevêque de Reims, le Saint-Siège et le roi de France, lorsque l'Artois fut réuni à la couronne. La vente au comte d'Artois, en 1244, de la seigneurie d'Hénin, n'eut guère d'importance pour l'abbaye qui désormais aura surtout des rapports avec la ville d'Hénin. (...) Après son introduction historique, Dom Becquet examine les sources, insistant tout particulièrement sur Baudouin de Glen, à qui il consacre une longue notice. L'Historia de Baudouin, récit chronologique en latin des origines de l'abbaye et des faits et gestes des abbés, est basée non seulement sur la tradition orale mais sur des documents écrits : chroniques, obituaires, compilations locales antérieures, aujourd'hui disparues, et surtout chartes de l'abbaye. Il utilise ces divers documents avec un réel esprit critique et recopie souvent les actes cités. (...) L'ouvrage est complété par une carte des possessions de l'abbaye et un plan de la ville et de l'abbaye, avec commentaires et par deux index, noms de lieux et noms de personnes." (Fr. Muret, Revue belge de philologie et d'histoire, 1968)
La Croisade contre les Albigeois et l'union du Languedoc à la France (1209-1249).
Plon, 1942, in-8°, 495 pp, 9 gravures h.t., 2 croquis, un tableau généalogique et une grande carte dépliante hors texte, index
"Un livre qui manquait. Si M. Belperron est bien informé ; – et il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir les chapitres très nourris qu'il a écrits sur les origines, le développement, les résultats de la Croisade, il s'agit ici d'un livre à thèse, une thèse séduisante, mais qui ne recueillera certainement pas l'assentiment unanime. Pour M. Belperron, le programme de la papauté à l'égard de l'hérésie se résume dans le mot d'ordre “pax et fides” ; cet idéal d'ordre dans les choses et de discipline dans les âmes s'oppose à l'anarchie sociale, intellectuelle et religieuse des pays de langue d'oc aux XIIе et XIIIе siècles ; il se retrouve, au contraire, dans la France du Nord, aussi bien dans la dynastie capétienne de Louis VI à Philippe III que chez les seigneurs de l'Ile-de-France, comme Simon de Montfort, les uns et les autres bons catholiques, administrateurs consciencieux, accoutumés à la persévérance dans l'effort. L'annexion du Midi par les rois de Paris a été une étape nécessaire dans la formation de l'unité française. Quoi qu'il en soit, il convient de souligner que M. Belperron s'efforce toujours de rester impartial, malgré son désir de présenter en bonne lumière les faits favorables à sa thèse – c'est ainsi qu'il n'essaie pas de pallier l'atrocité des massacres ; il se contente de les expliquer par les mœurs du temps. Reconnaissons aussi qu'il abonde en aperçus ingénieux dont il faudra tenir compte, ne fut-ce que pour les discuter : par exemple, il réagit, avec raison, semble-t-il, contre la part exagérée donnée à l'aspect militaire de la Croisade, il insiste, également à bon droit, sur les éléments spirituels de l'affaire (continuité de vues des conciles méridionaux, importance des statuts de Pamiers, action administrative de la royauté et ď Alfonse de Poitiers). L'influence des croisades d'Orient, omise ou sous-estimée par les historiens modernes, est définie en termes brefs, mais précis. Les origines de l'Inquisition sont également restituées avec une grande clarté. L'ouvrage est complété par des généalogies simplifiées des familles royales de France, d'Angleterre, d'Aragon et des comtes de Toulouse, par 2 cartes, par des plans de Toulouse et de Muret, par des reproductions de photographies bien choisies. En somme, le livre le mieux au point actuellement sur la question, mais dont certaines conclusions tout au moins apparaissent comme discutables." (Ch. Samaran, Bibliothèque de l'École des chartes) — "On a tout dit sur cet ouvrage publié en 1942, aussi important que déplaisant à bien des égards. Son parti pris « anti-sudiste » et orthodoxe, son atmosphère de « révolution nationale » n'empêchent pas qu'il a fait justice de certaines exagérations, et qu'il a apporté un récit de la Croisade très documenté, grâce en particulier aux notes de Pascal Guébin, auquel un juste hommage est rendu par Belperron dans sa préface. Il était utile de réimprimer ce livre épuisé depuis longtemps." (Philippe Wolff, Annales du Midi, 1968)
La Croisade contre les Albigeois et l'union du Languedoc à la France (1209-1249).
Perrin, 1967, in-8°, 472 pp, 16 pl. de gravures et un tableau généalogique hors texte, 2 cartes sur les gardes, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
"Un livre qui manquait. Si M. Belperron est bien informé ; – et il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir les chapitres très nourris qu'il a écrits sur les origines, le développement, les résultats de la Croisade, il s'agit ici d'un livre à thèse, une thèse séduisante, mais qui ne recueillera certainement pas l'assentiment unanime. Pour M. Belperron, le programme de la papauté à l'égard de l'hérésie se résume dans le mot d'ordre “pax et fides” ; cet idéal d'ordre dans les choses et de discipline dans les âmes s'oppose à l'anarchie sociale, intellectuelle et religieuse des pays de langue d'oc aux XIIе et XIIIе siècles ; il se retrouve, au contraire, dans la France du Nord, aussi bien dans la dynastie capétienne de Louis VI à Philippe III que chez les seigneurs de l'Ile-de-France, comme Simon de Montfort, les uns et les autres bons catholiques, administrateurs consciencieux, accoutumés à la persévérance dans l'effort. L'annexion du Midi par les rois de Paris a été une étape nécessaire dans la formation de l'unité française. Quoi qu'il en soit, il convient de souligner que M. Belperron s'efforce toujours de rester impartial, malgré son désir de présenter en bonne lumière les faits favorables à sa thèse – c'est ainsi qu'il n'essaie pas de pallier l'atrocité des massacres ; il se contente de les expliquer par les mœurs du temps. Reconnaissons aussi qu'il abonde en aperçus ingénieux dont il faudra tenir compte, ne fût-ce que pour les discuter : par exemple, il réagit, avec raison, semble-t-il, contre la part exagérée donnée à l'aspect militaire de la Croisade, il insiste, également à bon droit, sur les éléments spirituels de l'affaire (continuité de vues des conciles méridionaux, importance des statuts de Pamiers, action administrative de la royauté et ď Alfonse de Poitiers). L'influence des croisades d'Orient, omise ou sous-estimée par les historiens modernes, est définie en termes brefs, mais précis. Les origines de l'Inquisition sont également restituées avec une grande clarté. L'ouvrage est complété par des généalogies simplifiées des familles royales de France, d'Angleterre, d'Aragon et des comtes de Toulouse, par 2 cartes, par des plans de Toulouse et de Muret, par des reproductions de photographies bien choisies. En somme, le livre le mieux au point actuellement sur la question, mais dont certaines conclusions tout au moins apparaissent comme discutables." (Ch. Samaran, Bibliothèque de l'École des chartes) — "C'est le texte même de l'ouvrage publié en 1942 par la librairie Plon qui vient d'être réimprimé. Seule la présentation est légèrement modifiée : reliure toilée sous jaquette, papier meilleur que celui de 1942, illustration en partie renouvelée. On a tout dit sur cet ouvrage, aussi important que déplaisant à bien des égards. Son parti pris « anti-sudiste » et orthodoxe, son atmosphère de « révolution nationale » n'empêchent pas qu'il a fait justice de certaines exagérations, et qu'il a apporté un récit de la Croisade très documenté, grâce en particulier aux notes de Pascal Guébin, auquel un juste hommage était rendu par Belperron dans sa préface. Il était utile de réimprimer ce livre épuisé depuis longtemps." (Philippe Wolff, Annales du Midi, 1968)
Histoire de Bel-Ile. Texte établi et présenté par Nicolas Tafoiry.
Rennes, Editions Ouest-France, 2005, gr. in-8°, 329 pp, notes, broché, bon état
Les aléas de l'histoire n'ont pas voulu que paraisse, il y a deux siècles et demi, cette Histoire de Bel-Île. Pressé par ses compatriotes, le Révérend-Père François-Marie de Bel-Île avait pourtant rédigé au beau milieu du siècle des Lumières le premier essai historique consacré à ce territoire qui n'a jamais été le plus négligeable de France. Sans s'embarrasser des exigences de l'historiographie moderne, les lignes inédites de ce manuscrit dévoilent l'histoire d'une île depuis ses origines jusqu'en 1750. Des événements qui rythment ce passé aussi riche que mouvementé, du génie de l'endroit qui y est particulièrement développé, jusqu'aux préoccupations des insulaires... l'auteur nous livre, avec ce tableau complet, un véritable témoignage sur cette île où il naquit en 1677. Dans ce passionnant entretien, ses opinions, sentiments et souvenirs personnels donnent une forme éminemment humaine à ce qui ne serait ailleurs qu'une suite de dates et de faits. Ainsi, à travers l'histoire du Révérend-Père François-Marie de Bel-Île, ce sont, en quelque sorte, les Bellilois du XVIIIe siècle qui nous content leur passé, nous confient leurs attentes dans l'avenir et, ce faisant, nous révèlent leur présent qui est devenu notre histoire.
Œuvres complètes. Chichois, poèmes, contes et épîtres, en vers provençaux, mêlés de vers français.
Marseille, Barlatier-Feissat et Demonchy, 1853, 2 vol. in-12, 301 et 304-(1) pp, un portrait gravé de l'auteur en frontispice, les 2 tomes reliés ensemble en un volume demi-basane bleu-nuit, dos lisse avec titres et fleurons dorés et faux-nerfs à froid (rel. de l'époque), pt accroc à la coiffe inf., un mors fendu sur 5 cm, bon état
Par le poète provençal d’inspiration marseillaise Gustave Bénédit (1802-1870). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages en vers français et provençaux, notamment la série de nouvelles autour du personnage de « Chichois ». Il fut élu en 1847 à l'Académie de Marseille. — "Vers 1840, les « nervis » sont, dans la presse et dans les jugements correctionnels, des ouvriers et des artisans tapageurs qui molestent les bourgeois et perturbent les réjouissances de la bonne société. Oubliés de la belle croissance libérale de la Monarchie de Juillet, ils révèlent l’existence d’antagonismes sociaux dans ce Marseille qui n’abrite pas encore de classe ouvrière particulièrement politisée. En cette même année 1840, Gustave Bénédit, professeur au conservatoire de Marseille et critique musical au Sémaphore, érige le nervi en personnage littéraire dans “Chichois vo lou nervi de Moussu Long” (“Chichois ou le nervi de Monsieur Long”). Il lui prête une mise recherchée mais outrancière, ainsi qu’un goût imparable pour l’indiscipline, le tapage et les plaisanteries douteuses. Le succès du portrait est tel, que le nervi devient bientôt un type marseillais incontournable. Ouvrier déviant, il n’est pas, jusqu’à la fin du Second Empire, un malfaiteur. Son personnage renvoie plutôt aux questionnements et aux inquiétudes identitaires polarisés sur l’idiome local, les usages, et les traditions, menacés par la modernité." (Laurence Montel, Marseille. Capitale du crime, 1820-1940) — "Les véritables titres de Bénédit à la notoriété sont ses poèmes en patois provençal : il a laissé dans ce genre de petits chefs-d'œuvre, notamment le Chichois, peinture spirituelle et exacte des mœurs populaires provençales." (François-Joseph Fétis et Arthur Pougin, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique. Supplément et complément. 1878-1880)
Procès verbal fait pour délivrer une fille possédée par le Malin Esprit à Louviers (1591). Publié d'après le manuscrit original et inédit de la Bibliothèque Nationale par A. Bénet. Précédé d'une introduction par B. de Moray.
P., Delahaye, aux bureaux du Progrès Médical, 1883, in-8°, cxiv-98 pp, broché, bon état- (Coll. Bibliothèque diabolique)
Relation du procès verbal, établi en 1591, concernant la possession et la guérison de Françoise Fontaine, infortunée servante à Louviers. — "De la Bibliothèque diabolique du Dr. Bourneville. Fort intéressante étude sur une possédée de Louviers, Françoise Fontaine, peu connue et généralement oubliée de ceux qui se sont occupés du satanisme et des possessions." (Caillet I, 946). Voir aussi Dorbon, 280.
Véhicules d'incendie des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.
La Seyne-sur-mer, Editions Carlo Zaglia, 2015, in-4°, 287 pp, 405 photos en couleurs, 3 cartes sur double page, reliure cartonnée illustrée de l'éditeur, bon état (Coll. Des camions et des hommes)
Un ouvrage exceptionnel sur les Soldats du Feu à travers la vie, les activités et le matériel roulant des sapeurs-pompiers des Bouches du Rhône. Au fil des chapitres, on apprend l’histoire des véhicules des soldats du feu, accompagnée de photos de leur évolution, on découvre aussi tous les types de véhicules utilisés aujourd’hui, avec un descriptif du type de mission ou de situation dans lesquels tel ou tel engin est utilisé, les différentes menaces justement auxquelles il est possible de faire face entre un feu domestique, un feu naturel, un feu industriel, etc. Enfin, le recueil s’achève sur une liste de tous les types de véhicules utilisés depuis les années 80 pour la lutte contre le feu dans le département, les marques, les modèles, la date et le lieu de la 1ère mise en circulation et même leurs plaques d’immatriculation ! Le service d’incendie des Bouches-du-Rhône, l'un des premiers Sdis de France, protège la population du département de tous les risques qui existent. Pour remplir ses missions de secours, le parc automobile du Sdis 13 est l’un des plus complets et des plus modernes de France, avec des choix technologiques hors du commun. Découvrez dans ce livre tous les véhicules du «13 », des fourgons aux échelles et des véhicules légers aux engins spéciaux, sans oublier l'importante force de frappe contre les feux de forêt !
La Provence et le Comtat Venaissin. Arts et traditions populaires.
Avignon, Aubanel, 1978, in-8°, 390 pp, 45 illustrations et 5 cartes, 32 pl. de photos hors texte, biblio, broché, couv. illustrée à rabats, MANQUE un cahier (pp. 117-126), sinon bon état
"De longue date Fernand Benoit s'était intéressé au folklore. Dans cet ouvrage substantiel, il donne une véritable somme de « ces petits faits que l'histoire et l'archéologie considèrent comme des broutilles » et dont il a tiré un exposé parfaitement scientifique. Lui- même écrivait dans son Avant-Propos : « L'enquête d'ethnographie folklorique rejoint le travail de laboratoire historique et archéologique qui ordonne des faits humains ». Après quoi il développe tout ce qui touche au langage, à l'habitat, au mobilier, au costume, à l'alimentation, aux âges de la vie, au travail agricole, aux métiers de la terre et de la mer, aux croyances et aux légendes, aux jeux et aux arts. Abordant même l'analyse des mentalités, il caractérise le peuple provençal « où le noble est rustique et le paysan propriétaire » et discerne chez lui à la fois « sociabilité et esprit démocratique ». Ce livre fortement documenté et toujours concret est peut- être celle de ses œuvres à laquelle il tenait le plus ; on y retrouve à toutes les pages ses sentiments de traditionaliste mistralien." (Jean-Rémy Palanque)
Ramond de Carbonnières. Procès du collier. La débâcle de Cagliostro.
P., Impr. générale Lahure, 1920, gr. in-8°, 341 pp, broché, bon état (Le passé du pyrénéisme. Notes d'un bibliophile). Edition originale (Labarère, 154). Rare
Une des premières études d'Henri Beraldi est consacrée à Ramond de Carbonnières (1753-1827), l'inventeur du Mont Perdu, à la fin du XVIIIe siècle, dans laquelle il nous donne l'idée d'un pyrénéisme qui possède une référence littéraire autonome : « Les Pyrénées n'existent que depuis cent ans. Elles sont “modernes”. Les Pyrénées ont été inventées par Ramond. »
Histoire de Bordeaux, contenant la continuation des dernières histoires de cette ville, depuis 1675, époque où elles se terminent, jusqu'en 1838 ; précédée d'un résumé des principaux événements rapportés dans ces mêmes histoires, depuis la fondation de Bordeaux. Nouvelle édition revue, corrigée (...) avec vues, portraits et cartes.
Bordeaux, de l'imprimerie de A. Castillon, 1839, fort in-8°, 527 pp, 2 gravures, 3 portraits (Tourny, Montaigne et Montesquieu) et 2 plans de Bordeaux dont un replié hors texte (un plan de Bordeaux en l'an 206 après J.C. et un autre levé en 1737), reliure demi-veau brun foncé, dos lisse orné en long, titre et fleurons dorés (rel. de l'époque), bon état
Par Pierre Bernadau (1762-1852). "« Avocat, journaliste, jurisconsulte, magistrat, poète, bibliographe, paléographe, historiographe, archéographe, viographe, membre de plusieurs Sociétés savantes, auteur des Antiquités bordelaises, du Panthéon d’Aquitaine, de la continuation des Chroniques de Bordeaux et de divers ouvrages de droit et de littérature, etc. etc. » , comme il aimait à se présenter lui-même, dans ses ouvrages, avec une certaine complaisance, il fut en conflit avec la plupart des littérateurs de sa génération, puis sévèrement critiqué par les suivants. Ceux-ci lui ont reproché, notamment, sa « période révolutionnaire » . Les circonstances ont fait qu’il fut l’un des seuls chroniqueurs de son temps à avoir traversé les événements dramatiques de la Révolution à Bordeaux et survécu à la Terreur." (Michel Colle, Revue historique de Bordeaux, 2015)
Itinéraires protestants dans le Gard et les Cévennes.
Uzès, H. Peladan, 1969, in-8°, 101 pp, 10 illustrations, broché, bon état
Notice historique sur le Collège de Beaupréau et sur M. Urbain Loir-Mongazon. Nouvelle édition revue, remaniée et complétée par l'abbé J. Moreau.
Angers, chez l'auteur et imprimerie Saint-Antoine, et Angers, J. Siraudeau, 1900 et 1903, 2 vol. gr. in-8°, 342 et 210 pp, 4 pl. de gravures hors texte dans le premier volume, appendices et pièces justificatives, reliures pleine toile rouge, dos lisses avec pièces de titre chagrin rouge, couv. conservées, bon état
Avec : Notice historique sur le collège de Beaupréau (suite de l’édition de 1900), 1831-1861. Angers, J. Siraudeau, 1903.
Histoire de Méréville et de ses seigneurs (Essonne). Edition du centenaire 1903-2003. Avec une biographie, une chronologie, un glossaire, un index par Pierre Saget.
Cholet, Editions Pays et Terroirs, 2003, in-8°, viii-249-149 pp, 18 gravures et portraits, broché, couv. illustrée, bon état (Saffroy II, 24370). Réimpression de l'édition de 1903, augmentée d'une biographie de l'auteur et de documents annexes, un des 270 ex. numérotés sur papier Velours, réservés aux souscripteurs
1903. Première édition de l'Histoire de Méréville et de ses seigneurs. Ce livre retrace l'évolution qui s'est produite durant le second millénaire sur ce territoire, composante du royaume de France dès 987 : le renouveau de la puissance locale, la modernisation de l'Etat royal depuis Henri IV, le pouvoir absolu avec Louis XIV, l'échec de réformes successives du XVIIIe siècle, refusées tant par la noblesse que par les bourgeois, qui ont ensemble conçu et théorisé la nouvelle force de pression, l'opinion, née des Lumières, et enfin la Révolution française. Au fil des pages, sur plus de cents terroirs, comme ceux de Glaire, de Saint-Lubin, de Méréville, de Saint-Père, mais aussi ceux d'Etampes, d'Orléans, de Paris, ce livre invite le lecteur à suivre la vie d'hommes et de femmes, illustres ou anonymes, petits et grands, gentilshommes et marchands, prévôts et curés, papes et rois, barons et laboureurs, et lui fera découvrir les coutumes et les lois qui régissaient leurs relations.
Nouville, un village francais.
P., Institut d'ethnologie, 1953, gr. in-8°, vii-447 pp, 17 figures, 4 planches hors-texte, broché, bon état. Edition originale (Travaux et mémoires de l'Institut d'ethnologie, LVII)
Magistrale étude d'ethnologie consacée à un village de Seine Maritime limitrophe de la Picardie. Publié par l'Ecole pratique des Hautes Etudes. — "Nouville est le nom d'une commune de 613 habitants en 1946, située sur la Bresle, aux confins de la Normandie et de la Picardie. Des verreries y sont installées depuis la fin du XVIIIe siècle, et le village a ainsi une double population, agricole et ouvrière. Ce fait explique sans doute, en partie, le choix de cette commune pour une étude aussi complète que possible, destinée à l'origine « à savoir s'il existe ou non une relation entre les traits du caractère individuel et les attitudes collectives » . Les auteurs, dont l'un est ethnographe et l'autre psychologue, ont résidé à Nouville plusieurs mois pour en observer tous les aspects. Les données relatives à la géographie, l'histoire, la démographie, au cadre économique, forment une sorte d'introduction. La partie centrale couvre le cycle de la vie individuelle, l'enfant et son éducation, l'adolescent jusqu'à son entrée dans la vie active, et à son mariage, la vie familiale, enfin la vieillesse et la mort. La vie collective est étudiée dans la troisième partie, dans un effort pour saisir derrière l'existence du groupe les valeurs qui l'animent, les représentations qu'il se forme du temps, de l'espace, des étrangers au groupe, et du monde dans son ensemble. Détails et observations assurent à cet ouvrage une attachante objectivité. Les auteurs présentent un remarquable travail." (A. G., Population, 1954)
Le Pays des Basques. Types et coutumes. Dessins originaux de Iñigo Bernoville.
P., Editions des Horizons de France, 1930, in-4°, 149 pp, environ 70 dessins en couleurs hors texte, reliure demi-chagrin lie-de-vin à coins, dos à 5 larges nerfs soulignés à froid, titres dorés, tête dorée, couverture illustrée et dos conservés (rel. de l'époque), bon état (Coll. Provinces de France - Types et coutumes)
La côte et le pêcheur ; Le paysage et le paysan ; La vie rurale et les métiers ; Le foyer ; La paroisse ; La danse, le jeu de pelote... « La pastorale basque dérive directement des soties et moralités du moyen âge. Elle a d'ailleurs été composée à cette époque, quoique assez profondément et à plusieurs reprises remaniée, surtout par les acteurs eux-mêmes (...) Le texte est en langue basque et en vers (...) L'humour est... fort gras (...) La plaisanterie la plus courante porte sur la facilité avec laquelle les filles du pays, perdent, avant leur mariage, leur virginité...» (p. 115)
Histoire de l'Ile-de-France.
P., Boivin, 1934 pt in-8°, xii-283 pp, 16 pl. de photos hors texte, broché, bon état (Coll. Les Vieilles provinces de France)
"Dans une collection qui compte déjà nombre d'estimables volumes, dont trois sont dus à la plume de chartistes, notre confrère M. Pierre Bernus a publié une histoire de l'Ile-de-France. C'était entreprendre une œuvre difficile. L'Ile-de-France n'est pas une région naturelle ; elle est formée d'éléments d'origine et d'aspects très divers groupés autour d'un noyau, qui est Paris. Ils sont picards, normands, champenois, orléanais, et le nom d'Ile-de-France ne devint usuel qu'au XVe siècle. Il fallait aussi se garder de répéter l'histoire de la royauté française et de donner à celle de Paris une place qui pour être légitime n'en eût pas moins été démesurée. Notre confrère a su éviter ces écueils et même donner à son livre un caractère un peu particulier, celui d'un vade mecum du visiteur de l'Ile-de-France, « qui y trouvera, pense-t-il justement, l'essentiel pour comprendre l'histoire, l'art et la nature d'une région qui est beaucoup plus variée qu'on ne se le figure en général, et qui est beaucoup moins connue qu'on ne le croit ». Pourtant, ce livre n'est pas un guide. Il est surtout l'histoire bien résumée des origines et de la formation de l'Ile-de-France. Aussi s'agit-il tout particulièrement, après les temps les plus reculés, du moyen âge. Notre confrère fait preuve d'une information aussi étendue et variée que précise. Son exposé est clair, il est le résultat de beaucoup de travail, et de multiples et judicieuses observations personnelles. Une soixantaine de pages seulement sont accordées à la période qui s'étend de la Renaissance à nos jours. Si notre confrère avait pu consacrer aux quatre derniers siècles un second volume, nul doute que ce volume n'eût été aussi suggestif que le premier. Son livre se lit avec profit, et l'illustration abondante et bien choisie contribue, elle aussi, à mieux faire connaître les caractères et les trésors de l'Ile-de-France." (Jean Cordey, Bibliothèque de l'École des chartes, 1934)
Histoire de l'Ile-de-France.
P., Boivin, 1934, pt in-8°, xii-282 pp, 16 pl. de photos hors texte, reliure demi-maroquin bordeaux, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres dorés, couv. conservées, bon état (Coll. Les Vieilles provinces de France)
"Dans une collection qui compte déjà nombre d'estimables volumes, dont trois sont dus à la plume de chartistes, notre confrère M. Pierre Bernus a publié une histoire de l'Ile-de-France. C'était entreprendre une œuvre difficile. L'Ile-de-France n'est pas une région naturelle ; elle est formée d'éléments d'origine et d'aspects très divers groupés autour d'un noyau, qui est Paris. Ils sont picards, normands, champenois, orléanais, et le nom d'Ile-de-France ne devint usuel qu'au XVe siècle. Il fallait aussi se garder de répéter l'histoire de la royauté française et de donner à celle de Paris une place qui pour être légitime n'en eût pas moins été démesurée. Notre confrère a su éviter ces écueils et même donner à son livre un caractère un peu particulier, celui d'un vade mecum du visiteur de l'Ile-de-France, « qui y trouvera, pense-t-il justement, l'essentiel pour comprendre l'histoire, l'art et la nature d'une région qui est beaucoup plus variée qu'on ne se le figure en général, et qui est beaucoup moins connue qu'on ne le croit ». Pourtant, ce livre n'est pas un guide. Il est surtout l'histoire bien résumée des origines et de la formation de l'Ile-de-France. Aussi s'agit-il tout particulièrement, après les temps les plus reculés, du moyen âge. Notre confrère fait preuve d'une information aussi étendue et variée que précise. Son exposé est clair, il est le résultat de beaucoup de travail, et de multiples et judicieuses observations personnelles. Une soixantaine de pages seulement sont accordées à la période qui s'étend de la Renaissance à nos jours. Si notre confrère avait pu consacrer aux quatre derniers siècles un second volume, nul doute que ce volume n'eût été aussi suggestif que le premier. Son livre se lit avec profit, et l'illustration abondante et bien choisie contribue, elle aussi, à mieux faire connaître les caractères et les trésors de l'Ile-de-France." (Jean Cordey, Bibliothèque de l'École des chartes, 1934)
 Write to the booksellers
Write to the booksellers