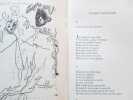837 books for « char rene »Edit
-
Type
Book (837)
Magazine (6)
-
Latest
Last 3 days (3)
Last month (23)
Last week (2)
-
Century
16th (1)
20th (482)
21st (30)
-
Countries
Belgium (35)
Brazil (3)
Canada (18)
Côte d'Ivoire (2)
France (636)
Germany (1)
Switzerland (148)
-
Syndicate
ALAC (14)
CLAM (5)
CLAQ (1)
CNE (1)
ILAB (364)
NVVA (1)
SLACES (1)
SLAM (305)
SNCAO (3)
Topics
- Abstract art (3)
- Aragon (3)
- Autographs (22)
- Avignon et comtat (2)
- Bachelard gaston (3)
- Ballard jean (2)
- Bibliography (3)
- Bibliophilism (14)
- Biography (2)
- Blanchot maurice (2)
- Braque georges (21)
- Caillois roger (6)
- Camus albert (8)
- Chagall marc (3)
- Christmas (6)
- Cocteau jean (3)
- Cubism (6)
- Dali (8)
- Desnos (3)
- Doisneau robert (2)
- Drawings (2)
- Early printed books (2)
- Earth (3)
- Eluard paul (33)
- Exhibition catalogue (4)
- Ferry jules (2)
- Fine arts (11)
- First edition (115)
- French literature (6)
- Gallimard (11)
- Guide books (2)
- Hemingway ernest (3)
- Holland (3)
- Hugo victor (5)
- Illustrated books (2)
- Industrial arts & crafts - fine arts (2)
- Kafka franz (2)
- Kandinsky (2)
- Klossowski de rola balthasar (2)
- Laude jean (3)
- Leiris michel (3)
- Léon paul (2)
- Levis (17)
- Leymarie jean (2)
- Literary review (6)
- Literature (40)
- Lorca fédérico garcia (4)
- Lyric (2)
- Man ray (3)
- Manuscripts (3)
- Matisse (4)
- Menard alias colin de lafferierre (2)
- Michaux henri (3)
- Miro (22)
- Modern comic (5)
- Modern illustrated book (5)
- Neruda pablo (4)
- Newspapers press (5)
- Painters (3)
- Painting (2)
- Painting (6)
- Paris (16)
- Paz octavio (4)
- Photography (2)
- Picasso (24)
- Pléiade & album de la (2)
- Poetry (156)
- Ponge francis (3)
- Provence (2)
- Queneau raymond (7)
- Reliure (2)
- Review (39)
- Reviews (8)
- Revue de l'art (4)
- Salvador (6)
- Sculpture (3)
- Shapes & colours (3)
- Sun (2)
- Surrealism (57)
- Tardieu andré (2)
- Theatre (11)
- Typography (19)
- Vellum (3)
- Vieira da silva (3)
- War (6)
- Woods & woods’ price lists (10)
- Zao wou ki (2)
Magritte, 1898 - 1967.
Bruxelles: Gallerie Isy Brachot, 1979 in-8, 56 pages, 43 illustrations. Broché.
Magritte, 1898 - 1967. Exposition: Galerie Isy Brachot, Bruxelles, 1979. [M.C.: catalogue d'exposition, Beaux-arts, peinture, Belgique]
L'Action de la Justice est éteinte.
Paris, Editions Surréalistes, 1931 In-4 de 1 f. bl., 34pp., (2) ff., 2 ff. bl., broché sous couverture rempliée, entièrement non rogné, étui bordé.
"Édition originale. Tirage limité à 100 exemplaires numérotés sur papier Vidalon à la forme, les cinq premiers imprimés en vert (et trois hors commerce); celui-ci n°14. Ce recueil de courts poèmes est contemporain des expérimentations collectives que mène alors Char avec Éluard et Breton. Il les complète et son importance est en partie due à ce qu'y résonne la voix propre de René Char, telle qu'elle se déploie pendant les cinq ans (1929-1934) où le surréalisme aura été pour lui, précisera-t-il dans une lettre à Benjamin Péret, ""tout au monde"". Le titre représente une citation partielle d'un passage du texte de Char À Rimbaud: ""L'action de la Justice est éteinte là où brûle, où se tient la poésie, où s'est réchauffé quelques soirs le poète."" Envoi autographe, au crayon, signé de René Char à Benjamin Cremieux. Benjamin Crémieux, écrivain et critique, pilier intellectuel de la N.R.F., faisait partie des quelques personnes capables de mesurer la portée de l'œuvre immensément exigeante de René Char. La convergence de leurs trajectoires n'en sera pas moins entièrement réalisée plus tard, sur un plan aussi ou plus élevé… Sous l'occupation, en effet, Crémieux, comme Char qui prend le maquis, s'engage de façon active et totale dans la Résistance. Membre du réseau Combat, il est arrêté en avril 1943 et meurt un an plus tard à Buchenwald. Exemplaire à l'état de neuf. Antoine Coron, René Char, BnF, n° 36. - P. A. Benoit, Bibliographie des œuvres de René Char, 5."


(CNE)
Phone number : + 33 (0)1 42 89 51 59
SALUT À RENÉ CHAR.
Supplément au n° 76 de la revue marseillaise SUD, paru après la mort de René Char, avril 1988. Plaquette in-8° agrafée. 20 pages. E.O. Propre.
Textes - surtout des poèmes - en hommage à René Char de Max Alhau, Gabrielle Althen, Simon Brest, Yves Broussard, Pierre Dhainaut, Jean Digot, Hughes Labrusse, Jacques Lepage, Daniel Leuwers, Jacques Lovichi, Benito Pelegrin, Gaston Puel, Jacques Phytilis, Dominique Sorrente, Jean-Max Tixier, André Ughetto. Sur les deuxième et troisième plats sont reproduits sept dédicaces autographes de René Char à certains de ces poètes régionaux.
Deux poèmes.
Exemplaire sur japon avec envoi Paris, Jean Hughes, (3 août) 1960. 1 plaquette (165 x 250 mm) non paginée de 2, [8] et 3 f. Broché, chemise et étui. Edition originale. Portrait photographique d'Éluard en frontispice et illustration réhaussée à l'aquarelle par René Char en couverture. Un des 50 premiers exemplaires sur japon (n° 3). Envoi signé : « pour Edmée Maus, ces poèmes fraternels. René Char ».
En 1937, Paul et Nusch Éluard viennent rejoindre René Char au Cannet où il poursuit sa convalescence avec son épouse, Georgette. C'est là que les deux poètes écrivent «Neuve» et «Paliers», textes qui ne seront publiés qu'en 1960 sous ce titre Deux Poèmes, ornés en couverture d'un dessin de René Char intitulé «La Torche du Prodige». L'éditeur Jean Hugues publia également deux autres recueils de Char : Arrière-histoire du poème pulvérisé, en 1953, avec une lithographie de Nicolas de Staël, et Se rencontrer, paysage avec Joseph Sima en 1973. Exemplaire offert par le poète à Edmée Maus : cette dernière a réuni à Genève l'une des plus importantes collections de livres des années 1950-1960, sur le modèle des grandes bibliothèques de la fin du XIXe. Après avoir collectionné les livres illustrés du XVIIIe siècle, elle se consacre au début des années 1950 aux débuts de l'imprimerie, ainsi que des des éditions et reliures contemporaines. Ce volume passa ensuite dans la collection de Bernard Loliée. Parfait état.
ARSENAL (L'exemplaire d' André Breton sur papier vert justifié par René Char)
de la main à la main, s.l. 1930. 1 volume in-4 (270 x 215 mm) broché sous couverture rouge (279 x 220 mm) imprimée du titre en noir sur le premier plat uniquement, 35 pp. + 2 fnch. Seconde édition, (en partie originale), du premier recueil de poèmes de René Char augmentée de cinq nouveaux, les quatorze originaux étant ici modifiés. Avec une illustration hors-texte du peintre catalan Francesc Domingo imprimée en noir. Aussi rare que la première (26 ex.) celle-ci a été tirée "qu'on le veuille ou non" à 39 exemplaires hors-commerce le 5 Février 1930 : 5 Vergé d'Arches + 7 sur Guérimand vert d'eau + 27 sur couché Prioux. Au colophon on lit : " Il est réconfortant de savoir que les imbéciles n'en sauront rien ". Celui-ci 1 DES 7 EXEMPLAIRES SUR PAPIER VERT, numéroté et justifié à l'encre par René Char "EXEMPLAIRE D'ANDRÉ BRETON". Sur le faux-titre, René Char a ajouté de sa plume "Pour distraire Madame Marcelle Ferry, cet ARSENAL, René Char". Le recueil est dédié à Paul Eluard.
Exemplaire des plus précieux et d'une magnifique provenance. Marcelle Ferry (1904-1985), "femme surréaliste" a alors une liaison amoureuse avec André Breton. Celui-ci lui dédicacera un exemplaire de Violette Nozière ainsi : "À Marcelle / le sureau noir / le cornouiller sanguin / le bois de Ste Lucie / et toutes les autres fleurs, à / langage hermétique". Ses premiers poèmes "L'Île d'un jour" ne paraitront néanmoins qu'en 1938 aux Éditions surréalistes. Préservé broché, en parfait état sans la moindre décoloration des papiers.
Sur la Poésie. Nouvelle édition augmentée.
Paris, G.L.M., Paris, G.L.M.1967 ; in-16 carré, broché. 50 pp., 3 ff.ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Ces réflexions sur la poésie avaient paru pour la première fois chez G.L.M. en 1958. Dix ans plus tard, Guy Lévis Mano imprime en caractères Bodoni cette nouvelle édition augmentée, à 998 exemplaires numérotés “Le poète est la partie de l’homme réfractaire aux projets calculés. Il peut être appelé à payer n’importe quel prix ce privilège ou ce boulet. Il doit savoir que le mal vient toujours de plus loin qu’on ne croit, et ne meurt pas forcément sur la barricade qu’on lui a choisi.”Un des 968 exemplaires sur bouffant fleur d’alpha (n° 160) offert par René Char au poète René Ménard. ENVOI AUTOGRAPHE sur un carton au verso du faux-titre “À René Ménard dans une pensée fraternelle qui ne l’a jamais quitté, année après année, René Char. Les Busclats 16.1.68”René Ménard (Paris 1908 - Fontainebleau 1980) avait publié des poèmes dans la revue Empédocle (dirigée par R. Char et A. Camus) au début des années 50. C’est à cette période qu’il s’était lié d’amitié avec Char, Guillevic, Follain.
L'Action de la justice est éteinte
Paris, Les Éditions Surréalistes, 1931. In-4, 33 pp., broché, couverture originale imprimée (minuscules déchirures et taches au dos).
Édition originale de ce recueil de poèmes de René Char. Un des 95 exemplaires imprimés en noir sur papier Vidalon à la forme, second papier après 5 exemplaires tirés en vert. Cet exemplaire est enrichi d'un envoi autographe signé de René Char à Tristan Tzara. Les deux hommes se sont probablement rencontrés dans les cercles surréalistes parisiens lors de la venue de Tzara à Paris. Ils adhèrent tous deux au mouvement en 1929 et Char dédie un de ses poèmes non publié au poète d'originale roumaine. Tzara rédigera le prière d'insérer du Marteau sans maître de Char en 1934. On joint un morceau de l'enveloppe avec l'adresse autographe de René Char. Exemplaire non coupé. Voir photographie(s) / See picture(s) * Membre du SLAM et de la LILA / ILAB Member. La librairie est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 19h. Merci de nous prévenir avant de passer,certains de nos livres étant entreposés dans une réserve.
Le temps de la poésie n° 6.- Poésie partagée: 49 poètes, 49 poèmes; 6 peintres, 6 dessins. Introduction par René Char.
GLM, Troisième Cahier du Temps de la Poésie, 1952 In-8 broché (22,7 x 14,5 cm), 52 pages. Textes et dessins, Introduction de rené Char. Tirage limité à 1080 exemplaires numérotés , celui-ci le n° 1071 sur papier vélin. Très bon état.
Fureur et mystère. Nouvelle édition.
Gallimard, 1986. Collection blanche. 1986. Nouvelle édition. In-8, br. 234 pages, taches sporadiques de café,dos un peu insolé. .
"Poète n'appartenant à aucune école, malgré quelques affinités avec les Surréalistes, Char ne cherche pas le scandale, il ne veut pas faire partie d'une « avant-garde » en rupture avec tout ce qui peut exister. Son seul souci est d'être, d'écrire au présent, de chercher une forme-sens en adéquation avec sa poésie : archaïque, originelle, existentielle. Une poésie portant les traces d'un patient travail sur le Dire du monde, le Faire du poète, l'Être de l'homme.René Char est né en 1907 à l'Isle-sur-la-Sorgue. Il est âgé de onze ans, lorsque son père décède. Il tente, un temps, de travailler dans le commerce, mais ses pas le mènent déjà vers la poésie. À vingt deux ans il écrit, en collaboration avec André Breton et Paul Éluard, Ralentir travaux. Son adhésion au mouvement surréaliste ne dure pas, mais il reste proche d'Éluard. Durant la seconde guerre mondiale il s'engage activement dans la Résistance. Après la guerre, il se consacre entièrement à son oeuvre, vouant sa vie à la poésie. Il participe en 1983 à l'édition définitive de ses Oeuvres complètes pour La Pléiade. Il meurt en 1988. " ( René Char Fiction Sublimes G. Plazy) Franco de port France jusqu'à 29 euros iclus. PAYPAL immédiat. MONDIAL RELAY pour : FRANCE, Portugal, Pologne, Espagne, Allemagne, Autriche, Pays Bas, Luxembourg, Italie, Belgique. Toutes les étapes sont accompagnées. Achat, estimations et listages (Papiers, Archives, monographies, arts et métiers, sciences humaines et bibliophilie) France / Suisse (sur rdv).
Exposition René Char.
Catalogue de l'exposition René Char au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris organisée avec le concours de la Fondation Maeght. Paris / Vence : Musée d'Art moderne de la ville de Paris / Fondation Maeght, 1971. Un volume 20,8x20,8cm broché sous couverture illustrée (Nicolas de Staël), non paginé. Catalogue présentant 831 oeuvres et pièces illustré dans et hors texte en noir et en couleurs de Georges Braque, René Char, Max Ernst, Alberto Giacometti, Vassili Kandisky, René Magritte, Joan Miro, Pablo Picasso, Nicolas de Staël, Zao Wou Ki, etc... COMPLET DE LA LITHOGRAPHIE EN COULEURS EN DOUBLE PAGE, reproduisant le poème enluminé "Six patiences pour Joan Miro" (Imprimerie Arte de Maeght). Textes de Jacques Dupin et Jacques Lassaigne. Exemplaire en bon état.
Tous nos livres sont visibles sur notre site : https://www.livrepoesie.com/
PAYS DE RENÉ CHAR.
Flammarion. 2007. In-4° broché. Jaquette illustrée. Documents et photographies à chaque page. 260 pages. E.O.
Très bon état.
René Char. Le Soleil des eaux : Spectacle pour une toile des pêcheurs. Paris, Radiodiffusion française, 29 avril 1948. Témoignages La Générosité des eaux, par Garnodier les Pêcheurs de la Sorgue, par Marius Dimier Évocation de l'armurier et d'Apollon, par Louis Curel de La Sorgue la Culture physique, par Edmond Desbonnet. Couverture de Mario Prassinos [Unknown Binding] Char, René; Curel de la Jongue, Louis; Desbonnet, Edmond and Dimier, Marius
Broché bon état .Contenu propre. Coiffe et pied de dos fragilisés.Couverture tâchée. 1951. 159 pages René Char. Le Soleil des eaux . PHOTOS SUR DEMANDE
Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence dans notre boutique à Authon-du-Perche.
Partage formel.
Paris, Marie-Françoise Dumur, 1982-1986. In-4 (300 x 245 mm), 43 ff. n. ch. Veau ivoire, décor de stries et d'aplats sur les plats, jeux d'ombres, titre et auteur sur le premier plat, dos muet, chemise, étui (Marie-Françoise Dumur, mars 1986).
Exemplaire unique. Cet ouvrage fut entièrement réalisé à la main par l'artiste Marie-Françoise Dumur. Le texte de René Char est entièrement manuscrit. L'ouvrage est décoré et illustré à l'aquarelle et à la gouache sur papier d'Arches. Il fut dédicacé par René Char : “A Marie-Françoise Dumur, reconnaissant et ici même. R. C.”, à qui l'artiste avait adressé une lettre pour le rencontrer. Le poète lui répondit qu'il la recevra: “en me réjouissant de connaître votre travail sur Partage formel.” Il cite le nom du grand historien Pierre Vidal-Naquet qui servit d'intermédiaire entre eux. La lettre et son enveloppe furent reliées dans l'exemplaire. Exceptionnelle réalisation originale et unique, qui fut appréciée par René Char.
Le Monde de l'art n'est pas le monde du pardon
Maeght 1974 In-4 en feuilles, couverture rempliée, emboitage éditeur
Edition collective rassemblant les textes et poèmes de René Char sur les artistes du XIX & XXéme siècle. Hors texte, reproductions en noir et en couleurs de Fantin-Latour, Valentine Hugo, Max Ernst, Jean Villeri, Balthus, Braque, Matisse, de Stael, Brauner, Louis Fernandez, Pierre Charbonnier, Miro, Lam, Picasso, Zao Wou-Ki, Vieira da Silva, Giacometti, Szenes, Sima, Boyan. Illustrations en noir dans le texte de Klee, Kandinsky, Jean Hugo. Très bon 0
Exposition René Char.
Musée d'art moderne de la ville de Paris, 1971. In-8 carré br. Catalogue de l'exposition René Char au Musée d'art Moderne avec le concours de la Fondation Maeght en 1971. Préface de J. Lassaigne. Texte de Jacques Dupin, diverses contibutions. Liste des oeuvres et documents exposés. Très importante iconographie en noir & blanc et en couleurs. E.O.
FUREUR ET MYSTERE. Poèmes.
Paris Gallimard NRF 1948 In-12 Broché, couverture illustrée
EDITION ORIGINALE en service de presse. EXEMPLAIRE DU GUY LEVI MANO portant cet envoi autographe : «à Guy Levis-Mano avec ma vieille amitié René Char ». Prospectus conservés. Très bon 0
Poèmes et proses
Paris N.R.F., Editions Gallimard 1957 In-12 Broché Ed. numérotée
Edition originale collective de ce choix établi par René Char, extraits de : Moulin premier- Placard pour un chemin des écoliers - Dehors la nuit est gouvernée - Fureur et mystère - Les Matinaux - A une sérénité crispé - La Paroi et la prairie - Lettera amorosa - Recherche de la base et du sommet - Poèmes des deux années - Le Deuil des Névons - La bibliothèque est en feu - Les Compagnons dans le jardin.> Un des 80 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma Navarre, troisième papier après 23 sur Hollande et 13 sur Madagascar. Bon 0
Feuillets d'Hypnos.
Paris, N.R.F., Coll. Espoir, 1946, in-12, broché, couverture imprimée, 97 p. Edition originale. Service de presse (après 23 ex. sur vélin pur fil Lafuma-Navarre). Très bel envoi autographe signé de René Char sur le faux-titre à Gaëtan Picon : “Parole, orage, glace et sang finiront par former un givre commun. Avec mon entière sympathie René Char”. Correction manuscrite de Char p. 67. Prière d’insérer joint.


Phone number : 33 01 48 04 82 15
Les cloches sur le coeur avec des dessins de Louis Serrière-Renoux.
[sans lieu], Le Rouge et le Noir, 1928. In-12 broché de 63-[9] pages, couverture de papier bleu pâle, imprimée en rouge et noir, non coupé. Pâles rousseurs sur les tranches et au dernier feuillet blanc, petite marque au second plat, sans gravité. Chemise, étui.
Illustré de 3 dessins en noir de Louis Serrière-Renoux. Édition originale tirée à seulement 153 exemplaires numérotés, celui-ci (n°48) un des 150 sur papier vergé. Premier livre de René Char, dont il détruira la plus grande partie des exemplaires, ce recueil rassemble les premiers poèmes écrits entre 1922 et 1926. Sur les tâtonnements et parfois les repentirs de René Char, on peut lire ce passage de José Corti dans ses Souvenirs désordonnés: "Un manuscrit de Char est toujours la recherche de la dernière perfection. Quand on en est à l'impression, le repentir intervient: un mot, une inversion et le livre n'est pas plutôt achevé que se révèle ce qui aurait pu le parfaire. Tel poème de quelques vers n'a pas eu moins de sept ou huit états dont chacun a été définitif pendant quelques heures ou quelques jours (...)".
LE SOLEIL DES EAUX. Spectacle pour une toile et des pêcheurs.
Paris Gallimard 1951 In-12 Broché Dédicacé par l'auteur
EDITION ORIGINALE en papier courant. >>EXEMPLAIRE DU GUY LEVI MANO portant cet envoi autographe : «à Guy Levis-Mano cette histoire d'homme clairs et d'une rivière sombre. Son ami de t.c. René Char ». Bandeau et prospectus conservés. Très bon 0
CHAR (René) -TARDIEU (Jean) - PENICAUD (Michel) - FORESTIER (Léon) - FAJON (Pierre) - LESCURE (Jean) - DUMAYET (Pierre) - LEIRIS (Michel) - FRENAUD (André) - SCHELER (Lucien) - QUENEAU (Raymond) - CREGUT (Robert) - DUBILLARD (Roland) - CATESSON (Jean) - GUILLY (René) - DESGRAUPES (Pierre) -
Reference : 43704
Messages n° I - II, octobre 1946 : Les mots et les signes.
Paris : Editions de Minuit, octobre 1946. Un volume broché (18,7x24 cm), (160) pages. Au sommaire : André Frenaud : Les poèmes du petit vieux, Raymond Queneau : Pictogrammes, René Char : L'extravagant, Jean tardieu : Les travaux du professeur Freppel, Jean Lescure : La Marseillaise bretonne. Couverture passée sinon bon état.
Revue dirigée par Jean Lescure qui comprendra 12 fascicules de janvier 1938 à octobre 1946. Dès 1942, soutenue par Jean Paulhan qui a dû abandonner la Nouvelle Revue Française à Drieu La Rochelle, elle devient la principale revue de résistance intellectuelle française en zone occupée. Comité de rédaction : René Char, André Frénaud, Michel Leiris, Jean Lescure et Raymond Queneau. Tous nos livres sont visibles sur notre site : https://www.livrepoesie.com/
Le soleil des eaux. Spectacle pour une toile des pêcheurs, illustré par Georges Braque.
Paris H. Matarasso 1949 1 vol. Broché in-4, broché, 146 pp. Edition originale sans les illustrations. Exemplaire sur papier ordinaire numéroté H.C. avec cette justification au stylo bleu de la main de René Char : "Il a été tiré à part, pour les amis de l'auteur, quelques exemplaires hors-commerce ne comportant pas les gravures". Et cet envoi à l'encre rose : "Pour Diane et pour Georges Bataille, cette lutte que les eaux ont emportée. Affectueusement, R. Char". Dos passé et fendillé, couverture partiellement brunie. Sinon bel exemplaire conservé sous un double emboîtage d'Elbel Libro.
Feuillets d'Hypnos.
Paris, N.R.F., Coll. Espoir, 1946, in-12, broché, couverture imprimée, 97 p. Edition originale. Exemplaires du Service de presse (après 23 ex. sur vélin pur fil Lafuma-Navarre). Très bel envoi autographe signé de René Char sur le faux-titre à Raymond QUENEAU : à Raymond Queneau quand le rocher et le foin avaient d’aussi bons yeux que nous, terriblement. De tout coeur René Char”. Correction manuscrite de Char p. 67 : évalue pour évolue. Prière d’insérer joint.


Phone number : 33 01 48 04 82 15
Seuls demeurent.
Paris, N.R.F., 1945, in-4, br., 90 p. Edition originale sur papier Châtaignier. Bel envoi autographe signé au peintre Pierre Charbonnier, dont l'univers touche le mien et le complète - fraternellement / René Char / L'Isle 4 juillet 1947. Deux manuscrits autographes (3 pages 21 x 29 cm) de René Char de deux des poèmes du recueil sont joints : Médaillon et Fenaison ce dernier poème comporte également une belle dédicace toujours à Pierre Charbonnier. Annotations d'ordre typographique à l'encre bleu et rouge et au crayon de Char.


Phone number : 33 01 48 04 82 15
A propos de “Claire”. Manuscrits autographes.
4 pages de divers formats, à l’encre noire. 1949-1950. Montage de textes critiques favorables à Claire, pièce en 10 tableaux de René Char, qui a soigneusement recopié de sa belle écriture les passages les plus saillants : “Livre incomparable, inentamable, qui est je crois bien, un chef d’oeuvre” Maurice Saillet. “La poésie de Char mêne les mots à leur éclatement et n’en laisse subsister qu’une poussière éblouissante... De cette fièvre de lumière, Claire donne en des tableaux qui se succèdent dans des milieux et des circonstances diverses la figure animatrice, la jeune fille irréductible à ces circonstances et à ces milieux vouée à des noces infinies, que symbolisel’immensité limpide et limoneuse d’un fleuve...” Georges Bataille. “Ce petit livre qui se veut “théâtre de verdure” est vaste et lourd de vraie poésie... René Char a su allier dans ce poème dialogué beaucoup de fraîcheur et de rigueur à beaucoup d’humanité”. France-Asie. Et coetera...


Phone number : 33 01 48 04 82 15
 Write to the booksellers
Write to the booksellers