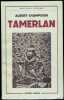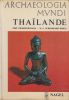Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (9)
19th (218)
20th (1942)
21st (182)
-
Syndicate
ILAB (2356)
SLAM (2356)
Le Pouvoir exécutif aux Etats-Unis. Etude de droit constitutionnel. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée. Avec préface de M. Pierre de Chambrun.
P., Librairie Thorin et fils, A. Fontemoing, éditeur, 1896, in-8°, xvi-336 pp, broché, couv. lég. salie, bon état (Coll. Bibliothèque de l’histoire du droit et des institutions)
Tamerlan.
Payot, 1957, in-8°, 246 pp, 7 cartes (4 sur double page), biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Bibliothèque Historique)
L'un des plus fameux conquérants de l'Orient. "L'auteur possède ce rare talent de réveiller un passé millénaire, d'animer des ruines enfouies sous les sables..." – "M. Albert Champdor a su joindre à la précision documentée de l'historien un sentiment très vif de la couleur..." — Timour, plus connu sous le nom de Tamerlan (du persan Timur(-i) Lang, qui signifie littéralement « Timour le Boiteux »), né à la fin des années 1320 ou en 1336, dans l'actuel Ouzbékistan, et mort en 1405 à Otrar dans l'actuel Kazakhstan, est un conquérant turco-mongol du XIVe siècle, le premier dirigeant de la dynastie des Timourides. Tamerlan mène des campagnes militaires à travers l'Asie occidentale, méridionale et centrale, le Caucase et le sud de la Russie, battant au passage la Horde d'Or, les Mamelouks d'Égypte et de Syrie, l'Empire ottoman émergeant, ainsi que le Sultanat de Delhi en Inde, et tente même de restaurer la dynastie Yuan en Chine. Se désignant lui-même comme « l'Épée de l'Islam », il émerge en tant que dirigeant le plus puissant du monde musulman. À partir de ces conquêtes, il fonde l'Empire timouride, qui se fragmente peu après sa mort. Commandant militaire invaincu, il est largement considéré comme l'un des plus grands chefs militaires et tacticiens de l'histoire, ainsi que comme l'un des plus brutaux et des plus meurtriers.
Tamerlan.
Payot, 1942, in-8°, 246 pp, 7 cartes (4 sur double page), biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Bibliothèque Historique)
L'un des plus fameux conquérants de l'Orient. "L'auteur possède ce rare talent de réveiller un passé millénaire, d'animer des ruines enfouies sous les sables..." – "M. Albert Champdor a su joindre à la précision documentée de l'historien un sentiment très vif de la couleur..." — Timour, plus connu sous le nom de Tamerlan (du persan Timur(-i) Lang, qui signifie littéralement « Timour le Boiteux »), né à la fin des années 1320 ou en 1336, dans l'actuel Ouzbékistan, et mort en 1405 à Otrar dans l'actuel Kazakhstan, est un conquérant turco-mongol du XIVe siècle, le premier dirigeant de la dynastie des Timourides. Tamerlan mène des campagnes militaires à travers l'Asie occidentale, méridionale et centrale, le Caucase et le sud de la Russie, battant au passage la Horde d'Or, les Mamelouks d'Égypte et de Syrie, l'Empire ottoman émergeant, ainsi que le Sultanat de Delhi en Inde, et tente même de restaurer la dynastie Yuan en Chine. Se désignant lui-même comme « l'Épée de l'Islam », il émerge en tant que dirigeant le plus puissant du monde musulman. À partir de ces conquêtes, il fonde l'Empire timouride, qui se fragmente peu après sa mort. Commandant militaire invaincu, il est largement considéré comme l'un des plus grands chefs militaires et tacticiens de l'histoire, ainsi que comme l'un des plus brutaux et des plus meurtriers.
Voiliers de John Chancellor.
Anthese, 1984, in-4° à l'italienne (37 x 28,5 cm), 80 pp, introduction de Austin Hawkins, abondamment illustré en noir et en couleurs dans le texte et hors texte, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état
Le deuxième ouvrage de John Chancellor (1925-1984) réunit dix-huit tableaux, accompagnés de l'histoire des hommes et des navires qu'il peignait. Ses qualités artistiques combinées à des recherches approfondies ainsi que sa connaissance de la mer (il passa 30 ans dans la marine) font de son œuvre un document remarquable sur l'héritage maritime britannique.
Les Frères Ennemis. La péninsule indochinoise après Saïgon.
Presses du CNRS, 1987, gr. in-8°, 369 pp, traduit de l'américain, préface de Jean Lacouture, chronologie, notes, index, broché, couv. à rabats, bon état
Un peu plus de 3 ans après l'évacuation de Saïgon du dernier Américain, répliquant aux agressions des Khmers rouges, les soldats vietnamiens envahissent le Cambodge, en décembre 1978. Deux mois plus tard, en représailles, la Chine lance une expédition punitive contre le Vietnam. Ce qui nous paraît un combat fratricide entre des peuples hier encore unis contre la puissance américaine traduit en fait la résurgence d'antagonismes séculaires, un temps masqués par la rhétorique de la fraternité révolutionnaire. Nayan Chanda montre comment la logique des conflits et alliances présentes – où Phnom Penh, Hanoi, mais aussi Pékin, Moscou et Washington sont parties prenantes – plonge ses racines dans le passé le plus lointain. Œuvre d'historien autant que de journaliste informé aux meilleures sources, ce livre constitue un témoignage capital pour comprendre les causes et les enjeux de la "Troisième guerre d'Indochine". — "Comment les trois partis communistes de la Péninsule, vainqueurs de leurs adversaires locaux soutenus par les États-Unis, en sont-ils venus à se faire la guerre, un affrontement impliquant l'intervention de la Chine populaire, auparavant alliée de ces mêmes communistes indochinois ? L'étude de ce redéploiement de l'échiquier politique extrême-oriental nous vient d'un historien réputé pour son sérieux. Son livre ne contient rien qui ait un caractère théorique ; une grande partie de la documentation est constituée par des sources orales (entretiens de l'auteur moins avec des décideurs qu'avec des exécutants de haut niveau), mais le résultat présente un grand intérêt ; il est même passionnant par endroits. Désormais, aucune étude historique de cette période et de la Péninsule ne saurait se passer du livre de Nayan Chanda. Il n'est pas superflu d'ajouter que l'auteur s'efforce à l'honnêteté et à déceler les responsabilités de chacun avec équité. Cela dit, ce sont tout de même les Vietnamiens qui nous apparaissent sous le jour le plus favorable..." (Pierre Brocheux, Revue française d'histoire d'outre-mer, 1990) — Collaborateur de la Far Eastern Economic Review, diplômé du Presidency College de Calcutta et docteur de la Sorbonne en relations internationales, Nayan Chanda est l'auteur de nombreux ouvrages sur la politique asiatique, la sécurité et les questions de politique étrangère.
Goa 1510-1685. L’Inde portugaise, apostolique et commerciale.
Autrement, 1996, gr. in-8°, 225 pp, 22 gravures, 3 cartes, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Conquise en 1510 par Afonso d'Albuquerque, à 400 km au sud de Bombay, Goa fut aux XVIe et XVIIe siècles l'un des plus grands ports de l'Asie, un carrefour du monde entre les civilisations hindoue, chrétienne et musulmane. Capitale des Indes portugaises et archevêché de l'Église d'Orient, elle comptait alors plus de 60 000 habitants et régnait sur des millions d'âmes. Saint François Xavier, dont le corps est toujours conservé et exposé dans l'église du Bon-Jésus, fut la figure emblématique et charismatique de la ville, qui vit nombre d'autres célébrités vivre en ses murs : Luís de Camões, Fernão Mendes Pinto, Garcia da Orta, etc. Mais la splendeur du pouvoir lusitanien et le rayonnement d'une culture profondément hybride et syncrétique connurent aussi leur « légende noire » que décrirent nombre de chroniqueurs et de voyageurs. Réputée la « ville la plus licencieuse d'Asie », Goa fut le cœur d'un empire maritime miné par la corruption, la débauche et les excès d'une inquisition impitoyable entre toutes. Au XVIIe siècle, les revers militaires subis devant les Hollandais provoquèrent la perte des monopoles commerciaux et le déclin de la ville, déjà décimée par des épidémies sans fin. La vieille cité fut abandonnée en 1685, et tomba peu à peu en ruines. L'État de Goa fut annexé par l'Union indienne en 1961.
La Bolduc. La vie de Mary Travers (1894-1941).
Québec, Isaac-Dion Editeur, 1992, in-8°, 213 pp, 27 photos et 2 fac-similés, discographie, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Mary Rose Anna Travers dite La Bolduc est une auteur-compositrice-interprète québécoise née le 4 juin 1894 à Newport et morte le 20 février 1941 à Montréal. Musicienne autodidacte, considérée comme la première « chansonnière » du Québec, elle a connu un succès phénoménal auprès du public québécois et la consécration par le biais du disque.
Nomades noirs du Sahara.
Plon, 1958, in-8°, 446 pp, 12 pl. de photos en noir et 2 pl. de photos en couleurs hors texte, 11 figures, 9 cartes et croquis, une grande carte dépliante in-fine, biblio, index, broché, bon état (Coll. Recherches en sciences humaines)
Sur les Toubous, les nomades sahariens noirs. — "Un « grand classique saharien » selon les termes de Théodore Monod, qui reste encore de nos jours le principal ouvrage de référence sur les Toubou. Ce livre n'a guère vieilli. Ses précieuses notations sur la mentalité et le mode de vie des Toubou restent très actuelles, tant il est vrai que dans ce milieu ingrat – sans doute plus qu'ailleurs – de telles choses sont longues à changer." (Catherine Baroin, L'Homme, 1983) — "On ne saurait trop recommander la lecture de cet ouvrage qui apporte de précieuses informations sur des nomades sahariens noirs peu connus, les Toubous. La richesse du texte n'a d'égale que la qualité de l'expression, toujours heureuse, alerte, élégante. La précision dans la description ethnologique n'exclut ni humour ni sourire... Un livre riche, passionnant à lire, accompagné de cartes, de croquis et de photographies éclairant les divers chapitres (Regards sur le passé ; le peuplement toubou ; l'exploitation du milieu saharien ; la vie domestique ; de la naissance à la mort ; la vie en société ; la religion des Toubous)..." (Guy Lasserre, Cahiers d'outre-mer, 1960) — "Vue ethno-sociologique d'un peuple noir au faciès europoïde, encore peu connu, vivant aux confins de la Libye, du Tchad et du Soudan, peuplant l'aride Tibesti et nomadisant, dans les régions les plus déshéritées du Sahara. Autochtones, semble- t-il, depuis les temps préhistoriques, 195.000 Toubous environ (évaluation de 1957), répartis en de nombreux clans très épars, ont su conserver leur indépendance, leurs mœurs, et bien qu'islamisés, échapper à « l'arabisation » оu à la « targuisation ». Cet éparpillement dans cet immense espace, se traduit par la diversité des dialectes tedas, de l'habitat, de l'activité, de la couleur de peau, etc. Leur régime clanique, de type patriarcal, revêt un caractère assez particulier, car tous les membres en sont égaux. Cependant les clans composés de Tedas et de Dazas constituent la classe sociale la plus élevée hiérarchiquement ; ceux des Azzas figurent au bas de l'échelle et se voient, de ce fait, contraints à l'endogamie..." (Population, 1959)
La Vie animale sous les tropiques. Mon observatoire aérien au Barro Colorado de Panama.
Payot, 1939, in-8°, 225 pp, 14 photos sur 4 pl. hors texte, 2 croquis, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Bibliothèque géographique)
L’auteur était conservateur au Museum d’histoire naturelle de New-York. Il a passé douze saisons sèches à Barro Colorado, la plus grande des îles du lac Gatun sur le canal de Panama. Elle est entièrement couverte de forêts et offre le plus grand intérêt pour y observer la vie à l’état primitif.
Le dernier convoi d'opium.
Editions S.E.S., s.d. (1950), in-8°, 234 pp, préface de Jean d'Esme, illustrations à pleine page de Théophile Jean Delaye, une carte, broché, couv. illustrée, bon état
La jeunesse passionnée de Gallieni. Les années d'apprentissage d'un grand Chef.
Bourg-en-Bresse, Éditions touristiques et littéraires, 1952, gr. in-8°, 124 pp, préface de l'amiral Lacaze, 6 photos, 7 fac-similés et une carte sur 10 planches hors texte, qqs figures dans le texte, broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s. à Pierre Chanlaine
"Le général Jean Charbonneau, dont nous avons signalé à plusieurs reprises les ouvrages historiques, et notamment en 1950 un substantiel “Galliéni à Madagascar”, nous donne un nouveau livre consacré à ce dernier sous le titre “La jeunesse passionnée de Galliéni”. L’auteur a eu la bonne fortune de retrouver dans les Archives de la Marine deux études écrites au Sénégal en 1877 par le futur Maréchal alors lieutenant, et de pouvoir consulter le carnet de notes personnelles de celui-ci de 1876 à 1879. Ce précieux carnet, propriété de la famille Galliéni, présente cette particularité d’être rédigé presque entièrement en allemand, en italien et en anglais, comme son titre même, assez cocasse : Erinnerungen (souvenirs) of my life (de ma vie) di ragazzo (de garçon). À l’aide de ces documents, le général Jean Charbonneau trace du jeune Galliéni un portrait psychologique, dans lequel il étudie successivement l’homme dans sa vie intérieure et son comportement extérieur, l’officier français avec ses belles qualités et ses petits travers, l’officier colonial dont il montre, au cours de circonstances critiques, parfois tragiques, la formation tactique, la formation politique, la formation morale. Ce livre est agrémenté de plusieurs fac-similés des notes ou travaux de Galliéni, ou de ses photos comme « brution » (élève du Prytanée militaire), « cyrard » et jeune officier." (Edmond Delage, Revue Défense Nationale, 1953)
Guinée. Photographies de Marc Riboud et Bernard Charles.
Lausanne, Editions Rencontre, 1963, pt in-4°, 222 pp, texte sur 2 colonnes, 48 pl. de photos hors texte, illustrations et gravures anciennes dans le texte, carte, reliure cartonnée illustrée de l'éditeur, soulignures stylo, bon état (Coll. Atlas des Voyages)
L'Âme musulmane.
Flammarion, 1958, pt in-8°, 284 pp, broché, bon état (Coll. Bibliothèque de Philosophie scientifique)
Il ne s'agit pas d'une étude sociojuridique mais d'une approche psychologique et sociologique, d'une telle qualité d'observation et d'analyse, qu'elle transcende les quelques préjugés émis sur la civilisation arabo-islamique. Une vision complète de l'homme islamique par un Français de profonde culture chrétienne, ayant su marier ses connaissances universitaires avec une longue expérience en milieu arabo-berbère. Un livre qui « nous fait toucher du doigt le noeud gordien qui entrave l'Islam moderne. (...) Le mérite principal de « L'âme musulmane » demeure de poser en toute clarté le grave problème, surmonté mais non résolu par l'Islam, qu'est celui d'une coexistence fructueuse entre le profane et le sacré. » (Slimane Zeghidour)
L'Âme musulmane.
Casablanca (Maroc), Editions Eddif, 1997, in-8°, iv-284 pp, avant-propos de Slimane Zeghidour, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Bibliothèque arabo-berbère)
Un grand titre oublié : L'âme musulmane du juriste français Raymond Charles, publié en 1958. Il ne s'agit pas d'une étude sociojuridique mais d'une approche psychologique et sociologique, d'une telle qualité d'observation et d'analyse, qu'elle transcende les quelques préjugés émis sur la civilisation arabo-islamique. Ce texte, nourri de faits et d'exemples concrets, a été redécouvert par le journaliste Slimane Zéghidour, qui a tenu à le présenter car, selon lui, il “nous fait toucher du doigt le noeud gordien qui entrave l'Islam moderne”. Le préfacier ajoute : “Le mérite principal de L'âme musulmane demeure de poser en toute clarté le grave problème, non résolu par l'Islam, qui est celui d'une coexistence fructueuse entre le profane et le sacré”. “L'âme musulmane” est aussi une vision complète de l'homme islamique par un Français de profonde culture chrétienne, ayant su marier ses connaissances universitaires avec une longue expérience en milieu arabo-berbère.
Histoire de l'établissement, des progrès et de la décadence du christianisme dans l'empire du Japon, ou l'on voit les différentes révolutions qui ont agité cette monarchie pendant plus d'un siècle. Par le R. P. de Charlevoie [sic].
P., Bureau de la Bibliothèque catholique, s.d. (1828), 2 vol. in-12, (4)-xxiv(2)-362 et (4)-476 pp, reliures pleine basane blonde racinée, dos lisses ornés de fleurons, filets et roulette, pièces de titre et de tomaison basane noire, tranches marbrées (rel. de l'époque), coiffes frottées, bon état
Première réédition de cette œuvre parue originellement en 1715, elle a été publiée en même temps dans la bibliothèque catholique à Lyon chez Rusand. Après une description du Japon et des mœurs de ses habitants, l'ouvrage raconte le début du christianisme au Japon vers le milieu du XVIe siècle par Saint François Xavier. Après une bonne réception, les choses se dégradent assez vite et les premières persécutions commencent en 1597. En 1614, le Shogun de la dynastie des Tokugawa interdit le Christianisme.
La Société victorienne.
Armand Colin, 1978, in-12, 222 pp, biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. U Prisme), envoi a.s. des deux auteurs à Lucien Genet
"Tous deux spécialistes reconnus de la Grande-Bretagne, M.C. et R.M. partagent, disent-ils, le même enthousiasme pour l'époque victorienne ; cela nous vaut, en deux cents petites pages qui se lisent comme un roman, un tableau complet, coloré, précis, nuancé d'une société qui, à bien des égards, préfigure la société britannique d'aujourd'hui. Epoque de transition, de contrastes violents, de bouleversements sociaux et économiques profonds, le règne de Victoria a vu la fin de l'Angleterre terrienne et aristocratique, la naissance des classes moyennes, l'explosion démographique et urbaine, l'expansion de l'impérialisme fondé sur un libéralisme conquérant, l'élargissement du monde politique et l'avènement d'une démocratie moderne. Autant de phénomènes qui sont ici remarquablement restitués grâce à une étude très sérieusement documentée et argumentée." (Revue française de science politique, 1979)
La Tunisie et la Tripolitaine.
Panazol, Editions Lavauzelle, 2002, in-8°, iii-443 pp, reliure demi-basane acajou mouchetée de l'éditeur, dos à 4 faux-nerfs, bon état. Réimpression de l'édition de 1883
L'auteur, ayant quitté l'Egypte en pleine insurrection militaire, a parcouru la Tunisie et la Tripolitaine dans les meilleures conditions pour bien voir. Il a trouvé dans ces deux pays, dans le second surtout, une situation sur laquelle les événements d'Egypte excerçaient une grande influence... (Avertissement) — Table : D'Alexandrie à Malte ; Malte ; La situation militaire et politique ; La commission financière ; Les capitulations ; Les consulats ; Le protectorat ; L'organisation administrative ; L'occupation militaire ; Les critiques contre l'occupation ; L'Algérie et la Tunisie ; L'Italie et la Tunisie ; Les travaux publics ; L'avenir de la Tunisie ; Tripoli ; L'agitation islamique ; Les troupes turques ; Les Arabes et les Senoussia ; Commerce, influence française. — "Gabriel Charmes publie en 1883 un ouvrage intitulé “La Tunisie et la Tripolitaine”, se composant d'une série de lettres parues dans “Le Journal des Débats” durant l'été 1882. L'auteur semble regretter l'absence de mise en valeur d'un pays que l'Europe toute entière a semble-t-il confié à la France, alors que dans le même temps, l'Angleterre a, selon lui, remarquablement mis en valeur l’Égypte. Il affirme donc que la Tunisie « possède un climat doux, une terre sablonneuse, des coteaux parfaitement exposés au soleil et garantis de tous les vents. La vigne y pousse avec une vigueur remarquable ». Dans l'esprit de Gabriel Charmes, il s'agit de survaloriser un territoire, en jouant sur l'imaginaire des Européens à son égard, dans le but d'encourager la colonisation." (Nessim Znaien, Les Raisins de la domination. Histoire sociale de l’alcool en Tunisie à l’époque du Protectorat (1881-1956), 2017)
Voyage en Syrie, impressions et souvenirs.
Calmann-Lévy, 1891, in-12, iii-327 pp, modeste reliure demi-toile vermillon, dos lisse avec titres et fleuron dorés, charnière de la page de titre consolidée avec une bande de papier blanc, état correct. Edition originale
"En 1883, le journaliste Gabriel Charmes (1850-1886) se rend en Syrie et observe sa société bigarrée. Il réserve 124 pages à Beyrouth et 55 autres au Mont-Liban. Sa perspicacité se révèle lorsqu'il aborde les contradictions et les maux dont souffre le pays, et en particulier les méfaits du communautarisme : « On s'aperçoit tout de suite qu'on est dans une contrée où le despotisme turc est tempéré par une demi-liberté. La vie déborde de ces hauteurs pittoresques, chargées de maisons et de cultures ; on dirait un coin de l'ancienne Phénicie ; mais on reconnaît la Syrie actuelle quand on pénètre dans les rues de Beyrouth. Voilà bien la ville moderne, telle que le goût oriental l'a faite, avec ses constructions bizarres, son mélange perpétuel d'élégance criarde et de pauvreté naïve, ses fantaisies européennes et ses souvenirs asiatiques, ses combinaisons imprévues de tous genres, de tous les styles, de toutes les modes, et malgré ces affreux disparates, avec son charme persistant et son indestructible attrait. [...] Aujourd'hui la transformation est complète ; le présent a mis partout son cachet. Les vieux murs sont tombés pour permettre à Beyrouth de s'étendre et de se donner l'air d'une grande ville ; il n'y a plus de créneaux, plus de tours, plus d'ogives, presque plus de minarets ; les navires à voiles ont fait place à de leurs bateaux à vapeur ; le port s'est élargi ; des milliers de constructions modernes se sont dressées dans tous les sens ; le moyen âge a complètement disparu, et c'est en vain que la rêverie chercherait un coin d'ombre et de fraîcheur, dans cet amas informe de bâtiments, qui rappelle Alexandrie et l'union bâtarde du goût oriental avec les nécessités européennes. [...] En dépit de son déguisement moderne, Beyrouth est restée une ville du moyen âge. Les couvents et les églises dominent chacun de ses quartiers, et s'ils n'ont plus l'élégance d'autrefois, c'est qu'ils ont dû y renoncer pour gagner en importance et en étendue. Je ne connais pas de ville, sauf Jérusalem, où l'on se sente plus complètement plongé dans une atmosphère religieuse. Mais Jérusalem a conservé son aspect antique, c'est une ruine du passé ; tandis qu'à Beyrouth la religion se mêle à tous les actes de la vie moderne. Elle n'y domine pas seulement le présent, elle y prépare l'avenir. Toutes les écoles sont confessionnelles, toutes les politiques le sont également. On est d'un parti parce qu'on est d'une religion ou d'une communauté. Personne n'est syrien : les musulmans sont turcs ; les chrétiens sont français, autrichiens, italiens ou russes ; les druzes sont anglais. [...] Il se passera bien des années encore, avant que l'esprit scientifique fasse assez de progrès en Orient pour y remplacer l'esprit religieux d'aujourd'hui. Un Oriental qui renonce à son culte ne devient pas plus libre penseur, qu'il ne devient Européen en s'habillant à la française... Ce qui m'a particulièrement frappé à Beyrouth, c'est de voir combien une société pouvait faire de progrès incontestables vers la civilisation sans sortir des formes religieuses auxquelles elle est habituée depuis des siècles. » (pp. 131, 134, 162 et 181)." (Abdallah Naaman, Le Liban, Histoire d'une nation inachevée, 2016)
La vie musulmane en Algérie d'après la jurisprudence de la première moitié du XXe siècle.
PUF, 1965, gr. in-8°, xvi-393 pp, préface de Jacques Berque, glossaire, broché, bon état (Bibliothèque de Sociologie contemporaine)
"A partir du dépouillement de la jurisprudence des tribunaux algériens en matière dite « musulmane » et des arrêts de la Chambre de révision de la Cour d'appel d'Alger qui assumait depuis 1892 une tâche de normalisation, J.-P. C. tente de déceler, à travers les litiges, les tensions qui se manifestaient dans la vie quotidienne en Algérie jusqu'aux lendemains de la Seconde guerre mondiale : tensions familiales, lutte pour la terre (la moitié des crimes ruraux étaient commis à propos de litiges fonciers), rôle du musulman algérien dans la vie publique, apparition du « militant ». Également riche en enseignements sur les mécanismes et la pratique de la justice en Algérie – où s'enchevêtraient un droit musulman déformé par les mœurs locales et une législation française aux buts parfois divergents, ce tableau vivant de la société algérienne doit son intérêt à la connaissance directe que possède J.-P. C. de la psychologie musulmane. D'autre part, les faits ici relatés le sont moins pour éclairer la règle juridique que pour témoigner de la réalité sociale. J.-P. C. multiplie volontairement la description des situations et des personnages pour donner au récit un caractère concret et vivant." (Revue française de science politique, 1966)
Thaïlande.
Nagel, 1976, gr. in-8°, 269 pp, 261 illustrations hors texte dont 93 en couleurs, une carte, notes, biblio, index, reliure éditeur, jaquette illustrée, bon état (Coll. Archaeologia Mundi)
Voyage à Canton, capitale de la province de ce nom, à la Chine; par Gorée, le Cap de Bonne-Espérance, et les Isles de France et de la Réunion; suivi d'observations sur le voyage à la Chine, de Lord Macartney et du Citoyen Van-Braam, et d'une Esquisse des arts des Indiens et des Chinois.
Amsterdam, Time-Life Books, 1984, in-8°, viii-607 pp, reliure plein cuir havane de l'éditeur, dos à 4 faux-nerfs, pièces de titre cuir carmin avec titres et filets dorés, doubles filets d'encadrement et titre dorés au 1er plat, tranches dorées, bon état (Coll. Classiques de l'exploration). Réimpression de l'édition de Paris, 1799 (Cordier, Bib. Sinica, 2105)
Récit d'un voyage en Chine par Joseph François Charpentier de Cossigny, ancien Ingénieur du Roi, ayant fait sa carrière à l'Ile de France (Ile Maurice). Ce voyage vers la Chine fut entrepris en 1753, sous le règne de Louis XV. L'auteur ne fit paraître ses mémoires que plus de quarante ans après son périple. — "Tout ce qui regarde l'Inde et la Chine paraît avoir droit à la curiosité du public. Il s'est empressé de lire les relations des ambassades anglaise et hollandaise, auprès de l'empereur de la Chine. On y trouve en effet des détails très curieux... (...) Cependant ces deux ouvrages [de Macartney et Van Braam] m'ont paru incomplets dans bien des points, inexacts dans quelques-uns, fautifs dans quelques autres. Leurs auteurs n'ont pas pris, sur les arts et sur la législation des Chinois, les renseignements que les circonstances les mettaient à portée d'obtenir. Ils ne nous ont pas fait connaître l'esprit des lois qui sont le plus opposées à nos usages, à nos mœurs, à nos principes. Ces considérations m'ont déterminé à faire part au public de mes observations sur les deux ouvrages que je viens de citer. Je les ai étendues, lorsque le sujet m'a paru susceptible de développement, ou lorsqu'il m'a conduit à des résultats qui peuvent intéresser le lecteur. (...) Enfin je donne une esquisse incomplète des arts des Chinois, sur lesquels j'ai pris des notions dans le cours de mes voyages à la Chine ; mais dont une partie exige des recherches plus exactes. En attendant, l'esquisse que je donne des arts des Chinois, ne sera peut-être pas sans utilité. Elle détaille quelques procédés nouveaux ; elle en indique d'autres qui sont totalement ou partiellement inconnus en Europe ; elle donne quelques recettes dont l'efficacité est constatée par l'expérience. Elle mettra les artistes ingénieux sur la voie des découvertes."
L'Afrique Ardente. 150 croquis à la plume de l'auteur.
P., La Caravelle, 1925, in-12, 165 pp, typographie verte sur papier beige, broché, couv. illustrée, bon état. Edition originale, un des 200 ex. numérotés sur Alfa ivoire, envoi a.s.
Poèmes sur le Sud tunisien, de Bizerte à Ben Gardane. Précédé d'une Note de l'auteur où il précise que « Ce livre est un carnet de route : “L'Afrique Ardente” – poèmes et dessins –, et donc, en fin de compte, un livre véritablement documentaire. »
Le Tour du Monde. Nouveau journal des voyages. Deuxième semestre 1891.
Hachette, 1891, in-4°, 427 pp, 313 gravures sur bois dans le texte et hors texte, 4 cartes, reliure demi-basane havane, dos lisse, titres dorés (rel. de l'époque), pas de rousseurs, bon état
Le Transcanadien et l'Alaska, 1890, par E. Cotteau - Du Niger au Golfe de Guinée, 1887-1889 (suite), par le capitaine Binger - La Sardaigne, 1890, par Gaston Vuillier - A travers l'Arménie russe, 1890 (suite), par Mme B. Chantre - De Paris au Tonkin à travers le Tibet inconnu, 1889-1890, par Bonvalot.
Le Tour du Monde. Nouveau journal des voyages. Premier semestre 1882.
Hachette, 1882, in-4°, 430 pp, 301 gravures sur bois dans le texte et hors texte, 9 cartes et plans, reliure demi-basane rouge époque, dos à 4 nerfs lég. épidermé, pt manques de papier au 1er plat, rousseurs éparses, état correct
Pélerinage au Nedjed, berceau de la race arabe, par Lady Anna Blunt. - Voyage de la "Vega" autour de l'Asie et de l'Europe, par Nordenskiold. - La Belgique, par Camille Lemonnier. - La Syrie d'aujourd'hui, par M. Lortet. - Voyage d'exploration à travers la Nouvelle-Grenade et le Venezuela, par le docteur Crevaux. - A travers la Toscane, par E. Müntz. - Excursion au Samourzakan et en Abkasie, par Mme Carla Serena.
Scènes des camps et des bivouacs hongrois pendant la campagne de 1848-1849. Extraits des mémoires d'un officier autrichien...
P., Eugène Didier, 1855 in-12, xxiv-327 pp, reliure demi-basane bleu-nuit, dos lisse, titres et triples filets dorés (rel. de l'époque), bon état. Edition originale, envoi a.s.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers