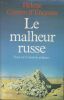Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (9)
19th (218)
20th (1942)
21st (182)
-
Syndicate
ILAB (2356)
SLAM (2356)
Géographie de la circulation sur les continents.
Gallimard, 1946, in-8°, 296 pp, 32 illustrations hors texte, biblio, broché, nombreuses soulignures crayon bleu, état correct (Coll. Géographie humaine)
La circulation et le genre de vie - Les moyens de transport et le milieu naturel - La circulation et le peuplement.
Tefedest. Méharée au Sahara central.
Arthaud, 1953, in-8°, 266 pp, une carte en frontispice, 32 photographies de Georges Bourdelon reproduites en héliogravure, préface de Raymond Coche, broché, jaquette illustrée, bon état (Coll. Les Clefs de l'aventure)
Les péripéties de la mission archéologique française qui parcourut la vaste chaîne granitique de la Tedefest d'octobre 1949 à mars 1950 à la recherche de gravures et peintures rupestres (Mission Hoggar 1950). Cette mission comprenait Louis Carl et Joseph Petit, ainsi que Georges Bourdelon et Robert Guérard. Les deux premiers étaient chargés d’une importante exploration longeant en partie la Téfedest blanche à l’ouest, puis l’intégralité de la Téfedest noire, à l’est. La méharée de Carl et Petit a été racontée dans “Tefedest”, un ouvrage remarquable de véracité, écrit avec beaucoup d’humour.
Sur les routes de la mer avec les Messageries Maritimes.
P., André Bonne, 1968 gr. in-8°, 249 pp, 20 pl. de gravures et photos hors texte, carte, annexes, broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s.
"Directeur de la compagnie des Messageries maritimes, Roger Carour nous donne dans ce livre un bilan historique complet de cette entreprise depuis ses débuts en 1851, alors que la France devait rattraper son retard sur les compagnies anglaises, américaines, allemandes. Du berceau méditerranéen, il nous entraîne à la conquête de nouveaux océans vers l'Amérique du Sud, l'Extrême-Orient, l'Océan Indien. Il montre bien comment l'ouverture du canal de Suez précise en quelque sorte sa vocation. Les conquêtes coloniales de la IIIe République assurent l'essor des Messageries qui connaissent au début du siècle des années difficiles. L'auteur nous conduit jusqu'aux problèmes contemporains de la concurrence aérienne, et des nécessaires adaptations. Une bibliographie sommaire (exclusivement maritime) garantit le sérieux de l'histoire commerciale et maritime. Il faut remercier l'auteur de nous donner une perspective historique complète du domaine colonial vu par les compagnies de navigation." (R. Cornevin, Revue française d'histoire d'outre-mer, 1968) — "Ce livre retrace l'histoire d'une grande Compagnie de navigation qui, pendant plus d'un siècle, a fait flotter le drapeau français sur toutes les mers du globe. La vie d'une entreprise est un long et dur combat et celui qu'a mené les Messageries Maritimes depuis 1852 en est un vivant exemple. Etablir des relations maritimes entre la métropole et des pays situés aux quatre coins du monde, construire et entretenir une flotte capable de les assurer, créer le réseau commercial indispensable au succès de l'affaire, lutter contre l'incompréhension de certains, l'hostilité des autres, édifier en somme une entreprise a l'échelle mondiale capable de défendre, partout ou elle se trouve, le prestige de la France et ses intérêts, voilà la tâche immense accomplie par ceux qui, tour à tour, ont servi cette grande Maison ou présidé a ses destinées. L'auteur est un Breton, né a Lorient; il aime la mer et les marins et aussi la Compagnie dont il est Directeur Général, Nul mieux que lui ne pouvait évoquer, dans ces annales, les heures graves et passionnantes qu'ont vécues les dirigeants de la Société, leurs joies mais aussi les jours de deuil, d'angoisse, et faire revivre les drames, les aventures cocasses parfois, auxquels ont assisté ou participé les équipages des navires au cours de leurs longs voyages. Cet ouvrage donnera au lecteur un bel exemple de ce que peuvent faire les hommes qui ont du courage, de la volonté et aussi la foi dans le destin de l'entreprise qu'ils servent." (4e de couverture)
Le Malheur russe. Essai sur le meurtre politique.
Fayard, 1988, fort in-8°, 547 pp, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Pour Hélène Carrère d'Encausse, l'histoire russe peut s'analyser comme une histoire continue du meurtre politique... Pour échapper à ce cycle fatal, estime à juste titre l'auteur au terme de cet essai fort instructif, une ultime exécution est indispensable, celle de Lénine lui-même, l'idole embaumée qui continue de trôner dans son mausolée de la place rouge. Les lecteurs d'Hélène Carrère d'Encausse connaissaient déjà l'ampleur de son information, la rigueur de ses analyses, la pondération de son jugement : ils découvriront, ici, avec plaisir, d'autres facettes de son talent, un don d'évocation, un sens de la mise en scène, un art du portrait qui lui permettent de redonner vie de manière admirable au passé de la sainte Russie, si riche de crimes effrayants et de figures atroces. Sous nos yeux, se déroule le reportage dont le commentaire est parfait. — "A qui tente d'établir un atlas et une chronologie des meurtres politiques, trois évidences s'imposent. Nulle société n'a été continûment à l'abri du meurtre politique sous ses aspects divers. Mais il est des temps historiques où le meurtre connaît une fortune remarquable: le XVIe siècle européen, par exemple ; ou encore le XXe, où, sous la forme de la terreur de masse et des mouvements terroristes, il gagne plus ou moins tous les continents. Il est aussi des moments où le meurtre politique régresse et apparaît plutôt comme un moyen exceptionnel de résoudre des conflits de pouvoir. Pourtant, à cette conception qui met à un moment ou à un autre toutes les cités sur le même plan et qui fait du meurtre politique la clé des épisodes tragiques de leur histoire, un pays – peut-être pas le seul, mais son exemple est le plus éclatant, s'agissant d'un grand pays d'Europe – fait exception: la Russie. L'histoire de ce pays dans lequel Tocqueville, lorsqu'il scrute l'avenir, discerne qu'il est appelé "par un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans ses mains la moitié du monde" à égalité avec les seuls Etats-Unis, dont il dit que le monde "découvrira tout à la fois la naissance et la grandeur", est avant tout une histoire continue du meurtre politique. Du moment où se fonde la Russie, au IXe siècle, et où commence sa christianisation, jusqu'à l'apogée prévue par Tocqueville, il n'est guère de génération qui n'y ait assisté, pétrifiée, à l'éternelle liaison entre meurtre et politique. Les temps de répit, dans ce pays, ce sont les guerres et les invasions qui les ont apportés, autres formes de violence et de mort, mais dont l'avantage est qu'agissant de l'extérieur, elles unissent pour un temps pouvoir et société contre l'ennemi porteur de mort. Cette longue tradition meurtrière a sans nul doute façonné une conscience collective où l'attente d'un univers politique pacifié tient peu de place, tandis que la violence ou sa crainte y sont profondément ancrées. De ce malheur si profondément ressenti à tous les âges, que les esprits superficiels nomment l'âme russe, l'on peut se demander où est la cause, où est l'effet. Est-ce le meurtre politique trop longtemps utilisé qui a produit une conscience sociale malheureuse et soumise, et, par là, incapable d'imposer, comme ailleurs, un autre cours au politique? Ou bien est-ce cette conscience malheureuse, épouvantée, qui appelle sur elle, sinon la colère des dieux, du moins le déchaînement des meurtriers." (Hélène Carrère d'Encausse)
Nicolas II. La Transition interrompue. Une biographie politique.
Fayard, 1996, in-8°, 552 pp, 4 cartes, sources et biblio, généalogies, index, reliure souple éditeur illustrée lég. abîmée, bon état
Le règne du dernier empereur de Russie a-t-il marqué l'inexorable déclin d'un régime ne pouvant déboucher que sur une rupture violente et radicale – celle d'octobre 1917 – ou bien recelait-il les éléments d'une transition interrompue ? S'attachant au destin du dernier tsar de Russie, l'ouvrage soulève une multitude de questions. Plus que tout autre, Nicolas II, héritier des réformes d'Alexandre II, a œuvré pour la modernisation de son pays, apportant des changements profonds à l'Etat, à la société et à l'économie russes. L'échec et la révolution étaient-ils alors inscrits dès le départ dans le processus de modernisation ? Faut-il accepter l'idée défendue par certains historiens que toute tentative de réforme est en Russie condamnée à ouvrir la voie à la barbarie ? Ou bien peut-on regarder le stalinisme puis la stagnation néostalinienne comme une funeste parenthèse ? Tel sont les thèmes sous-jacents de cette chronique et analyse du règne de Nicolas II.
Nicolas II. La Transition interrompue. Une biographie politique.
Fayard, 2007, in-8°, 552 pp, 4 cartes, sources et biblio, généalogies, index, broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s.
Le règne du dernier empereur de Russie a-t-il marqué l'inexorable déclin d'un régime ne pouvant déboucher que sur une rupture violente et radicale – celle d'octobre 1917 – ou bien recelait-il les éléments d'une transition interrompue ? S'attachant au destin du dernier tsar de Russie, l'ouvrage soulève une multitude de questions. Plus que tout autre, Nicolas II, héritier des réformes d'Alexandre II, a œuvré pour la modernisation de son pays, apportant des changements profonds à l'Etat, à la société et à l'économie russes. L'échec et la révolution étaient-ils alors inscrits dès le départ dans le processus de modernisation ? Faut-il accepter l'idée défendue par certains historiens que toute tentative de réforme est en Russie condamnée à ouvrir la voie à la barbarie ? Ou bien peut-on regarder le stalinisme puis la stagnation néostalinienne comme une funeste parenthèse ? Tel sont les thèmes sous-jacents de cette chronique et analyse du règne de Nicolas II.
Le Mouvement national palestinien.
Gallimard/Julliard, 1977, in-12, 218 pp, 8 cartes dans le texte, biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Archives)
Et s'il y avait, en deçà des empires d'autrefois, des royaumes d'hier et des Etats de demain, une histoire de la Palestine ? C'est à la retrouver que s'attache cette évocation par les textes, avant l'occupation de 1967, avant la partition de 1948, pour comprendre l'explosion du mouvement national provoqué depuis dix ans par ce que les Palestiniens ont ressenti comme une "invasion sioniste". Une foule de textes, pour la première fois réunis, et souvent pour la première fois traduits (du document officiel à la poésie militante) raconte les grandes espérances et les grandes épreuves. Par un expert des deux côtés reconnu, un dossier qui se voudrait éloquent, utile, efficace.
Essai d'une carte des sols de Madagascar. Par Henri Besairie.
Service des Mines de Madagascar, 1946, (50 x 74), * pp, carte imprimée en noir et rouge sur papier fort, bon état
Explorateurs et explorations.
Larousse/Paris-Match, 1974, in-4°, 400 pp, nombreuses illustrations et cartes en noir et en couleurs, biblio, index, reliure toile éditeur, jaquette illustrée (lég. défraîchie), bon état
Alexandre le Grand, Jean du Plan Carpin, Guillaume de Rubroek, Marco Polo, Ibn Battuta, Hernan Cortés, Francisco Pizarro, les Jésuites, Cartier, Champlain, Marquette, La Salle, Lewis et Clark, Alexandre de Humboldt, Livingstone et Stanley, la conquête des Pôles
Mes vacances au Brésil.
Desclée de Brouwer, 1928, pt in-8°, 186 pp, 20 illustrations au trait par N. V. Cambier, couv. illustrée, C. de bibl.
A Class-Book of Irish History, with maps and illustrations.
London, Macmillan & Co, 1957-1959, in-8°, 176-180-176-176 pp, 98 gravures et cartes, index, reliure toile verte éditeur, qqs rares marques au crayon dans les marges, état correct. Book I. From the Earliest Times to the Norman Invasion (1169). Book II. From the Norman Invasion to the flight of the Earls (1607). Book III. From the Earls to the act of Union (1800). Book IV. From the act of Union (1800).
Des toits sur la grève. Le logement des travailleurs et la question sociale à Bombay (1850-1950). (Thèse).
Armand Colin, 2013, in-8°, 412 pp, 4 photos, 12 cartes, 5 plans, 4 schémas, 11 tableaux, 5 graphiques, glossaires, sources, biblio, index, broché, bon état (Coll. Recherches)
Bombay, capitale indienne de l'économie et des services, forte de 20 millions d'habitants, s'est hissée au rang de cinquième métropole mondiale. Pôle d'attraction des migrations, sa croissance s'est faite au prix de fortes inégalités, si bien qu'aujourd'hui plus de la moitié de la population de la ville vit dans des bidonvilles, sur 6 % de la superficie urbaine. Ce problème crucial n'est pas récent. La question du logement des plus pauvres a en effet émergé, dès le tournant du XXe siècle, comme une question politique majeure. Les autorités coloniales, puis le Parti du Congrès à partir des années 1930, ont choisi d'en faire l'un des principaux terrains du traitement politique de la question sociale. Réfutant une approche longtemps prédominante dans le domaine de l'histoire urbaine des mondes coloniaux, selon laquelle l'urbanisme colonial est un processus imposé par le haut, cet ouvrage démontre combien le gouvernement colonial a été perméable à l'agitation sociale, qu'il a tenté de juguler en construisant des immeubles pour loger la main-d'oeuvre industrielle, jetant littéralement des toits sur la grève. L'intérêt manifesté par les autorités pour ce problème et leur intervention précoce dans cette sphère ont également contribué à l'émergence de nouveaux terrains de négociation et de confrontation entre les travailleurs et le pouvoir, et de moyens de lutte spécifiques, comme la création de syndicats de locataires des classes populaires. Fruit d'un travail mené à partir d'archives en partie inédites, cette étude apporte un éclairage nouveau sur la nature et les mécanismes de la domination coloniale, tout en complétant l'analyse des formes de mobilisation des travailleurs urbains indiens, qui s'était jusqu'alors limitée à la seule sphère du travail. Elle fournit, enfin, une perspective historique sur l'un des processus les plus marquants de la production de l'espace à Bombay, l'accaparement des ressources urbaines par les classes les plus aisées, établissant le rôle qu'y ont joué les autorités coloniales et les élites indiennes.
Un théâtre d'ombres. La politique impériale au Brésil, 1822-1889.
P., Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1990, gr. in-8°, vi-208 pp, traduit du portugais, 7 illustrations, lexique, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Phénomène unique dans l'Amérique indépendante – mise à part la tragique et brève expérience du Mexique –, la monarchie brésilienne garantit, pendant cette longue période, la stabilité politique du pays grâce à un accord implicite et instable entre le roi et les propriétaires terriens : en assurant l'ordre social, le roi assure leur pouvoir ; en prônant des réformes sociales (comme l'abolition de l'esclavage), il blesse profondément leurs intérêts matériels. La vie politique présente ainsi des caractéristiques théâtrales ; là réside le secret de l'apparente stabilité du système et de sa réelle fragilité.
Le Royaume-Uni de 1815 à 1914.
CDU, 1963, in-4°, 189-(3) pp, texte dactylographié, broché, bon état (Coll. Les cours de Sorbonne)
Le Royaume-Uni en 1914.
CDU, 1964, in-4°, 73 pp, texte dactylographié, broché, qqs annotations stylo, bon état
The Aztecs: People of the Sun.
Norman, University of Oklahoma Press, 1958, pt in-4°, xvii-125 pp, 42 superbes illustrations dans le texte et à pleine page, imprimées en 6 couleurs, des divinités et cérémonies aztèques par Miguel Covarrubias, plus 16 pl. de photos hors texte, index, reliure toile éditeur, jaquette illustrée (jaquette abîmée avec mque au 2e plat), bon état (Civilizations of the American Indian Series, 50). Edition originale. Texte en anglais
Alfonso Caso y Andrade (1896-1970) est un archéologue qui a apporté une contribution importante aux études précolombiennes dans son Mexique natal. Caso croyait que l’étude systématique des anciennes civilisations mexicaines était un moyen important de comprendre les racines culturelles mexicaines. Miguel Covarrubias (1904-1957), est un peintre et caricaturiste mexicain, mais également un ethnologue et historien de l'art autodidacte.
La Découverte du Nouveau Monde (XVe siècle).
Albin Michel, 1966, in-8°, 420 pp, une pl. en couleurs hors texte, 18 gravures et cartes hors texte, chronologie, biblio, index, broché, couv. illustrée à rabats, bon état (Coll. Le Mémorial des siècles)
"La découverte du Nouveau Monde au XVe siècle fut un événement capital dans l'histoire du monde. L'ouvrage comprend une large introduction, véritable exposé général, due à Jean Cassou. Cet exposé est excellent. Rédigé de façon claire, vivante, vibrante même, il est complet et sous bien des rapports nouveau. Il souligne, en particulier le rôle capital joué par le Portugal dans la découverte du Nouveau Monde. Les relations contemporaines, souvent dramatiques, toujours intéressantes, sont tirées de la “Chronologie de la découverte du Nouveau Monde” ; de “l'Histoire de la conquête des Canaries”, par le sieur de Béthencourt ; de “La vie et les voyages de Christophe Colomb”, racontés par son fils, Fernand Colomb ; de Pierre Martyr d'Anghiera, « De orbe novo » ; du « Routier », journal du voyage de Vasco de Gama aux Indes Orientales ; de la “Lettre de Américo Vespucci, sur les îles nouvellement découvertes dans ses quatre voyages” ; enfin des “Colonisateurs vus par un colonisé” (série de dessins de 1613). Il faut les lire et ils donnent à réfléchir. Ils permettent de pénétrer dans l'ambiance de cette époque difficile, dans la vie quotidienne des explorateurs, de connaître leurs impressions, leur étonnement, et leurs angoisses. Un très beau livre." (J. M., Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 1967)
Les Conquistadors.
Gallimard, 1941, in-8°, 244 pp, 16 gravures et photos hors texte, une carte, reliure pleine toile écrue, pièce de titre basane carmin (rel. de l'époque), bon état (Coll. La Découverte du monde)
Histoires de pouvoir.
Gallimard, 1978, in-8°, 278 pp, traduit de l'anglais, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Témoins)
Sur une place publique de la ville de Mexico, un homme agonise sous les yeux de Castaneda et de don Juan ; sur une autre place, le présage attendu par le disciple se présente sous les traits d'une belle jeune femme, à la tombée de la nuit. Parcs urbains encombrés de passants et de badauds, marché, restaurant, compagnie d'aviation, tels sont les cadres choisis par le «maître», habillé en citadin, pour libérer progressivement son disciple des contraintes de la raison et pour lui faire assumer pleinement sa condition de «guerrier». Confronté à des expériences inexplicables mais convaincantes, Castaneda franchit les étapes qui séparent le «guerrier» de «l'homme de connaissance». À la fin du récit, quand don Juan dévoile l'explication des sorciers, en analysant les principales expériences que l'auteur avait vécues dans les précédents ouvrages, l'apprenti deviendra sorcier lui-même, dans un dénouement terrifiant et surprenant. Castaneda déploie les ailes de sa perception et franchit les portes de l'inconnu, pour lequel il n'y a plus d'explication. Car malgré tous les éclaircissements, les actions merveilleuses des sorciers ne seront pour le lecteur que des histoires, des «histoires de pouvoir».
Le Don de l'Aigle.
Gallimard, 1982, in-8°, 292 pp, traduit de l'anglais, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Témoins). Edition originale française (il n'est pas mentionné de grands papiers)
Depuis le jour où l'étudiant en ethnologie Castaneda a rencontré pour la première fois le maître Juan Matus, le chemin parcouru a été très long à la fois dans l'espace, dans le temps et par-delà l'espace et le temps. De ce voyage vers la tierce attention, nous ne possédions jusqu'ici que des jalons épars – les ouvrages où Castaneda retraçait les expériences vécues par le disciple, telles que celui-ci les avait ressenties dans l'instant. Avec Le don de l'Aigle, l'apprenti passé maître a enfin la possibilité de prendre un certain recul par rapport au vécu et de jeter sur l'ensemble de son cheminement un regard qui intègre contradictions apparentes et incertitudes. Don Juan n'apparaît plus soudain comme un maître exceptionnel isolé mais comme le maillon d'une longue chaîne, un Nagual parmi d'autres Naguals, choisi par son benefactor pour constituer un clan de guerriers, réceptacle d'une tradition ancienne, et chargé de transmettre à un autre Nagual la règle qui est une carte – le don de l'Aigle.
Le Feu du dedans.
Gallimard, 1985, in-8°, 282 pp, traduit de l'anglais, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Témoins)
Le feu du dedans n'est pas seulement la reprise et l'approfondissement des notions familières de «voir» et de l'«aigle», cette instance suprême introduite par Castaneda dans Le don de l'Aigle et dont les émanations sont à la fois la source et l'aboutissement de la perception et de la conscience. L'architecture du mythe s'enrichit ici de nouveaux thèmes : l'«impulsion de la terre», le «monde de l'homme», la «tanière de la perception», le «point d'assemblage». Ce dévoilement progressif débouche sur la vision d'un univers remarquablement foisonnant et cohérent. L'évolution de la «connaissance», depuis l'époque des anciens voyants toltèques - prodigieusement doués mais victimes «par fascination» de leurs découvertes - jusqu'à celles des naguals du clan de don Juan, est exposée et commentée tout au long du livre dont elle constitue le contrepoint permanent. En sorte que Le feu du dedans prend souvent l'allure d'un traité du bien et du mal, de la sagesse et de la folie.
Histoire des peuples d'Europe centrale.
Fayard, 1994, gr. in-8°, 528 pp, 8 cartes, chronologie, biblio, index, reliure souple illustrée de l'éditeur, bon état
Les peuples de l'Europe centrale ont partagé tous les grands moments de l'aventure européenne – féodalité, Réforme et Renaissance, Lumières, révolution libérale et capitalisme. Cet ouvrage voudrait fournir les points de repère de leur histoire millénaire. Une histoire riche en bouleversements politiques – des Habsbourg aux Ottomans, l'Europe centrale fut souvent dominée par des dynasties étrangères – et marquée par deux siècles de luttes religieuses. Une histoire que l'on ne peut envisager dans une optique nationale et qu'il faut replacer dans un contexte plus large : les Polonais ne sont devenus une nation qu'après avoir vu disparaître leur État en 1795, tandis que les Tchèques n'ont pris conscience de leur spécificité qu'en rejetant une culture allemande qui les avait dominés pendant dix siècles. Ce n'est en effet qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale que furent créés de nouveaux États dits "nationaux". Mais les vainqueurs ne purent faire coïncider les États et les nations : la Tchécoslovaquie était multinationale, la Pologne comptait 33 % d'allogènes, et la Hongrie vaincue avait deux millions de Magyars à l'extérieur de ses frontières. Les démocraties formelles qui avaient été instaurées à Budapest, à Varsovie, à Vienne débouchèrent rapidement sur des dictatures. Seule la Tchécoslovaquie se révéla fidèle aux démocraties occidentales, qui l'abandonnèrent aux appétits du IIIe Reich. Le rêve fou de Hitler de construire un "espace vital" pour le peuple allemand entraîna tous les peuples d'Europe centrale dans la Seconde Guerre mondiale. Le sort des armes offrit les peuples "libérés" à la volonté de Staline qui allait faire de l'Europe centrale un glacis de l'URSS. Le réveil des revendications nationales, conjugué au marasme économique des démocraties populaires, conduisit en 1989 aux "révolutions de velours", sonnant le glas des pouvoirs marxistes.
Vers le Nil français avec la Mission Marchand.
Flammarion, s.d. (1898), in-8°, 437 pp, un portrait photo de l'auteur en frontispice, 150 gravures d'après les photographies et les dessins de l'explorateur dans le texte et hors texte, reliure demi-chagrin carmin, dos à 4 nerfs soiulignés à froid, titres et fleurons dorés (rel. de l'époque), coupes frottées, bon état
En 1896, le directeur de "L'Illustration" propose à Charles Castellani (1838-1913), peintre militaire et illustrateur, de se joindre à la Mission Marchand qui va remonter le cours du fleuve Oubangui. Voyage mouvementé qui lui permet néanmoinst de dessiner et de peindre à loisir. Il arrêta son voyage à Bangui. La Mission Marchand quitta la France en quatre fractions dont les départs s'échelonnèrent du 25 avril au 25 juin 1896. La « course au Nil » était engagée contre les concurrents anglais : Kitchener, Colvile, et belges : Dhanis, Chaltin. Marchand envisageait d'atteindre Brazzaville dès la fin du mois d'octobre 1896, Bangui en novembre-décembre et le Bahr el Ghazal à la fin de 1897. La « visite » à Fachoda devait avoir lieu à ce moment. Marchand en aurait rapporté les témoignages d'amitié destinés à renforcer la position de la France lors de la grande conférence internationale sur le Nil que la diplomatie française aurait alors suscitée.
Tebessa. Histoire et description d'un territoire algérien.
P., Henry Paulin et Cie, s.d. (1905), 2 vol. gr. in-8°, xiv-192 et 252 pp, préface du Dr Alcide Treille, Sénateur de Constantine, nombreuses illustrations photographiques dans le texte, 2 cartes en couleurs repliées in fine, les 2 tomes reliés ensemble en un volume demi-chagrin carmin, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres et caissons dorés richement ornés, encadrements à froid sur les plats, fer de prix doré de la ville de Paris au 1er plat, tranches dorées (rel. de l'époque), très bon état
Ouvrage très documenté, riche et précis, par Pierre Castel, lieutenant du bureau arabe de Tébessa. — "On serait heureux d'avoir, pour nombre de nos départements français, une étude aussi complète, aussi minutieuse que celle dont le lieutenant Pierre Castel s'est tracé le cadre. Tebessa n'est plus aujourd'hui un nom ignoré, plus ou moins mystérieux. Il évoque le souvenir de gisements de phosphate presque célèbres et surtout l'image de ruines romaines, de monuments historiques... Mais l'auteur du livre dont je parle, qui a profité de sa fonction d'adjoint au bureau des affaires indigènes pour rechercher toutes sortes d'informations, ne s'est pas borné à nous décrire les pierres respectables et les vestiges lointains. C'est tout un coin de la vie musulmane, de l'activité algérienne qu'il dévoile à nos yeux. Le cercle de Tebessa n'est pas, au surplus, un district rétréci, exigu. Ses dimensions seraient plutôt celles d'un très grand département de la métropole. Il est étrange de noter les transformations qui s'accomplissent dans une société, quand la justice est exactement rendue et que les écoles prospèrent. Autrefois, les trois tribus qui résident dans les contours du cercle : les Brarcha, les Alaaoua, les Oulad Sidi Abid, en venaient fort aisément aux mains et les étrangers qui traversaient la région passaient de très mauvais quarts d'heure. Les vieilles chansons exaltent encore les époques de guerres, de carnages et de rapt. Maintenant les descendants des farouches aventuriers arabes se contentent de faire paître leurs troupeaux sur les hauts plateaux et d'aller vendre leurs bœufs ou leurs vaches dans les grands marchés des oasis. (...) Nos soldats ne devaient entrer dans la vieille ville qu'après la prise de Constantine, et encore furent-ils appelés par les discordes des tribus. Le 2 juin 1842, le général de Négrier, après une marche forcée de 50 kilomètres, plantait nos couleurs sur la forteresse romaine le lendemain il se retirait, emportant les clefs de la place, mais il avait eu le tort de trop se fier à la loyauté des gens de Tebessa, car en franchissant un passage scabreux, il fut attaqué par la horde des Nemencha qui lui tuèrent un certain nombre d'hommes. Durant des années et des années, il fallut guerroyer, mener des colonnes dans les oasis. L'occupation opérée par le général de Saint-Arnaud, en 1851, n'amena qu'un semblant d'ordre et de paix ; le tempérament d'une race ne se modifie point en un jour, et en 1871 encore, la grande vague d'insurrection qui sillonna l'Algérie ne laissa pas indemne la frontière tunisienne. Aujourd'hui, Tebessa jouit d'une administration qui lui assure le calme et la sécurité, et qui s'efforce de lui restituer la richesse perdue. Les gisements de phosphate faciliteront cette tâche de civilisation, les cultures diverses favorisées et propagées par des officiers et des fonctionnaires intelligents constituent d'excellents éléments. Si nous avons pris comme exemple ce petit cercle de l'extrême Est algérien, c'est qu'il synthétise et symbolise à merveille notre œuvre africaine..." (Jean Frollo, Le Petit Parisien, 10 janvier 1905)
El ferrocarril de Panamá y su historia.
Panama, Imprenta nacional, 1932, in-8°, vii-145-vi pp, 15 pl. de gravures et photos hors texte, biblio, broché, 1er plat lég. sali, bon état. Edition originale, envoi a.s. Texte en espagnol. Rare
 Write to the booksellers
Write to the booksellers