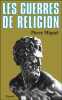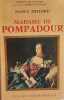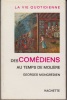-
Type
Book (2343)
Magazine (3)
-
Latest
Last month (21)
Last week (1)
-
Century
16th (1)
17th (28)
18th (99)
19th (407)
20th (1661)
21st (116)
-
Countries
France (2345)
Switzerland (1)
-
Syndicate
ILAB (2336)
SLAM (2336)
Le Confesseur du Roi. Les directeurs de conscience sous la Monarchie française.
Fayard, 1988, fort in-8°, 556 pp, liste des confesseurs des rois de France, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Les Guerres de Religion.
Fayard, 1980, fort in-8°, 596 pp, une carte du voyage de Charles IX en France, généalogie simplifiée des familles princières, chronologie, biblio, index, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
Du premier martyr protestant – en 1523 – au dernier pasteur persécuté – à la fin du XVIIIe siècle – l'affrontement des deux religions, la catholique et la réformée, fit des centaines de milliers de victimes dans toutes les régions de France, et pas seulement à Paris : les villes, les villages et jusqu'aux familles étaient divisées. Dans les deux partis, l'enchaînement de la peur et de la violence conduisait aux pires excès. Le lent combat des huguenots pour la liberté, la longue marche des catholiques pour la réforme de l'Eglise ont touché de près tous les Français, dans le flamboiement sauvage du XVIe siècle. Les idées de Luther et de Calvin n'ont pas apporté que la guerre et la torture. Elles ont fait entrer les Français, à toute allure, dans le monde moderne où chacun choisit et défend passionnément sa religion, au péril de sa vie...
La mission secrète de Mirabeau à Berlin (1786-1787), d'après les documents originaux des Archives des Affaires étrangères. Avec introduction et notes par Henri Welschinger.
Plon, 1900, gr. in-8°, 522 pp, copieuse introduction de Henri Welschinger (86 pp), notes sur les diverses éditions, index, broché, dos abîmé recollé, état correct
"La partie essentielle de ce livre est la réimpression de “l'Histoire secrète de la cour de Berlin”. M. W. a retrouvé aux archives étrangères les originaux des lettres de Mirabeau, les textes revus et corrigés par Talleyrand, et a cru pouvoir en tirer une édition définitive de cet ouvrage célèbre. Une longue introduction résume à grands traits la vie de Mirabeau : c'est une exécution à coups de trique de l'infortuné provençal ; c'est une vraie trahison que de résumer avec cette brutalité sa biographie ; il n'en reste qu'un tissu de scélératesses et de turpitudes. Tout ce qui dans ce monstre de laideur et d'esprit, dans cet être bouillonnant et physiquement fol, comme disait l'Ami des hommes, tout ce qui était enthousiasme, imagination, passion, « estrambor », car rien ne le définit mieux que le mot provençal, tout cela est supprimé de cette notice, et, pour être trop véridique, elle laisse une impression fausse. (...) Il faut cependant savoir gré à M. W. d'avoir réimprimé sous une forme plus complète que dans les éditions antérieures, avec les variantes de Talleyrand et un petit commentaire historicobiographique que l'on voudrait plus abondant, ces admirables dépêches de Mirabeau, qui forment un merveilleux tableau de la Prusse à la mort de Frédéric II, et de l'avènement de Frédéric-Guillaume. Mirabeau s'y montre aussi grand écrivain que grand politique." (L.-G. Pélissier, Annales du Midi, 1900)
Une Province française au temps du Grand Roi : la Brie.
Hachette, 1958, in-8°, 352 pp, 4 plans de l'époque sur 2 pl. hors texte, notes, biblio, liste des lieux cités, broché, bon état
Panorama de l'activité rurale en Brie au XVIIe siècle et analyse de la vie quotidienne des villages sous Louis XIV. — "Etude d'histoire sociale, fondée sur le Mémoire de la généralité de Paris, rédigé en 1699, et sur le dépouillement d'archives administratives, judiciaires, ecclésiastiques et notariales conservées à Melun. Après avoir décrit les cadres de la vie rurale en Brie à la fin du XVIIe siècle et la hiérarchie féodale des terres, Emile Mireaux montre que la prépondérance de la grande propriété y est récente, et qu'elle résulte d'un accaparement. Le tableau qu'il brosse de la vie et de l'activité économique des fermes et des villages, des rapports entre villageois, citadins, châtelains et gens d'Eglise est précis et vivant." (Revue française de science politique, 1959) — La Brie est une région naturelle située dans la partie orientale du bassin parisien, approximativement entre les vallées de la Marne au nord, de la Seine au sud et la côte d'Île-de-France à l'est. Elle couvre une superficie d'environ 5.000 km2. D'un point de vue géographique, on distingue une Haute-Brie (autour de Meaux) et une Basse-Brie (autour de Provins). Historiquement parlant, on distingue la Brie française (Brie-Comte-Robert), la Brie champenoise (Meaux) et la Brie pouilleuse (Château-Thierry).
Une Province française au temps du Grand Roi : la Brie.
Hachette, 1979, in-8°, 350 pp, préface de Pierre Goubert, sources, biblio, liste des noms de lieux cités, broché, couv. illustrée, bon état
Panorama de l'activité rurale en Brie au XVIIe siècle et analyse de la vie quotidienne des villages sous Louis XIV. — "Étude d'histoire sociale, fondée sur le Mémoire de la généralité de Paris, rédigé en 1699, et sur le dépouillement d'archives administratives, judiciaires, ecclésiastiques et notariales conservées à Melun. Après avoir décrit les cadres de la vie rurale en Brie à la fin du XVIIe siècle et la hiérarchie féodale des terres, Émile Mireaux montre que la prépondérance de la grande propriété y est récente, et qu'elle résulte d'un accaparement. Le tableau qu'il brosse de la vie et de l'activité économique des fermes et des villages, des rapports entre villageois, citadins, châtelains et gens d'Église est précis et vivant." (Revue française de science politique) — La Brie est une région naturelle située dans la partie orientale du bassin parisien, approximativement entre les vallées de la Marne au nord, de la Seine au sud et la côte d'Île-de-France à l'est. Elle couvre une superficie d'environ 5.000 km2. D'un point de vue géographique, on distingue une Haute-Brie (autour de Meaux) et une Basse-Brie (autour de Provins). Historiquement parlant, on distingue la Brie française (Brie-Comte-Robert), la Brie champenoise (Meaux) et la Brie pouilleuse (Château-Thierry). — "Aux premières pages de ce livre remarquable M. Emile Mireaux évoque l’histoire « événementielle », celle des empires, des guerres et des révolutions. Il y ajoute celle de la pensée et des lettres. Laissons la pensée qui nous obligerait à nous interroger sur sa valeur. Il suffit de constater que les « lettres » et l’objet qu’elles choisissent généralement : les modes différentes de l’amour, comptent pour peu sur le fond. M. Emile Mireaux dit : la toile de fond — de l’histoire des conditions vraies de la vie, le travail — il s’agit ici de celui de la terre, le salaire qu’en reçoivent ceux qui l’accomplissent, et le profit de ceux à qui cette terre appartient. C’est pourquoi il me semble que ce livre est important. Il l’est d’autant plus que son auteur ne peut être accusé de conclusions tendancieuses. Il expose le résultat de ses recherches ; elles rejoignent les observations que l’on pourrait faire aujourd’hui dans la Brie. L’agriculture s’y exerce au profit d’un « régime capitaliste de grande propriété et de grande exploitation ». Ce régime a commencé à s’établir à la fin du quinzième siècle pour trouver sous Louis XIV une forme que la Révolution n’a fait que confirmer. Les bénéficiaires seuls en furent changés. M. Emile Mireaux s’appuie sur une remarque de Camille Jullian qui avait vu, à la suite des troubles de la seconde moitié du troisième siècle en Gaule, que la grande propriété sort toujours plus grande encore d’une période d’anarchie. La misère issue de la guerre de Cent Ans avait dépeuplé la terre connue ; elle appartenait depuis trois siècles aux paysans qui l’avaient reçue à mesure que les défrichements créaient les parcelles cultivées de manière quasi communautaire. Un fait nouveau apparut dans la distribution des terres qui se fit au début du seizième siècle. On chercha bien à retenir le petit peuple et les artisans nécessaires à la société rurale, mais pour la première fois des baux portant sur de grandes superficies furent consentis à ceux que M. Mireaux nomme les laboureurs. Il cite en exemple : 120 arpents (47 hectares) à Sucy-en-Brie, 140 arpents (54 hectares) à Mory, 148 arpents (63 hectares) à Rozoy. Souvent un même bénéficiaire cumula plusieurs baux. Ainsi serait apparu dans la région parisienne la constitution de grandes propriétés formées par des terres tenues en roture. Les conséquences en furent nombreuses. Elles durent encore. Je ne peux pas ici suivre toutes les analyses de M. Emile Mireaux. Cette révolution, écrit-il, dura deux siècles, ce qui est peu dans l’histoire d’une nation. Les « riches laboureurs », pour parler comme La Fontaine, ou les marchands qui, à Rozoy, avaient accaparé les huit dixièmes des terres baillées à cens, eurent des héritiers qui prirent rang parmi les bourgeois et les anoblis. Ils rejoignent les rangs de la bourgeoisie parisienne, de la noblesse de cour et des hommes d’Eglise qui par achat ou par legs provoqués se constituent des placements sûrs. La terre est alors le meilleur de ces placements. En 1588, le chapitre de Notre-Dame cède à la Grande Paroisse 300 arpents de terres en friche (127 hectares) au greffier en chef du bailliage de Montereau. Ce domaine sera au dix-huitième siècle celui de M. de Trudaine, seigneur de Montigny. Chaque période de troubles donne lieu à de nouvelles distributions de la terre, allant de plus en plus au profit des classes supérieures, riches ou aisées, et au détriment de la classe paysanne qui a été progressivement évincée. Cette classe paysanne, on la retrouve dans les ouvriers de culture et les manouvriers employés par les « riches laboureurs » qui font figure déjà d’industriels. Et ceux-ci travaillent aussi pour des propriétaires qui ne résident pas et ne prennent aucune part, sauf de rares exceptions, au travail qui s’accomplit pour eux. Il arrive ainsi que la Brie paie en location quelquefois plus qu’elle ne recevra de Paris par la vente de ses produits. Les années de récolte abondante lui sont aussi désastreuses, à cause de la baisse des prix, que celles de disette où elle n’a pas assez à vendre après avoir dû prélever ce qui est nécessaire à la consommation de la ferme et à celle des bêtes. Autant que le permettent les chiffres qui résultent de ce genre de recherches, M. Emile Mireaux estime à 17,5 pour cent la part du revenu qui va aux propriétaires. Proportion considérable, écrit-il, à laquelle il faut ajouter la dîme qui est supérieure elle-même au produit de l’impôt. On lira le chapitre Revenus et niveaux de vie, qui traite de cette question. L’une des conclusions les plus intéressantes de ce livre note le renversement qui s’est fait à notre époque : la ville industrielle et commerçante prenant quelquefois en charge l’agriculture nécessaire et frappée d’anémie. Sous Louis XV, la ville était un « compartiment économiquement sous-développé ». La civilisation était agricole. La Brie, en l’occurrence, nourrissait et finançait Paris." (Robert Coiplet, Le Monde diplomatique, 1959)
Calendar of manuscripts in Paris archives and libraries relating to the history of the Mississippi Valley to 1803. Edited by N. M. Miller Surrey. In two volumes. Privately printed. Volume I., 1581-1739.
Washington, Carnegie Institution, Department of Historical Research, 1926, in-4°, xvi-889 pp, reliure pleine percaline havane éditeur, bon état. Premier volume seul (sur 2)
Madame de Pompadour.
Club des Libraires de France, 1958, in-8° oblong, 299 pp, 14 gravures sur un dépliant hors texte, biblio, tirage numéroté sur vélin blanc, reliure soie gris-bleu décorée de l'éditeur, rhodoïd, signet, bon état
Des favorites royales, la marquise de Pompadour est sans aucun doute la plus célèbre. Pourtant, son ascendance bourgeoise aurait dû lui fermer les portes de la Cour. Et c'est grâce à sa beauté, à sa prodigieuse énergie et à son intelligence qu'elle parvint à séduire Louis XV. Même lorsque leur relation prit un tour platonique, elle resta sa plus chère amie. Avec talent et habileté, elle sut également s'imposer à Versailles et y exerça une influence qui ne se démentit jamais au cours des vingt années de son "règne" : faisant et défaisant les ministres, se mêlant de politique et de prodiguer ses conseils. Femme de goût, elle fut encore un véritable mécène, soutien indéfectible des érudits et artistes de son temps. Dans l'intimité de cette femme de pouvoir, Nancy Mitford fait revivre la cour de Louis XV et décrit avec malice ses intrigues et l'entourage de la marquise.
Madame de Pompadour.
Le Livre contemporain, 1958, in-8°, 315 pp, 12 pl. de gravures et fac-similés hors texte, biblio, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
Des favorites royales, la marquise de Pompadour est sans aucun doute la plus célèbre. Pourtant, son ascendance bourgeoise aurait dû lui fermer les portes de la Cour. Et c'est grâce à sa beauté, à sa prodigieuse énergie et à son intelligence qu'elle parvint à séduire Louis XV. Même lorsque leur relation prit un tour platonique, elle resta sa plus chère amie. Avec talent et habileté, elle sut également s'imposer à Versailles et y exerça une influence qui ne se démentit jamais au cours des vingt années de son "règne" : faisant et défaisant les ministres, se mêlant de politique et de prodiguer ses conseils. Femme de goût, elle fut encore un véritable mécène, soutien indéfectible des érudits et artistes de son temps. Dans l'intimité de cette femme de pouvoir, Nancy Mitford fait revivre la cour de Louis XV et décrit avec malice ses intrigues et l'entourage de la marquise.
Madame de Pompadour.
Club du Livre d'Histoire, 1955, in-8°, 264 pp, traduit de l'anglais par René Chalupt, une gravure en frontispice, tirage à 3000 ex. sur Alfa Mousse Navarre, plus quelques exemplaires hors commerce, le notre un des ex. marqués H.C., reliure demi-basane carmin de l'éditeur, dos à 3 faux-nerfs, titres dorés, emboîtage, bon état
Des favorites royales, la marquise de Pompadour est sans aucun doute la plus célèbre. Pourtant, son ascendance bourgeoise aurait dû lui fermer les portes de la Cour. Et c'est grâce à sa beauté, à sa prodigieuse énergie et à son intelligence qu'elle parvint à séduire Louis XV. Même lorsque leur relation prit un tour platonique, elle resta sa plus chère amie. Avec talent et habileté, elle sut également s'imposer à Versailles et y exerça une influence qui ne se démentit jamais au cours des vingt années de son "règne" : faisant et défaisant les ministres, se mêlant de politique et de prodiguer ses conseils. Femme de goût, elle fut encore un véritable mécène, soutien indéfectible des érudits et artistes de son temps. Dans l'intimité de cette femme de pouvoir, Nancy Mitford fait revivre la cour de Louis XV et décrit avec malice ses intrigues et l'entourage de la marquise.
Œuvres complètes. Texte établi et annoté par Gustave Michaut. Dessins de Henri Jadoux, gravés par H. Renaud.
Bibliothèque des Editions Richelieu, 1947-1949, 11 vol. in-8° carré, 4080 pp, brochés, couv. rempliées (traces anciennes d'humidité au dos, sinon très bon état). Exemplaire numéroté sur alfa ivoire. Edition tirée sur les presses de l'Imprimerie Nationale (le caractère employé est le Grandjean ou Romain du Roi gravé sur l'ordre de Louis XIV), illustrée de bois gravés en en-tête, culs-de-lampe et hors-texte
Tome I. Avant-propos de René Groos. Molière, par Gustave Michaut : La vie - L'homme - Sa pensée - Ses idées littéraires - Les précurseurs & l'originalité de Molière - Avertissement - Bibliographie - Iconographie. L'estourdy ou Les contre-temps. Appendice: Le dépit amoureux en deux actes, adaptation de Valville ; II. Les Précieuses ridicules. Dom Garcie de Navarre ou Le Prince jaloux. L'escole des maris. Documents contemporains: Récit en prose & en vers de la farce des Précieuses, par Mlle des Jardins - Commentaire de Sganarelle, par Neuf-Villenaine ; III. Les facheux. L'escole des femmes. La critique de l'escole des femmes. Documents contemporains: La précaution inutile, par Scarron - Zélinde, ou le véritable critique de l'école des femmes, par Donneau de Visé - Le portrait du peintre, par Boursault ; IV. L'impromptu de Versailles. Le mariage forcé. La Princesse d'Élide. Le Tartuffe ou L'imposteur. Documents contemporains: La vengeance des marquis, par Donneau de Visé - Lettre sur les affaires du théâtre, par Donneau de Visé - Panégyrique de L'école des femmes, par Robinet - L'impromptu de l'Hôtel de Condé, par A.-J. Monfleury - Les amours de Calotin, par Chevalier - La guerre comique, par Philippe de La Croix - Lettre sur la comédie de L'imposteur ; V. Dom Juan ou Le festin de Pierre. L'amour médecin. Le Misantrope. Documents contemporains: Observations sur une comédie de Molière intitulée Le festin de Pierre - Responses aux observations touchant Le festin de Pierre de monsieur de Molière - Lettre sur les observations d'une comédie du sieur Molière intitulée Le festin de Pierre ; VI. Le médecin malgré-luy. Mélicerte. Pastorale comique. Le Sicilien ou L'Amour peintre. Amphytrion ; VII. George Dandin ou Le mary confondu. Le grand divertissement royal de Versailles. L'Avare. Monsieur de Pourceaugnac ; VIII. Les amants magnifiques. Le Bourgeois gentilhomme. Psiché ; IX. Les fourberies de Scapin. La comtesse d'Escarbagnas. Les femmes savantes. Documents contemporains: La soeur, par Rotrou - Le pédant joué, par Cyrano de Bergerac - La comédie des Académistes, par Saint-Évremond - L'Académie des femmes, par S. Chappuzeau ; X. Le Malade imaginaire. Poésies: Remerciement au Roy - La gloire du Val-de-Grace. Poésies diverses: A Monsieur de La Mothe le Vayer sur la mort de Monsieur son fils - Quatrains - Sonnet au Roy, sur la conqueste de la Franche-Comté - Bouts-rimez commandez sur le Bel-air. Oeuvres attribuées à Molière: Farces: La jalousie du barbo¥illé - Le médecin volant. Poésies: Couplet - Les maris - Les Bohémiennes. Documents biographiques contemporains: Nouvelles Nouvelles, par Donneau de Visé - Zélinde, par Donneau de Visé - Elomire hypocondre ou les Médecins vengez, par Le Boulanger de Chalyssay - Préface de La Grange & Vivot ; XI. Notes et Variantes (des 10 tomes). La langue de Molière, par Georges Matoré: Introduction à la stylistique de Molière - Bibliographie de la langue de Molière - Index grammatical - Lexique. Addenda à la Bibliographie. Table alphabétique des Œuvres de Molière.
Les Œuvres complètes, iIllustrées de gravures de l'époque de l'auteur et comprenant les suites monumentales de Boucher, Coypel, Moreau le Jeune, Buguet, Desenne, Johannot, Horace Vernet, Hédouin et de la suite dite "inconnue".
P., Jean de Bonnot, 1983-1984, 6 vol. in-8°, xiii-(16)-361-(47 ff ), 445-(10 ff), 403-(34 ff), 454-(10 ff), 378-(50 ff), 331-(78 ff) pp, très nombreuses gravures de l'époque hors texte, dont un frontispice à chaque volume, bandeaux et culs-de-lampe, reliures plein cuir noir de l'éditeur, plats ornés à froid et fers dorés, dos très ornés de fers et titre dorés dans le style du XVIIe s., tranches sup. dorées, signet, imprimés sur papier vergé, très bon état
Complet en 6 volumes. — Edition intéressante pour la reproduction des grandes suites de gravures des premières éditions de Molière au XVIIe siècle (Boucher, Coypel, Moreau le Jeune, Buguet, Desenne, Johannot, Horace Vernet, Hédouin et la suite dite "inconnue"), mais aussi des reproductions d'autres illustrations dont 6 frontispices (un par volume) représentant des portraits de Molière, ainsi que 2 partitions de musique de Lully pour deux pièces musicales.
The Russian Court in the Eighteenth Century.
London, Hutchinson & Co, 1905, 2 vol. in-8°, xii-318 et x-[319-597] pp, 2 portraits gravés sur acier en frontispices et 16 pl. de gravures hors texte, reliures percaline bordeaux, dos lisses avec titres dorés, têtes dorées (rel. de l'éditeur), plats lég. défraîchis, qqs rares rousseurs, bon état. Texte en anglais.
"This belongs to a class of books which it is difficult to appreciate. They are certainly not edifying, and yet they tell a story which has to be told. How can we understand the French Revolution unless we know something about the crimes of the ancien regime ? And how can we understand the Russia of today except we see how it was governed in the past. But it must be confessed that the task of making oneself acquainted with these things is nothing less than nauseous. There is scarcely a relief in the uniform level of baseness and wickedness. Sometimes we come across a strong man or woman ; but a good one almost never. What a story, for instance, is that of the deposition of Peter by Catherine ! There is nothing quite so sordid even in the revolutions, whether accomplished in the Palace or the camp, of the Roman or the Byzantine Empire. And in the midst of it all "the Holy Synod awaited to greet and congratulate her," while the crowds admired her piety when, having doffed her uniform, she went to attend Mass. Less than a week after this the deposed Peter was dead, – of dysentery, it was said. It was not he, it was she, who was felix opportunitate mortis. Mr. Molloy acquits her of complicity, and it is perfectly trim that the Orloffs were capable of that or of any other crime; but that she was "an inexperienced young woman" who did not know that her deposed husband would be a source of danger we cannot believe, even on the authority of Frederick the Great. For an "inexperienced young woman" she acted with extraordinary courage and readiness." (The Spectator, 30-12-1905))
Histoire de la reine Marguerite de Valois, première femme du roi Henri IV.
P., Ruault, 1777, in-8°, (8)-422-(2) pp, reliure plein veau brun marbré, dos lisse à caissons orné de fleurons, pièce de titre basane noire, triples filets encadrant les plats, coupes filetées, tranches marbrées (rel. de l'époque), bon état
Edition originale du premier ouvrage du chanoine Mongez (1747-1835), archéologue et historien à la carrière politique agitée. C'est la première biographie de Marguerite de Valois, dite la reine Margot, qui aura aura attendu 1777 pour qu'un historien daigne s'intéresser à sa vie sulfureuse. D'une grande clarté, elle est le premier signe d'un intérêt moderne pour la reine Marguerite, qui connut les développements romanesques que l'on sait au XIXe siècle. (Cioranescu, XVIII, 45 971).
Mazarin.
Paris Hachette, coll. "Génies et réalités" 1959 1 vol. Relié in-8, skivertex rouge éditeur, 295 pp. (sans rhodoïd), nombreuses illustrations. Textes de J. de Bourbon-Busset, G. Dethan, Fr. Nourissier, Jean d'Ormesson, etc. Bon état.
Cyrano de Bergerac.
Berger-Levrault, 1964, pt in-8°, 228 pp, 21 gravures, biblio, reliure toile rouge de l'éditeur, rhodoïd, bon état
"Nous offrons au lecteur un Cyrano authentique, qui ne tend nullement à faire oublier celui du poète, mais à permettre aux curieux de comparer l'histoire et la légende." — "Un livre bien fait pour intéresser les spectateurs et satisfaire la curiosité des érudits. (...) M. Georges Mongrédien, dont nul n'ignore la connaissance particulièrement étendue des événements et des personnalités du Grand Siècle, a pris à cœur de reconstituer une vie authentique et aussi complète que possible du véritable Cyrano, Parisien du quartier des Halles et homme de grand savoir. Cette biographie permet de préciser les libertés prises avec Clio par Rostand ; mais, elle énumère aussi les sources utilisées par le poète et décèle chez lui une connaissance approfondie des textes de l'époque. (...) Cette vie réelle de Cyrano, est, grâce à la science et à l'art de M. Mongrédien, presqu'aussi attrayante et entraînante que le chef-d'œuvre de Rostand." (A. Gavoty, Revue des Deux Mondes, 1964) — Si Théophile Gautier l'a réhabilité, et qu'il fut ensuite rendu célèbre par Edmond Rostand aux quatre coins de la planète , Cyrano de Bergerac a bel et bien existé. Mais qui était cet écrivain méconnu ? Georges Mongrédien nous présente l'homme, sa famille, son milieu, son temps, en se fondant sur des témoignages de contemporain et des documents d'archives.
L'Affaire Foucquet.
Genève, Cercle du Bibliophile, 1973, in-8°, xx-254 pp, préface de Frédéric Pottecher, 22 pl. de gravures hors texte, biblio, reliure skivertex havane de l'éditeur, plats et dos ornés, bon état (Coll. Les causes célèbres)
Excellente étude consacrée au procès le plus célèbre du siècle, avec des chapitres sur les satires et épigrammes sur Colbert. — "... C’est autour de ce procès, et de l'opposition Colbert-Fouquet que vont se cristalliser discussions et critiques, souvent sécrétées par l’incompétence. Car enfin le problème est résolu depuis près de cent ans : Jules Lair, en 1890, démontait l'assez ignoble mécanique mise en place par Colbert pour perdre son brillant rival, prendre sa place et détruire toute trace de ses propres malversations et de celles de son premier maître, Mazarin . Voilà trente ans, l’excellent et très modéré Georges Mongrédien reprenait pour le grand public l’analyse de l'Affaire Foucquet (Hachette, 1956), y revenait un peu plus tard dans son Colbert, et concluait paisiblement ainsi : « Il nous faut bien écarter la conception simpliste de l'honnête et scrupuleux ministre faisant avec une justice rigoureuse le procès d'un prédécesseur indélicat ... odieuse parodie de justice qui cache l'acharnement personnel d’un homme à perdre son rival pour prendre sa place... le moins qu’on puisse dire c’est que [ce procès] ne lui fait pas honneur. » " (Pierre Goubert, Le Monde, 120 mars 1987) — "La figure de Foucquet, surintendant des Finances au temps de Mazarin et de la jeunesse de Louis XIV, procureur général près le parlement de Paris, riche bourgeois, épris de luxe et de faste qui, jouant au grand seigneur, dépensait largement et donnait des fêtes splendides dans son château de Vaux-le-Vicomte, ami et protecteur des artistes et des poètes, séducteur et amant généreux (« jamais surintendant ne trouva de cruelles ») a toujours captivé les historiens. Dans peu de carrières la Roche tarpéienne apparut aussi proche du Capitole. La chute de Foucquet fut soudaine. Victime de la haine violente de son rival Colbert, détesté de Louis XIV et de Louvois, il fut arrêté pour malversations – qui n'étaient que trop certaines – et poursuivi avec acharnement. Son procès, qui dura trois ans et fut entaché de nombreuses irrégularités, se termina par une condamnation au bannissement que le roi « commua » en détention perpétuelle. Foucquet, interné à Pignerol, y resta dix-neuf ans et sa mort, survenue alors qu'il allait être libéré, reste mystérieuse. M. Georges Mongrédien, éminent historien du XVIIe siècle, a pris Foucquet pour sujet d'un nouveau livre. Il a remarquablement mis en lumière le rôle de Colbert ainsi que les mobiles, à la fois politiques et intimes, qui incitèrent Louis XIV à se montrer aussi rigoureux." (Revue des Deux Mondes, 1956)
La Journée des Dupes. 10 novembre 1630.
Gallimard, 1967, in-8°, xxiv-276 pp, introduction par Gérard Walter, 32 pl. de gravures hors texte, biblio, index, broché, rhodoïd, bon état (Coll. Trente journées qui ont fait la France)
La journée des Dupes désigne les évènements des dimanche 10 et lundi 11 novembre 1630 au cours desquels le jeune roi de France Louis XIII, âgé de 29 ans, réitère contre toute attente sa confiance à son ministre Richelieu, élimine ses adversaires politiques et contraint la reine-mère Marie de Médicis à l'exil.
La Vie privée de Louis XIV.
Hachette, 1948, in-12, 252 pp, broché, couv. illustrée, état correct (Coll. Les Vies privées)
La vie quotidienne des comédiens au temps de Molière.
Hachette, 1966, in-8°, 284 pp, biblio, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
Comment vivaient les comédiens du XVIIe siècle ? C'est ce que Georges Mongrédien nous décrit avec précision, en les replaçant d'abord dans a société de leur temps, puis dans leurs propres théâtres, Hôtel de Bourgogne, théâtre du Marais, Palais-Royal, Comédie-Française, Italiens, Opéra. Nous voyons ces artistes vivre dans les coulisses et à la scène régler tous les problèmes de la représentation théâtrale – décors, mise en scène, costumes –, évoluer dans leur vie familiale et professionnelle. A l'histoire des grands acteurs parisiens, Georges Mongrédien ajoute celle, plus pittoresque encore, des comédiens errants, que, grâce à des documents nouveaux, il a pu suivre dans leurs pérégrinations à travers la France et l' Europe entière. Ce livre, dû à un spécialiste, qui ne néglige pas l'anecdote, constitue un panorama très animé de la vie théâtrale en France au XVIIe siècle, depuis les premiers farceurs de l'Hôtel de Bourgogne jusqu'aux grands interprètes du théâtre classique.
La vie quotidienne des comédiens au temps de Molière.
Hachette, 1982, in-8°, 284 pp, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Comment vivaient les comédiens du XVIIe siècle ? C'est ce que leur historien, Georges Mongrédien, nous décrit avec précision, en les replaçant d'abord dans a société de leur temps, puis dans leurs propres théâtres, Hôtel de Bourgogne, théâtre du Marais, Palais-Royal, Comédie-Française, Italiens, Opéra. Nous voyons ces artistes vivre dans les coulisses et à la scène régler tous les problèmes de la représentation théâtrale – décors, mise en scène, costumes –, évoluer dans leur vie familiale et professionnelle. A l'histoire des grands acteurs parisiens, Georges Mongrédien ajoute celle, plus pittoresque encore, des comédiens errants, que, grâce à des documents nouveaux, il a pu suivre dans leurs pérégrinations à travers la France et l' Europe entière. Ce livre, dû à un spécialiste, qui ne néglige pas l'anecdote, constitue un panorama très animé de la vie théâtrale en France au XVIIe siècle, depuis les premiers farceurs de l'Hôtel de Bourgogne jusqu'aux grands interprètes du théâtre classique.
La Vie quotidienne sous Louis XIV.
Hachette, 1967, in-8°, 250 pp, biblio, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état
Dans l'histoire du règne de Louis XIV on a trop souvent négligé la vie des petites gens au profit du Roi et de la Cour. M. Mongrédien à voulu pénétrer dans l'intimité des classes moyennes : bourgeois, paysans, ouvriers, artisans, soldats. Le grand évènement social du règne de Louis XIV est l'accession de la bourgeoisie au rang de grande classe, enrichie, honorée et souvent enviée de la noblesse, que paralyse ses préjugés et les exigences de la Cour. Appuyé sur une vaste documentation, M. Mongrédien étudie le genre de vie de ces bourgeois ; il les regarde élever leur enfants, faire leurs comptes, s'habiller, recevoir leurs amis. Peu à peu, la hiérarchie des fortunes tend à se substituer à celle des naissances et les anciennes castes se mêlent. Quant aux paysans, la plupart des documents nous les présentent mal outillés, mal nourris, mal logés, écrasés d'impôts, travaillant une terre trop morcelée. Il est naturel que nous aimions à entendre parler de la vie quotidienne des hommes et des femmes d'autrefois qui avaient les mêmes soucis et les mêmes plaisirs que nous. L'histoire est aussi notre vie de tous les jours, et nous sommes plus curieux de détails sur les costumes et sur l'alimentation d'autrefois que sur les clauses du traité de Nimègue. C'est cette curiosité que M. Mongrédien vient satisfaire avec un rare bonheur.
La Vie quotidienne sous Louis XIV.
Hachette, 1952, in-8°, 250 pp, biblio, broché, couv. illustrée salie, état correct
Dans l'histoire du règne de Louis XIV on a trop souvent négligé la vie des petites gens au profit du Roi et de la Cour. M. Mongrédien à voulu pénétrer dans l'intimité des classes moyennes : bourgeois, paysans, ouvriers, artisans, soldats. Le grand évènement social du règne de Louis XIV est l'accession de la bourgeoisie au rang de grande classe, enrichie, honorée et souvent enviée de la noblesse, que paralyse ses préjugés et les exigences de la Cour. Appuyé sur une vaste documentation, M.Mongrédien étudie le genre de vie de ces bourgeois ; il les regarde élever leur enfants, faire leurs comptes, s'habiller, recevoir leurs amis. Peu à peu, la hiérarchie des fortunes tend à se substituer à celle des naissances et les anciennes castes se mêlent. Quant aux paysans, la plupart des documents nous les présentent mal outillés, mal nourris, mal logés, écrasés d'impôts, travaillant une terre trop morcelée. Il est naturel que nous aimions à entendre parler de la vie quotidienne des hommes et des femmes d'autrefois qui avaient les mêmes soucis et les mêmes plaisirs que nous. L'histoire est aussi notre vie de tous les jours, et nous sommes plus curieux de détails sur les costumes et sur l'alimentation d'autrefois que sur les clauses du traité de Nimègue. C'est cette curiosité que M. Mongrédien vient satisfaire avec un rare bonheur.
La Vie quotidienne sous Louis XIV.
Hachette, 1952, in-8°, 250 pp, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Dans l'histoire du règne de Louis XIV on a trop souvent négligé la vie des petites gens au profit du Roi et de la Cour. M. Mongrédien à voulu pénétrer dans l'intimité des classes moyennes : bourgeois, paysans, ouvriers, artisans, soldats. Le grand évènement social du règne de Louis XIV est l'accession de la bourgeoisie au rang de grande classe, enrichie, honorée et souvent enviée de la noblesse, que paralyse ses préjugés et les exigences de la Cour. Appuyé sur une vaste documentation, M.Mongrédien étudie le genre de vie de ces bourgeois ; il les regarde élever leur enfants, faire leurs comptes, s'habiller, recevoir leurs amis. Peu à peu, la hiérarchie des fortunes tend à se substituer à celle des naissances et les anciennes castes se mêlent. Quant aux paysans, la plupart des documents nous les présentent mal outillés, mal nourris, mal logés, écrasés d'impôts, travaillant une terre trop morcelée. Il est naturel que nous aimions à entendre parler de la vie quotidienne des hommes et des femmes d'autrefois qui avaient les mêmes soucis et les mêmes plaisirs que nous. L'histoire est aussi notre vie de tous les jours, et nous sommes plus curieux de détails sur les costumes et sur l'alimentation d'autrefois que sur les clauses du traité de Nimègue. C'est cette curiosité que M. Mongrédien vient satisfaire avec un rare bonheur.
Les Grands Comédiens du XVIIe siècle. Les origines de la Comédie-Française.
P., Société d'Edition "Le Livre", Emile Chamontin, 1927, pt in-8°, xxi-309 pp, préface de Madame Dussane, 10 portraits hors texte, index, broché, couv. à rabats, traces de scotch sur les gardes, bon état (Coll. Essais et curiosités littéraires). Edition originale, un des 110 ex. numérotés sur pur chiffon Bright White
Louis XIV.
Albin Michel, 1963, in-8°, 392 pp, un frontispice hors texte, biblio, broché, jaquette illustrée à rabats, bon état (Coll. Le Mémorial des siècles, XVIIe siècle, Les hommes)
Un ample portrait psychologique et moral de Louis XIV par un éminent historien dix-septièmiste.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers