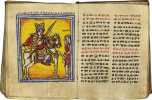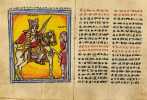-
Type
Artists book (1)
Autograph (35)
Book (8673)
Disk (1)
Drawings (1)
Engraving (3)
Magazine (47)
Manuscript (147)
Maps (6)
Old papers (63)
Photographs (3)
Posters (1)
-
Latest
Last 3 days (12)
Last month (96)
Last week (13)
-
Language
Danish (1)
Dutch (1)
English (5)
French (8966)
German (1)
Italian (2)
Latin (4)
Portuguese (1)
-
Century
16th (41)
17th (93)
18th (380)
19th (1089)
20th (2013)
21st (99)
-
Countries
Belgium (1012)
Canada (36)
China (4)
Côte d'Ivoire (12)
France (7549)
Greece (2)
Italy (2)
Netherlands (4)
Switzerland (360)
-
Syndicate
ALAC (33)
CLAM (40)
CLAQ (16)
CNE (56)
ILAB (2597)
NVVA (284)
SLACES (284)
SLAM (2231)
SNCAO (2364)
Manuscrit intitulé : "Saint Paul et l'Illumination chrétienne" - (vers 1900) -
611 pages in4 - Reliure demi toile verte - Trés bon état intérieur -
Interessant et long manuscrit, d'une écriture appliquée et régulière - Le texte est signé in fine par une autre main (?) - Nous n'avons pas trouvé trace de ce titre - La première partie s'intitule: "Les origines apostoliques du Christiannisme"; la seconde: "L'Evangile de Paul"; et la troisième : "L'Apôtre des Gentils" -
Girart de rousilon ou l'épopée de bourgogne.
s.l., Philippe lebaud imprimeri marcel bon, 1990; in-4, 227 pp., br. Sans reliure.
Sans reliure.
Histoire du diocèse de Châlons-sur-Marne.
(Châlons en Champagne), 1766 (1865). Fort volume in-4, 2 ff. imprimés (faux-titre, titre), 765 ff. manuscrits (au recto uniquement, quelques notes au verso). Reliure demi-chagrin, manque de cuir au dos, reliure signée "Vivin fils". Copie manuscrite, d'une belle écriture très lisible, par M. Amédée Lhote, de Châlons, en 1865, du manuscrit de Dom Jean François déposé, à cette époque, à la bibliothèque de Châlons.
"Religieux, bénédictin de la Congrégation de Saint-Vanne, Dom François, avait été envoyé par son ordre à Saint-Pierre-aux-Monts de Châlons, et sa profonde érudition lui ouvrit les portes de l'ancienne Académie de Châlons qui l'invita à travailler à l'histoire des cité, diocèse, villes, bourgs et pays de Châlons-sur-Marne." L'ouvrage est divisé en quatre parties : "Châlons antique ; Châlons soumise aux Rois d'Austrasie depuis Thierry 1er en 511, jusqu'à l'an 963 ; Châlons sous l'autorité des évêques depuis l'an 963 jusqu'en 1429 ; Châlons remise sous la pleine domination des rois de France depuis l'an 1429 jusqu'à nos jours" (1764).
Cherbourg, port américain.
Manuscrit in-4° de 12 ff numérotés, reliure cartonnée recouverte de papier caillouté bleu et brique, pièce de titre doré sur chagrin au milieu du plat.
Manuscrit d’un article écrit (vraisemblablement en juillet 1944) pour Révolution nationale et a priori censuré. Première publication posthume dans Rivarol le 22 mars 1951. Reprise dans les recueils récents Révolution nationale (pp. 195-201) et Drieu en kiosque (volume 8) comme l’article «Thèses» ci-dessous. Lansard signale (p. 101) que Lucien Combelle (directeur de Révolution nationale) prétend dans le numéro spécial de la revue la Parisienne consacrée à Drieu (n° 32, octobre 1955) que l’article aurait bien paru. On n’en trouve pourtant pas trace en consultant la collection, mais il est possible qu’un ultime numéro ait été imprimé et non distribué en août 1944… Mais si c’était le cas, il serait surprenant que la censure de l’occupant ait laissé publier cet article hostile à la politique de Collaboration avec les Allemands au même titre qu’à celle qui s’ébauche avec les Américains après le débarquement. Il est d’ailleurs à noter qu’un article de Drieu de la même époque, également écrit pour Révolution nationale («Bilan fasciste») a été censuré en juillet 1944. Le paragraphe final de ce manuscrit a été barré par Drieu et n’a donc pas été publié dans Rivarol. Article très désabusé de Drieu qui tentera peu après sa rédaction de se donner la mort pour la première fois, le 11 août 1944, avant d’y parvenir, après plusieurs autres tentatives, le 15 mars 1945…


Phone number : 06 60 22 21 35
Thèses.
In-4°, bradel demi-maroquin à coins noir, plat simili bois ; 17 feuillets (16 + 6bis) manuscrits.
Manuscrit de l’article paru à la Une (et se poursuivant en page 2) du n° 134 (6 mai 1944) de Révolution nationale, journal collaborationniste fondé par Jean Fontenoy, le pittoresque aventurier fasciste que la bibliographie à succès de Gérard Guégan (Stock) a fait connaître au grand public en 2011. Les articles de Révolution nationale postérieurs au 11 décembre 1943 ne figurent pas dans le recueil d’articles Le Français d’Europe, imprimé le 20 juillet 1944 pour le compte des éditions Balzac – il s’agit des éditions Calmann-Lévy «arianysées» – et pilonné, et resteront inédits en volume jusqu’à la publication du recueil Révolution nationale en 2004 aux éditions de l’Homme libre (cet article s’y trouve pages 139 à 148), avant l’édition récente de l’intégrale des parutions dans la presse des textes de Drieu (Drieu en kiosque, 8 volumes, Éditions Place Maubert, 2017). Voir Lansard, p. 100.«Il est bon, avant les mois décisifs, de résumer les principales thèses que j’ai soutenues dans ce journal.»


Phone number : 06 60 22 21 35
Les derniers jours.
[Revue: cahier politique et littéraire fondé et rédigé par Pierre Drieu La Rochelle et Emmanuel Berl-1927] ; in-4°, demi-chagrin à coins rouge vif, dos à quatre nerfs encadrant les auteurs et le titre.
Recueil de fragments de notes manuscrites, tapuscrits et épreuves corrigées d’articles parus dans la revue Les derniers jours dont ils étaient les deux seuls rédacteurs. Cette revue bimensuelle qui a compté seulement 7 numéros (appelés «cahiers») a disparu, non pas faute de lecteurs, mais d’intérêt de ses rédacteurs pour la poursuite de sa parution…Drieu la Rochelle :I. – «Le capitalisme, le communisme et l’esprit» : article paru dans le 1er cahier (1er février 1927), pages 1-4 et repris avec coupures, pp. 216-220 de “Genève ou Moscou”. (Drieu la Rochelle ou la passion tragique de l’unité. Tome III, Aux amateurs de livres, 1991, p. 44 par Pierre Lansard) . 1) Notes manuscrites : 20 ff. numérotés (1; 2; 2bis; 3; 4; 5; 6; 6bis; 7; 8; 9; 10; 11; 11bis; 12; 13; 14; 15; 16; 16bis). Le f. n° 1 est recto-verso. Le autres, recto seulement ; 2) Tapuscrit annoté et signé de la main de Drieu: 9 ff. recto.II. – «Première note sur le drame de l’Action française» : article paru dans le 1er cahier (1er février 1927), pages 5-8 et repris pp. 260-266 de “Genève ou Moscou” . 1) Notes manuscrites, certaines au crayon et la plupart à l’encre noire, qui constituent une première version de l’article sous le titre «Le trône, l’autel, le coffre-fort» : 14 ff.; 2) Première version manuscrite de l’article sous son titre définitif : 5 ff. foliotés de 1 à 5 ; 3) Fragments reliés à la suite : 3 ff. ; 4) Tapuscrit annoté et signé de la main de Drieu : 10 ff. recto ; 5) Épreuves d’imprimerie corrigées de la main Drieu : 2 ff. recto.III. – «Consolation à Maurras»: article paru dans le 4e cahier (20 mars 1927), pages 1-6. Manuscrit de 26 pages de la main de Drieu. La page de titre porte en plus de celui-ci la date, postérieure à la date de publication, d’avril 1927. Il est assez fréquent de trouver des erreurs de date ou de titre dans les indications dont Drieu annote tardivement ses manuscrits. Par exemple, comme le relève Lansard dans sa bibliographie (p. 47), il indique dans “Genève ou Moscou” que sa «Réponse à l’Enquête sur l’intelligence et les partis» a paru dans Les derniers jours, dont le dernier numéro date du 8 juillet 1927, alors que ce texte a paru dans la Grande Revue en mai 1928.Double foliotage des feuillets : à la même encre noire et dans la même taille de caractères que le texte (en haut à droite des feuillets, avec parfois des numéros bis) et, en caractères plus gros et au crayon bleu (en général en bas des feuillets), en commençant à 12 bis pour la page de titre qui n’est pas numérotée en noir. La page foliotée 33 bis en bleu ne porte pas non plus de folio en noir (elle aurait dû être la 18 bis), mais se situe néanmoins au bon endroit si l’on en juge par la version imprimée dans la revue.Exceptionnel ensemble présentant les différentes étapes de la rédaction d’un article de Drieu, permettant de comprendre sa méthode de travail et de suivre le cheminement de sa pensée.Emmanuel Berl : «Notes sur la Révolution»: manuscrit d’un premier jet (assez éloigné de la version définitive) de l’article «Propos sur la Révolution» paru dans le 4e cahier (20 mars 1927), pages 7-11.8 ff. manuscrits d’une écriture très lisible, non foliotés et non signés.


Phone number : 06 60 22 21 35
[Correspondance active avec le ministre de la marine].
Saïgon, s.d (1874-76) 7 pièces in-8, en feuilles sur papier de deuil.
Très intéressante correspondance active de Victor-Auguste Duperré (1825-1900), fils de Victor-Guy, gouverneur de Cochinchine du 30 novembre 1874 au 16 octobre 1877, adressée à Louis-Raymond de Montaignac de Chauvance (1811-1891), qui fut ministre de la marine et des colonies du 22 mai 1874 au 9 mars 1876. Voulue directe et hors des communications officielles (par suite de l'acheminement inégal du courrier, est-il prétexté), elle se compose de sept longues lettres ne comportant que l'éphéméride, et dont l'année doit être reconstituée à partir du contenu (avec une marge d'incertitude pour certaines). Elles fournissent les détails les plus précis et les plus circonstanciés sur l'administration de la seule colonie que nous possédions alors en Indochine, avant la signature des traités de 1883 et 1884.I. Du 7 décembre [1874] : 3 bifeuillets écrits sur les 12 pages. La missive a tout d'un envoi consécutif à une prise de fonction récente ("Mon prédécesseur vous ayant rendu compte lui-même des incidents importants, je me suis contenté de signer quelques dépêches relatives au service courant : d'ailleurs les visites particulières & celles que j'ai faites dans nos établissements ont absorbé tout mon temps depuis cinq jours, & je n'oserais aborder dès à présent dans une correspondance officielle des sujets qui méritent l'examen attentif que je vais commencer de toutes les affaires dont je dois poursuivre la solution"). Sont ensuite abordés pêle-mêle les sujets les plus importants : relations avec la Cour de Hué, règlement du budget et des dépenses locales pour 1875, observations sur Jules-François-Émile Krantz (1821-1914), qui fut gouverneur militaire de Cochinchine du 16 mars au 30 novembre 1874, et avait assuré l'intérim du gouvernorat général de mars à novembre 1874 après le départ de Jules Dupré, etc. Elle se termine par un appel au soutien du ministère : "Le bien que je pourrai faire peut seul me soutenir et m'encourager, je vous supplie de m'accorder les moyens de le tenter et d'accueillir avec bienveillance les propositions que je vous adresserai lorsque j'aurai étudié la situation sous toutes ses faces, visité la colonie, recueilli auprès des personnes compétentes les renseignements nécessaires".II. Du 26 avril [1875] : 4 bifeuillets écrits sur 15 pp. Il s'agit d'un compte-rendu officieux de la mission du commandant Charles-Paul Brossard de Corbigny (1822-1900) auprès de l'Empereur Tu Duc à Hué. Brossard avait en effet été chargé d'une mission en Annam où il se rendit avec son frère, alors lieutenant de vaisseau et hydrographe de l'expédition, Jules-Marcel. L'escadre partit ainsi de Saïgon le 4 avril 1875, atteignit la rade de Tourane, remontant la rivière jusqu'à Hué où Tu-Duc reçut les voyageurs (14 avril) et dut y ratifier le traité de semi-protectorat signé l'année précédente. Les Français revinrent ensuite à Tourane et par un croiseur retournèrent à Saïgon (24 avril). La missive de Duperré suit donc de près le retour des marins. Suivent des considérations sur la ratification du traité par l'assemblée, et sur les allégements de contributions de la Cochinchine consentis par le ministre des finances.III. Du 20 mai : 4 bifeuillets écrits sur les 16 pages. Cette longue lettre commence par une assurance sur la fin des révoltes des provinces de M Tho et Tan Nay ("Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que l'ordre est complètement rétabli") ; elle se poursuit par des considérations plus générales, très représentatives des mentalités coloniales de la fin du XIXe et du mythe de la "mission civilisatrice" : "Il faut, monsieur le ministre, que nous profitions de la leçon : en Cochinchine, comme partout ailleurs, nous avons la prétention de charmer, d'être admirés, aimés ; nous comptons sur la séduction qu'inspirent nos personnes, nos institutions, notre civilisation, et nous nous abandonnons à une confiance présomptueuse et irréfléchie. Ici, à peine campés dans des provinces ... nous avons cru que tous ces notables, ces lettrés, ces fonctionnaires annamites besogneux seraient subitement ralliés à la nouvelle administration, que fidélité à leur Roi, patriotisme, attachement aux traditions séculaires disparaîtraient par enchantement". Puis les conclusions tirées sont d'ordre uniquement pratique (doublement des inspections, envoi des administrateurs au contact des populations, meilleure répartition des impôts, etc.), mais le diagnostic initial a le mérite de la clairvoyance. Le reste de la lettre concerne les constructions et travaux entrepris, ainsi que le futur traité de commerce (cf. infra).IV. Du 25 août [1875] : 4 bifeuillets écrits sur les 16 pages. Après une longue note sur le cas personnel d'un secrétaire de la mission française à Hué, la lettre revient sur les ratifications du traité de commerce d'avril précédent, désormais aux mains de Pierre-Paul Rheinart (1840-1902), chargé d'affaires dans la capitale impériale de 1875 à 1876, puis s'étend sur les difficiles relations avec les fonctionnaires de la Cour de Hué, leur susceptibilité, leur inertie, leur mauvaise volonté à exécuter les clauses de la convention. Duperré se plaint également des personnels militaires envoyés par la métropole, ce qui jette une lumière assez crue sur la qualité des sujets : "Permettez-moi, monsieur le ministre, d'appeler votre attention sur les compositions bien regrettables des envois de personnel en Cochinchine. J'ai ici deux colonels qui, en présence des actes trop nombreux d'indiscipline dont je me plains, reconnaissent qu'ils agissaient lorsqu'ils étaient en France exactement comme le font leurs collègues, aujourd'hui : lorsque l'on forme les compagnies destinées à la colonie, les chefs de corps ont tous une seule pensée, celle de se débarrasser de tous les mauvais sujets du régiment, les feuilles de punition sont là pour l'attester". Ce qui "perpétue dans les ports cette opinion trop répandue que la Cochinchine est une colonie placée dans des conditions telles que l'on peut la considérer comme un lieu de déportation pour les mauvais serviteurs & les hommes indisciplinés".V. Du 24 octobre : 4 bifeuillets écrits sur 13 pages. La lettre commence par des mesures personnelles en faveur du capitaine de vaisseau Marie-Charles Lehelloco (1827-1880), commandant du Duchaffaut. Elle se continue par un exposé des difficultés persistantes dans les relations avec la Cour de Hué : "Nous avons à lutter sans cesse contre le parti qui nous sera toujours hostile, à vaincre les hésitations, la timidité des mandarins qui, personnellement enclins à accepter les faits accomplis, ne se sentent pas assez forts pour proclamer bine haut la nécessité d'entrer dans une voie nouvelle ; de là des tiraillements, des intrigues qui lasseraient les plus patients et découragent parfois M. Rheinart". Puis sont abordées les relations diplomatiques avec la Chine, au sujet des provinces du nord du Tonkin : "Je crois qu'il faut abandonner pour le moment toutes démarches à Pékin puisque le gouvernement chinois fait examiner par le même mandarin, Li Hang Chang [Li Hongzhang, 1823-1901] la double question de Bahmo & du Song Coï, que l'on considère, à bon droit, comme ne pouvant pas être scindée. Si les Anglais obtiennent l'ouverture du Yunnan par sa frontière nord-ouest, peut-être aurons-nous gain de cause".VI. Du 17 janvier [1876] : 3 bifeuillets, écrits sur 9 pages, après le congé que le ministre a accordé à Duperré au commencement de 1876 (cf. fin de la lettre du 25 août), et portant essentiellement sur l'évolution des mentalités des populations de la Cochinchine ("Le moment est opportun, car, après avoir parcouru le territoire de la Cochinchine, j'ai reconnu avec une bien vive satisfaction : que les idées claires avaient fait des progrès réels dans l'esprit des populations ; que la confiance dans l'administration française rendrait désormais plus difficile la propagande à laquelle n'ont pas encore renoncé les mécontents, petits fonctionnaires et lettrés, qui, dans l'ancien gouvernement, étaient les maîtres. Deux bonnes récoltes ont singulièrement aidé à ce résultat et, je peux le dire, les exécutions que j'ai cru nécessaires pour arrêter la dernière rébellion ont produits les meilleurs effets en ce sens que les chefs seuls ont été frappés. Les Annamites semblent vouloir secouer leur apathie routinière en ce qui concerne la culture, et je les vois marcher avec résolution dans la voie que quelques notables intelligents leur ont ouverte à notre instigation").VII. Du 31 janvier [1876]: 4 bifeuillets écrits sur 14 pages, au ton notablement différent de l'apaisement exprimé par la précédente missive. C'est que l'approche du Nouvel an annamite fait craindre des mouvements de révolte. Duperré se veut cependant toujours rassurant : "Permettez-moi donc de vous rendre compte, en peu de mots, de la situation qui, j'ai hâte de le dire, ne doit pas vous préoccuper au moment des fêtes annuelles annamites, les gens sans aveu causent toujours quelques désordres, les actes de piraterie deviennent plus nombreux, le pays éprouve un certain malaise, dont ont voulu profiter des agents de rébellion dont nous découvrirons, je l'espère, les projets en même temps que nous retrouverons les traces d'une direction supérieure". Duperré ne croit cependant pas à une action occulte de la Cour impériale de Hué, et donne ensuite un état de la répression des fauteurs de troubles. Suivent des considérations sur les crédits nécessaires "à notre prochain établissement au Tonkin" (armements, troupes, constructions).ON JOINT : une L.A.S. du 4 juillet [1866] du même Duperré, alors chef de cabinet du ministre de la marine [Chasseloup-Laubat], adressée à un amiral non identifié, mais probablement le préfet maritime de Cherbourg [Aimé Reynaud], et annonçant un voyage impromptu du ministre : "Le ministre se propose de partir demain, jeudi, pour Cherbourg par le train de 8 h du soir. Il voyagera tout à fait incognito : son aide de camp Dumas, Dupuy de Tome et Trébault l'accompagneront. Par conséquent personne à la gare, vous seul". Une curieuse consigne y figure concernant l'amiral Camille de La Roncière-Le Noury (1813-1881). - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT - LIEN DE PAIEMENT, NOUS CONSULTER.


Phone number : 06 46 54 64 48
Varia Patrum et scripturae loca. Suivi de : Affectus aniname devotae ex Psalmodià Davidica deprompti.
S.l., s.d. ; in 12 veau brun épidermé ; 385 et 168 pp., pages de titres propres, 8 pp. de tables. Les titres sont dans des encadrements richement décorés et le texte est encadré d'un simple filet.


Phone number : 06 60 22 21 35
Manuscrit: "Recueil de Formules et Secrets des plus Célèbres Mds et Pharmaciens tant du Royaume que des Pays étragers" -
A Paris - 1745 - 1 volume in8 de 165 pages - sans couverture ni reliure - page de titre poussièreuse et détachée - par ailleurs très bon état -
Manuscrit: "Usages de quelques Remedes et la manière de les employer" -
A Paris - 1746 - 1 volume in8 de 176 pages - sans couverture ni reliure -
COURS D'INSTRUCTION RELIGIEUSE sous la direction de Monsieur (Gustave Fabre?), Pasteur de l'Eglise réformée de Nimes (1903-)
0 in 4 (30,5 x 21,5) 1 volume demi chagrin marron, dos à nerfs, plat de percaline verte, plats ornés d'un décor d'encadrement estampé à froid portant au centre du plat supérieur les 2 lettres EC, page de titre imprimée, 202 pages d'une très fine et très lisible calligraphie (avec quelques pages intercalaires vierges). Cette copie manuscrite du cours d'instruction religieuse donné sous la direction de Monsieur (Gustave Fabre?), Pasteur de l'Eglise réformée de Nimes (1903-) est due à Emilie Carénou (On peut lire dans la marge supérieure de la première page du manuscrit le nom de: Emilie Carénou). On joint un feuillet imprimé: Certificat de réception à la Sainte-Cène délivré à Mademoiselle Emilie Carénou (daté du 30 mai 1904). Bel exemplaire ( Photographies sur demande / We can send pictures of this book on simple request )
Très bon Couverture rigide
Cahier de Devoirs Corrigés appartenant à Arguyot Classe de Mr Briand professeur de Sixième au Lycée Charlemagne (1er titre). 2e titre: Arguyot élève de Monsieur Lefortier rue Geoffroy-Lasnier n°30 à Paris.-
Cahier commencé le 15 avril 1815. In-12 (107 x 167 mm) plein parchemin à dos lisse, étiquette de titre au dos, 138 pages en partie non chiffrées. Écriture assez peu soignée mais lisible, quelques taches d'encre, couverture tachée mais en assez bon état.
Mémoire sur une question relative aux biens soi disant nationaux.
S.l., 20 janvier 1813 in-folio, [3] ff. n. ch., couverts d'une écriture fine et lisible (environ 50 lignes par page), en feuilles.
Intéressant document concocté en émigration et attestant de l'importance majeure que revêtait, aux yeux des fidèles des Bourbons, la question de la restitution des biens nationaux, de seconde origine au moins. L'occasion est fournie par les revers de Napoléon en Russie : "Les revers que Buonaparte vient d'éprouver, en relevant nos espérances, ont exalté toutes les têtes. Chacun se permet de raisonner sur ce que le Roi fera en pareilles circonstances ; et comme on ne doute point que Sa Majesté n'annonce ses intentions ultérieures par des proclamations au peuple françois, on agite particulièrement quelle sera la manière dont le Roi s'expliquera relativement aux biens dont la plus grande partie de la noblesse et la totalité du clergé ont été injustement dépouillés."Son objet est de combattre l'opinion "modérée" conseillant de laisser la jouissance des biens nationaux aux détenteurs qui se rallieront à Louis XVIII, et ce, par mode de proclamation générale. Loin de cette mesure, l'auteur du mémoire, minimisant le nombre des bénéficiaires, conseille de rallier les sénateurs et les généraux les plus compromis dans l'acquisition des domaines nationaux par des négociations individuelles, et de laisser le reste dans le flou le plus général, donc le plus politique, et le plus propice aux restitutions ultérieures, envisagées comme de bonne justice : "Cette restitution que la force des choses amènera nécessairement un jour, ne peut s'opérer qu'avec sagesse et mesure par un gouvernement ferme et bien établi. Et pour, en dernière analyse, exprimer notre opinion, nous pensons que sur une matière aussi délicate, le silence absolu du Roi est le parti le plus sage, le plus prident et le plus avantageux que Sa Majesté puisse prendre."Pour les biens nationaux de première origine, l'auteur exclut de même la compensation par le paiement sur le Trésor royal des traitements des ministres du culte catholique (ce qui était, somme toute, la solution concordataire), et exige donc leur restitution.Par où l'on voit que l'éloignement des choses fait perdre le sens des réalités. A l'opposé de ces chimères, la Charte constitutionnelle de 1814 se verra obligée de déclarer en son article 9 : "Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles". - et, en son article 7 : "Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent seuls des traitements du Trésor royal".On joint : une autre copie in-folio du même texte, de [4] ff. n. ch. , d'une écriture plus épaisse, présentant des variantes minimes et quelques biffures et ratures. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT - LIEN DE PAIEMENT, NOUS CONSULTER.
Le dernier Dialogue.
Emile Gérard-Gailly, Le dernier Dialogue. Les Sablons de Tourgéville [Calvados], 2 au 10 août 1917. Petit in-12 carré, 96f. Manuscrit original complet de cette nouvelle publiée en 1923 dans son volume Ni moi sans vous. La Chronique des lettres françaises (1924, p.275) décrit ainsi la nouvelle : « Le dernier Dialogue est une nouvelle sans description ni récit, toute en conversation. Combien tragique, dans leur simplicité, ces derniers propos de deux amants, deux étudiants, que l'habitude de la plus précise analyse a rendus trop clairvoyants sur eux-mêmes, et si pitoyables dans leur scrupuleuse probité de conscience ! ». Le manuscrit, écrit d'une belle écriture à l'encre noire, sur le recto de chaque feuillet. Il porte ensuite de nombreuses corrections à l'encre brune, vraisemblablement en vue de l'édition. Beaucoup de corrections sont assez importantes et débordent parfois sur le verso d'autres feuillets. Ces corrections ont vraisemblablement été faites en vue de la publication. Le manuscrit porte un envoi juste après l'édition : « à mon ami Armand Delvigne, / j'offre et cette nouvelle et / ce manuscrit, avec l'espoir / qu'il me rendra un / jour la pareille. / Gérard-Gailly / Paris, juin 1923 ». Ce manuscrit fut donc écrit à Tourgéville où Gérard-Gailly avait ses habitudes. Il vivait entre sa villa Ghislaine à Tourgéville et son domicile parisien. La ville normande est probablement l'une des rares à ne pas l'avoir oublié en donnant son nom à une rue. Il sera aussi un ami proche de René Boylesve dont il sera l'exécuteur testamentaire avant de devenir le président de l'association des amis de René Boylesve. Reliure demi-basane à coins, tête dorée. Epidermures et frottements. Rare manuscrit de cet auteur belge.
[Heures à l’usage de Paris]. Très plaisant manuscrit enluminé parisien orné de 6 grandes miniatures revêtu d’une élégante reliure du XVIe siècle.
Chatoyant manuscrit enluminé orné de 6 peintures à pleine page d’une qualité d’exécution remarquable. Paris, vers 1485. Petit in-8 de 150 ff. sur peau de vélin, le premier et le dernier blancs. Exemplaire réglé. Ecriture gothique à l’encre brune, le calendrier en français en encre bleue, rouge et or. Justification du calendrier : 80 x 50 mm, 17 longues lignes, Justification du texte en latin : 81 x 50 mm, 16 longues lignes, écriture textura, ff. 25v et 86v blancs. Veau brun, plats entièrement ornés d’un décor doré, large motif losangé au centre portant un supra-libris, dos à nerfs, tranches dorées, traces de liens. Reliure lyonnaise du milieu du XVIe siècle. 155 x 103 mm.
[embed]https://youtu.be/4oVMrXDbj7Y[/embed] Chatoyant manuscrit enluminé orné de 6 peintures à pleine page d’une qualité d’exécution remarquable et de coloris chatoyants, témoignant de l’art des artistes enlumineurs français sous le règne de Charles VIII. Le texte : Ff. 1-12v Calendrier en français avec un saint pour chaque jour de l’année à l’encre or, bleue et rouge dérivé de Perdrizet 1933 (présence de Sainte Arragonde le 30 janvier, de Saint Amant le 6 février, de saint Vaast le 8 août). Ff. 13-18v Péricopes des 4 évangiles. Ff. 18v-25 Obsecro te et O Intemerata rédigés au masculin. Ff. 26-86 Heures de la Vierge à l’usage de Paris. Ff. 87-105v Psaumes de la Pénitence suivis avec s. Denis, s. Gervais, s. Prothais et s. Germain. Ff. 106-112v Heures de la Croix et Heures du s. Esprit. Ff. 113-148v Office des morts à l’usage de Paris. Ornementation : l’ornementation comprend 6 grandes miniatures à pleine page de belle facture. F. 13 Saint Jean l’évangéliste sur l’île de Patmos avec l’aigle et un gros rocher derrière lui. F. 26 Annonciation : la Vierge a les mains croisées sur sa poitrine, son livre est déposé derrière elle, l’ange la salue. F. 87 David vainqueur de Goliath dans un beau paysage formé de collines bleues et vertes. F. 106 Crucifixion : la Vierge et Saint-Jean prient à gauche, le centurion et ses soldats sont sur la droite. Le centurion porte une ceinture nouée. Le ciel est rempli de petits points d’or. F. 110 Pentecôte : la scène est construite sur une diagonale. La Vierge prie devant suivie des apôtres. Saint-Jean est à côté d’elle et Saint-Pierre derrière elle. F. 113 Job sur le fumier avec un ami qui porte une ceinture nouée. Superbes bordures sur quatre coté des miniatures avec troncs écotés et un hybride au f. 13, un héron au f. 87, une femme hybride sur fond d’or au f. 110, un hybride aux ff. 26 et 113 sur fond de parchemin compartimenté. Bordures latérales au f. 18v, 22v, en tête des Heures ff. 48v, 60, 65, 68, 71v, 75, 81v. Initiales sur 1 et 2 lignes à fond rouge et bleu lettre en or, initiales sur 3 lignes parisiennes fond d’or lettre en rouleau blanc et rose et fond rouge lettre en rouleau blanc et bleu. Très beau manuscrit en parfait état enluminé par un artiste à plusieurs noms. J. Plummer et J. Lauga le nomment le Maître du Morgan 26 et situent le début de sa carrière à Langres (J. Lauga, Les manuscrits liturgiques dans le diocèse de Langres à la fin du Moyen Age. Les commanditaires et leurs artistes, 2007, Université de Paris IV, direction F. Joubert, vol. 1, p. 273-284, vol. 2, notice 58, p. 577-611, notice 56, p. 541-560). J. Plummer et Fr. Avril lui attribuent le Jeu des échecs moralisés (Paris BnF., Ms. Fr. 2000). Fr. Avril lui donne le nom de Maître du Romuléon du Musée de Cluny d’après les fragments (Cl. 1804 et Cl 1819) de Limoges, Niort Rés. G.2.F. L’artiste s’inspire de modèles germaniques. Ainsi la comparaison de Jésus devant Pilate du Morgan 26 est l’exacte réplique d’une gravure d’Israël van Meckenem reproduite dans le Bartsch ilustrated 493 (fig. 354-355) comme l’a reconnu J. Lauga. Les échecs moralisés portent les armes de Nicolas d’Anjou, petit fils du roi René fils de Jean de Galabre qui meurt en 1473 mais le style évoque plutôt les années 1480 comme le suggére N. Reynaud en 1993 (Les manuscrits à peintures en France 1440-1520, cat. 213). L’auteur propose que le manuscrit laissé en souffrance aurait pu être achevé pour René II de Lorraine. M. Herman propose à la suite de Fr. Avril que le manuscrit ait été offert par Yolande D’Aragon à son fils René II de Lorraine (« Enluminure et commande de manuscrit enluminés », Langres à la Renaissance, cat. expo. 19 mai au 7 oct. 2018 Musée d’Art et d’histoire de Langres, Ars-en-Moselle, Langres 2018, p. 336-340 notice 83). N. Reynaud lui attribue le codex 2538 de Vienne La Guerre des Juifs qui semble avoir été peint pour Louis de Laval ou François de Laval. Le manuscrit a été copié par Pierre Rouche de Langres qui a également travaillé à Paris. I. Delaunay propose de l’identifier à Pierre Garnier peintre au service du roi René de 1476 à 1480 qui vient s’installer à Paris vers 1485 (Echanges artistiques entre livres d’heures manuscrits et imprimés produits à Paris vers 1480-1500, Paris université de Paris, ss. La direction de f. Joubert, thése 2000, t. I, p. 186, t. II, p. 57-60). De plus il s’inspire d’un artiste actif à la cour de Lorraine : Georges Trubert. Il reprend ses cadrages à mi-corps dans plusieurs de ses manuscrits. On retrouve le même rocher derrière saint Jean dans les Heures à l’usage de Langres Pierpont Morgan Library M. 26 et la miniature du même sujet dans Chaumont 34. Des petits points dorés pour éclairer le ciel sont communs à la Piéta de New York. Les visages rosés sont très beaux. L’artiste enlumine d’autres manuscrits parisiens (Paris, BnF. Ms. Latin 13295 et 1423). Le manuscrit a été revêtu au milieu du XVIe siècle d’une élégante reliure décorée de style lyonnais. Provenance : de la bibliothèque Marie//de/Lisle avec supra libris partagé entre les deux plats.
Manuscrit liturgique illustré écrit en ge’ez. Précieuse bible éthiopienne manuscrite sur peau de vélin enluminée de 13 figures polychromes à pleine page.
Rare bible éthiopienne manuscrite sur peau de vélin. Éthiopie, XIXe siècle. Petit in-4 de (134) ff. sur peau de vélin, 13 figures polychromes à pleine page. Texte écrit à l’encre noire rubriqué sur deux colonnes, avec des titres et des noms de saints écrits en rouge. Exemplaire réglé à la pointe sèche, piqûres de réglure dans les marges extérieures. Relié en veau estampé à froid de l’époque sur ais de bois, dos lisse bien présent. Reliure de l’époque. 205 x 148 mm.
Rare bible éthiopienne manuscrite sur peau de vélin. Elle est écrite en ge’ez, le langage liturgique de l’église éthiopienne. L’un des champs les plus significatifs de la culture éthiopienne est sa littérature, principalement des textes religieux en grec ancien et hébreu traduits en ancien ge’ez. Le ge’ez, l’une des langues les plus anciennes du monde, est encore utilisée par l’église orthodoxe éthiopienne, qui a ses propres coutumes et traditions. Les premières inscriptions en ge’ez (langue sémitique officielle de l’empire d’Axoum) datent du IVe siècle de notre ère, époque où florissait une dynastie puissante, qui reçut des influences grecques et sous laquelle eut lieu la conversion au christianisme. Le ge’ez s’écrit et se lit de gauche à droite, contrairement aux autres langues sémitiques. Le présent manuscrit est d’un format peu courant, ce type de bible étant le plus souvent composée au format in-8. L’illustration, dans les teintes jaunes, bleues et roses, reprend les thèmes de l’iconographie des VIe et VIIe siècles. Elle comprend 13 peintures à pleine page aux couleurs vives et chatoyantes (Saint Georges terrassant le dragon, une Vierge à l’Enfant, Saint Michel archange vainqueur du démon, ...). Précieux manuscrit enluminé éthiopien conservé dans sa reliure d’origine en cuir estampé à froid sur ais de bois.
Manuscrit liturgique illustré écrit en ge’ez. Précieuse bible éthiopienne manuscrite sur peau de vélin enluminée de 13 figures polychromes à pleine page.
Précieux manuscrit enluminé éthiopien conservé dans sa reliure d’origine en cuir estampé à froid sur ais de bois. Éthiopie, XIXe siècle. Petit in-4 de (134) ff. sur peau de vélin, 13 figures polychromes à pleine page. Texte écrit à l’encre noire rubriqué sur deux colonnes, avec des titres et des noms de saints écrits en rouge. Exemplaire réglé à la pointe sèche, piqûres de réglure dans les marges extérieures. Relié en veau estampé à froid de l’époque sur ais de bois, dos lisse bien présent. Reliure de l’époque. 205 x 148 mm.
Rare bible éthiopienne manuscrite sur peau de vélin. Elle est écrite en ge’ez, le langage liturgique de l’église éthiopienne. L’un des champs les plus significatifs de la culture éthiopienne est sa littérature, principalement des textes religieux en grec ancien et hébreu traduits en ancien ge’ez. Le ge’ez, l’une des langues les plus anciennes du monde, est encore utilisée par l’église orthodoxe éthiopienne, qui a ses propres coutumes et traditions. Les premières inscriptions en ge’ez (langue sémitique officielle de l’empire d’Axoum) datent du IVe siècle de notre ère, époque où florissait une dynastie puissante, qui reçut des influences grecques et sous laquelle eut lieu la conversion au christianisme. Le ge’ez s’écrit et se lit de gauche à droite, contrairement aux autres langues sémitiques. Le présent manuscrit est d’un format peu courant, ce type de bible étant le plus souvent composée au format in-8. L’illustration, dans les teintes jaunes, bleues et roses, reprend les thèmes de l’iconographie des VIe et VIIe siècles. Elle comprend 13 peintures à pleine page aux couleurs vives et chatoyantes (Saint Georges terrassant le dragon, une Vierge à l’Enfant, Saint Michel archange vainqueur du démon, ...). Précieux manuscrit enluminé éthiopien conservé dans sa reliure d’origine en cuir estampé à froid sur ais de bois.
Manuscrit liturgique illustré écrit en ge’ez. Séduisante bible éthiopienne manuscrite sur peau de vélin enluminée de 2 figures polychromes à pleine page.
Rare bible éthiopienne manuscrite sur peau de vélin. Éthiopie, XIXe siècle e.In-8 de (131) ff. sur peau de vélin, 2 figures polychromes à pleine page protégées par du tissu, déchirure aux 6e et 46e feuillets. Texte écrit à l’encre noire et rouge, avec quelques bandeaux peints en tête de plusieurs chapitres, piqûres de réglure dans les marges extérieures. Relié en veau estampé à froid de l’époque sur ais de bois, dos lisse avec qq. usures. Reliure de l’époque. 179 x 110 mm.
Rare bible éthiopienne manuscrite sur peau de vélin. Elle est écrite en ge’ez, le langage liturgique de l’église éthiopienne. L’un des champs les plus significatifs de la culture éthiopienne est sa littérature, principalement des textes religieux en grec ancien et hébreu traduits en ancien ge’ez. Le ge’ez, l’une des langues les plus anciennes du monde, est encore utilisée par l’église orthodoxe éthiopienne, qui a ses propres coutumes et traditions. Les premières inscriptions en ge’ez (langue sémitique officielle de l’empire d’Axoum) datent du IVe siècle de notre ère, époque où florissait une dynastie puissante, qui reçut des influences grecques et sous laquelle eut lieu la conversion au christianisme. Le ge’ez s’écrit et se lit de gauche à droite, contrairement aux autres langues sémitiques. L’illustration comprend 2 peintures à pleine page aux couleurs vives et chatoyantes dont une Vierge à l’Enfant, ainsi que plusieurs bandeaux peints en-tête. Précieux manuscrit enluminé Ethiopien conservé dans sa reliure d’origine en cuir estampé à froid sur ais de bois.
La mémoire des siècles 2 000 ans d'écrits en Alsace.
Strasbourg, Fondation mécénat science et arts, 1988; in-4, 247 pp., cartonnage de l'éditeur. Très bon état.
Très bon état.
La mémoire des siècles 2 000 ans d'écrits en Alsace.
Strasbourg, Fondation mécénat science et arts, 1988; in-4, 247 pp., cartonnage de l'éditeur.
.
La mémoire des siècles 2 000 ans d'écrits en Alsace.
Strasbourg, Fondation mécénat science et arts, 1988; in-4, 247 pp., cartonnage de l'éditeur.
.
La mémoire des siècles 2 000 ans d'écrits en Alsace.
Strasbourg, Fondation mécénat science et arts, 1988; in-4, 247 pp., cartonnage de l'éditeur. Très bon état.
Très bon état.
La mémoire des siècles 2 000 ans d'écrits en Alsace.
Strasbourg, Fondation mécénat science et arts, 1988; in-4, 247 pp., cartonnage de l'éditeur. Très bon état.
Très bon état.
La mémoire des siècles 2 000 ans d'écrits en Alsace.
Strasbourg, Fondation mécénat science et arts, 1988; in-4, 247 pp., cartonnage de l'éditeur. En bel état.
En bel état.
La mémoire des siècles 2 000 ans d'écrits en Alsace.
Strasbourg, Fondation mécénat science et arts, 1988; in-4, 247 pp., cartonnage de l'éditeur.
.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers![Histoire du diocèse de Châlons-sur-Marne.. [MANUSCRIT] Dom Jean François. (1722-1791).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LRC/8478_1_thumb.jpg)
![Histoire du diocèse de Châlons-sur-Marne.. [MANUSCRIT] Dom Jean François. (1722-1791).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LRC/8478_2_thumb.jpg)
![Histoire du diocèse de Châlons-sur-Marne.. [MANUSCRIT] Dom Jean François. (1722-1791).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LRC/8478_3_thumb.jpg)
![Cherbourg, port américain.. [Manuscrit] Drieu La Rochelle (Pierre ; 1893-1945) :](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CLA/20904_1_thumb.jpg)
![Thèses.. [Manuscrit] Drieu La Rochelle (Pierre ; 1893-1945) :](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CLA/20905_1_thumb.jpg)
![Thèses.. [Manuscrit] Drieu La Rochelle (Pierre ; 1893-1945) :](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CLA/20905_2_thumb.jpg)
![Les derniers jours.. [Manuscrit] Drieu La Rochelle (Pierre) - Berl (Emmanuel) :](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CLA/20903_1_thumb.jpg)
![Varia Patrum et scripturae loca. Suivi de : Affectus aniname devotae ex Psalmodià Davidica deprompti.. [Manuscrit du XVIIe siècle]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CLA/19928_1_thumb.jpg)
![Le dernier Dialogue.. [Manuscrit] Emile Gérard-Gailly,](https://static.livre-rare-book.com/pictures/JNL/012873_1_thumb.jpg)
![Le dernier Dialogue.. [Manuscrit] Emile Gérard-Gailly,](https://static.livre-rare-book.com/pictures/JNL/012873_2_thumb.jpg)
![Le dernier Dialogue.. [Manuscrit] Emile Gérard-Gailly,](https://static.livre-rare-book.com/pictures/JNL/012873_3_thumb.jpg)
![[Heures à l’usage de Paris]. Très plaisant manuscrit enluminé parisien orné de 6 grandes miniatures revêtu d’une élégante reliure du XVIe siècle.. ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/AGA/lcs-18115_thumb.jpg)
![[Heures à l’usage de Paris]. Très plaisant manuscrit enluminé parisien orné de 6 grandes miniatures revêtu d’une élégante reliure du XVIe siècle.. ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/AGA/lcs-18115_1_thumb.jpg)
![[Heures à l’usage de Paris]. Très plaisant manuscrit enluminé parisien orné de 6 grandes miniatures revêtu d’une élégante reliure du XVIe siècle.. ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/AGA/lcs-18115_2_thumb.jpg)