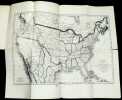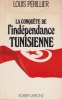Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (9)
19th (207)
20th (1868)
21st (182)
-
Syndicate
ILAB (2271)
SLAM (2271)
Histoire universelle des explorations.
Nouvelle Librairie de France, 1958-1975, 6 vol. in-8° carré, 416, 414, 366, 446, 338 et 389 pp, préface de Lucien Febvre, très nombreuses illustrations dans le texte + 256 planches de gravures hors texte en noir, 40 planches de gravures hors texte en couleurs et 162 cartes dont certaines en couleurs hors texte pour les 4 premiers volumes (parus en 1958) ; nombreuses illustrations dans le texte plus 148 illustrations hors texte en noir et en couleurs pour les 2 derniers (parus en 1974-1975), biblio, imprimés sur vélin supérieur, reliures vélin ornées de l'éditeur, bon état. Bien complet du lexique alphabétique des explorateurs (16 pages) imprimé à part et qui manque souvent
I. De la préhistoire à la fin du Moyen Age (L.-R. Nougier, J. Beaujeu et Michel Mollat) ; II. La Renaissance, 1415-1600 (Jean Amsler) ; III. Le temps des grands voiliers (P.-J. Charliat) ; IV. Époque contemporaine (J. Rouch, P.-E. Victor, H. Tazieff) ; V. Exploration de l'espace (Albert Ducrocq) ; VI. Exploration du système solaire (Albert Ducrocq). — "L'oeuvre a été entreprise sous la direction de L.-H. Parias ; le tome premier renferme une préface de Lucien Febvre ; Louis- René Nougier expose ensuite la découverte du monde par l'humanité préhistorique ; Jean Beaujeu retrace le cheminement des hommes pendant l'antiquité ; Michel Mollat décrit les efforts accomplis au moyen âge pour établir un lien entre l'Occident et l'Orient. Le second tome, rédigé par Jean Amsler, est entièrement consacré aux conquêtes de la Renaissance. Le tome troisième a été confié à P.-J. Charliat et concerne « le temps des grands voiliers », les XVIIe et XVIIIe siècles ; le tome quatrième a été consacré aux XIXe et XXe siècles ; la matière a été partagée entre J. Rouch, P.-E. Victor et H. Tazieff. La présentation de cette œuvre considérable est irréprochable ; de très nombreuses planches et des cartes, en noir et en couleur, ne laissent rien à désirer. Le but de cette magnifique publication n'est pas seulement l'histoire des explorations, au sens restreint du mot, mais aussi celle des progrès accomplis par les hommes dans la découverte des peuples qu'ils ne connaissaient pas encore et des effets qu'ont eu ces progrès sur le développement de la civilisation. (...) Ce résumé est insuffisant pour faire saisir l'importance d'une oeuvre qui est beaucoup mieux qu'une large vulgarisation, parce qu'elle s'élève souvent jusqu'aux idées générales. L'information n'offre pas de lacune ; elle dépasse les bibliographies sommaires placées à la fin de chaque livre ; l'exposition est conduite avec une réelle maîtrise... Cette vaste synthèse de l'exploration est une grande œuvre." (Robert Perret, Annales de Géographie, à propos de la première édition, qui ne comprenait que les 4 premiers volumes)
Histoire universelle des explorations. III. Le Temps des grands voiliers, les XVIIe et XVIIIe siècles. Par Pierre-Jacques Charliat.
Nouvelle Librairie de France, 1955, gr. in-8° carré, 366 pp, très riche iconographie dans le texte et hors texte (64 planches de gravures en noir et 9 planches de gravures en couleurs hors texte) + 35 cartes et plans (certaines cartes dépliantes en couleurs hors texte), biblio, reliure plein vélin éditeur, dos et 1er plat ornés, bon état
"Au XVIIe siècle, l'âge héroïque des conquistadors est passé. Il s'agit moins d'errer à la recherche de terres nouvelles que de tracer des routes commerciales, d'occuper des positions favorables, et d'améliorer les cartes. Venise, Gênes, l'Espagne et la Hanse teutonique ont vu décliner leur puissance maritime ; la France, l'Angleterre et la Hollande s'emparent des successions vacantes. Les compagnies des Indes commencent à donner des produits fabuleux. Hudson découvre la rivière qui porte son nom et Champlain fonde Québec ; Batavia devient la base de l'exploration du Pacifique. De 1648 à 1712, le Grand Siècle voulut mettre en ordre les cartes du monde. La Propagande, dotée d'un service cartographique, divulgua largement cartes et portulans. La France, avec Cassini, commença par dresser la carte de son propre territoire. L'Angleterre fit de même. La Société Royale de Londres, protégée par Charles II, publia les Philosophie Transactions où se trouve l'histoire des découvertes ; cet organisme suscita l'émulation de Colbert, qui créa l'Académie des Sciences ; de nombreuses missions furent envoyées dans les deux mondes. Le centre d'études pour l'Asie fut l'Université de Leyde. En Amérique, Jolliet, le Père Marquette et Cavelier de la Salle partirent vers l'Ouest et descendirent le Mississipi. En Asie, Tournefort parcourut l'Anatolie ; Chardin et Tavernier visitèrent la Perse ; les Jésuites occupèrent à Pékin, en tant qu'hommes de science, une situation privilégiée. En Afrique du Sud, Van Riebeck transforma l'aspect du pays en important des plantes venues d'Europe et d'Asie. Le XVIIIe siècle fut une époque très favorable aux découvertes. De nouvelles académies s'ouvrirent, comme celles de Berlin, d'Upsal et de Saint-Pétersbourg. On publia des encyclopédies : celle de Chambers à Londres, et à Paris celle de Diderot et d'Alembert. Des missions scientifiques s'enfoncèrent dans l'intérieur des continents et de grandes expéditions maritimes entreprirent le tour du monde. L'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg organisa l'exploration de la Sibérie autour de l'axe transsibérien et envoya Bering reconnaître le Kamchatka et l'Alaska. En Amérique du Sud, La Condamine mesura une étendue de 80 lieues afin de vérifier si la Terre était renflée à l'équateur. L'œuvre de la cartographie de la Chine arriva à son terme. La Bourdonnais fit reconnaître les Seychelles, et Anquetil-Duperron explora l'Inde en ethnologue. Au Pacifique, après les tours du monde de Roggeveen et de Wallis, la période qui commença en 1766 fut l'ère de Bougainville, de Marion- Dufresne, de Kerguelen, de Cook, de La Pérouse et d'Entrecasteaux. La nouveauté de ce temps, c'est bien la campagne de découvertes scientifiques et la présence d'ethnologues soucieux d'étudier les indigènes. Cette dernière préoccupation avait été étrangère à l'humanisme de la Renaissance." (Robert Perret, Annales de Géographie, 1958)
Souvenirs de Marine. Collection de plans ou dessins de navires et de bateaux anciens ou modernes existants ou disparus avec les éléments numériques nécessaires à leur construction.
Grenoble, Editions des 4 Seigneurs, 1975-1976, 3 vol. in-4° à l'italienne, 266,314 et 244 pp, 360 planches (120 par tome) accompagnées de très nombreux croquis, une planche en couleurs hors texte à la fin du tome 3 (navires japonais du XVIIIe siècle), table des planches en début de volume, reliures pleine toile bleues de l'éditeur, jaquettes illustrées, bon état
Réimpression de la très rare édition de 1882. François-Edmond Pâris (1806-1893), est un amiral français du XIXe siècle, connu pour ses travaux en construction navale dans la période de développement de la propulsion à vapeur, pour son rôle dans l'organisation du Musée national de la Marine et pour ses publications sur la construction navale dans le monde. Les "Souvenirs de Marine" de l'amiral Pâris, avec leurs 360 plans cotés en grand format, constituent une documentation unique au monde dans le domaine de l'archéologie navale. L'immense mérite de Pâris a été de s'astreindre à collecter et à faire graver vingt années durant, sans souci des modes et des préoccupation de rentabilité, les plans de bateaux d'origines et de catégories différentes. C'est ainsi que nous lui devons de connaître les relevés de centaines d'embarcations côtières du monde entier, d'un grand intérêt archéologique, et dont aucun plan n'a jamais existé. Les très nombreux plans de vaisseaux, galères, bombardes, bricks... des "souvenirs" nous épargnent d'interminables quêtes dans tous les musées d'Europe. La finesse de la gravure fait d'ailleurs oublier le prestige des documents originaux des XVIIe et XVIIIe siècles, parfois peu clairs, et qui sont rarement accessibles au commun des mortels. La réédition des "Souvenirs de Marine" est un outil incomparable pour les modélistes et amateurs d'architecture navale.
Mythologies africaines.
P., ODEGE, 1969, in-4°, 139 pp, 57 illustrations en couleurs (la plupart pleine page) et 107 illustrations en noir, 6 figures, une carte pleine page, biblio, index, reliure toile rouge éditeur, 1er plat illustré en noir, titre en noir au dos, jaquette illustrée en couleurs, bon état
PSB. Les fastes du Parti Socialiste Belge, 1885-1960.
Bruxelles, Parti socialiste belge, Institut Emile Vandervelde, s.d. (1960), gr. in-8°, 368 pp, préface de Léo Collard, 69 planches de photos hors texte, reliure pleine toile imprimée de l'éditeur, jaquette illustrée (lég. abîmée), bon état
Tout sur le PSB à travers de nombreuses et importantes contributions : Les antécédents (Jan Dhondt) ; La naissance du POB (Marc-Antoine Pierson) ; 1886, année terrible (Denise de Weerdt) ; La période héroïque : 1886-1914 (Marcel Busieau) ; La guerre 1914-18 (Pierre Vermeylen) ; La période 1918-1926 (Arthur Wauters) ; Les socialistes et le réveil de la Flandre (Julien Kuypers) ; La période 1926-1939 (Georges Bohy) ; La résistance socialiste : 1940-1944 (Charles Rahier) ; Le Congrès de la Victoire (Jules Bary) ; L'oeuvre de redressement (Edmond Leburton) ; Naissance de l'Action Commune (Victor Larock) ; La période 1950-1959 (René Evalenko) ; L'action internationale du POB et du PSB (Fernand Dehousse) ; Le Mouvement Coopératif (Emile Dutilleul) ; L'histoire syndicale (Léon Delsinne) ; L'effort mutualiste (Alex Lombard) ; Jeunesses socialistes (Georges Dejardin) ; Présence des femmes au coeur de l'action socialiste (Irène Pétry et Renée Farge) ; Les activités culturelles (Léo Magits) ; La presse socialiste (Albert Housiaux) ; Situation et perspectives (Marc-Antoine Pierson et René Evalenko).
Un jeu dangereux : la falsification de l'histoire. Recueil d'études et d'articles.
Bucarest, 1987, gr. in-8°, 276 pp, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état
Histoire politique et sociale du peuple américain. 2.2. De 1825 à nos jours.
Picard, 1931, in-8°, (381) pp, paginé 707-1087, 34 illustrations et cartes hors texte, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Seconde partie seule du tome II sur la période de 1825 à nos jours. Cet important ouvrage en 2 tomes (et 3 volumes : le tome II est découpé en 2 volumes) suit l'évolution historique, politique, économique et sociale des États-Unis : industrialisation intensive, complexité des problèmes liés aux Indiens, aux esclaves, au flux continu des migrants.
Histoire politique et sociale du peuple américain. 1. Des origines à 1825.
Picard, 1924, in-8°, x-410 pp, 25 gravures et cartes hors texte, broché, couv. illustrée, bon état
"L'ouvrage de M. D. Pasquet, qui repose sur des lectures extrêmement abondantes, n'a cependant rien d'une compilation. L'auteur a repensé son sujet, et, sur un grand nombre de points, il nous présente des vues neuves et personnelles, ainsi, pour ne citer qu'un exemple, sur le peuplement des colonies anglaises de l'Amérique du Nord (p. 125). Son exposé, d'une clarté et d'une simplicité qui ne laissent rien à désirer, s'agrémente, çà et là, mais très discrètement, d'une pointe d'humour. L'illustration, empruntée à des gravures du temps ou à des relations de voyages, est des plus instructives, ainsi que les cartes. Somme toute, un beau livre que tout ami de l'histoire lira d'un seul trait." (F. Lot, Bibliothèque de l'École des chartes, 1925) — "Un beau livre, et qui nous manquait. Nous n'avions, en français, que des résumés, parfois commodes mais tous incomplets, de l'histoire des États-Unis. Nous aurons maintenant une vraie histoire du peuple américain, et où je crois que les Américains reconnaîtront leur image. (...) Sur la coupure de 1825 : date capitale : c'est le moment où l'expansion vers l'Ouest commence à donner ses premiers résultats importants, où la révolution industrielle prépare l'émancipation économique, où va déferler le flot des immigrants, où la question des voies de communication apparaît comme le problème vital pour les États jusqu'alors isolés ; c'est le lendemain du message de Monroe, c'est bien la naissance de « la nouvelle Amérique ». (...) Cet excellent livre, bien présenté, illustré de documents qui sont toujours contemporains, marquera dans notre littérature historique." (Henri Hauser, Revue Historique, 1924)
Londres et les ouvriers de Londres. (Thèse).
Armand Colin, 1914, gr. in-8°, 762 pp, une planche et une carte dépliante hors texte, 23 cartes et graphiques dans le texte, biblio, index, broché, dos abîmé avec manque, intérieur propre, état correct
C'est par l'histoire, et plus particulièrement par l'histoire économique, que Pasquet est venu à la géographie. L'influence de son maître Vidal de la Blache fut décisive pour l'orientation de ses travaux. En 1893, sa thèse d'agrégation avait porté sur “La Chambre des Communes jusqu'à l'avènement d'Edouard III” ; en 1913, sa thèse de doctorat eut pour sujet “Londres et les ouvriers de Londres” ; dans l'intervalle, plusieurs voyages en Angleterre lui avaient permis de réunir la documentation nécessaire. Dans les Annales (t. XXIII-XXIV, 1914-1915, p. 430-433), Vidal de la Blache, auquel était dédiée la magistrale étude sur Londres, a dit tout le bien qu'il en pensait : « Ce livre tient plutôt de la sociologie politique et de l'économie politique que de la géographie... Mais par l'attention qu'il apporte à localiser les phénomènes, à les traduire en graphiques ou en cartes, l'auteur prouve combien sa méthode est imprégnée de géographie.» (H. Busson, Annales de Géographie 1928). Pasquet fut successivement professeur aux lycées d'Alençon, de Toulon, de Versailles, et à Condorcet, avant de donner sa mesure à l'Ecole pratique des Hautes-Études : d'abord suppléant d'Adolphe Landry pour l'Histoire des faits et des doctrines économiques (1919), il fut nommé en 1924 directeur d'Etudes d'une chaire d'Histoire étrangère.
Sor Juana Inés de la Cruz ou Les pièges de la foi.
Gallimard, 1987, in-8°, 636 pp, traduit de l'espagnol, 31 illustrations sur 32 pl. hors texte, index, broché, bon état (Coll. Bibliothèque des Idées)
Singulier destin que celui de Sor Juana Inés de la Cruz (1648 ?-1695), un des fleurons de la littérature hispanique à la fin de l'âge baroque ! Féministe avant l'heure, cette jeune femme de génie, belle de surcroît et adulée du monde, mais fille naturelle, comprit tôt qu'elle ne pourrait satisfaire sa vocation d'écrivain qu'en entrant au couvent. Elle y fut bonne religieuse, quoique un peu mondaine, y écrivit beaucoup et put y jouir de l'extraordinaire renommée que son œuvre littéraire et sa culture, bien rares à l'époque chez une femme, lui avaient value tant en Espagne qu'en Amérique. Jusqu'au jour où l'appui des Grands qui la cautionnaient lui faisant défaut, celui des quelques princes de l'Église qui la protégeaient à contre-courant cessa du même coup. Elle se vit alors contrainte de renoncer aux lettres et à tous ses biens pour mourir peu après, victime de son dévouement auprès de ses sœurs, lors d'une grave épidémie qui ravagea le couvent. C'est ce que raconte Octavio Paz, en poète qui se fait historien. Un dialogue passionné s'instaure entre deux grands écrivains du Mexique à trois siècles de distance. Occasion pour l'auteur du Labyrinthe de la solitude de reprendre, à travers une figure qu'il rend proche et dont paraît en même temps que cette biographie un recueil de poèmes, Premier somge..., les grands thèmes qui lui sont chers, notamment celui de la liberté de l'écrivain face à l'orthodoxie régnante et aux abus du pouvoir dans les sociétés bureaucratiques.
Histoire des Incas.
P., Maisonneuve & Larose - Wamani, 1995, gr. in-8°, 187 pp, 22 illustrations et cartes, biblio, broché, bon état
"L'histoire des indiens Cuzco, présentée ici, bénéficie des apports de la documentation administrative coloniale, de l'archéologie et de l'ethnographie."
Sur les chemins de l'Océan. Paquebots 1830-1972.
Hachette, 1971, in-8°, 271 pp, 16 pl. de gravures et photos hors texte, biblio, index, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
"Né le 25 novembre 1898 à Toulon, d'une famille de marins, Léonce Peillard a fait ses études dans les ports avant de s'engager dans l’armée anglaise et d'être licencié en droit. Pour écrire ce livre, il s’est rendu à Londres, Hambourg, Marseille, Ottawa, chercher les livres de bord, des rapports, des documents, des lettres, des interviews auxquels il a ajouté ses souvenirs personnels. Son ouvrage est un vaste tableau qui s'adresse à tous ceux qui aiment l'aventure et la mer car il est l'histoire des clippers américains, des navires anciens et modernes, des premiers vapeurs, des navires de plaisir ou de guerre qui ont flotté sur toutes les mers, portant le pavillon des plus grandes nations terrestres ou maritimes." (Georgette Lacroix, L'Action-Québec, 8 avril 1972)
Yougoslavie. Présentation de Léonce Peillard, photographies de Mladen Grcevic, notices géographiques, historiques et archéologiques de Myriana.
Hachette, 1956, in-8° carré, 128 pp, 62 pl. en noir et 8 pl. en couleurs hors texte, une carte, reliure éditeur, jaquette illustrée, bon état (Coll. Les Albums des Guides Bleus)
"Située aux confins des pays slaves, baignée au sud-ouest par une Adriatique longtemps dominée par les trirèmes romaines puis par les vaisseaux des puissants doges de Venise, avec, au sud, cette Macédoine encore tout imprégnée d'Islamisme, la Yougoslavie, petite par sa surface, grande par son histoire, a su amalgamer, dans le creuset ardent de ses champs de bataille, blonds Slovènes aux yeux bleus, Serbes intelligents et rétifs, géants monténégrins aux fortes moustaches, pêcheurs dalmates à la faconde méditerranéenne, placides bergers macédoniens vêtus des peaux de leurs moutons et jouant du pipeau à deux branches comme le dieu Pan, et même ces Musulmans de Titograd qui, le soir, abandonnant la cotte bleue pour les culottes bouffantes et le boléro soutaché, se rendent à l'appel rituel du muezzin. Visiter plusieurs pays en un seul, tel est l'avantage du tourisme en Yougoslavie. Franchissez quelques kilomètres, et, d'une république à l'autre, moeurs et coutumes changent comme par enchantement. Loin de nous cette Yougoslavie ? Non pas : elle est à deux jours de voiture de Paris, à un jour de Nice, à vingt heures de chemin de fer, à quelques heures d'avion..."
Chez les Yougoslaves, de la Save à l’Adriatique. Sarajevo et sa région. Avec de nombreuses illustrations hors-texte et plusieurs croquis (carte et plan).
P., Aux Editions des “Belles-Lettres” de la Société Guillaume Budé, 1934, gr. in-8°, xix-273 pp, préface de Paul Labbé, 24 pl. de gravures et photos hors texte, une carte de la Yougoslavie et un plan dépliant de Sarajevo hors texte, broché, bon état, envoi a.s. à A. t'Serstevens
"Sarajevo ! nom qui a une résonance tragique dans bien des oreilles françaises ; cette ville ne fut-elle point, le 28 juin 1914, le théâtre d'un attentat qui allait déchaîner la guerre mondiale ? Rien de plus exact, mais Sarajevo est plus et mieux que cela : une cité d'un pittoresque extrême, où l'Orient et l'Occident s'affrontent et se concilient, une cité sise au centre d'une des plus curieuses régions de la Yougoslavie. Révéler les charmes de Sarajevo aux Français qui les ignorent, telle est la tâche entreprise par M. René Pelletier ; disons-lui de suite qu'il y a pleinement réussi ; il nous a été donné cette année de faire un bref séjour, trop bref séjour dans la capitale de la Bosnie, et l'émerveillement que traduisent toutes les pages de l'ouvrage de M. René Pelletier a été le nôtre : nulle ville, nulle province ne savent autant que Sarajevo et sa région séduire, retenir le visiteur. A tous ceux qu'anime, au cours d'un voyage, la recherche des beaux paysages, le contact avec des populations accueillantes, aux costumes éclatants, nous recommandons Sarajevo. Ajoutons que le livre de M. Pelletier leur sera un excellent guide, guide qualifié et guide enthousiaste. M. Pelletier aime en effet d'amour conscient cette région yougoslave où la destinée l'a fixé et. où il poursuit une oeuvre de propagande française utile entre toutes. Par lui, le lecteur français sera pleinement initié à l'histoire tourmentée de la Bosnie, aux étranges coutumes nées de la différence des religions, de l'opposition, toute extérieure d'ailleurs, entre Serbes orthodoxes et Serbes islamisés ; à sa suite, il visitera Sarajevo et son célèbre bazar (Carsija), ses mosquées, ses vieilles maisons; avec lui, il poussera jusqu'à Mostar, capitale de l'Herzégovine ; les légendes, les traditions populaires lui seront révélées par le menu ; il pourra mesurer la variété d'un folklore qui a gardé toute sa fraîcheur, tout son éclat. Sarajevo et la Bosnie, ville et région, fières de leur indépendance retrouvée, ne sauraient laisser le passant indifférent. M. René Pelletier vous en convaincra, j'en suis sûr, et nous pensons lui donner sa pleine valeur en soulignant qu'il constitue une véritable invitation au voyage, à la recherche d'un imprévu devenu si rare aujourd'hui." (Jean Hugonnot, La Revue du Pacifique, 1935)
Le Mouvement ouvrier aux Etats-Unis.
Seghers, 1965, in-12, 269 pp, traduit de l'américain, préface d'Yves Delamotte, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Vent d'Ouest)
Transplantés sur le sol vierge du Nouveau Monde, les Américains ont dû improviser d'abord, façonner peu à peu ensuite, un mode d'expression politique, sociale et syndicale qui réponde à des données particulières et originales. Pour ce qui est du syndicalisme, ses manifestations américaines d'aujourd'hui ressemblent assez peu à celles qui prévalent en Europe où, traditionnellement, les syndicats sont liés aux mouvements politiques et où les syndicalistes ont le sentiment d'appartenir à la "classe ouvrière". Aux Etats-Unis, nous dit Henry Pelling, le monde du travail s'est donné pour but, non pas la transformation révolutionnaire de la société selon une idéologie ou une autre, mais bien l'amélioration continue de son niveau de vie. Une des conséquences d'une telle orientation, c'est l'absence d'idéologie qui caractérise le syndicalisme américain. La présente étude couvre trois cents ans du mouvement ouvrier en Amérique. Elle nous aide à en comprendre l'unité et la diversité, unité et diversité symboliquement exprimées dans le sigle de cette vaste fédération syndicale, l'AFL-CIO.
L'Egypte et le Soudan égyptien.
Hachette, 1895, in-12, (6)-400 pp, une carte dépliante en couleurs in fine, biblio, reliure demi-chagrin carmin, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres et fleurons dorés (rel. de l'époque), pt. épidermure en tête, bon état. Rare
I. L'Egypte en 1879 ; II. Les puissances européennes pendant la crise, 1881-1882 ; III. Les Anglais en Egypte depuis 1882 ; IV. Etat social, économique et budgetaire de l'Egypte en 1895.
Les Conquérants d'Asie. Les Perses et Alexandre, Attila, Genséric, Ye-Liu Ta-Ché, Gengis Khan, Tamerlan, Les grands Mogols, Jéhanjir, destin de l'Asie.
Payot, 1951, in-8°, 255 pp, 3 cartes biblio, broché, couv. illustrée, papier lég. jauni, bon état (Coll. Bibliothèque historique)
Réforme et révolution dans les sociétés traditionnelles : histoire et ethnologie des mouvements messianiques.
Éditions Anthropos, 1968, pt in-8°, xix-391 pp, préface de Roger Bastide, 8 pl. de photos hors texte, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
"Il s'agit de comparer les mouvements messianiques du Moyen âge européen et les mouvement messianiques contemporains (ou quasi contemporains) des pays sous-développés. L'auteur combine, pour aboutir à une synthèse, la réflexion critique sur les innombrables documents concernant les mouvements messianiques et l'analyse directe d'un mouvement messianique brésilien – l'une et l'autre démarches fondées sur une longue pratique de l'étude de la paysannerie brésilienne... Ceci posé, à quoi peut-on reconnaître un mouvement messianique ? Il surgit de la rencontre de trois éléments : « une collectivité mécontente ou opprimée ; l'espoir en la venue d'un émissaire divin, qui doit redresser les torts dont elle souffre ; la croyance en un paradis en même temps sacré et profane » (p. 7)... L'auteur reprenant la définition classique des concepts de réforme et révolution proposée par E. Hobsbawn, ré-analyse les mouvement messianiques... A l'instar des révoltes paysannes, les mouvements messianiques agissent en fait, « comme des facteurs de réorganisation de la société traditionnelle » (p. 315) . L'auteur rejetant la thèse souvent avancée selon laquelle les mouvements révolutionnaires contemporains prendraient leur source dans les mouvements messianiques..." (Michel Dion, Revue française de sociologie, 1969)
Les Indiens de l'Eldorado. Etude historique et ethnographique des Muiscas de Colombie.
Payot, 1955, in-8°, 400 pp, préface de Louis Marin, 16 photos sur 8 pl. hors texte et 8 figures, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Bibliothèque historique)
"... Comme document ethnique, le volume de M. de Barradas est un excellent livre sur les Muiscas. Il est le plus complet qui existe. Il renferme nombre de détails qui ne semblent figurer nulle part ailleurs. Malgré l'abondance des matériaux, il est intellectuellement très bien composé, dans un ordre très clair, que chaque lecteur saisit immédiatement et qui le rend facile à consulter. C'est un guide sûr..." (Louis Marin, préface)
La conquête de l'indépendance tunisienne. Souvenirs et témoignages.
Laffont, 1979, in-8°, 304 pp, manque la page de faux-titre, prière d'insérer conservé
L'inquiétude de l'Orient. I. Sur la route de l'Inde. II. En Asie musulmane.
Hachette, 1927, 2 vol. in-12, 252 et 243 pp, brochés, couv. illustrées, bon état, envoi a.s.
Pendant un an, de décembre 1924 à décembre 1925, sur l'invitation de la Revue des Deux Mondes, Maurice Pernot a parcouru l'Egypte, Ceylan, une grande partie de l'Inde, l'Afghanistan, la Perse, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Dans tous ces pays, il s'est entretenu avec les oppresseurs et les opprimés, il a écouté les chefs d'Etat et de gouvernement, les agitateurs politiques et les chefs religieux... Tome I : Vers l'indépendance égyptienne. Les destinées de l'Egypte. De Ceylan à Golconde. L'Inde et les Anglais. L'Inde et l'Occident. Passé et avenir de l'Inde ; Tome II : En Afghanistan. Politique persane. A travers la Perse. Deux expériences : l'Irak et la Syrie. La réforme turque. Le devoir de l'Europe.
L'Amérique du Sud au XVIIIe siècle. Mélanges anecdotiques et bibliographiques.
Mantes, Imprimerie du "Petit Mantais", 1942, pt in-4°, 121 pp, 16 gravures (3 dans le texte, 11 pleine page hors texte dont le frontispice et 2 dépliantes, dont une carte), index, broché, trace de mouillure ancienne au coin des derniers feuillets, état correct (Coll. Cahiers d'histoire et de bibliographie)
Etude faite à partir de l'importante collection des livres et des manuscrits du XVIIIe de la bibliothèque de M. Jean Lebaudy consacrés à l'Amérique Méridionale. Sommaire : La Prise de Rio-de-Janeiro par une escadre française en 1711 ; Un Journal de voyage inédit au long des côtes du Chili et du Pérou ; Les tribulations d'un négrier ; Une émeute sous l'Equateur : les mésaventures de trois académiciens ; Une réussite sociale : les Réductions des Jésuites au Paraguay.
Villes du Sud.
Balland, 1990, gr. in-8°, 404 pp, 48 photos dans le texte, index, broché, couv. illustrée, état correct
Cinquante villes, trente pays. Des Caraïbes à l'Indus, du Congo au Liban, de Bucarest libérée à Damas captive, des mégapoles comme Le Caire, Marseille, Beyrouth et Bogota aux villes oubliées comme Antioche, Syracuse ou Melilla : singulièrement contrasté est le Sud que nous fait découvrir Péroncel-Hugoz, grand reporter au Monde. On croise dans ses chroniques des écrivains, des dictateurs, des sultans, des prostituées, des gigolos, un ayatollah sénégalais, un ministre roumain exorciste, les juges d'un tribunal arabe siégeant à Valence depuis mille ans, et surtout beaucoup de gens ordinaires. L'islam est bien sûr l'un des fils conducteurs de ce périple, sous ses aspects souvent les plus inattendus.
La raison de ma vie.
Raoul Solar, 1952, pt in-8°, 320 pp, traduit de l'espagnol (“La razón de mi vida”), 2 portraits en couleurs (Eva et Juan Perón), 20 photos à pleine page, cart. éditeur, sans la jaquette, bon état
Le 26 juillet 1952, disparaissait la madone de los descamisados (les sans-chemises), victime de leucémie, après de longs mois de souffrances et plusieurs interventions chirurgicales. Et pour tous les Argentins, même après des décennies, Eva Duarte-Perón reste une icône. Celle qui deviendra la seconde femme du général Juan Domingo Perón est née le 7 mai 1919 à Los Toldos en Argentine. Très jeune orpheline, sa jeunesse fut empreinte de misère et de pauvreté tel qu’était le lot de millions de ses compatriotes à cette époque. Adolescente elle rejoint la capitale Buenos Aires, dans l’espoir d’une vie meilleure et connut divers métiers comme chanteuse de cabaret, actrice de cinéma et animatrice de la radio locale « Belgrano », ce qui la fit connaître auprès de la population. C’est elle qui en 1945 alerta les travailleurs et l’opinion publique sur la disgrâce de Perón et parvint par son opiniâtreté à le réhabiliter. Ils ne se quitteront plus et « Evita » se transformera en propagandiste de charme et de choc pour le régime, tout spécialement en faveur de la femme argentine et des pauvres du pays, multipliant les institutions, les écoles et les dispensaires à leur intention. Prêchant le justicialisme social, elle anime et dirige aussi les trois principaux quotidiens du pays, ayant perçu le poids des médias auprès de la population. Eva Perón sera l’élément majeur des réussites de son mari, infatigable combattante de l’oligarchie, au point de susciter une véritable idolâtrie de la part des descamisados, les déshérités de la nation dont le culte survivra à sa disparition à l’âge de 33 ans. Dans son autobiographie « la razon de mi vida » Eva Perón distingue trois parties : les raisons de ma mission, les ouvriers et ma mission et les femmes et ma mission, ayant comme ligne directrice le sentiment fondamental qui a toujours dominé l’esprit et la vie d’Evita : l’indignation devant l’injustice. Car pour elle, le spectacle de toute injustice a toujours été synonyme de souffrance. A la fin de son livre, quelques mois avant son décès, Eva Perón affirme : « Mais je n’ai pas écrit pour l’Histoire. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour le présent, pour ce présent extraordinaire et merveilleux qu’il m’est donné de vivre, pour le peuple argentin et pour toutes les âmes qui, dans le monde, de près ou de loin, sentent qu’un jour nouveau se lève pour l’humanité : le jour du « Justicialisme ». Je ne regrette aucun des mots que j’ai écrits. Sinon, il faudrait d’abord les effacer du cœur et de l’âme de mon peuple qui les a entendus si souvent et qui m’en a récompensé par son affection inestimable ! Une affection qui a plus de prix que ma vie ! »
 Write to the booksellers
Write to the booksellers