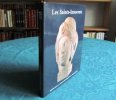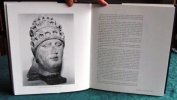50000 books for « collectif a t p du ... »Edit
-
Latest
Last 24h (138)
Last 3 days (86)
Last month (2557)
Last week (147)
-
Century
15th (1)
16th (43)
17th (203)
18th (1955)
19th (52313)
20th (403206)
21st (67468)
-
Countries
Belgium (5570)
Canada (420)
China (45)
Côte d'Ivoire (126)
France (648108)
Germany (68)
Greece (76)
Switzerland (5407)
United States of America (1)
-
Syndicate
ALAC (416)
CLAM (326)
CLAQ (1)
CNE (5)
ILAB (539844)
NVVA (476)
SLACES (476)
SLAM (538532)
SNCAO (11)
Type
- Any type (2)
- Art print (2)
- Artists book (3)
- Autograph (2)
- Book (657867)
- Disk (9)
- Drawings (1)
- Engraving (9)
- Magazine (1740)
- Manuscript (24)
- Maps (45)
- Music sheets (2)
- New book (17)
- Object book (1)
- Old papers (75)
- Photographs (5)
- Postcards (3)
- Posters (13)
- Reprint (1)
Language
- Albanian (3)
- Arabic (1)
- Czech (2)
- Danish (1)
- Dutch (13)
- English (192)
- Finnish (1)
- French (659344)
- German (56)
- Greek (1)
- Hebrew (2)
- Italian (65)
- Japanese (4)
- Latin (35)
- Polish (3)
- Portuguese (18)
- Romanian (1)
- Russian (2)
- Slovenian (2)
- Spanish (74)
- Swedish (1)
Topics
- Agriculture (2907)
- Almanac (2468)
- Annals (1621)
- Aquitaine (11769)
- Archaeology (4697)
- Architecture (2950)
- Atlas (4019)
- Aviation (4401)
- Belgium (1202)
- Bible (1776)
- Biography (1536)
- Brittany (2416)
- Children’s books (12309)
- Christianity (3884)
- Cinema (9869)
- Collections (5964)
- Comic strip (12086)
- Computer science (1123)
- Cooking (5317)
- Culinary art (4290)
- Dictionaries (1719)
- Drawings (2170)
- Dressmaking (2518)
- Economics (2329)
- Education (5560)
- Education - morals (5142)
- Ethic (2045)
- Faith (2103)
- Family (1906)
- Fashion (1133)
- Figaro (6528)
- Fine arts (4459)
- First edition (3659)
- Fishing (1330)
- Genealogy (1766)
- Geography (10261)
- Germanic languages (5417)
- Germany (1204)
- Guide books (4697)
- History (23854)
- Humour anecdotes (1140)
- Hunting (1434)
- Ile de france (1248)
- Industrial arts & crafts - fine arts (5999)
- Iron (2206)
- Italian (1468)
- Italy (1427)
- Journalism (28052)
- L'illustration (newspaper) (6694)
- Law (2563)
- Literature (17218)
- Lorrain (2075)
- Magazine (82321)
- Mathematics (7615)
- Medicine (5455)
- Midi pyrenees (1322)
- Military arts (2974)
- Mines & miners (1301)
- Motor vehicle (4926)
- Museums (6225)
- Music (3331)
- Navy (3357)
- Newspaper (8634)
- Newspapers press (112909)
- Opera (1042)
- Opera ballet (1065)
- Painters (3348)
- Painting (1642)
- Paris (1192)
- Periodicals (5983)
- Philosophy (2788)
- Phone directory (1374)
- Photography (4461)
- Poetry (3471)
- Policy (4780)
- Portugal (1075)
- Psychology (2890)
- Regionalism (8363)
- Religions (16121)
- Repertory post office directory (1367)
- Review (11319)
- Reviews (86535)
- Sciences (8204)
- Scores (3021)
- Social sciences (2248)
- Spiritualism (1830)
- Sports (2056)
- Sports (5365)
- Switzerland (1559)
- Telephone - telegraph (2208)
- Theatre (4435)
- Theology (8117)
- Travel (7219)
- Various (5834)
- Viticulture (2002)
- War (5206)
- Wine (2130)
- Youth (1365)
La collection des années 70 du Musée du Costume et de la Dentelle.
2013 Souple Bruxelles, Musées de la ville de Bruxelles, 2013. Un volume in-8 (24 x 17 cm), broché,couverture illustrée à rabats. 125 (1) pages, illustrées de nombreuses reproductions photographiques en couleurs. Catalogue publié à l'occasion de l'exposition "Seventies - chacun ses audaces", réalisée par le Musée du Costume et de la Dentelle de la ville de Bruxelles. En 5 chapitres, ce catalogue particulièrement bien fait retrace une histoire de la mode des années 70 et propose une riche iconographie de cette époque. Edition originale. Bel état du texte et des illustrations, bon exemplaire.
Très bon
NEZ - The olfactory magazine - N°13 - Spring 2022
2022 Couverture souple Paris, Nez, 2022. Un volume petit in-4 (26 x 20 cm), couverture souple avec motifs découpés sur fond violet. 160 pages, illustrées de nombreuses reproductions photographiques en noir et en couleurs, une carte postale olfactive (Bois vivant). Edition anglaise. Nez, revue fondée en 2016, propose de découvrir le monde à travers nos sensations olfactives, avec une approche pluridisciplinaire : art, littérature, photographie, sciences, histoire, gastronomie, parfumerie… Pour comprendre le rôle essentiel de l'odorat dans notre vie. Nez explores the world around us via our sense of smell, adopting a novel approach that encompasses art, literature, photography, science, history, gastronomy and perfumery to illustrate the essential role that olfaction plays in our lives. Bel exemplaire, comme neuf.
Comme neuf
Los Logos N°7
2014 Couverture rigide Sans lieu, Gestalten, 2014. Un volume in-8 oblong (19 x 24 cm), cartonnage illustré de l'éditeur, dans son blister d'origine. 400 pages, illustrés de modèles de logos en couleurs.Los Logos 7 est l'ouvrage de référence qui fait autorité en matière de conception de logos contemporains dans le monde entier. Comme les éditions précédentes de la série Los Logos de Gestalten, ce livre est à la fois un guide des dernières innovations et un précurseur des tendances à venir. Ce recueil de 400 pages, entièrement indexé, présente une sélection inégalée d'exemples de pointe provenant du monde entier, classés intuitivement par style ou par motif. Six entretiens avec des designers de premier plan dans le domaine de la conception d'entreprises, de logos et d'étiquettes ponctuent la compilation et offrent un aperçu des coulisses de jeunes agences ou d'agences bien établies. Manuel pratique sur les développements actuels en matière de conception de logos et source d'inspiration de dernière minute, Los Logos 7 est un ouvrage indispensable pour tout designer, responsable de marque, découvreur de tendances ou stratège en marketing. Bel exemplaire, à l'état neuf.
Comme neuf
Géricault.
1987 Couverture souple Tokyo, Journal Maïnichi, 1987. In-4, broché (28 x 22 cm), couverture illustrée, quelques marques marginales de frottements au second plat. 325 pages, illustrées de reproductions en noir et en couleurs d'oeuvres de Géricault. Catalogue publié à l'occasion de l'exposition au Musée d'Art Moderne de Kamakura en 1988. Texte en japonais et en français. Bel état des planches et du texte, bon exemplaire.
Très bon
Bibliothèque imaginaire - numéro spécial noël 1956.
1956 Couverture rigide Paris, Compagnie Française d'Edition, 1956. Grand in-4 (32 x 25 cm), cartonnage d'éditeur à la Bradel, petits manques aux charnières en pied et en tête, jaquette illustrée, coiffe supérieure légèrement émoussée, jaquette bien conservée cependant, créée et gravée par Draeger frères à Montrouge. Catalogue d'imprimeurs et de typographes, contenant de nombreuses illustrations, ainsi que différents papiers d'impression. Riche iconographie. Bel état des planches, bel exemplaire.
Très bon
Magritte.
2003 Couverture rigide Paris, Galerie nationale du Jeu de Paume, Ludion, 2003. In-4 (27 x 22 cm), reliure entoilée de l'éditeur, jaquette illustrée à rabats, catalogue sous son blister d'origine. 303 pages, nombreuses illustrations en couleurs en noir et en couleurs. Catalogue édité à l'occasion de l'exposition Magritte du 11 février au 9 juin 2003 à la galerie nationale du jeu de paume. Bon exemplaire, comme neuf.
Comme neuf
CLAUDE DEBUSSY, La revue musicale. Carnet critique. N°259.
1964 Couverture souple Paris, Editions Richart-Masse, 1964. Brochure in-8 agrafée (26 x 19 cm), couverture illustrée, couverture légèrement passée. 55(1) pages, petit enfoncement page 28, non coupé. Carnet détaillant les programmes radiodiffusés et télévisés consacrés en 1962 à l'oeuvre de Claude Debussy en l'année du centenaire de sa naissance. Préface de Jack Bornoff, secrétaire du comité de la musique à l'Unesco. Bonne documentation, bon exemplaire.
Bon
Imago Cataloniae. Mapes de Catalunya, empremtes de la Historia. Les cartes de la Catalogne, des empreintes de l'Histoire.
2005 Couverture rigide À Barcelone, chez Generalitat de Catalunya, 2005. In-4 carré (30 x 31cm), jaquette illustrée de l'éditeur, reliure entoilée, quelques marques marginales sur la jaquette et petite déchirure d'1cm en pied, cahiers légèrement décollés du dos en pied. 285 pages, nombreuses reproductions de cartes anciennes et modernes de la Catalogne, du 12ème siècle à nos jours (cartes manuscrites, dessins, photos), légère déchirure en pied de la page 129 sans perte de texte. Edition bilingue, en français et en espagnol. Bel état des planches et du texte. Malgré le défaut de la reliure, bon exemplaire de cet ouvrage de référence.
Bon
Apollinaire.
Couverture souple Paris, Editions de l'Esprit Nouveau, Jean Budry & Cie, sans date. In-8 (25,5cm x17cm), broché, couverture illustrée d'un portrait d'Apollinaire par Picasso, quelques marques à la couverture, dos insolé et petits manques aux coiffes. 98 pages non chiffrées, illustrations et photographies in et hors-texte, une lithographie originale de Marcoussis. Contient un fac-similé du conte inédit de l'auteur, La Plante. Dans ce numéro de la revue de l'Esprit Nouveau, contributions de Roch Grey, André Salmon, Paul Dermée, Pierre Albert-Birot, Henri Hertz, Ivan Goll, Alberto Savinio. Contient également des lettres à Fernand Divoire, Paul Demée, Francis Picabia, Fernand Fleuret. Manisfeste futuriste. On joint le bandeau original lors de la sortie de la revue. Bon exemplaire.
Bon
Panorama du XXè siècle. Encyclopédie du monde contemporain [tome I]
1975 Couverture rigide Paris, Larousse, 1975. Un volume in-4 (29x23,5cm), reliure basane maroquinée, à la bradel, titre doré, couverture illustrée à rabats, petites déchirures en tête et en pied (voir photo). 320 pages, préface de Louis Leprince - Ringuet. Tome 1 d'un ensemble contenant 9 volumes. Lettres A et B dans ce tome, de "A bout de souffle" à "Berlin". Ouvrage de référence conçu dans les années 70. Bon état intérieur, bon exemplaire de cette édition abondamment illustrée.
Bon
Cobra 1948-1941.
1982 Couverture souple Paris, Éditions AFAA, 1982. Un volume in-4 (27x21cm), broché, couverture illustrée, couverture légèrement passée, quelques marques marginales au dos. 223 pages illustrées de nombreuses reproductions en couleurs et en noir ( peintures, photographies). Catalogue des expositions se tenant à Paris, Chalon-sur-Saône, Rennes, du 9 décembre 1982 au 12 juin 1983. Catalogue consacré au mouvement artistique Cobra. Bon état intérieur, bon exemplaire.
Bon
Le troisième régiment de tirailleurs algériens pendant la campagne d'Italie (Janvier - Août 1944).
1945 Couverture souple Paris, Les éditions de la Nouvelle France, 1945. Un volume in-8 carré (19x14cm), broché, couverture illustrée à rabats, papier cristal de protection. 183 pages, illustrées de nombreuses reproductions photographiques en noir. Cet ouvrage fait parti de la collection " La vie exaltante". Préface du Général Juin : "... Ces hommes ont écrit, avec leur sang, une page de gloire qui restera dans les annales de l'Armée Française...". Bon exemplaire, en très bon état. Edition originale sur papier courant, imprimée le 18 juin 1945.
Très bon
1844-1944, un siècle d'assurance sur la vie [brochure des assurances Phénix]
Couverture souple Paris, Mars-Publicité, 1944. In-4, couverture rempliée, avec médaillon gauffré au premier plat, couverture légèrement passée, petits manques aux coiffes. 16 feuillets non-chiffrés, comprenant des illustrations in et hors-texte (photographies, aquarelles contrecollées de Mourgue, cartes), quelques décharges des illustrations sur la page en regard. Cette brochure porte sur les événements marquants de la société d'assurance Phénix, depuis sa création en 1844 jusqu'en 1944. Brochure tirée à 1042 exemplaires. Un des 1000 exemplaires numérotés sur pur chiffon des papèteries Lana. Commencée sous l'occupation allemande, cette édition a été achevée la veille de la Saint Sylvestre de l'année de la Libération. Bon exemplaire.
Bon
GALERIE FRANÇAISE ou Collection de portraits des hommes et des femmes qui ont illustré la France, dans les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Avec des notices et des fac similé.
1821 Couverture rigide Paris, Imprimerie de Firmin Didot, 1821. 3 forts volumes in-4, reliure demi-maroquin à long grain rouge à petits coins de l'époque, dos lisse orné d'élégants fleurons, reliure frottée, manque au dos du tome II en queue, petit sticker de l'ancien propriétaire sur les plats. Tome 1 : VIII, 65, 288 pages ; tome 2 : 598 pages ; tome 3 : 549 pages. Non rogné, rousseurs dans les tomes 1 et 2, rousseurs éparses au tome 3, édition illustrée d'un beau frontispice allégorique d'après Fragonard, et de 176 (sur 177) portraits sous serpentes, ainsi que de nombreux fac-similés. Manque un portrait au tome 1.Édition originale rare de cette galerie biographique contenant 177 notices composées "par une société d'hommes de lettres et d'artistes" composée notamment de Firmin Didot, Denon, Boissy d'Anglas, Andrieux, Villemain, Alavoine, Richerand, Droz, Lemontey...
Assez bon
UBAC
1970 Couverture rigide Paris, Maeght, 1970. In-4 carré, jaquette illustrée à rabats, reliure entoilée de l'éditeur, petit scotch présent en tête de la jaquette (voir photo), scotch équivalent sur le 1er rabat, étui cartonné d'origine avec petit décollement marginal. 177 pages, nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Les lithographies originales ont été tirées dans les ateliers ARTE à Paris. Textes de J. Bazaine, Y. Bonnefoy, P. Eluard, A. Frénaud, G. Limbour, P.L Nougé, J. Pfeiffer, M. Ragon, R. de Solier, R. Ubac, P. Volboudt. Bel état des planches, bon exemplaire.
Bon
Paris-Londres. KEEPSAKE français 1837.
1837 Couverture rigide Paris, Delloye, 1837. In-8, demi-maroquin rouge de l'époque, dos à 5 nerfs; titre gravé avec vignette, titre, 218 pages, 25 gravures anglaises sur acier hors-texte, quelques rousseurs et taches. Textes de E. Deschamps, Chateaubriand, A. Karr, A. de Vigny, A. Barbier. Edition originale.
Bon
CHROMA
2002 Couverture Espace de l'Art concret, 2002. In-8 carré, broché, couverture en couleurs, quelques marques sur les plats. 44 pages, photographies des oeuvres en couleurs. Catalogue de l'exposition du 08 juillet au 10 novembre 2002 à l'espace de l'Art Concret ; commissaire de l'exposition : Dominique Boudou. Bon exemplaire.
Bon
LANGBEIN ; SCHILLER ; BURGER ; SANDER ; KIND ; HELL... [Collectif]
Reference : 593
(1836)
Sammlung von Balladen und Gedichten für die Jugend. Mit 8 illuminirten Bildern. Zweite vermehrte Auflage.
1836 Couverture rigide Berlin, Winckelmann & Söhne, [1836]. Petit in-12, reliure demi-toile, cartonnage avec papier marbré sur les plats, coins émoussés. 128 pages, 8 illustrations hors-texte en couleurs (comprenant le frontispice), rousseurs marquées sur les 5 derniers feuillets, sinon très bon état du texte et des planches. 2ème édition (Kulturerbe Niedersachsen). Ouvrage en allemand. Bon exemplaire. Envoi soigné.
Bon
La vérité, revue trotskyste [lot de 9 numéros - 513 à 521 - allant de novembre 1958 à mai 1961]
Couverture souple Paris, La Vérité (5 rue de Charonne, Paris XI), 1958, 1959, 1960, 1961. 8 plaquettes in-4, couverture passée pour le N°513 et charnière insolée pour le N°519. Avec les contributions notamment de Pierre Lambert, Charles Lemoine, François Forgue, John White, Jean Perrin... On notera en particulier les dossiers suivants: "L'URSS vu par un révolutionnaire hongrois" (N°519), "De Gaulle, la gauche et l'Algérie" (N°520), "le Dossier de la laïcité" (N°517-518, numéro double). Edition originale. Exemplaires en très bon état. Rare.
Très bon
Exposition de l'affiche en couleurs, de Chéret à nos jours. Juillet-Août 1939 [Catalogue]
1939 Couverture souple A Paris, Conservatoire national des Arts et Métiers, 1939. In-4, broché, V pages, 79 (2) pages, 32 planches, 6 planches de publicité. Déchirure en haut du dos, couverture passée et légèrement piquée. Planches décollées du dos. Bon état intérieur des pages de texte et des planches.
Satisfaisant
Cahiers de l'Atelier n556: hospitalits et identits fragilises
Atelier Broch D'occasion tr¿s bon tat 12/04/2018 100 pages
Je suis courage.
<p class="p1"><span class="s1">Le collectif Cèdre Photographe s’est formé en janvier 2022 à partir<span></span></span><span class="s1">d’un projet de témoignage visant à mettre l’outil photographique à leur<span></span></span><span class="s1">service. Ce projet, conçu et mené par Joseph Aimard, étudiant et bénévole au Secours catholique, a été mis en place avec<span></span></span><span class="s1">le concours du CEDRE (Centre d’entraide pour les demandeurs d’asile</span><span class="s1">et les réfugiés), une antenne du Secours catholique dans le XIX<sup>e</sup><span></span>arrondissement de Paris. Le collectif compte huit membres</span></p><p class="p1"><span>issus de l’Afrique subsaharienne, du Maghreb et de l’Asie du Sud :</span><span class="s1">Harouna S., Khalid M., Mamadou Lamine D., Ousmane B., Riadh D.,</span><span class="s1">Richard C., Seydou D. et Tidjane D.<br></span><span class="s1">Ces huit photographes migrants, ainsi que Joseph Aimard et Isis Khan,<span></span></span><span class="s1">jeune professionnelle et bénévole au Secours catholique, se sont réunis chaque dimanche au cours de l’année 2022, animés par le désir<span></span></span><span class="s1">de témoigner grâce à la photographie. Ainsi, le collectif est devenu source de création,<span></span></span><span class="s1">de partage<span class="Apple-converted-space"><span></span></span>et de solidarité pour ces artistes-amateurs exilés, dont l’existence, souvent tragique, est marquée par la solitude et la difficulté</span><span class="s1">de se sentir écoutés ou compris. Par le biais d’un regard franc et nouveau, le collectif a souhaité mettre en lumière ce que la distance – linguistique, culturelle, sociale – empêche souvent de saisir dans la réalité de l’exil.</span><span class="s1"></span></p><p class="p1"><span class="s1">De cette aventure commune s’est construit cet ouvrage, les photographies<span></span></span><span class="s1">ayant été prises par le collectif et les textes écrits par Joseph Aimard.</span><span class="s1"></span></p><p class="p1"><span class="s1"><em>Je suis courage</em><span></span>est</span><span class="s1">le récit d’une traversée méconnue et incertaine.<span></span></span><span class="s1">Une traversée, car ce travail photographique s’inscrit<span></span></span><span class="s1">avant tout dans le mouvement, un mouvement par-delà</span><span class="s1">les frontières, et ici un mouvement d’errance dans un Paris</span><span class="s1">de contrastes: on y croise des visages, plus ou moins familiers, dans des lieux tantôt reconnaissables et touristiques, tantôt mystérieux et intimes.</span></p> Chantepie, 2024 Les Editions de Juillet 96 p., relié coutures apparentes 21 x 24,5
Neuf
Les Saints-Innocents. (A Paris)
Ouvrage collectif présenté par la Délégation à l'Action Artistique de la Ville de Paris. (Le cimetière, l'église, le marché, le square, le quartier).Nombreuses illustrations en noir et en couleurs suivi d'une Iconographie et d'une Bibliographie.Paris, Délégation à l'Action Artistique de la Ville de Paris, non daté, vers 1992 - 200 pages. Diffusion Hachette.Cartonnage de l'éditeur pleine percaline bleue. Jaquette illustrée. Très bon état. Format in-4°(28x25).
COLLECTIF - FLEURY - LEPROUX
[# ILLUSTRATEUR: collectif] - # AUTEUR: Jean d'Auvergne (collectif)
Reference : 0538
(1963)
# TITRE: Pilat - Saint-Etienne - Forez
# AUTEUR: Jean d'Auvergne (collectif) # ILLUSTRATEUR: collectif # ÉDITEUR: Ed. Jean d'Auvergne Saint-Etienne # ANNÉE ÉDITION: 1963 # ENVOI, BEAUX PAPIERS: Vélin crème de Renage # COUVERTURE: chemise impr. # DÉTAILS: In 4° en feuilles sous chemise et étui CXVI + XXIX planches ht (manque les planches 1 et 2 souvent manquantes). Tirage total de 1777 exemplaires, celui-ci n° 376 des 1000 sur vélin crème de Renage. Tome 1 seul paru. # PHOTOS visibles sur www.latourinfernal.com
# ÉTAT: Bon état
 Write to the booksellers
Write to the booksellers![La collection des années 70 du Musée du Costume et de la Dentelle.. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1674_1_thumb.jpg)
![La collection des années 70 du Musée du Costume et de la Dentelle.. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1674_2_thumb.jpg)
![La collection des années 70 du Musée du Costume et de la Dentelle.. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1674_3_thumb.jpg)
![NEZ - The olfactory magazine - N°13 - Spring 2022. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1639_1_thumb.jpg)
![NEZ - The olfactory magazine - N°13 - Spring 2022. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1639_2_thumb.jpg)
![NEZ - The olfactory magazine - N°13 - Spring 2022. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1639_3_thumb.jpg)
![Los Logos N°7. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1618_1_thumb.jpg)
![Los Logos N°7. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1618_2_thumb.jpg)
![Los Logos N°7. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1618_3_thumb.jpg)
![Géricault.. [COLLECTIF] ; GERICAULT, Théodore.](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1426_1_thumb.jpg)
![Géricault.. [COLLECTIF] ; GERICAULT, Théodore.](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1426_2_thumb.jpg)
![Géricault.. [COLLECTIF] ; GERICAULT, Théodore.](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1426_3_thumb.jpg)
![Bibliothèque imaginaire - numéro spécial noël 1956.. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1383_1_thumb.jpg)
![Bibliothèque imaginaire - numéro spécial noël 1956.. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1383_2_thumb.jpg)
![Bibliothèque imaginaire - numéro spécial noël 1956.. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1383_3_thumb.jpg)
![Magritte.. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1377_1_thumb.jpg)
![Magritte.. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1377_2_thumb.jpg)
![Magritte.. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1377_3_thumb.jpg)
![CLAUDE DEBUSSY, La revue musicale. Carnet critique. N°259.. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1374_1_thumb.jpg)
![CLAUDE DEBUSSY, La revue musicale. Carnet critique. N°259.. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1374_2_thumb.jpg)
![CLAUDE DEBUSSY, La revue musicale. Carnet critique. N°259.. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1374_3_thumb.jpg)
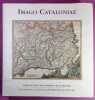


![Panorama du XXè siècle. Encyclopédie du monde contemporain [tome I]. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1240_1_thumb.jpg)
![Panorama du XXè siècle. Encyclopédie du monde contemporain [tome I]. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1240_2_thumb.jpg)
![Panorama du XXè siècle. Encyclopédie du monde contemporain [tome I]. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1240_3_thumb.jpg)
![Cobra 1948-1941.. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1215_1_thumb.jpg)
![Cobra 1948-1941.. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1215_2_thumb.jpg)
![Cobra 1948-1941.. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1215_3_thumb.jpg)
![Le troisième régiment de tirailleurs algériens pendant la campagne d'Italie (Janvier - Août 1944).. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1180_1_thumb.jpg)
![Le troisième régiment de tirailleurs algériens pendant la campagne d'Italie (Janvier - Août 1944).. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1180_2_thumb.jpg)
![Le troisième régiment de tirailleurs algériens pendant la campagne d'Italie (Janvier - Août 1944).. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1180_3_thumb.jpg)
![1844-1944, un siècle d'assurance sur la vie [brochure des assurances Phénix]. Collectif](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1150_1_thumb.jpg)
![1844-1944, un siècle d'assurance sur la vie [brochure des assurances Phénix]. Collectif](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1150_2_thumb.jpg)
![1844-1944, un siècle d'assurance sur la vie [brochure des assurances Phénix]. Collectif](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/1150_3_thumb.jpg)



![UBAC. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/905_1_thumb.jpg)
![UBAC. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/905_2_thumb.jpg)
![UBAC. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/905_3_thumb.jpg)
![Paris-Londres. KEEPSAKE français 1837.. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/48_1_thumb.jpg)
![Paris-Londres. KEEPSAKE français 1837.. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/48_2_thumb.jpg)
![Paris-Londres. KEEPSAKE français 1837.. [COLLECTIF]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/48_3_thumb.jpg)
![CHROMA. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/665_1_thumb.jpg)
![CHROMA. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/665_2_thumb.jpg)
![CHROMA. [Collectif]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/665_3_thumb.jpg)


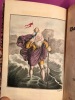
![La vérité, revue trotskyste [lot de 9 numéros - 513 à 521 - allant de novembre 1958 à mai 1961]. Collectif](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/306_1_thumb.jpg)
![La vérité, revue trotskyste [lot de 9 numéros - 513 à 521 - allant de novembre 1958 à mai 1961]. Collectif](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/306_2_thumb.jpg)
![La vérité, revue trotskyste [lot de 9 numéros - 513 à 521 - allant de novembre 1958 à mai 1961]. Collectif](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/306_3_thumb.jpg)
![Exposition de l'affiche en couleurs, de Chéret à nos jours. Juillet-Août 1939 [Catalogue]. COLLECTIF](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/200_1_thumb.jpg)
![Exposition de l'affiche en couleurs, de Chéret à nos jours. Juillet-Août 1939 [Catalogue]. COLLECTIF](https://static.livre-rare-book.com/pictures/ECV/200_2_thumb.jpg)