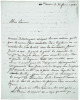[SAINT-DOMINGUE] — CAMPAN DE FONTANELLE (Jean-Antoine).
Lettre autographe signée [à Louis-Antoine de Thomassin, comte de Peynier].
Saint-Marc, 21 février 1790. 2 pp. in-4 (23,9 x 18,5 cm), avec une pièce autographe signée jointe, 1 p. in-4; en feuilles.
Reference : LBW-8719
Les premières révoltes de Mulâtres à Saint-Domingue. A partir de 1789, les Mulâtres de Saint-Domingue demandèrent l’égalité des droits avec les Blancs. N’ayant rien obtenu, ils commencèrent à se révolter dès février 1790, comme le montre la présente lettre, écrite par le commandant de Saint-Marc: «Menacé de toutes parts et ayant des avis certains que les gens de couleur sont assemblés dans la plaine au nombre de 3 ou 4 cents, ceux du Mirebalais s’étant joints à eux, je prends le parti de rassembler les compagnies de Dragons blancs pour marcher à leur tête et prendre ou disperser toute cette canaille, mais comme il seroit peut-être dangereux d’entreprendre cette poursuite avec seulement des troupes non disciplinées, j’ai demandé à Mr de La Jaille de vous expédier la cornette du Roy, pour vous prier de m’envoyer les compagnies de Grenadiers et de Chasseurs, comme plus en état de soutenir les fatigues d’une marche forcée […]. Un Blanc rencontré par environ 300 Mulâtres a été forcé par eux de se mettre à genoux et de jurer qu’il les regarderoit comme ses semblables, avec menace de le faire mourir s’il s’en plaignoit à ses supérieurs. Tous les avis s’accordent pour des menaces de couper le col, et d’incendier ceux qui ne se rendroient point à leur assemblée. Les habitants de la plaine sont en alarme, on craint des incursions […]. Je vous prie de me faire envoyer des vivres pour la troupe, des fusils, des caisses de cartouches à balles et à leur défaut des balles, une pièce à la Rostaing avec ses canonniers…». Né en 1741 à Saint-Bauzille-de-la-Sylve (Hérault), Jean-Antoine Campan de Fontanelle fut capitaine-commandant au régiment de Port-au-Prince, puis major-commandant pour le Roi à Saint-Marc de janvier à juin 1790. Chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, il était aussi propriétaire d’une caféterie à Saint-Domingue (source: site domingino.de). Issu d’une importante famille de la noblesse provençale, Louis-Antoine de Thomassin, comte de Peynier (1731-1809) fut nommé, le 1er juillet 1789, gouverneur de la partie française de Saint-Domingue. Arrivé à la fin du mois d’août dans la colonie, il resta en fonction jusqu’à la fin de l’année 1790, ayant à affronter une situation politique extrêmement troublée. La pièce jointe contient le témoignage, en copie conforme, du nommé Grooters qui avait croisé le groupe de Mulâtreset avait été obligé de se mettre à genoux.
Bookseller's contact details
Librairie Le Bail
Didier Le Bail
13 rue Frédéric Sauton
75005 Paris
France
33 01 43 29 72 59
Payment mode
Sale conditions
Conditions de vente conformes aux usages et aux règlements du Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne (SLAM) et de la Ligue Internationale de la Librairie Ancienne (LILA). Paiements acceptés : cartes bancaires, via un lien de paiement, chèques, virements Conditions of sale in accordance with the practices and regulations of the Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne (SLAM) and the International League of Antiquarian Booksellers (ILAB). Payments accepted: credit cards, via payment link, checks, and bank transfers.
2 book(s) with the same title
Lettre autographe signée [à Louis-Antoine de Thomassin, comte de Peynier].
Saint-Marc, 13 octobre 1789. 3 pp. in-4 (22,7 x 18,7 cm); sur une feuille double.
Les premiers troubles de Saint-Domingue. Dès la fin de 1789, les premiers troubles éclatèrent dans la partie française de Saint-Domingue (actuelle République d’Haïti). La présente lettre, écrite par le commandant de Couagne, en poste à Saint-Marc, témoigne du climat tendu qui régnait alors dans la colonie: attroupement devant la maison du commandant, incident entre Blancs et fusiliers mulâtres soupçonnés de vouloir libérer des esclaves, mise à sac de la maison d’un huissier de justice. Extraits: «[Le 12] en arrivant à ma porte, j’ai trouvé deux mulâtres galériens enchaînés, avec quelques couples de nègres de chaînes, qui demandoient leur grâce, j’ai dit que je n’avois pas le droit de gracier des gens condamnés pour crimes par les lois […]. D’un commun accord je renvoyois ces hommes à leur prison, quand la compagnie des fusiliers mulâtres qui venoient à ma porte pour me rendre des honneurs militaires, a été rencontrée par les galériens mulâtres: aux prières des malheureux coupables, les fusiliers mulâtres me les ont ramené pour solliciter en leur faveur: j’ai répété que je n’avois aucun droit pour leur faire grâce, et j’ai chargé les fusiliers mulâtres de reconduire dans les prisons les deux galériens; mais en passant devant la salle de la comédie, les compagnies des jeunes négociants et celle des canonniers de la ville, qui étoient là pour une répétition théâtrale, par une précipitation extrême, ont cru que les fusiliers mulâtres armés vouloient donner la liberté aux criminels, en conséquence ils sont venus avec vivacité attaquer les mulâtres qui ne s’attendoient point à une telle escarmouche […]. Pendant les débats et le tumulte, les deux galériens se sont sauvés. J’obligeai les bas officiers des fusiliers mulâtres de courir après, ils ont repris le galérien qui étoit condamné pour la vie, son compagnon qui n’avoit que deux mois à rester à la chaîne n’a pu être joint. Il n’y a eu personne de blessé ni de tué […]. On n’a pu empêcher la populace de se porter à la maison de l’huissier Gévroin, homme ayant la haine publique par sa rigidité et son insolence dans ses fonctions d’huissier, et là, on a brisé les portes, les fenêtres, cassé son argenterie, enfoncé les armoires &c., mais il n’a été fait aucun vol, du moins on me l’a assuré…». Né en 1727 à Louisbourg (Nouvelle-Ecosse), Michel de Couagne servit comme ingénieur militaire et se distingua au Canada pendant la guerre de Sept Ans. Après un passage à Saint-Pierre-et-Miquelon, il fut nommé, en 1783, lieutenant-colonel et lieutenant du Roi au quartier de Saint-Marc, à Saint-Domingue. Chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, il mourut le 28 octobre 1789 à Saint-Marc (cf. Dictionnaire biographique du Canada, vol. IV). Issu d’une importante famille de la noblesse provençale, Louis-Antoine de Thomassin, comte de Peynier (1731-1809) fut nommé, le 1er juillet 1789, gouverneur de la partie française de Saint-Domingue. Arrivé à la fin du mois d’août dans la colonie, il resta en fonction jusqu’à la fin de l’année 1790, ayant à affronter une situation politique extrêmement troublée. Malgré les difficultés, il chercha toujours à faire appliquer les décrets de l’Assemblée nationale. Provenance: archives personnelles de Louis-Antoine de Thomassin, comte de Peynier.
Lettre autographe signée [à Louis-Antoine de Thomassin, comte de Peynier].
Port-au-Prince, 15 octobre 1789. 1 p. in-4 (25,5 x 20 cm) ; en feuille.
Création d’une nouvelle compagnie de Dragons mulâtres à Saint-Domingue. Les Dragons mulâtres étaient une milice composée de mulâtres libres ; faisant fonction de maréchaussée, elle était essentielle au maintien de l’ordre dans la colonie. Compte tenu du climat d’effervescence qui régnait alors, le gouverneur décida de créer une nouvelle compagnie. Pour cela, il envisagea de prendre des hommes dans une compagnie d’infanterie de Port-au-Prince commandée par Gaudé, mais celui-ci lui répondit négativement en évoquant la question de l’entretien des chevaux : « Il se trouvera assez de sujets […] sans qu’il soit besoin de toucher à ma compagnie d’infanterie, étant composée presque toute de sujets qui sont en ville où il n’est pas possible qu’ils puissent entretenir des chevaux très dispendieux lorsque comme icy il n’y a point de savanes communes, si quelques-uns d’eux sont forcés ou séduits par des commandants pour y entrer, il résultera que dans les temps secs ils perdront leurs chevaux […]. Il y aura une compagnie de Dragons sans Dragons ainsi qu’il est cy-devant arrivé, motif qui a par deux fois occasionné la réforme de cette compagnie, ce qui n’aurait pas lieu si on n’y incorporait que ceux qui sont habitans ou économes, seuls assurés de pouvoir entretenir des chevaux… ». Issu d’une importante famille de la noblesse provençale, Louis-Antoine de Thomassin, comte de Peynier (1731-1809) fut nommé, le 1er juillet 1789, gouverneur de la partie française de Saint-Domingue. Arrivé le mois suivant dans la colonie, il resta en fonction jusqu’à la fin de 1790, ayant à affronter une situation politique de plus en plus troublée. L’auteur de cette lettre était peut-être apparenté à Joseph Gaudé, négociant, propriétaire d’une caféterie et résidant à Port-au-Prince (source : Colons de Saint-Domingue, sur le site domingino.de).
 Write to the booksellers
Write to the booksellers