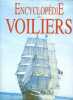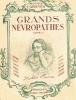-
Latest
Last 3 days (3)
Last month (22)
-
Century
17th (2)
18th (9)
19th (206)
20th (1736)
21st (233)
-
Syndicate
ILAB (2192)
SLAM (2192)
Histoire de la Philosophie. II. XVIIe-XVIIIe siècles. Edition revue et mise à jour par Pierre-Maxime Schuhl et André-Louis Leroy.
PUF, 1990, pt in-8°, 506-vi pp, broché, bon état
"L'ouvrage de M. Brehier rendra de très grands services non seulement aux philosophes, mais encore aux historiens du XVIIIe siècle. D'abord parce qu'il replacera avec une grande précision les philosophes français dans le milieu général de la philosophie européenne qu'il n'est pas donné à tous de connaître directement. Et puis parce que cette analyse est extrêmement pénétrante et souvent, sur les points où je puis la juger, tout à fait neuve. En quelques pages, parfois en quelques lignes précises et lumineuses, elle apporte des aperçus qui n'ont jamais été exposés avec cette vigoureuse simplicité." (Daniel Mornet, Revue d'Histoire littéraire de la France, 1931)
Histoire de l'Eglise. 5. Grégoire le Grand, les états barbares et la conquête arabe (590-757).
P., Bloud et Gay, 1938, gr. in-8°, 576 pp, 2 cartes hors texte, biblio, broché, bon état (T. 5 de l'Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'à nos jours, publiée sous la direction de Augustin Fliche et Victor Martin)
"Pour cette période de 160 années environ, les deux auteurs, MM. Bréhier et Aigrain se sont divisé le travail, M. Bréhier prenant en charge – comme on pouvait s'y attendre – Byzance et l'Eglise d'Orient, M. Aigrain traitant des chrétientés occidentales. Aussi bien le volume débute t-il par deux études conjuguées sur Grégoire le Grand : M. Aigrain exposant la biographie du pape, rappelant ses oeuvres, analysant sa politique italienne, M. Bréhier traitant de sa politique byzantine, de ses rapports avec le patriarcat de Constantinople et les empereurs Maurice et Phocas..." (Pierre Tisset, Revue d'histoire de l'Église de France, 1940)
Esquisse des principaux faits du XIIIe et XVIIe siècles tels qu'on les trouve présentés dans leur germe, leur développement et leurs conséquences dans la collection de nos écrivains originaux de chroniques et mémoires. Pour servir d'introduction à la lecture des Chroniques du « Panthéon littéraire ».
P., Auguste Desrez, 1840, gr. in-8°, (8)-141 pp, chronologie des auteurs et des faits contenus dans la collection des Chroniques et mémoires du Panthéon littéraire, broché, couv. imprimée, pt déchirure sans manque au 1er plat, bon état. De la bibliothèque du Comte de Chambord
En 1836, Louis Aimé-Martin (1781-1847), conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, inaugure une collection remarquable qui restera inachevée : Le Panthéon littéraire (1836-1845), destiné à accueillir le meilleur de la littérature française et des traductions d'ouvrages étrangers. Jean-Alexandre Buchon (1791-1846) s'occupera essentiellement, de 1830 à 1839, de la partie historique de cette entreprise, soit 56 volumes de chroniques et mémoires du Moyen Âge et des temps modernes.
La Révolution de l'évolution : l'évolution de l'évolutionnisme.
PUF, 1989, in-8°, 339 pp, préface de Pierre Chaunu, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Histoires)
Cette oeuvre fondamentale sur l'évolution de l'évolutionnisme, centrée sur la révolution de l'évolution – une des plus grandes mutations de la pensée –, est riche d'une thèse nouvelle, projetant une lumière originale sur le développement du monde vivant. Partant d'une synthèse historique indispensable à la compréhension de la connaissance – présentée selon un modèle élaboré par l'auteur concernant la dynamique des mutations scientifiques –, cet ouvrage multidisciplinaire brosse un tableau de la période contemporaine, qui prend appui, notamment, sur le darwinisme, le néo-darwinisme et la théorie synthétique, pour aboutir à une théorie synergique de l'évolution. Cette théorie nouvelle ouvre des perspectives à l'horizon de la biosphère, où l'évolutionnisme d'aujourd'hui rencontre le génie génétique de demain.
Encyclopédie des voiliers.
Lausanne, Edita, 1994, in-4°, 384 pp, très nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte et à pleine pages, glossaire, cart. illustré de l'éditeur, jacquette illustrée, bon état
Bulfinch's Mythology: Including the Complete Texts of The Age of Fable, The Age of Chivalry, Legends of Charlemagne. Illustrated Edition.
New York, Gramercy Books, 1979, fort in-8°, xx-957 pp, 42 illustrations, cartes, index (80 pp), reliure demi-toile éditeur, jaquette illustrée, bon état. Texte en anglais
Thomas Bulfinch (1796-1867) était un banquier américain et un latiniste érudit. “Bulfinch's Mythology” est une compilation posthume des trois volumes publiés par Bulfinch de son vivant qui étaient destinés à présenter au lecteur les mythes et les légendes de la civilisation occidentale. Les trois volumes originaux sont L’Âge de la fable (1855), traitant en grande partie de la mythologie grecque et romaine, mais aussi abordant la mythologie d’autres cultures telles que les mythes indiens, égyptiens et nordiques ; L’Âge de la chevalerie (1858), traitant de la légende arthurienne, du Saint Graal et du Mabinogon ; et Legends of Charlemagne (1863), traitant des légendes fantastiques entourant Charlemagne et de ses « paladins » comme Orlando, Oliver et Rogero. Cette édition réunissant ses trois œuvres, titrée “Bulfinch's Mythology”, eut un grand succès et reste un des livres les plus populaires jamais publiés aux États-Unis.
Plus ou moins 5 mètres.
SOS Océans, 2011, in-4° à l'italienne (23,2 × 33,5 × 5,6 cm), 548 pp, préface de Albert II de Monaco, très nombreuses photos en couleurs, reliure demi-toile de l'éditeur, plats cartonnés illustrés, emboîtage cartonné illustré, livre en très bon état, emboîtage lég. abîmé, exemplaire enrichi d'un envoi a.s. de l'auteur photographe
Joe Bunni, né en 1955, docteur en chirurgie dentaire, photographe depuis son plus jeune âge, pratique la plongée depuis plus de vingt-cinq ans. Dès ses premières plongées, il a emporté son appareil photo au cours de ses escapades sous-marines. Dans cet ouvrage de 700 photographies prises parfois dans des conditions extrêmes, le photographe nous montre dans une féerie de couleurs les merveilles animales situées à 5 mètres au-dessus et en dessous du niveau de la mer, des espèces rares et menacées que chacun peut observer avec beaucoup de chance, de patience et un simple masque. L'auteur a invité quatorze écrivains du monde, qui chacun, ont pris en charge la rédaction d'un chapitre. Leurs contributions poétiques sont traduites dans les quatorze langues qui architecturent l'ouvrage. Joe Bunni a créé l'association SOS Océans pour la sauvegarde des mers et la sensibilisation du grand public à leur préservation. Il vit sa passion tout en tirant lui aussi le signal d'alarme et essaie, avec détermination et par tous les moyens, de susciter une prise de conscience de la menace qui pèse sur notre planète bleue. Auteur de Impressionniste de l'Océan (2007), il a récemment remporté le prestigieux prix BBC Veolia environment (Wildlife Photographer of the Year 2011 Catégorie mammifères) avec Sa Majesté L'Ours Polaire (couverture).
Parler la mort. Des mots pour la vivre. Préface de Bernard-Henri Lévy.
Desclée de Brouwer, 1999, in-8°, 285 pp, Très bon état
La Découverte de la Terre.
PUF, 1942, in-12, 64 pp, broché, bon état (Coll. Bibliothèque du peuple)
BURGUIERE (André), KLAPISCH-ZUBER (Christiane), SEGALEN (Martine) et ZONABEND (Françoise, sous la direction de)
Reference : 42561
ISBN : 9782200371555
Histoire de la famille Tome 1 Mondes lointains, mondes anciens
Armand Colin 1988, grand in-8 broché, 640 p. (très bon état ; épuisé) Illustrations in-texte, glossaire, bibliographie et index. Préfacé par Duby et Lévi-Strauss, ce premier volume d'une histoire unique en son genre de par l'étendue de son parcours dans le temps et l'espace couvre les temps antiques et les temps médiévaux, évoquant aussi la famille en Chine, au Japon, en Inde et dans l'islam arabe.
BURGUIÈRE (André) et Jacques REVEL (dir.).
Reference : 38932
(1990)
ISBN : 9782020102384
Histoire de la France. L'Etat et les conflits. Sous la direction de Jacques Julliard.
Seuil, 1990, gr. in-8°, 670 pp, 140 illustrations, notes, biblio, index, reliure pleine toile rouge de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état, envoi a.s. de Jacques Revel
1. Révoltes et contestations d'Ancien Régime (Christian Jouhaud) – 2. Du dissentiment religieux au dissentiment politique : cathares, protestants, jansénistes (Solange Deyon) – 3. L'imbroglio révolutionnaire : conflits et consensus (Jean-Pierre Hirsch) – 4. Le conflit politique (Jacques Julliard) – 5. Le conflit social (Patrick Fridenson) – 6. Les minorités périphériques : intégration et conflits (Emmanuel Le Roy Ladurie). — "Une Histoire de la France qui s'attache à écrire autrement l'histoire nationale. On ne trouvera pas ici un récit continu de l'évolution politique, économique, sociale et culturelle de la France. Dans leur programme de recherche, les auteurs posent l'histoire nationale comme un problème et non comme un genre. Du traité de Verdun à nos jours, il s'agit bien de s'interroger sur la France comme construction et non comme un cadre a priori de l'enquête historique..." (Jean-Frédéric Schaub, Annales ESC, 1992)
BURGUIÈRE (André) et Jacques REVEL (dir.).
Reference : 38927
(1989)
ISBN : 9782020102377
Histoire de la France. L'Etat et les pouvoirs. Sous la direction de Jacques Le Goff.
Seuil, 1989, gr. in-8°, 654 pp, 123 gravures et cartes, notes, biblio, index, reliure pleine toile rouge de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état
La France monarchique : 1. Le Moyen Age (Jacques Le Goff) – 2. Un Etat des temps modernes ? (Robert Descimon et Alain Guéry) – La France contemporaine : 1. Les Français et le pouvoir politique (de 1789 à nos jours) (Pierre Lévêque) – 2. Etat et société.(du XIXe siècle à nos jours) (Pierre Rosanvallon). — "Une Histoire de la France qui s'attache à écrire autrement l'histoire nationale. On ne trouvera pas ici un récit continu de l'évolution politique, économique, sociale et culturelle de la France. Dans leur programme de recherche, les auteurs posent l'histoire nationale comme un problème et non comme un genre. Du traité de Verdun à nos jours, il s'agit bien de s'interroger sur la France comme construction et non comme un cadre a priori de l'enquête historique..." (Jean-Frédéric Schaub, Annales ESC, 1992)
BURLAUD (Alain) et Frank BOURNOIS (dir.).
Reference : 123205
(2021)
ISBN : 9782376874539
L'enseignement de la gestion en France. Identité, défis et enjeux.
EMS Editions, 2021, gr. in-8°, 452 pp, tableaux, notes, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
L'ouvrage réunit les contributions de 35 auteurs, professeurs en universités et écoles de commerce. Avant de se projeter sur l'avenir de l'enseignement de la gestion, ils reviennent sur son histoire et rappellent les grandes étapes de son évolution. Ils portent ensuite un regard critique sur son fonctionnement et les évolutions récentes qui impactent l'enseignement et la recherche. La diversité des réflexions apporteront aux lecteurs des points de vue variés et éclairés sur ce qu'est aujourd'hui la discipline, de son enracinement à son futur.
Le Préjugé de race et de couleur, et en particulier le problème des relations entre les blancs et les noirs.
Payot, 1949, in-8°, 171 pp, traduction de Denis-Pierre de Pedrals, broché, bon état (Coll. Bibliothèque scientifique)
Une constatation de base : le système colonial anglais, s'il est le plus efficace quant il s'agit de gérer des populations primitives est moins bon que le système français dès que l'on a à faire à des évolués. A partir de là une étude intéressante sur les rapports entre blancs et noirs et sur les manières de conduire ces derniers. Sommaire : Introduction. Naissance et développement du préjugé de couleur. Attitude de divers peuples au sujet des différences de race et de couleur. Les Noirs ont le ressentiment du préjugé de couleur. Mesures de discrimination légale et politique à l'encontre des Noirs. Mesures de discrimination sociale à l'encontre des Noirs. Prétendue infériorité des Noirs. Insuffisances prétendues des Noirs. Différences physiques et mentales entre les races. Répugnances physiques de race à race. Les unions mixtes. Conséquences des conditions de milieu et des circonstances historiques. Manque d'unité et complexe d'infériorité des Noirs. Conclusion.
Histoire de l'Atlantique, de l'Antiquité à nos jours.
Perrin, 1997, gr. in-8°, 358 pp, 5 cartes, graphiques, notes, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Des mystères de l'Atlantide à l'ère de supertankers, Paul Butel a écrit ce que l'on peut considérer comme la première histoire globale de l'Atlantique. Cette histoire est d'abord celle des espoirs les plus fous – ainsi l'erreur salvatrice de Colomb découvrant le Nouveau Monde –, mais aussi celle des exploits des aventuriers de la mer, guerriers ou marchands. Débutant avec la navigation des Phéniciens, au-delà des colonnes d'Hercule dans les archipels atlantiques, la saga de l'Océan se mêle à la légende qui mène l'Occident à la recherche des Iles Fortunées. Mais elle lance très vite les Européens à la conquête de trésors à l'attraction souveraine : ceux de la mer – pêcheries de l'Atlantique nord où Portugais, Basques, Bretons et Britanniques apprennent la navigation au grand large – mais encore plus ceux du Nouveau-Monde. Les Ibériques ne gardent pas longtemps ces derniers pour leur exploitation. La Grande-Bretagne y trouve l'origine d'une domination des mers incontestée sur près de deux siècles. Refuges offerts aux dissidents ou aux hors la loi de l'Europe, les ports de la Nouvelle-Angleterre et des Antilles créent un nouvel Atlantique promis au plus grand avenir. Les produits de la plantation, tabac, sucre, coton, répondent au goût européen des nourritures et des parures nouvelles. L'Amérique du XIXe siècle tire de l'Atlantique des liners sa plus grande richesse : avec l'essor de New York et de Liverpool, les bateaux des émigrants permettent la traversée des hommes qui font progresser la "Frontière". A la fin du siècle, les Allemands de Hambourg et Brême deviennent les plus grands marins de l'Atlantique. C'est déjà la fin d'une prédominance britannique qui s'achève avec les guerres mondiales du XXe sicèle. Les Etats-Unis dominent alors l'Atlantique mais l'Europe y reprend sa place à l'âge des porte-containers et des supertankers.
L'Opium. Histoire d'une fascination.
Perrin, 1995, in-8°, 492 pp, 7 cartes et graphiques, notes, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Depuis les temps les plus reculés ("Plante de joie" dans les inscriptions sumériennes) et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le suc qui s'écoule de la capsule de pavot est considéré avant tout comme le remède à tous les maux, la panacée de la médecine populaire qui redonne confiance dans la vie, libère du quotidien, fait accéder à de fabuleux mirages. L'opium est consommé dès l'origine au Proche-Orient puis, à partir du VIIIe siècle, en Inde, à Java, en Chine. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle, comme le montre Paul Butel, que l'on commence à reprocher à l'opium l'état de dépendance dans lequel il plonge ses adeptes. Ainsi naît le concept de stupéfiant. L'opium connaît un développement foudroyant en Chine, inondée par les marchands britanniques qui l'exportent de l'Inde. Les empereurs ont beau multiplier les édits de prohibition, les Occidentaux leur livrent des "guerres de l'opium" pour pouvoir continuer un trafic dont ils tirent des revenus considérables. En France, c'est l'époque de la "drogue romantique", célébrée par les intellectuels et les coloniaux. La Marine française est atteinte à son tour (40% des officiers seraient opiomanes vers 1900). La naissance de la morphine, puis, au XXe siècle, de l'héroïne, fait surgir un âge nouveau, celui de la répression menée sous l'impulsion des Etats-Unis par un Occident conscient, enfin, des ravages causés par les dérivés de l'opium. Paul Butel, agrégé d'histoire, docteur émérite ès lettres est professeur d'histoire moderne à l'université de Bordeaux.
Histoire, critique et responsabilité.
Editions Complexe, 2003, in-8°, 358 pp, textes réunis par Gabrielle Muc et Michel Trebitsch, présentation de Henry Rousso, bibliographie de François Bédarida, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Histoire du temps présent)
Le succès récent de l'histoire du temps présent s'est accompagné de discussions intenses sur les concepts, les méthodes, les problèmes éthiques soulevés par l'ambition d'écrire, sur des bases scientifiques, une histoire du passé proche, celle qui est portée par des acteurs, des témoins éventuels, des sujets vivants, doués de parole et de mémoire. Ces débats ont été d'autant plus vifs qu'ils ont été concomitants de la prise de conscience de l'ampleur des souffrances engendrées par la violence de guerre, la violence politique, la violence extrême, la marque au fer rouge du XXe siècle. La redécouverte récente de l'événement dans le champ des études historiques a été, en effet, d'abord et avant tout celle de l'événement dévastateur, dont le souvenir cuisant marque souvent une borne paradoxalement fondatrice. Dans cette effervescence intellectuelle, l'historien François Bédarida, disparu le 16 septembre 2001, cinq jours après l'irruption sur la scène mondiale d'une violence d'un genre inédit, a joué un rôle essentiel. Porté par son engagement spirituel, sa foi catholique, et par une vision exigeante du métier d'historien, il a produit une œuvre importante qui s'est attaquée à quelques grands massifs de l'historiographie contemporaine. Le présent ouvrage propose une série de ses articles et contributions, publiés dans les années 1990-2000, sur l'émergence d'une nouvelle histoire du temps présent, sur le nazisme, la Seconde Guerre mondiale, la période de Vichy, sur les rapports entre histoire et mémoire, enfin, sur la responsabilité de l'historien.
Le Roman de Tristan et Iseut. Renouvelé par Joseph Bédier.
L'Edition d'Art, H. Piazza, 1955, pt in-8°, xiii-220 pp, broché, couv. illustrée, pt mque au dos, bon état (Coll. Epopées et légendes)
"Le cercle habituel des études de M. Bédier est la littérature française du moyen âge. Elève favori de Gaston Paris, dont il occupe depuis 1904 la chaire au Collège de France, il est le digne successeur de ce maître, à qui il a plusieurs fois rendu un noble hommage. M. Bédier a donné aux lettrés une ingénieuse édition en langage moderne du “Roman de Tristan et Iseut”, aux érudits une étude sur les “Fabliaux”. Sa grande oeuvre est son étude sur “les Légendes épiques” : par l'originalité des vues, elle fit sensation dans le monde savant et, par la portée générale de ses théories, elle toucha le grand public cultivé..." (La Revue critique des idées et des livres, 1920)
La Gerbe d'or.
Editions de France, 1928, in-12, 243 pp, reliure demi-chagrin vert bouteille, dos à 5 nerfs filetés et soulignés à froid, titres dorés, filet à froid sur les plats (rel. de l'époque), dos lég. et uniformément passé, papier lég. jauni, bon état. Première édition sur papier courant, enrichie d'un envoi a.s.
Les souvenirs d'enfance et jeunesse de Béraud dans le Lyon de la fin du XIXe siècle, autour de la boulangerie tenue par ses parents. "Né à Lyon en 1885, Henri Béraud peut être considéré comme le grand écrivain de cette ville, l'équivalent de ses contemporains Mauriac pour Bordeaux et Pagnol pour Marseille. Sa ville est omniprésente au long de son oeuvre et Béraud excelle à rendre son atmosphère florentine, impitoyable et feutrée. En 1922, il reçoit le prix Goncourt pour "le Martyre de l'Obèse" et le "Vitriol de Lune". Dans sa trilogie de la "Conquête du Pain", il fait d'abord revivre ses lointains ancêtres dauphinois, avec "le Bois du Templier pendu" (1926), puis la révolte de 1834 des canuts de la Croix-Rousse avec "les Lurons de Sabolas" (1932), enfin les atroces règlements de comptes de la bourgeoisie lyonnaise et du monde des soyeux avec "Ciel de Suie" (1933)." (Jean Butin)
La Russie. Perspectives économiques et sociales.
Armand Colin, 2002, gr. in-8°, 287 pp, 40 cartes et tableaux, biblio, index, qqs soulignures et annotations crayon (Coll. U)
Le Ciel dans la mer. Christianisme et civilisation maritime, XVe-XIXe siècle.
Fayard, 1990, in-8°, 426 pp, notes, index, broché, couv. illustrée, bon état
Immense, violente, imprévisible, dévoreuse d'hommes, la mer convie au sacré, et depuis l'aube des temps la religion occupe une place essentielle dans l'existence des gens de mer. Est-il imaginable que leurs conditions de vie, si particulières, n'aient pas d'incidences sur leurs pratiques, voire sur leurs croyances ? Peut-on penser que le temps des Réformes – qui est aussi celui des navigations lointaines – ait fait d'eux des chrétiens semblables à ceux des communautés rurales ou urbaines ? Chez ces hommes séparés de leur famille, vivant dans un cadre et à un rythme si différents, dépourvus de lieux de culte et presque toujours privés de l'assistance de clercs, il semble par exemple établi que le recours aux intercesseurs (Vierge, saints) prenait le pas sur la dévotion au Christ, et que beaucoup de leurs gestes ou de leurs invocations relevaient davantage de la magie que d'un christianisme épuré. Bien d'autres indices encore permettent de déceler une fragilité, une ambiguïté certaines de leurs convictions. L'écho des préceptes et des conduites prescrits par les autorités religieuses leur parvient assourdi, affaibli, avec retard. Ce n'est pas avant le milieu du XIXe siècle que les Eglises se soucient vraiment d'une pastorale qui s'adresse à eux. C'est alors que se multiplient les paroisses côtières, que se répandent les bénédictions de l'océan et les pardons des pêcheurs morutiers, que les aumôneries navales se structurent durablement. Mais, ans le même temps, tandis que s'amorce la déchristianisation des sociétés, les conditions techniques de la navigation se modifient, et le danger se fait moins pressant. Dès lors, le christianisme maritime perd une part de son originalité et de son unité, bien que ces mutations soient désormais masquées par l'image du marin fervent et fidèle façonnée par la littérature. — Agrégé d'histoire, docteur ès lettres, Alain Cabantous est chargé de recherche au CNRS. Il consacre ses travaux à l'histoire sociale et religieuse de l'époque moderne, et plus spécialement aux populations maritimes de l'Europe occidentale des XVIIe et XVIIIe siècles.
CABANTOUS (Alain), André Lespagnol et Françoise Péron.
Reference : 118059
(2005)
ISBN : 9782213624143
Les Français, la terre et la mer, XIIIe-XXe siècle.
Fayard, 2005, gr. in-8°, 902 pp, 12 pl. de gravures en couleurs, 46 cartes dans le texte, glossaire, biblio, index, reliure souple illustrée de l'éditeur, bon état, envoi a.s. de A. Cabantous
Certes, la France n'a pas de tradition maritime aussi vigoureuse et aussi exclusive que celles des Pays-Bas ou de la Grande-Bretagne, certes, elle a été une puissance engagée sur le continent et une colonisatrice tardive, mais comment croire qu'elle ait vécu sans la mer et que la mer n'ait pas modelé ses campagnes et ses villes, ses échanges commerciaux, ses circuits financiers, ses flux migratoires, ses modes de vie, ses questionnements intellectuels, ses goûts artistiques comme culinaires, bref son mode d'être comme nation et comme Etat depuis au moins le XIIIe siècle ? Ce pays est à cet égard servi par la géographie, qui fait de lui un lien entre le Levant et le Ponant et l'a doté de plus de 5.000 km de côtes ; aucun lieu de France ne se trouve à plus de 400 km de la mer et ses DOM-TOM lui confèrent le troisième domaine maritime du monde. Jamais les populations du littoral n'ont été coupées de l'intérieur, depuis des siècles la viticulture, la sylviculture, l'industrie travaillent avec et pour la mer et les horizons lointains. Quant à la connaissance du monde, à la recherche scientifique et aux imaginaires, ne sont-ils pas, eux aussi, largement tributaires de la mer ? La littérature, les beaux-arts, la pensée en témoignent en permanence, et l'état florissant de la navigation sportive et de loisirs le montre aujourd'hui. Ce n'est donc pas une supposée "France maritime", distincte du reste, qui est envisagée ici. L'équipe d'historiens et de géographes qui a mis cette très originale somme en œuvre a préféré observer sur la longue durée comment la France a attaché (et attache toujours) le même prix à l'intégration politique de l'espace côtier, à son aménagement et à son développement économique qu'à ceux de l' "intérieur", et comment les Français du XXIe siècle sont les héritiers d'une société tout à la fois terrestre et maritime.
Dans les coulisses de l'Histoire, 1ère série.
Albin Michel, 1947, pt in-8°, 256 pp, 42 gravures, broché, couv. illustrée, bon état
"Le Dr Cabanès a publié, de 1893 à 1928, dans quelques-uns des meilleurs périodiques de publicité pharmaceutique, et dans la presse quotidienne, de très nombreux articles. Il les réunissait en volumes, enrichis de documents iconographiques. Ses recherches, inspirées par la médecine, dans le domaine de l'histoire, lui permettaient d'éclairer, d'une lumière plus ou moins décisive, certaines particularités de la biographie d'illustres personnages, des événements historiques, des aventures demeurées mystérieuses, l'origine de croyances, coutumes, médications populaires, l'évolution des moeurs au cours des siècles, nombre de faits instructifs touchant les doctrines, progrès, conflits, succès, échecs des praticiens de l'art médical. Plusieurs de ces recueils ont été publiés après la disparition de leur auteur. Ils ont toujours obtenu un accueil favorable des médecins et du grand public." (Cl.-G. Collet, Revue d'histoire des sciences, 1955)
Esculape chez les artistes.
P., Librairie Le François, 1928, pt in-8°, 403 pp, 197 gravures dans le texte et à pleine page, broché, couv. illustrée, bon état
"... Ce sont des médecins qui ont montré le rôle considérable des événements d'ordre biologique dans la conduite des rois, rectifié des erreurs, réhabilité des accusés, décrit la névrose derrière les pseudo-énergies, créé enfin cette pathologie historique qui se pose, désormais, en auxiliaire de l'Histoire, et qui justifie bien le monument que l'on élèvera sur la tombe de Cabanès." (Paul Voivenel, 1929)
Grands Névropathes. Tome III : Hoffmann, Heine, Swift, Quincey, Coleridge, Cooper, Tennyson, Chopin, Gogol, Gontcharov, Lermontov, Dostoïevsky.
Albin Michel, 1935, pt in-8°, 377 pp, 45 gravures, notes, reliure demi-basane fauve, dos à 3 nerfs soulignés à froid et fleurons dorés, pièces d'auteur et de titre chagrin noir, couv. illustrées conservées (rel. de l'époque), dos lég. frotté, bon état
Tome III seul (sur 3). — "Au seuil de cette dernière et troisième série de Grands Névropathes, nous tenons à préciser le sens que le Dr Cabanès a entendu donner au titre qu’il a choisi. Il ne saurait être question, pour la plupart des personnages étudiés au cours de ces trois volumes, de ce que les psychiatres entendent par grande névrose. Le terme de « grands névropathes » – puisqu’il fallait, pour l’édition, une appellation d’ensemble – signifie simplement : grands hommes qui furent, aux degrés les plus divers, des névropathes. Il est à présumer que le Dr Cabanès eût repris et amplifié chacune de ces études au moment de les réunir en volumes. Nous ne nous croyons pas, quant à nous, le droit de les modifier dans le sens de théories, en apparence nouvelles, et dont l’outrance n’est pas obligatoirement un gage de durée. Nous ajouterons que le premier article de psychopathologie du Dr Cabanès, paru en 1886 (alors qu’interne en pharmacie, il préparait le doctorat en médecine, tout en étudiant l’Histoire), était intitulé : Les Souverains Névropathes. En juin 1907, Cabanès fondait la Société médico-historique « destinée à grouper, pour des recherches et des études communes, des médecins, des historiens, des littérateurs et des artistes ». Nous donnons, à la fin du présent volume, le texte intégral de l’exposé des buts de ce groupement, que la grande guerre devait disperser quelques années plus tard. Peut-être les lecteurs fidèles du Dr Cabanès, qui nous honorent d’une si précieuse sympathie, jugeront-ils que nous exagérons le souci de définir exactement la pensée et les desseins du disparu ; mais les initiés pensent avec nous que cette précaution n’est pas tout à fait inutile." (Bl.-A. Cabanès, avertissement)
 Write to the booksellers
Write to the booksellers