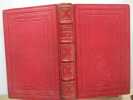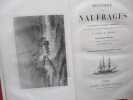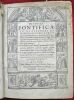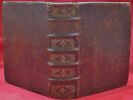5326 books for « jean baptiste p »Edit
-
Type
Autograph (2)
Book (5177)
Disk (2)
Drawings (5)
Engraving (3)
Magazine (8)
Maps (88)
Music sheets (27)
Old papers (6)
Photographs (7)
Posters (1)
-
Latest
Last 24h (1)
Last 3 days (3)
Last month (79)
Last week (72)
-
Language
Dutch (1)
English (2)
French (5312)
Greek (1)
Latin (5)
Russian (5)
-
Century
16th (2)
17th (90)
18th (738)
19th (1048)
20th (854)
21st (398)
-
Countries
Belgium (235)
Brazil (1)
Canada (32)
China (4)
Côte d'Ivoire (9)
Denmark (67)
France (4580)
Germany (46)
Greece (10)
Italy (7)
Switzerland (330)
United States of America (5)
-
Syndicate
ALAC (26)
CLAM (22)
CLAQ (14)
CNE (28)
ILAB (2430)
NVVA (57)
SLACES (57)
SLAM (2210)
SNCAO (48)
Topics
- Ancien régime (22)
- Arabic (72)
- Archaeology (24)
- Architecture (45)
- Army (30)
- Autographs (53)
- Auvergne (36)
- Baronian jean baptiste (43)
- Belgium (28)
- Biography (48)
- Books from the xviiith (27)
- Botany (24)
- Brittany (20)
- Cant hanet jean baptiste alias clery (21)
- Catholicism (59)
- Chemistry (26)
- Children’s books (23)
- China (47)
- Christianity (62)
- Churches (25)
- Crevier (31)
- D'alembert (31)
- Devilliers (61)
- Dictionaries (42)
- Diderot et d'alembert (37)
- Duroselle jean-baptiste (57)
- Early printed books (89)
- Economics (48)
- Education (32)
- Encyclopaedia (33)
- Engraving (books about) (28)
- Ethnology (26)
- Europe (24)
- Finances (24)
- Fine arts (26)
- First edition (261)
- Fourierism (24)
- French literature (21)
- Gardens (19)
- Geography (44)
- History (424)
- Illustrated books (29)
- Iran - persia (19)
- Law (99)
- Linnean society of lyons (29)
- Literature (269)
- Lorrain (20)
- Lyons and area (21)
- Lyons college (21)
- Lyons college pc (29)
- Lyons revue (21)
- Manuscripts (34)
- Maps (92)
- Massillon (70)
- Medicine (88)
- Memories (57)
- Middle east (70)
- Military arts (24)
- Molière j. b. poquelin (241)
- Napoleon i (28)
- Navy (36)
- Newspapers press (22)
- Paris (116)
- Philosophy (71)
- Photography (28)
- Poetry (88)
- Policy (34)
- Political economy (30)
- Professions guilds (27)
- Provence (29)
- Regionalism (82)
- Religions (114)
- Reliure (44)
- Reviews (20)
- Revolution 1789 (85)
- Rousseau jean jacques (92)
- Sciences (48)
- Scores (31)
- Songs (37)
- Switzerland (22)
- Tea (20)
- Theatre (58)
- Theology (61)
- Trade (19)
- Travel (52)
- Various (24)
- War (30)
HOMANN Jean-Baptiste / WITT Frédéric de / SEUTTER Matthieu (1678-1757) / & Alii
Reference : 1863
ATLAS : CARTES, PLANS ET VUES DU MONDE ENTIER. Colored Maps
XVII - XIX Nuremberg et Amsterdam principalement. Extrême fin XVIIème - début XIXème siècle. Format oblong in-Plano 54x64 cm. Recueil de cartes anciennes rassemblées et reliées au début du XIXème siècle. La majorité des cartes (COLOREES !) sont l'oeuvre de Frédéric de Witt d'Amsterdam et de Jean-Baptiste Homann (et ses héritiers) de Nuremberg (soit fin XVIIème - première moitié XVIIIème siècle). Des cartes non colorées et plus récentes d'origine française pour la plupart (seconde moitié du XVIIIème siècle et dans de rares cas début du XIXème siècle) ont été intercalées à la suite de chaque pays ou région. Cet ensemble exceptionnel représente ainsi 193 feuillets in-plano portant une ou plusieurs cartes, plans ou vues. Différentes numérotations à la plume laissent supposer que plusieurs ouvrages différents de moindre envergure ont servi à la constitution de cet ensemble imposant. Celui-ci se présente actuellement dans une reliure utilitaire en demi-parchemin à coins du XIXème siècle. Traces d'usage sur la reliure et poussière sur la tranche des cartes, quelques feuillets légèrement brunis, sinon contenu en bon état général.
CONTENU : Europe (Frédéric de Witt) / Espagne et Portugal (Frédéric de Witt) / Portugal (Frédéric de Witt) / carte routière dépliante d'Espagne et du Portugal (Hubert Jaillot 1793) / France (Frédéric de Witt) / France (Delafosse 1782) / Pays-Bas (Frédéric de Witt) / Belgique (Frédéric de Witt) / Frise (Frédéric de Witt) / Groningue (Frédéric de Witt) / Overyssel (Frédéric de Witt) / Geldre (Frédéric de Witt) / Zutphanice (Frédéric de Witt) / Région d'Utrecht (Frédéric de Witt) / Hollande (Frédéric de Witt) / Sud de la Hollande (Frédéric de Witt) / Région de Delft (Frédéric de Witt) / Région d'Amsterdam (Frédéric de Witt) / Nord de la Hollande (Frédéric de Witt) / Zélande (Frédéric de Witt) / Nord des Pays-Bas (Mr. Janvier 1780) / Sud des Pays-Bas (Mr. Janvier) / Belgique (Frédéric de Witt) / Flandre (Frédéric de Witt) / Artois (Frédéric de Witt) / Brabant (Frédéric de Witt) / Evêché de Cambrais (Frédéric de Witt) / Région de Namur (Frédéric de Witt) / Duché du Luxembourg (Frédéric de Witt) / Limbourg (Frédéric de Witt) / Evêché de Liège (Frédéric de Witt) / Région de Campen et Bruxelles (Frédéric de Witt) / Westphalie (Frédéric de Witt) / Route des Pays-Bas vers l'Italie / Italie antique (Guillaume de l'Isle 1715) / Italie au temps d'Auguste (Matthieu Seutter) / Italie (De la Marche 1778) / Lombardie occidentale (Robert) / Lombardie orientale (Robert) / Italie, Corse et Sardaigne (Frédéric de Witt) / Cours du Pô (1734) / Piémont et Montferrat en 2 planches (Gabriel Bodenehr) / Région de Nice (vers 1744) / Théâtre de la guerre entre la France et l'Italie / Duché de Milan (Jean-Baptiste Homann) / Parmes et Plaisance (héritiers Homann 1731) / Modène et Reggio (Matthieu Seutter) / République de Gênes avec plan et vue de la ville en 1743 (héritiers Homann) / Région du Mont-Blanc (M.A.P.) / Duché de Mantoue (héritiers Homann 1735) / Territoire de Vérone (Jean Jansson) / Plans des opérations de guerre en Italie en 1742 et 1743 (héritiers Homann) / Plans des forts de Fuentès, du château de Serravalle, des villes de Novarre, Crémone, Tortone, Casale et Pavie (atelier Homann) / Vue du château de Colorno près de Parme et du combat du 4 juin 1734 (atelier Homann) / Plan du passage de la Secchia et de la bataille de Guastalla en 1734 (héritiers Homann) / Plans des villes de Côme, Lodi, Picighitone, Crémone, Valence et Alexandrie (Gabriel Bodenehr) / Etats de l'Eglise, Toscane et Corse (Robert) / Corse (de Saint-Angelo) / Latium (héritiers Homann 1745) / Patrimoine de Saint-Pierre (héritiers Homann 1745) / Nord du royaume de Naples (Jaillot 1781) / Sud du royaume de Naples (Jaillot 1781) / Sicile (Frédéric de Witt) / Sicile et Sardaigne (Homann) / Malte (Frédéric de Witt) / Plans des villes de Florence, Pise, Ancone, Rome, Bologne, Sienne, Lucques, Capoue, Naples, Galliupoli, Tarente, Messine, Palerme ( Cornelis Danckerts) / Saint-Empire (Delamarche 1792) / Allemagne vers 1804 (Jean Walchs) / Cercle de la Bavière en 1796 (Jean Walchs) / Région de Munich (héritiers Homann 1743) / Cercle de Souabe en 1803 (Jean Walchs) / Région d'Ulm (Jean-Baptiste Homann) / Marquisat de Burgow (Matthieu Seutter) / Evêché de Freysingen (Matthieu Seutter) / Archevêché de Salzbourg (Jean-Baptiste Homann) / Tyrol (Gérard Valk) / Suisse (Weiss) / Cours du Rhin (Frédéric de Witt) / Cours du Danube (Gérard Valk) / Hongrie (Frédéric de Witt) / Hongrie et pays voisins jusqu'à Constantinople / Région de Posen en Hongrie (héritiers Homann 1757) / Hongrie et Serbie (2 petites cartes) / Ancienne Pannonie & Illyrie et Transylvanie (2 petites cartes) / Plan et vue de la ville de Temeswar (Matthieu Seutter) / Plan de Belgrade (Gabriel Bodenehr) et fortifications de la ville / Valachie et Bulgarie (2 petites cartes) / Moldavie et Pays slaves (2 petites cartes) / Vallachie et Moldavie (héritiers Homann 1769) / Croatie et Bosnie (2 petites cartes) / Dalmatie et Podolie - Bessarabie (2 petites cartes) / Dalmatie (R. P. Coronelli) / Canal de Cattaro avec les plans des villes et forts de Castelnuovo, Risano et Prevesa (5 petites cartes) / Golfe de Prevesa (4 petites cartes) / Plans d'Urana, Carin, Nadin, Duare, etc. (9 petites vues) / Coron, Calamata, Zarnata, etc. (9 petites vues) / Canal de Corfou, îles de Céphalonie, Zante, etc. (9 petites cartes et vues) / Plan et vue de l'île et ville de Corfou (Matthieu Seutter) / Ville de Corfou et environ (Jean-Baptiste Homann) / Siège de Corfou en 1716 (Jean-Baptiste Homann) / Achaïe antique et moderne (Jean-Baptiste Homann) / Empire Turque (Jean Lhuilier) / Grèce (Hugo Allardt) / Nord de la Grèce (héritiers Homann) / Péloponèse (héritiers Homann) / Mer Noire et région de Constantinople (T. C. Lotter) / Candie (Crète) (Frédéric de Witt) / Carte et vue de Candie (N.Visscher) / Candie et îles de la Mer Egée (Jean-Baptiste Homann) / Opérations militaires de la guerre entre Turcs, Hongrois et Polonais en 1737 (N. de Fer) / Bataille navale entre les Russes et les Turcs le 24 juin 1770 et plan du château de Lemnos / Pologne et Lithuanie (Frédéric de Witt) / Etats de la couronne de Pologne (N. de Fer) / Carte dépliante de la Lithuanie prussienne / Plan et vue de la ville de Danzig et du siège de 1734 (Jean-Baptiste Homann) / Carte, plan et vue de Danzig et environs / Intéressant montage en 4 feuillets superposés présentant les manoeuvres des troupes prussiennes près de Spandau (C. F. Vols) / Carte dépliante du théâtre de la guerre russo-française de 1806-1807 (Charles Dien) / Russie (J. Lhuilier) / Golfe de Finlande (héritiers Homann 1751) / Golfe de Finlande près de Kronstadt (Matthieu Seutter) / Finlande (Conrad Lotter) / Région de Saint-Petersbourg (héritiers Homann 1734) / Région de Saint-Petersbourg (Matthieu Seutter) / Cours de la Neva et canal Ladoga (Matthieu Seutter) / Plan et profil du canal Ladoga (Matthieu Seutter) / Plans du château de Kronslot et des forteresses de Kronstadt, Xexholm, Vibourg, Narva, etc. (héritiers Homann) / Plans de la forteresse de Neustadt et du château de Neuschloss en Finlande (héritiers Homann 1750) / Plans de Narva, Riga et Dunamunde (4 petits plans) / Suède et Norvège (Frédéric de Witt) / Partie de la Suède ( Jean-Baptiste Homann & Fils 1729) / Upland, Westmanie et Sudermanie (Frédéric de Witt) / Partie de la Suède et vue de Stockholm (Jean-Baptiste Homann) / Plan de Stockholm (Jean-Baptiste Homann) / Norvège (Frédéric de Witt) / Norvège danoise (héritiers Homann 1729) / Danemark (Frédéric de Witt) / Slesvie (Jean-Baptiste Homann) / Jutland (Jean-Baptiste Homann) / Islande (héritiers Homann 1761) / Angleterre, Ecosse et Irlande (Frédéric de Witt) / Iles britanniques en 1779 (Mr. Janvier) / Asie (Frédéric de Witt) / Asie en 1805 (héritiers Homann) / Empire Turc (N. de Fer) / Mer d'Azof (Matthieu Seutter) / Turquie asiatique (héritiers Homann 1771) / Asie Mineure et Mer Noire (héritiers Homann 1743) / Perse, Arménie, Anatolie (Frédéric de Witt) / Perse près de la Mer Caspienne (Jean-Baptiste Homann & Fils) / Mer Caspienne + Kamtchatka (2 cartes par Jean-Baptiste Homann) / Tartarie et partie de la Chine (Frédéric de Witt) / Chine / Japon (Matthieu Seutter) / Philippines, Molucques, Iles de la Sonde (Sanson d'Abbeville 1654) / Plan et vue de la ville de Batavia à Java (héritiers Homann) / Sud-Est asiatique (Frédéric de Witt) / Carte dépliante du Sud-Est asiatique en 1748 (héritiers Homann) / Etats du Grand Mogol (Matthieu Seutter) / Plan et vue de la forteresse de Tranquebar (Matthieu Seutter) / Carte et plan du territoire de Tranquebar avec descriptif (Matthieu Seutter) / Ceylan (Matthieu Seutter) / Terre Sainte (Frédéric de Witt) / Afrique (Frédéric de Witt) / Afrique (F. L. Güssefeld) / Egypte (Jean-Baptiste Homann) / Maroc / Plan de la ville de Gigeri en 1664 (Estienne Vouillemont ) / Maroc avec vues (Jean-Christophe Homann 1728) / Plan et vue d'Oran et de la côte (héritiers Homann 1732) / Congo et Angola (Gér.Valk) / Guinée (héritiers Homann) / Sud de l'Afrique / Amériques / Amérique Centrale et Septentrionale / Canada oriental (Ballin 1745) / Canada occidental (Bellin 1745) / Plans des villes et forts de Louisbourg, Québec et Hallifax (héritiers Homann) / Terre Neuve, baie du Saint-Laurent, Acadie, Nouvelle Ecosse, Nouvelle Angleterre, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Virginie, etc. (4 petites cartes) / Pennsylvanie, New Jersey et New York (1750) / New York, Pennsylvanie et vue de New York / Nouvelle Angleterre (Jean-Baptiste Homann) / Virginie, Maryland et Caroline (Jean-Baptiste Homann) / Louisiane et Mississipi (Jean-Baptiste Homann 1687) / Golfe du Mexique et Isthme de Panama, vue de Mexico (héritiers Homann 1740) / Martinique (Matthieu Seutter) / Guadeloupe (petite carte par T. Jefferys) / Jamaïque (Matthieu Seutter) / Iles de Saint-Christophe, Antigua, Barbade, Jamaïque et Bermudes / Pérou (héritiers Homann) / Brésil (Matthieu Seutter) / Chili, Paraguay et détroit de Magellan (héritiers Homann 1733) / Missions des Jésuites au Paraguay (Matthieu Seutter) / Neu-Ebenezer.
[ Lot de 3 documents manuscrits écrits ou signés par Jean-Baptiste Michel de Montaigne : ]Copie par Jean-Baptiste Michel de Montaigne d'une lettre "que j'ay écrit par la poste à Mr. Rey procureur au sénéchal et présidial de Libourne, à Libourne". "A Bordeaux, le 21 décembre 1734, Le désir que j'ay, Mr, d'apprendre quel est l'état de vôtre santé, m'engage de vous prier de vouloir bien le faire le plaisir de m'en donner des nouvelles ; je souhaiterois de tout mon coeur trouver des occasions pour vous donnner des marques que personnes ne sçauroit s'intéresser plus particulièrement que moy à tout ce qui vous regarde, soyés en je vous prie bien persuadé. J'eusse fait dresser ma réponse aux blâmes que le Sr [ ... ] a fourni contre mon dénombrement si j'avois eu en main certaines pièces qu'on m'a promis de me communiquer, je serai bien aise dd'avoir par devers moi ces pièes avant de répondre à ses blames, je compte les avoir bien-tôt. Je vous ay marqué, par la lettre que je vous écrivis le 7 du mois d'août dernier, que le Sr [ ... ] avait en son pouvoir la baillette à fief nouveau de ma maison de Beausoleil du 14 may 1597 retenuë par papier notaire royal, c'est de quoi je suis assûré [ ... ]" [ ... ] "Le Sr [ ... ] ne voudra pas contester apparemment que l'énonciation de ce bail à fief de 1597 dans le dénombrement de 1691 et dans la sentence de sa réception, contradictoirement renduë par le Sénéchal de Fronsac le 15 juin 1691 entre feu M. le Duc de Richelieu et feu M. François de Montaigne, ne fasse foy suffisante ; il est de maxime en droit que les énonciations dans les anciens actes font foy sans rapporter l'acte énoncé, il faut d'ailleurs tenir pour constant que le rapport du titre primordial n'est pas nécessaire quand on produit et rapporte un dénombrement fait authentiquement et énonciatif de ce titre primitif, lequel dénombrement équipolle au premier titre quand il ne paroit pas, le remplace et en fait l'office étantune confirmation, un renouvellement bien exprès de l'ancienne inféodation." [etc... ] [ On joint : ] Copie par Jean-Baptiste Michel de Montaigne d'une lettre "que j'ay écrit par la poste à Mr. Rey mon procureur au sénéchal de Libourne", à Bordeaux le 26 février 1733 [même affaire ] [ On joint une copie authentique établie en 1762 d'un acte de juin 1686 ] : ] Acte daté de 1761 de la généralité de Bordeaux fait par Notaire Royal et retiré "par Messire Jean-Baptiste Michel de Montaigne Chevalier Seigneur de Beausoleil, ancien premier jurat de Bordeaux, y demeurant dans son hôtel rue Dumirail [ du Mirail ] Paroisse St Eloy sans avoir icy ajoutté ny diminué, fait à Bordeaux dans l'hôtel de ce Seigneur l'an mille sept cens soixante deux le treize du mois de mars et signé"
3 documents manuscrits à savoir : 1 document manuscrit signé de 2 ff. in-folio ( 38 x 25 cm), 2 pages et demie manuscrites : Copie par Jean-Baptiste Michel de Montaigne d'une lettre "que j'ay écrit par la poste à Mr. Rey procureur au sénéchal et présidial de Libourne, à Libourne". "A Bordeaux, le 21 décembre 1734, Le désir que j'ay, Mr, d'apprendre quel est l'état de vôtre santé, m'engage de vous prier de vouloir bien le faire le plaisir de m'en donner des nouvelles ; je souhaiterois de tout mon coeur trouver des occasions pour vous donnner des marques que personnes ne sçauroit s'intéresser plus particulièrement que moy à tout ce qui vous regarde, soyés en je vous prie bien persuadé. J'eusse fait dresser ma réponse aux blâmes que le Sr [ ... ] a fourni contre mon dénombrement si j'avois eu en main certaines pièces qu'on m'a promis de me communiquer, je serai bien aise dd'avoir par devers moi ces pièes avant de répondre à ses blames, je compte les avoir bien-tôt. Je vous ay marqué, par la lettre que je vous écrivis le 7 du mois d'août dernier, que le Sr [ ... ] avait en son pouvoir la baillette à fief nouveau de ma maison de Beausoleil du 14 may 1597 retenuë par papier notaire royal, c'est de quoi je suis assûré [ ... ]" [ ... ] "Le Sr [ ... ] ne voudra pas contester apparemment que l'énonciation de ce bail à fief de 1597 dans le dénombrement de 1691 et dans la sentence de sa réception, contradictoirement renduë par le Sénéchal de Fronsac le 15 juin 1691 entre feu M. le Duc de Richelieu et feu M. François de Montaigne, ne fasse foy suffisante ; il est de maxime en droit que les énonciations dans les anciens actes font foy sans rapporter l'acte énoncé, il faut d'ailleurs tenir pour constant que le rapport du titre primordial n'est pas nécessaire quand on produit et rapporte un dénombrement fait authentiquement et énonciatif de ce titre primitif, lequel dénombrement équipolle au premier titre quand il ne paroit pas, le remplace et en fait l'office étantune confirmation, un renouvellement bien exprès de l'ancienne inféodation." [etc... ] |On joint : ] Copie par Jean-Baptiste Michel de Montaigne d'une lettre "que j'ay écrit par la poste à Mr. Rey mon procureur au sénéchal de Libourne", à Bordeaux le 26 février 1733, 1 feuillet format 20,2 x 16,3 cm (même affaire) [ On joint une copie authentique établie en 1762 d'un acte de juin 1686 ] : ] Acte daté de 1761 de la généralité de Bordeaux fait par Notaire Royal et retiré "par Messire Jean-Baptiste Michel de Montaigne Chevalier Seigneur de Beausoleil, ancien premier jurat de Bordeaux, y demeurant dans son hôtel rue Dumirail [ du Mirail ] Paroisse St Eloy sans avoir icy ajoutté ny diminué, fait à Bordeaux dans l'hôtel de ce Seigneur l'an mille sept cens soixante deux le treize du mois de mars et signé" (copie d'un contrat de délaissements de certains pièces de terre par Antoine Ducasse notaire royal en faveur de Jean de Louche batelier, vers le grand Barrail). Acte signé par Montaigne, David, Robin, etc...
Très intéressante réunion de 3 documents manuscrits, les deux premiers rédigés et signés et le dernier signé par Jean-Baptiste-Michel de Montaigne (1701-1764) chevalier seigneur de Beausoleil et qui fut premier jurat de Bordeaux. On retrouve sa trace dans le "Livre des Bourgeois" de Bordeaux, à la date du 3 août 1761, où il justifie "descendre de Grimon Deyquem, Seigneur de Montaigne, qui fut maire de la ville de Bordeaux en l'année 1585, et dont la qualité de bourgeois fut vérifiée au tableau de 1663 en faveur de Guillaume, seigneur de Bussaguet". Il demeurait à Bordeaux dans son hôtel de la rue du Mirail, paroisse de Saint-Eloi, comme le précise le dernier document.
[NANTES - PORT-SAY [ACTUELLEMENT Marsa Ben M'Hidi - Commune en Algérie ] Louis Jean-Baptiste SAY EXPLORATEUR NANTAIS
Reference : 28393
(1905)
DOSSIER ORIGINAL : Louis Jean-Baptiste SAY- EXPLORATEUR NANTAIS - FONDATEUR DE PORT SAY EN ALGÉRIE EN 1905
NANTES PORT-SAY [ACTUELLEMENT Marsa Ben M'Hidi - Commune en Algérie ] 1905-1930 1- une LETTRE à "en-tête" imprimé en noir : "Algérie et Maroc Oriental - PORT-SAY DIRECTION" avec en dessous une gravure d'Ancre Marine, Port-Say, le 21 Avril 1907, format : 26,6 x 20,8 cm, lettre autographe manuscrite à l'encre noire de 2 pages, signée de Louis Jean-Baptiste SAY (EXPLORATEUR NANTAIS) adressée à Mr DURAND GASSELIN, Notaire Nantais, 2, Rue Voltaire, lettre concernant des sujets notariaux privés puis il donne des nouvelle fraiches de PORT-SAY depuis la prise de OUDJDA, l'importance militaire que prend PORT-SAY et les travaux routiers en cours... + 2- une LETTRE à "en-tête" imprimé en noir : "Algérie et Maroc Oriental - PORT-SAY DIRECTION" avec en dessous une gravure d'Ancre Marine, Port-Say, le 15 MAI 1907, format : 26,6 x 20,8 cm, lettre autographe manuscrite à l'encre noire d'une page, signée de Louis Jean-Baptiste SAY (EXPLORATEUR NANTAIS) adressée à Mr DURAND GASSELIN, Notaire Nantais, 2, Rue Voltaire, lettre concernant des sujets notariaux privés puis il donne des nouvelle fraiches de PORT-SAY, la route est arrivée, les Ponts et Chaussées sont campés à PORT-SAY... + 3- une LETTRE à "en-tête" imprimé en noir : MEMORANDUM - "Algérie et Maroc Oriental - PORT-SAY DIRECTION" avec en dessous une gravure d'Ancre Marine, Port-Say, le 13 Avril 1909, format : 21,2 x 13,6 cm, lettre autographe manuscrite à l'encre noire d'1 page, signée de Louis Jean-Baptiste SAY (EXPLORATEUR NANTAIS) adressée à Mr DURAND GASSELIN, Notaire Nantais, 2, Rue Voltaire, "enchanté d'être agréable au Docteur BUREAU (Gustave Édouard Bureau est né le 31 janvier 1868 à Nantes et mort le 22 février 1951. Il est le fils d'Émile . Il est docteur en médecine, professeur à l'École de médecine de Nantes, interne des Hôpitaux de Paris et médecin des Hôpitaux.), je me fais un vrai plaisir de lui louer les Jardins de la Rue Dobrée - prix de la location (20) 20 francs par Mois. Veuillez dire au Docteur que les 2 jardins (des N° 3 et 5) seront à sa disposition, Ces deux jardins communiquent et forment un grand jardin où peuvent courrir les enfants. Veuillez dire au Docteur qu'il pourra y envoyer tous les enfants qu'il voudra, tout ses petits malades pour qu'ils passent la journée au soleil..." + 4- Lettre du Docteur Gustave Édouard BUREAU , à "en-tête" imprimé en noir comportant l'adresse de son Cabinet : 5, rue voltaire à Nantes, lettre autographe Manuscrite à l'encre brune adressée à Maitre Durand-Gasselin Notaire à Nantes afin de le remercier de la demarche que celui-ci a entrepris auprès de Louis SAY pour lui louer les 2 jardins du 3 et 5 rue Dobrée pour que les enfants malades puisse y jouer. signature manuscrite : G. Bureau, 5- Lettre de 8 pages (écrite d'un seul côté), format : 21 x16 cm, écrite de PORT-SAY, le 20 Mai 1930, adressée à Maitre Durand-Gasselin à Nantes expliquant les difficultés politiques rencontrées par Louis SAY rendant la création de PORT-SAY comme un rêve innachevé, lettre autographe manuscrite à l'encre noire et signée de son fils adoptif, Daniel Bourmancé-Say + joint avec l'enveloppe originale marron clair avec l'adresse notée et le cachet de la poste de PORT-SAY ORAN du 22/5 1930 à 15h 20 (+ joint article illustré d'une carte de la région de PORT-SAY, illustrant un article sur "LA QUESTION DES PORTS DU MAROC SUR LA MEDITERRANEE" paru dans l'écho d'Oran du 9 mai 1930), 6- Lettre d'une page (écrite d'un seul côté), format : 21 x16 cm, écrite de PORT-SAY, le 25 Mai 1930, adressée à Maitre Durand-Gasselin à Nantes rappelant qu'il avait oublié d'envoyer la carte géographique de PORT-SAY dont il parlait dans sa lettre du 20 Mai 1930, voir carte jointe , lettre autographe manuscrite à l'encre noire et signée de son fils adoptif, Daniel Bourmancé-Say, 7- LETTRE à "en-tête", pré-imprimé et illustré en noir de "L'HÔTEL DU PALAIS D'ORSAY" PARIS, du 19 octobre 1908, lettre autographe Manuscrite signée à l'encre brune sur papier blanc, format : 20,8 x 13,2 cm, adressée à Maitre Durand-Gasselin Notaire à Nantes, afin de récuperer des fonds pour PORT-SAY, signé : LOUIS SAY, 8 - CARTE DE VISITE, pré-imprimée en noir : "LOUIS SAY - LIEUTENANT DE VAISSEAU DE RESERVE PORT-SAY par Marnia (Algérie)" et manuscrite de la main de Louis SAY à l'encre brune : "Tous mes Remerciements et mes bien cordiales salutations", format : 4,4 x 7,3 cm, 9- réponse manuscrite autographe à l'encre noire sur papier pelure , format : 20,8 x 13 cm, du Notaire Durand-Gasselin de Nantes aux lettres de Mai 1930 envoyée par Mr Daniel Bourmancé-Say de PORT-SAY ORAN, 10 - 9 PHOTOGRAPHIES ORIGINALES D'EPOQUE, format : 12 x 17 cm + une format : carte photo : 13,6 x 8,7 cm prises en 1907 par Louis SAY montrant differentes vues de PORT-SAY : 1- PORT-SAY - la Jetée - Les piles de cereales partant pour la france, 2- photo d'une carte géographique de la region de PORT-SAY, 3- Paysage de montagne de la region de PORT-SAY, 4- PORT-SAY - le "TRITON" en rade, débarquement de l'orge au Port, 5- PORT-SAY - le boulevard du_ front de mer , 6- Vue générale de la plage de Kiss à PORT-SAY, 7- PORT-SAY, les plages de la Moscarda, 8- PORT-SAY et sa montagne de marbre et le promontoire de Zéhiro, 9- Photo de la Casbah des marins Bocoyas à PORT-SAY,
Louis Jean-Baptiste Say (Nantes, 30 janvier 1852 - Port-Say, 3 octobre 1915) est un explorateur NANTAIS. Fils de Louis Octave Say (1820-1857), raffineur de sucre, et d'Octavie Étienne (remariée à Eugène Janvier de La Motte), ainsi que le petit-fils des raffineurs de sucre Louis Say (1774-1840) et Jean-Baptiste Étienne (1795-1866). Enseigne de vaisseau, il est membre en 1876 dans l'expédition de Victor Largeau El Oued-Ghadames. Il reprend en 1877 les routes du sud à partir de Ouargla et s'avance jusqu'à Timassinin en passant par Aïn Taya et El Biodh. Il explore en détail les Gassi, des couloirs naturels qui traversent le Grand Erg. En 1886, il mène une expéditions dans la région d'Oudjda et des Beni-Snassen. Fondateur de Port-Say en 1905 en Algérie, il y meurt en 1915.Marsa Ben M'Hidi (anciennement Port-Say pendant la colonisation française) est une commune algérienne de la wilaya de Tlemcen. PORT SAY, UN REVE INACHEVE : Avant tout propos, il faut souligner le caractère essentiellement privé de lentreprise mise en place par Louis Say et qui en fait, sans aucun doute, un cas unique dans les annales de la colonisation algérienne. Même sil était un propagandiste de lexpansion coloniale, il nen était pas moins un grand défenseur de lAlgérie. Lidée de construire un port à cet endroit remonte à 1764 lorsque le Bailli de Suffren, vice-amiral, voulut établir une liaison maritime avec les Iles Zaffarines. Mais cest finalement Say qui, sans autorisation aucune, entreprit la construction de son port en 1904. Grace à sa fortune de part sa mère, Il prit donc les mesures nécessaires pour acquérir toutes les terres et la plage du Kiss. A Nemours, il acheta par-devers notaires tout lespace compris entre les derniers contreforts du Cap Milona, de Chaïb Rasso et de la rivière Kiss. Le domaine acquis renferme les plages du Chelih ou Moscarda, le promontoire dEl Kelaa, les collines dargile et toute la plaine qui va jusquà lOued Kiss. Sa propriété est bornée par la mer et par les derniers chaînons de Chaïb Rasso. Commencés en 1904, les travaux de la jetée Ouest qui ne furent jamais achevés, se poursuivirent jusquen 1911 sans lapprobation des pouvoirs publics . Devant les visées qui risquaient de compromettre sérieusement lavenir de leur port, les Nemouriens firent appel à leurs représentants au Parlement et au Sénat et, grâce à cet appui, un courant politique et administratif ne devait pas tarder à se manifester en faveur de Nemours. De là, les tracasseries administratives et les diverses embûches dont eût à souffrir Louis Say. Mais Say resta attaché jusquà son dernier souffle à la grande idée de sa vie : construire un port tant pour le commerce que pour la marine. ..... Beaux DOCUMENTS D'EPOQUE .................... RARETÉ ..... en trés bon état (very good condition), en trés bon état
Atys, tragédie. [Copie manuscrite contemporaine / Contemporary handwritten copy].
SLND [circa 1680]. 1680 1 vol in-folio (418 x 268 mm) de : [3] ff bl., 314 pp. [notes inscrites sur 12 portées, texte du livret calligraphié en dessous, indications en bas de page], [1] ff avec portées vierges, [2] ff bl. Trace marquée dans le papier d'une inscription au verso de la dernière page de garde : " M Bouvet, Oui à de cet opéra" avec signature en dessous. 3 fragments de partitions non reliés glissés dans le manuscrit : « Doris de lEurope galante », « Les folies dEspagne », « La Pessac ». (Salissures, taches, quelques déchirures et galeries de vers marginales, papier assez frais). Plein veau moucheté d'époque, dos à 6 nerfs muet, traces de lacets de peau, tranches jaspées de rouge. (épidermures, coins accidentés avec manques mais reliure demeurée solide).
Rare copie manuscrite complète, antérieure à sa publication (1689), de « Atys », tragédie en musique composée par Jean-Baptiste Lully sur un livret de Philippe Quinault, créée en 1676 à Saint-Germain-en-Laye. Jean-Baptiste Lully (Florence, 1632- Paris, 1687) est un compositeur et violoniste italien de la période baroque qui a marqué le règne de Louis XIV. Naturalisé français en 1661, il est nommé surintendant de la musique du roi et l'année suivante maître de musique de la famille royale. Par ses dons de musicien et d'organisateur comme de courtisan, voire d'intrigant, Lully domine la vie musicale en France à l'époque du Roi-Soleil. Il conçoit et organise plusieurs formes de musique : la tragédie en musique, le grand motet, l'ouverture à la française. Il est une figure majeure de la musique baroque française. Son influence s'exerce sur toute la musique européenne de son temps. Des compositeurs éminents tels Henry Purcell, Georg Friedrich Haendel, Jean-Sébastien Bach ou Jean-Philippe Rameau lui sont redevables. Atys est le premier opéra à mettre l'amour au centre de l'intrigue, et la première tragédie en musique où le héros meurt en scène. La partition est publiée en 1689 (Paris, Ballard), édition très rare sur le marché. L'uvre comprend cinq actes précédés par un prologue. Le livret s'inspire des Fastes d'Ovide. uvre très marquée par les conventions, elle introduit en contrepoint la poésie du sentiment et le lyrisme du drame pour narrer le désarroi de la jeunesse confrontée à un monde d'intransigeance et de sacrifice. Dans l'Avant-scène Opéra, le musicologue Jean Duron insiste sur les qualités dramatiques : « Atys en effet nest pas un opéra, mais une tragédie-lyrique dont le maître duvre nest pas le musicien (Lully), mais le poète (Quinault) il ne sagit pas non plus dun livret, mais dune tragédie. ». Atys est la quatrième collaboration Jean-Baptiste Lully et Philippe Quinault. Le roi, en plus d'avoir suggéré le thème au librettiste, s'implique dans la création de la tragédie, cristallisant ainsi la volonté d'extraire le genre de l'influence italienne. Atys est destiné au divertissement « du plus grand des Héros », Louis XIV. Déjà joué depuis le mois d'août 1675 à Paris, l'ouvrage est créé devant le roi dans la Salle des Ballets du château de Saint-Germain-en-Laye le 10 janvier 1676 pour une dizaine de représentations. Il est repris devant le roi en janvier 1678 avec les mêmes interprètes puis en janvier 1682, avec une nouvelle distribution. Cet opéra est aussi appelé « lopéra du roi », tant Louis XIV lappréciait et chantait souvent pour lui-même des airs de cette uvre. Le clou du spectacle se situe à lacte trois avec le merveilleux passage du « sommeil » dAtys, et des airs des songes agréables. Le Roi Soleil se reconnaissait, disait-on, « dans cet Atys insensible à lamour ; que Cybèle ressemble fort à la reine, et Sangaride à Mme de Maintenon : « Le Conseil à ses yeux a beau se présenter, Sitôt qu'il voit sa chienne il quitte tout pour elle. Rien ne peut l'arrêter, Quand le beau temps l'appelle. » (Louis XIV, chantant sur un air dAtys après avoir renvoyé son Conseil pour partir à la chasse, le 20 février 1685). L'opéra est repris en décembre 1986 puis en 1987 à loccasion du tricentenaire de la mort de Lully, dans une coproduction entre l'Opéra de Paris et l'Opéra de Montpellier. La direction musicale est assurée par William Christie et la mise en scène par Jean-Marie Villégier ; Les Arts florissants forment le chur et l'orchestre. Le spectacle connaît un succès retentissant, marquant un tournant dans ce qui sera appelé a posteriori le renouveau de l'opéra baroque et faisant rapidement gravir Les Arts Florissants au rang d'institution en ce qui concerne l'opéra baroque français. Notre copie manuscrite est contemporaine de la création d luvre (filigrane du papier avec fleur de lys couronnée, reliure). Elle se compose de 314 pages numérotées. Les notes y sont inscrites sur 12 portées, avec le texte du livret calligraphié en dessous et des indications en bas de page. Cette transcription se distingue de la version imprimée de 1689 (nombre de portées par page) La trace dune inscription au verso du dernier feuillet autorisant la copie de cet opéra (" M Bouvet, Oui à copie de cet opéra" avec signature en dessous) est peut-être une indication quil sagirait dune copie faite à partir du manuscrit original antérieurement à lédition de Ballard. Nous avons trouvé une seule copie manuscrite complète identique passée sur le marché ces 30 dernières années : le lot 223 de la vente Sothebys du 23 May 2017 (adjugé 13 750 GPB) : 1 vol in-folio de 314 pages (385 x 250 mm), manuscrit à l'encre brun foncé sur douze portées par page. Lexpert précise : « nous n'avons trouvé aucune partition manuscrite complète d'Atys aux enchères. Schneider répertorie huit partitions manuscrites hors de France et vingt-six au total ». La photo dune page de ce manuscrit permet didentifier que le notre est de la main du même copiste et il présente lui aussi des corrections et altérations. Lexemplaire de la BN est très similaire ( 1 vol in-folio, 132 pp.), la fiche de Gallica indique sa provenance : le musicologue et compositeur François Brossard: « Copiste Ancien possesseur ». Fragments glissés dans le manuscrit : « LEurope galante », de la même main que notre manuscrit : [5] ff dont 2 blancs format in-8° (250 x 180 mm) de 6 portées par page. L'Europe galante est un opéra-ballet en un prologue et quatre entrées composé par André Campra, sur un livret d'Antoine Houdar de La Motte et une chorégraphie attribuée à Louis Pécour. L'uvre fut représentée pour la première fois le 24 octobre 1697 au Palais-Royal, par la troupe de l'Académie royale de musique. « Les Folies dEspagne » : [4] pp in folio repliées (460 x 300 mm) de 16 portées par page. La Folia (en portugais) également appelée Follia (en italien) ou communément Folies d'Espagne, est une danse apparue au XVe siècle au Portugal dont le thème a servi pour des variations à plus de 150 compositeurs, de Lully à Sergueï Rachmaninov en passant par Arcangelo Corelli et Antonio Vivaldi. « La Pessac, Andante » : [2] ff in-8° oblong (165 X 205 mm) dont 2 blancs. Précieux document musical conservé dans sa condition dorigine, qui mériterait une étude approfondie ainsi que les fragments de partitions qui laccompagnent. 1 vol. in-folio (418 x 268 mm) with : [3] bl. ff, 314 pp. [notes inscribed on 12 staves, booklet text calligraphed below, footnotes], [1] ff with blank staves, [2] ff bl. Marked trace in the paper of an inscription on verso of last flyleaf: M Bouvet, Oui à de cet opéra with signature below. 3 unbound score fragments slipped into the manuscript: Doris de l'Europe galante, Les folies d'Espagne, La Pessac. (Soiling, stains, a few marginal tears and wormholes, fairly fresh paper). Contemporary full speckled calf, spine with 6 mute nerves, traces of leather laces, edges speckled with red (epidermures, corners damaged and missing, but binding still solid). Rare complete manuscript copy, prior to its publication (1689), of Atys, a musical tragedy composed by Jean-Baptiste Lully to a libretto by Philippe Quinault, premiered in 1676 at Saint-Germain-en-Laye. Jean-Baptiste Lully (Florence, 1632- Paris, 1687) was an Italian composer and violinist of the Baroque period, who left his mark on the reign of Louis XIV. Naturalized as a French citizen in 1661, he was appointed superintendent of the king's music and, the following year, music master to the royal family. A gifted musician and organizer, as well as a courtier and intriguer, Lully dominated musical life in France during the reign of the Roi-Soleil. He conceived and organized several forms of music: the tragédie en musique, the grand motet and the Ouverture à la française. He is a major figure in French Baroque music. His influence was felt throughout the European music of his time. Eminent composers such as Henry Purcell, Georg Friedrich Handel, Johann Sebastian Bach and Jean-Philippe Rameau owe him a debt of gratitude. Atys is the first opera to place love at the heart of the plot, and the first musical tragedy in which the hero dies on stage. The score was published in 1689 (Paris, Ballard), a very rare edition on the market. The work comprises five acts preceded by a prologue. The libretto was inspired by Ovid's Fastes. A work strongly marked by convention, it introduces the poetry of sentiment and the lyricism of drama as a counterpoint to narrate the disarray of youth confronted by a world of intransigence and sacrifice. In l'Avant-scène Opéra, musicologist Jean Duron emphasizes the dramatic qualities: Atys is in fact not an opera, but a tragédie-lyrique whose master builder is not the musician (Lully), but the poet (Quinault) - nor is it a libretto, but a tragedy. Atys is the fourth collaboration between Jean-Baptiste Lully and Philippe Quinault. In addition to having suggested the theme to the librettist, the king was involved in the creation of the tragedy, thus crystallizing the desire to extricate the genre from Italian influence. Atys is intended for the entertainment of the greatest of Heroes, Louis XIV. Already performed in Paris since August 1675, the work was premiered before the king in the Salle des Ballets at the Château de Saint-Germain-en-Laye on January 10, 1676 for a dozen performances. It was revived before the King in January 1678 with the same performers, then in January 1682 with a new cast. This opera is also known as the king's opera, as Louis XIV was so fond of it that he often sang arias from it for himself. The highlight of the show comes in act three, with Atys's marvelous sleep passage, and arias from pleasant dreams. The Sun King was said to recognize himself in this love-insensitive Atys; that Cybèle bears a strong resemblance to the Queen, and Sangaride to Mme de Maintenon: The Council to his eyes may present itself, As soon as he sees his bitch he leaves everything for her. Nothing can stop him, When the fine weather calls him. (Louis XIV, singing an aria from Atys after dismissing his Conseil to go hunting, February 20, 1685). The opera was revived in December 1986 and again in 1987, to mark the tercentenary of Lully's death, in a co-production between the Opéra de Paris and the Opéra de Montpellier. William Christie was the musical director, Jean-Marie Villégier the stage director, and Les Arts florissants the chorus and orchestra. The show was a resounding success, marking a turning point in what would later be called the revival of Baroque opera, and rapidly establishing Les Arts Florissants as an institution in French Baroque opera. Our manuscript copy is contemporary with the work's creation (watermark on paper with crowned fleur-de-lys, binding). It comprises 314 numbered pages. The notes are written on 12 staves, with the libretto text calligraphed below and footnotes. This transcription differs from the printed version of 1689 (number of staves per page, etc.). The trace of an inscription on the verso of the last page authorizing the copying of this opera (M Bouvet, Oui à copie de cet opéra with signature underneath) is perhaps an indication that this was a copy made from the original manuscript prior to Ballard's edition. We have found only one identical complete manuscript copy on the market in the last 30 years: lot 223 of the Sotheby's sale of May 23, 2017 (sold for 13,750 GPB): 1 vol. in-folio of 314 pages (385 x 250 mm), handwritten in dark brown ink on twelve staves per page. The expert states: We found no complete manuscript score of Atys at auction. Schneider lists eight manuscript scores outside France, and twenty-six in all. The photo of a page from this manuscript shows that ours is by the same copyist, and it too shows corrections and alterations. The NL copy is very similar (1 vol. in-folio, 132 pp.), and the Gallica entry indicates its provenance: musicologist and composer François Brossard: Copiste Ancien possesseur. Fragments slipped into the manuscript: L'Europe galante, in the same hand as our manuscript: [5] ff including 2 blank in-8° format (250 x 180 mm) with 6 staves per page. L'Europe galante is an opera-ballet in a prologue and four entries composed by André Campra, to a libretto by Antoine Houdar de La Motte and choreography attributed to Louis Pécour. The work was first performed on October 24, 1697 at the Palais-Royal, by the troupe of the Académie royale de musique. Les Folies d'Espagne": [4] pp in folio folded (460 x 300 mm) of 16 staves per page. The Folia (in Portuguese), also known as Follia (in Italian) or Folies d'Espagne, is a dance that first appeared in 15th-century Portugal, the theme of which has been used for variations by over 150 composers, from Lully to Sergueï Rachmaninov, Arcangelo Corelli and Antonio Vivaldi. La Pessac, Andante": [2] oblong 8vo (165 X 205 mm) including 2 blanks. A precious musical document preserved in its original condition, which merits in-depth study along with the accompanying score fragments.


Phone number : 06 81 35 73 35
fables de La Fontaine Tome 1 et 2 (Pr face Etienne Wolff)
, Diane de Selliers, 1992 Reli , 2 VOLUMES, slipcase, 640 pages, illustr . 24,2 cm 31,2 cm 7,8 cm *Tres bon etat. ISBN 9782903656140.
En 1755, deux diteurs prestigieux, Desaint & Saillant et Durand, commenc rent la publication des Fables choisies, de Jean de La Fontaine, illustr es par Jean-Baptiste Oudry, peintre animalier du roi et professeur l'Acad mie royale de peinture. Cette dition devait constituer un magnifique hommage La Fontaine. Les Fables de La Fontaine que livrent les ditions Diane de Selliers se pr sentent en deux grands volumes : - 640 pages reli es pleine toile sous coffret, - 275 illustrations en couleurs repr sentent la totalit de cette oeuvre de Jean-Baptiste Oudry en format d'origine et dans le respect scrupuleux des coloris de l' poque, - 200 motifs floraux dessin s par Bachelier, en couleurs, viennent ornementer chaque fable, - la typographie a t travaill e dans un esprit fid le celui du XVIIIe si cle. Les illustrations de Jean-Baptiste Oudry ont t , l' poque, accueillies et salu es comme une oeuvre exceptionnelle et extr mement r v latrice des Fables de La Fontaine. L' dition de 1755 (aujourd'hui introuvable ou hors de prix) est la r f rence in gal e et incontournable pour toutes les r ditions partielles qui ont t tent es depuis plus de deux si cles avec les Fables de La Fontaine illustr es par Oudry. Toutes les tentatives ditoriales, depuis lors, avaient abouties des copies simplifi es, tronqu es, en format r duit et avec des couleurs fauss es ou, le plus souvent, sans couleurs. Seules les performances des techniques d'imprimerie les plus avanc es viennent de permettre la reproduction, un co t accessible, de la totalit de l' dition originale de 1755 qui avait demand plus de cinq ann es de travail 44 graveurs et typographes. La sortie de l'int grale des Fables de La Fontaine illustr es par Jean-Baptiste Oudry intervient deux ans avant le Tricentenaire de la mort du plus grand des moralistes fran ais. Animalier du Roi, professeur de peinture l'Acad mie royale, directeur de la Manufacture de Beauvais pendant vingt ans, Jean-Baptiste Oudry offre une interpr tation remarquable des Fables de La Fontaine. Depuis deux si cles, des millions de lecteurs ont en m moire ses illustrations les plus c l bres. Crayonn es par Oudry, grav es et rehauss es la gouache, elles t moignent de la ma trise de l'artiste. Les sc nes repr sent es captent les instants les plus significatifs des Fables et les animaux sont rendus avec une finesse in gal e. Tr s fid le au texte, l'interpr tation de Jean-Baptiste Oudry se veut cependant surtout " d corative " afin de souligner l'ambigu t de la mise en sc ne des r cits qui allient le naturalisme des tableaux la surr alit des mythes qu'ils repr sentent. Cette dition remet ainsi la disposition du public un des grands chefs-d'oeuvre de la litt rature fran aise. Elle donne enfin aux lecteurs l'occasion de renouer avec la longue tradition des Fables illustr es qui correspondent particuli rement bien au go t du jour pour les histoires courtes et le retour une certaine morale.
Dumas (Jean-Baptiste), Stas (Jean Servais) et Boussingault (Jean-Baptiste Joseph Dieudonné)
Reference : 100537
(1930)
L'air, l'acide carbonique et l'eau - Mémoires de Dumas, Stas et Boussingault , dans la collection Les Classiques de la Science (1. Recherches sur la véritable constitution de l'air atmosphérique - 2. Recherches sur le véritable poids atomique du carbone - 3. Recherches nouvelles sur le véritable poids atomique du carbone - 4. 4Recherches sur la composition de l'eau)
Armand Colin , Les Classiques de la Science Malicorne sur Sarthe, 72, Pays de la Loire, France 1930 Book condition, Etat : Bon broché, sous couverture imprimée éditeur verte, titre en bleu, plastifiée In-8 1 vol. - 104 pages
4 planches hors-texte dépliantes (reproduction des planches originales, complet) 1ere édition, 1930 Contents, Chapitres : Avertissement, Notices biographiques sur Dumas, Stas et Boussingault - 1. Dumas et Boussingault : Recherches sur la véritable constitution de l'air atmosphérique - 2. Dumas et Stas : Recherches sur le véritable poids atomique du carbone - 3. Stas : Recherches nouvelles sur le véritable poids atomique du carbone - 4. Dumas : Recherches sur la composition de l'eau - 1. Jean Baptiste André Dumas, né à Alès (Gard) le 14 juillet 1800 et mort à Cannes le 11 avril 1884, est un chimiste, pharmacien et homme politique français. Il formula les principes fondamentaux de la chimie générale, mesura de nombreuses densités de vapeur, détermina de façon précise la composition de l'air, de l'eau et du dioxyde de carbone (anciennement gaz carbonique). Dumas travailla notamment sur la chimie organique. Il découvrit les amines et l'anthracène. Il établit la théorie des substitutions, en démontrant la possibilité de substituer l'hydrogène par du chlore dans les composés organiques. Il définit la fonction alcool et donna la composition des éthers. Il s'intéressa notamment au poids atomique du carbone. 2. Jean-Baptiste Joseph Dieudonné Boussingault, né à Paris le 1er février 1801 et mort à Paris le 11 mai 1887, est un chimiste, botaniste et agronome français, connu pour ses travaux de chimie agricole et pour la mise au point des premiers aciers au chrome. Il va être le fondateur de la chimie agricole moderne. Il est devenu célèbre par ses découvertes sur la dynamique de l'azote, le métabolisme des graisses, le rendement de la photosynthèse mais aussi la métallurgie des aciers et métaux précieux. Il fait des recherches sur la composition exacte de l'air atmosphérique, en collaboration avec Dumas, sur la composition en végétaux de l'alimentation des herbivores, sur la détection de l'arsenic. Il découvre plusieurs corps chimiques - 3. Jean Servais Stas, né à Louvain le 21 août 1813 et mort à Bruxelles le 13 décembre 1891, est un médecin et chimiste analytique belge. Il est principalement connu pour ses travaux sur la masse atomique des éléments chimiques qui ont participé à la création du tableau périodique des éléments. Jean Servais Stas entreprend des études de médecine à l'Université d'État de Louvain en 1832 et obtient son diplôme de docteur en 1835. C'est durant sa formation qu'il commence à faire de la chimie comme préparateur dans le laboratoire de Jean-Baptiste Van Mons. Il approfondit ses connaissances en chimie en France à l'École polytechnique de Paris sous la direction de Jean-Baptiste Dumas, avec qui il établit la masse atomique du carbone. (source : Wikipedia) couverture plastifiée sinon en bon état, bords des plats un peu jaunis, intérieur sinon frais et propre, papier légèrement jauni, cela reste un bon exemplaire, bien complet des 4 planches hors-texte dépliantes
Le Casse-Tête. Organe fondé en 1869.
Paris, aux bureaux du journal, 1869. 15 livraisons en 1 vol. in-4, percaline gaufrée brune, dos lisse fileté (Ateliers Laurenchet).
Collection complète de ce journal fondé par Jean Baptiste Clément (1836-1903), l'auteur du Temps des cerises.Envoi autographe signé en tête du n°1 : Souvenir de Londres sur des choses du vieux temps – nous ferons mieux plus tard. À Kleinmann, J. B. Clément. Albert Kleinmann, né en 1844, fut ouvrier graveur sur métal et employé de l'administration des domaines durant la Commune, puis condamné par contumace en 1873, Jean-Baptiste Clément, comme beaucoup d'autres, a tenté de profiter du succès de la Lanterne de Rochefort, en 1868. Sous la même couverture rouge et dans le même format in-32 que La Lanterne, il publia, vers la fin du mois d'août 1868, une Lanterne impériale, qui se présente comme la réponse d'un journaliste officiel à Rochefort. Quelques jours à peine après la Lanterne impériale, parurent Deux Chansons politiques, première plaquette du genre où Jean-Baptiste Clément devait acquérir sa vraie gloire. Mais ignorant encore sa voie, il récidiva dans le pamphlet en produisant dans fa première quinzaine de septembre Ah, le joli temps ! O ma France !, dans sa seconde quinzaine, La Lanterne du Peupie, les Prophéties politiques.La Carmagnole, datée du 7 octobre 1868, sortit le 21, dans un format în-32 plus carré que celui des Lanternes. Elle fut tirée à 1500, d'après une note manuscrite portée sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale. Ce devait être une revue, mais la police s'en mêla. On lit en effet dans un rapport du préfet de police au ministre de l'intérieur du 2 décembre 1868 : « M. Clément a été prévenu que s'il persistait à donner à son journal le titre de La Carmagnole, l'autorisation, soit de l'afficher, soit de le vendre sur la voie publique, lui serait refusée. Malgré cette observation, il o maintenu son titre, et récépissé lui a été délivré ».Jean-Baptiste Clément, n'ayant pu faire imprimer un second numéro de la Carmagnole, mais plus riche de nouveaux brûlots tels que le Prisonnier de Sainte-Pélagie, revint à la préfecture de police le 3 juillet 1869 déclarer son intention de lancer tous les samedis Le Casse-tête, publication non politique dont il serait le propriétaire-gérant et qu'imprimerait Vallée, rue du Croissant.Le lancement du Casse-tête tarda jusqu'au 7 août. Le jour même, le préfet de police écrivait confidentiellement au ministre de l'intérieur : « Monsieur le Ministre, Pour faire suite à ma lettre du 15 juillet dernier, j'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence les renseignements que je possède sur M. Clément, qui a déclaré avoir l'intention de publier un journal non-politique intitulé Le Casse-tête. M. Clément (...) est ouvrier imprimeur. Il est favorablement représenté sous le rapport de la conduite et de la moralité, mais ses opinions sont hostiles au Gouvernement impérial. Il a publié divers écrits, dont plusieurs sont animés d'un mauvais esprit (...) On crois que le journal qu'il se propose de publier sous le titre de Le Casse-tête aura des tendances politiques et sera hostile au Gouvernement ».« Le Casse-tête dura du 7 août au 3 décembre 1869. Il eut un certain succès. Jean-Baptiste Clément y apprit le métier de journaliste qu'il devait exercer ensuite, notamment auprès de Jules Vallès, au Cri du Peuple. Ses chansons, en particulier Le Temps des Cerises, composé dès 1866, ne lui vaudront la célébrité que plus tard » (Jean Dautry, Les Débuts littéraires de Jean-Baptiste Clément).Bel exemplaire, dont les quinze numéros (en quatorze livraisons, les numéros 11-12 n'en formant qu'une) ont paru du 7 août au 3 décembre 1869. Réparations marginales à quelques feuillets.
BLANC (Charles) - Jean et François Clouet, Martin Fréminet , Simon Vouet, Nicolas Poussin, Philippe de Champagne, Louis et Henri Testelin, Sébastien Bourdon, Noël Coypel, Claude Lefèvre, Charles De Lafosse, Francisque Millet, Louis de Boullongne, Claude Gillot, Jean Raoux, Antoine Watteau, François Lemoyne, Nicolas Lancret, Jean Restout, Jean-Baptiste Pater, Etienne Jeaurat, Siméon Chardin, Charles Natoire, Maurice Quentin De Latour, Marie-Joseph Vien, Les Lagrenée, Jean-François Bachelier, Jean-Baptiste Le Prince, Jean-Germain Drouais, PIerre Guérin, Xavier Sigalon, Nicolas-Toussaint Charlet .
Reference : 45354
Les peintres célèbres : Ecole française -
Paris : Henri Laurens, sans date (ca 1900). Un fort volume pleine percaline ornée de motifs art nouveau en deux tons (reliure de l'éditeur). Ce volume abondamment illustré de gravures, comprend des études de Jean et François Clouet, Martin Fréminet , Simon Vouet, Nicolas Poussin, Philippe de Champagne, Louis et Henri Testelin, Sébastien Bourdon, Noël Coypel, Claude Lefèvre, Charles De Lafosse, Francisque Millet, Louis de Boullongne, Claude Gillot, Jean Raoux, Antoine Watteau, François Lemoyne, Nicolas Lancret, Jean Restout, Jean-Baptiste Pater, Etienne Jeaurat, Siméon Chardin, Charles Natoire, Maurice Quentin De Latour, Marie-Joseph Vien, Les Lagrenée, Jean-François Bachelier, Jean-Baptiste Le Prince, Jean-Germain Drouais, PIerre Guérin, Xavier Sigalon, Nicolas-Toussaint Charlet .
Historien de l’art, théoricien, professeur, directeur de revue, directeur de collections, Charles blanc (1813-1882) fut de 1878 à 1881, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d’esthétique et d’histoire de l’art. Charles Blanc est l'inventeur de la première histoire de l’art illustrée, qu'il débute en 1848. Tous nos livres sont visibles sur notre site : https://www.livrepoesie.com/
[NANTES - PORT-SAY [ACTUELLEMENT Marsa Ben M'Hidi - Commune en Algérie ] Louis Jean-Baptiste SAY EXPLORATEUR NANTAIS
Reference : 28394
(1909)
DOSSIER ORIGINAL : DOCUMENTS RENSEIGNANT AVEC PHOTOGRAPHIES LA VENTE DE L'HÔTEL DE LOUIS JEAN-BAPTISTE SAY [EXPLORATEUR NANTAIS - FONDATEUR DE PORT SAY EN ALGÉRIE],N°5 RUE DOBRÉE A NANTES EN 1909-10
NANTES PORT-SAY [ACTUELLEMENT Marsa Ben M'Hidi - Commune en Algérie ] 1909/10 + 1- une LETTRE à "en-tête" imprimé en noir : MEMORANDUM - "Algérie et Maroc Oriental - PORT-SAY DIRECTION" avec en dessous une gravure d'Ancre Marine, Port-Say, le 13 Avril 1909, format : 21,2 x 13,6 cm, lettre autographe manuscrite à l'encre noire d'1 page, signée de Louis Jean-Baptiste SAY (EXPLORATEUR NANTAIS) adressée à Mr DURAND GASSELIN, Notaire Nantais, 2, Rue Voltaire, "...Je suis en pourparlers pour vendre les Hôtels de Nantes (3 et 5 rue Dobrée)...Nouvelles de PORT-SAY..." + 2- projet de depliant à donner aux futurs clients pour la vente de l'Hôtel de Mr Louis SAY; 5, rue Dobrée à nantes, par l'Etude de Me Durand Gasselin, 2, rue Voltaire à Nantes, dépliant tapé à la machine en noir et violet et et illustré à la main à l'encre noire, format déplié : 21 x 31 cm avec une page centrale volante tapée à la machine et illustrée à la main en noir, +3- 4 lettres à "en-tête" de la société WYS MULLER & Cie (Wys muller est une agence de renseignements commerciaux qui fournit des informations sur mesure sur des entreprises mais aussi sur des personnes privées) illustré en noir, format : 21,5 x 14 sur papier blanc, tapé à la machine en violet, des 7,8,10,11 Décembre 1909, donnant une liste côté pile et côté face des personnes les plus fortunées de Nantes susceptibles d'être interessés par la vente de l'Hôtel de Mr LOUIS SAY, + 4- 7 photographies de l'Hôtel de LOUIS SAY, 5 rue Dobrée à Nantes, prises lors de la vente de 1909 : 1- Vue de la serre du jardin de l'Hôtel (vue animée), 2- le plan d'eau du jardin (vue animée), 3- vue du Jardin de l'Hôtel (vue animée), 4- l'Hôtel vu du Jardin (vue animée), 5- vu du trés beau salon de l'Hôtel, 6- l'Hôtel vu du Jardin - autre vue (vue animée), 7- facades de L'Hôtel vue de la rue (vue animée), 5- 2 lettres à "en-tête" du domaine agricole du Chateau de Jumilhac adressée à Me Durand Gasselin (Notaire) 2, rue Voltaire à Nantes, le 21/12/09 et le 12/2/10, lettres autographes manuscrites signée du fils adoptif de LOUIS SAY, Daniel Bourmancé-Say, pour assurer le suivi de la vente au nom de son père louis SAY, 6- un télégramme envoyé de PORT-SAY par Louis Say demandant au notaire Durand Gasselin de ne pas louer les Hotels (de NANTES), daté du 2/03/1909, 7- la petite annonce de la vente de l'Hôtel de LOUIS SAY, 5, rue Dobrée découpée dans le journal format : 5 x 5 cm parue en 1910, 8- une carte bristol autographe manuscrite en noir signée Ernest LOTZ, format : 9,5 x 13,7 cm et une carte de visite imprimée en noir : Ernest Lotz, Nantes 14 bis rue d'Alger, avec autographe manuscrite en noir par Ernest Lotz déclinant l'offre pour l'achat de l'Hôtel de Louis SAY, rue Dobrée à Nantes adressés au Notaire Durand Gasselin,
Louis Jean-Baptiste Say (Nantes, 30 janvier 1852 - Port-Say, 3 octobre 1915) est un explorateur NANTAIS. Fils de Louis Octave Say (1820-1857), raffineur de sucre, et d'Octavie Étienne (remariée à Eugène Janvier de La Motte), ainsi que le petit-fils des raffineurs de sucre Louis Say (1774-1840) et Jean-Baptiste Étienne (1795-1866). Enseigne de vaisseau, il est membre en 1876 dans l'expédition de Victor Largeau El Oued-Ghadames. Il reprend en 1877 les routes du sud à partir de Ouargla et s'avance jusqu'à Timassinin en passant par Aïn Taya et El Biodh. Il explore en détail les Gassi, des couloirs naturels qui traversent le Grand Erg. En 1886, il mène une expéditions dans la région d'Oudjda et des Beni-Snassen. Fondateur de Port-Say en 1905 en Algérie, il y meurt en 1915.Marsa Ben M'Hidi (anciennement Port-Say pendant la colonisation française) est une commune algérienne de la wilaya de Tlemcen ...... Beaux DOCUMENTS INTERESSANT NANTES ET LES NANTAIS ......... Beaux DOCUMENTS D'EPOQUE ........... RARETÉ ..... en trés bon état (very good condition), en trés bon état
[BOURGUIGNON d 'ANVILLE Jean-Baptiste] - CREVIER Jean-Baptiste-Louis
Reference : 17187
(1750)
Histoire des Empereurs romains, depuis Auguste jusqu'à Constantin. 6 volumes in-4° - Édition originale.
Par M. Crevier, Professeur Émérite de Rhétorique au Collège de Beauvais.Édition originaleillustrée 4 cartes repliées gravées par d'Anville (Géographe et Cartographe français). Lettrines, bandeaux et culs-de-lampes.A Paris, Chez Desaint et Saillant - 1750. Avec Approbation & Privilège du Roy.T1° Préface - Liste des Noms des Consuls, & des années que comprend ce volume - Carte (Germanie) - 616 pages - Table - 1750.T2° Liste des Noms des Consuls, et des années que comprend ce volume - Carte (L'Empire des Parthes) - 507 pages - Table - 1751.T3° Liste des Noms des Consuls, et des années que comprend ce volume - Carte (La Palestine) - Table - 546 pages - 1752.T4° Empereurs contenus dans ce volume - Carte (La Dace, La Moesie, La Thrace) - Table des sommaires - 528 pages - 1753.T5° Empereurs contenus dans ce volume - Table des sommaires - 500 pages - 1754.T6° Empereurs contenus dans ce volume - Table des matières - Fastes consulaires - 540 pages - 1756.Reliure plein veau granité de l'époque. Dos à nerfs joliment orné de fleurons et de grecques dorés. Pièces de titre et de tomaison maroquin rouge. Tranches jaspées. Triple filet doré encadrant les plats et double sur les coupes. Glose. Coiffes frottées. Pas de rousseur. Très bon état, intérieur très frais. Format in-4°(27x20).Jean-Baptiste-Louis Crevier littérateur et historien français. Fils d'un ouvrier imprimeur, il fut un des élèves les plus distingués de Charles Rollin, devint professeur de rhétorique au collège de Beauvais, remplit cette chaire pendant plus de vingt ans, avec autant de zèle que de succès, et mourut à Paris en 1765 après avoir donné au public divers ouvrages plus utiles que brillants. Il termina l'Histoire romaine de Rollin (il est l'auteur des volumes VIII à XVI), et la fit suivre d'une Histoire des empereurs romains jusqu'à Constantin, 1750, 6 volumes in-4.Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, né le 11 juillet 1697 à Paris (France) où il est mort le 28 janvier 1782, est un géographe et cartographe français.
BOURGUIGNON d 'ANVILLE Jean-Baptiste
Oeuvres complètes de Jean-Baptiste Say - Tome V (5). Oeuvres morales et politiques (Politique pratique)
Editions Economica Malicorne sur Sarthe, 72, Pays de la Loire, France 2003 Book condition, Etat : Bon broché, sous couverture imprimée éditeur bleu roi, titre en jaune fort et grand In-8 1 vol. - 954 pages
1ere édition dans la série des Oeuvres complètes de J.-B. Say, 2003, tome 5 seul Contents, Chapitres : 1. Introduction générale, Présentation du tableau chronologique et tableau chronologique (142 pages) - 2. Textes divers : De la liberté de la presse - Abrégé de la vie de Franklin - Olbie ou essai sur les moyens de réformer les moeurs d'une nation - Rapports au Tribunat - Eloge funèbre de Sir Samuel Romilly, Baronet - 3. Politique pratique : Introduction, préface, notes rassemblées (pages 289 à 750, soit 461 pages) - Annexes - Jean-Baptiste Say, né à Lyon le 5 janvier 1767 et mort à Paris le 14 novembre 1832, est le principal économiste classique français. Industriel du coton, il fut l'un des entrepreneurs huguenots de cette industrie alors en plein essor. Il fut également journaliste. Il est réputé pour ses positions libérales. Il est l'auteur de la distinction tripartite « production répartition consommation », devenue classique. Celle-ci sert de plan au Traité d'économie politique, son maître-ouvrage paru en 1803. Il est également connu pour avoir élaboré la « loi des débouchés », ou loi de Say. - Say défend une pensée économique libérale : il met en avant la propriété privée, la libre-concurrence et un rôle de l'État aussi limité que possible. Il se situe en fait dans le prolongement direct de l'école d'économie politique libérale française : Gournay, Turgot, François Quesnay ou du Pont de Nemours. On doit à Jean-Baptiste Say la division tripartite qui est restée classique : production, répartition, consommation. C'est ainsi qu'il divise son Traité d'économie politique (paru en 1803). - Dans la tradition de l'école française, il reprend la théorie de la valeur-utilité : « l'utilité [des] choses est le premier fondement de leur valeur ». Il distingue marchandises et richesses et souligne que la production est avant tout création de « richesses », donc d'utilité. En partie pour cela il est considéré comme un précurseur de l'école autrichienne d'économie. - Jean-Baptiste Say est également connu (et probablement surtout connu) pour avoir formulé dans son traité d'économie politique (1803) la loi des débouchés. (source : Wikipedia) "bel exemplaire du tome 5 des Oeuvres de Jean-Baptiste Say, complet en lui-même sur les oeuvres morales et politiques, avec notamment le texte ""Politique pratique"" (461 pages), composant près de la moitié du volume, infimes éraflures discretes sur les plats, la couverture reste en bon état, l'intérieur est frais et propre, tome 5 seul. Ce texte ""Politique pratique"" n'avait jamais été édité, il s'agit donc en quelque sorte de son édition originale de 2003..."
[Jean-Baptiste Le Marinier, Chevalier de CANY, Commandeur de l’Ordre de Malte (1645-1689)]
Reference : 3205
(1688)
« Reflexions dun Chevalier de Malte Religieux de l’ordre militaire des hospitaliers de Saint [Jean] de Jerusalem. Sur la grandeur et les devoirs de son Etat ».
Circa 1688 Manuscrit composé de 15 cahiers assemblés par des lacets et reliés entre eux par une cordelette de lin (177 feuillets in-folio (230 x 355 mm). Calligraphie très lisible, écrite à l’encre noire et à l’encre rouge, réglé au crayon en marge. Quelques déchirures, manques dans les premiers feuillets. Manuscrit très fortement raturé et surchargé. Composition - Avant-propos, 6ff.- Suivi de : « Formulaire de la profession reguliere des Chevaliers de Malte » (à l’encre rouge) 1ff.- Suivi de : « Oraisons que le prestre dit avant la profession ». En latin aux encres rouges et noires, 2ff.- Suivi de : « La forme de Donner l’ordre de Chevalerie, Les oraisons finies, le prestre commence la messe et sarreste avant levangil alors celui quy se dispose a recevoir l’habit se leve de devant l’autel, et va se mettre a genoux devant le chevalier quy la luy doit donner : pour en recevoir premierement lordre de chevalerie lequel luy dit (…), 4ff.- Suivi de : « Troisieme section contenant les paroles qui se prononcent en faisant les vœux », 1page. - suivi de : « Quatrième section contenant la forme de donner la croix et l’habit régulier de l’ordre et les oraisons quiserecitent pour conclusion de la cérémonie » 2 ff.- Suivi de : « Oraison après profession » (à genoux devant l’autel), 3ff.- Suivi de : « Reflexions dun Chevalier de Malte Religieux de l’ordre militaire des hospitaliers de Saint [Jean] de jerusalem. Sur la grandeur et les devoirs de son Etat ». 326 pages numérotées, dont les 4 derniers blancs. Le dernier marqué au verso d’une autre écriture : « Recu Ch de Malthe dan langue de provence le premier 7 bre 1572. »Défauts : Saut de pagination entre la dernière page de table marquée 293 à la partie commençant par : « réflexion d’un chevalier » paginée 303.
I – Historique de l’ordre de malte L’Ordre de chevalerie le plus ancien au monde : il fut créé en 1048. L’ordre dont le symbole est la croix blanche à huit pointes se donnera pour but la défense militaire des malades et des pèlerins lors des croisades. Sa double vocation militaire et hospitalière se verra confirmée au fil des siècles par la refonte en une seule entité des anciennes confréries de l’ordre des Templiers et des Antonins. Basé dans l’ile de Malte l’Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte eut au cours des XVIe et XVIIe siècles un rôle essentiel dans la lutte contre les Turques.Parallèlement à cette activité guerrière l’institution prit en charge les malades et lépreux qui bénéficièrent de l’expérience acquise par l’ordre des Antonins. En lutte constante contre les galères turques, l’ordre devint une puissance incontournable du bassin méditerranéen. À la fin du XVIIe siècle, le relâchement des moeurs et un certain laissé aller rendirent nécessaire une nouvelle mise au point des droits et devoirs de l’ordre. II – Texte de Jean Baptiste le Marinier de CanyC’est ce qu’entreprend en 1688 le commandeur Jean Baptiste le Marinier de Cany dans un travail intitulé « Réflexions d’un chevalier de Malte, Religieux de l’Ordre militaire des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem sur la grandeur de son état ». Ce texte, encore inédit de nos jours connaît deux versions, une italienne, une française. Le chercheur Luigi Michele de Palma a publié un article en 2019 « Jean-Baptiste Le Marinier de Cany un maestro della spiritualita giovannita » Edizioni La Villa, une analyse de la structure de ce texte fondamental concernant non seulement l’éthique et l’histoire de l’ordre mais aussi sur le rituel de l’adoubement des chevaliers. Son travail s’appuit sur l’analyse d’un manuscrit conservé à la Bibliothèque de La Valette (Libr.1416), celui ci, comprenant cinq parties, au lieu de trois dans notre exemplaire. Notre manuscrit offre en comparaison d’intéressantes variantes. Ainsi, dans la seconde partie, chaque section est précédée des phrases prononcées par le chevalier lors de sa réception ainsi que la description minutieuse de chacun des moments clefs de la cérémonie. Ces instants forts, sont dans notre manuscrit l’occasion d’en expliquer la symbolique rejoignant en cela l’exemplaire décrit par Luigi Michele de Palma de la bibliothèque de Malte. Par exemple : folio 190, « le profes donne lespée au recevant avec son fourreau en la main lui disant. (un mot rayé) à cette fin que mainteniez tout ce que vous avez promis prenez cette espée au nom du Pere, du Fils, et du Saint esprit. Ainsisoitil. »___ Des sentiments que doit inspirer un Chevalier de la manière dont on lui présente lépée »L’intégralité du déroulé de la cérémonie est également reportée en début d’ouvrage sous un titre écrit en rouge (la forme de donner l’ordre de chevalerie (…) Cette section est apparemment absente de l’exemplaire décrit par Luigi Michele de Palma. Carmen Depasquale, responsable du département français de la faculté des arts de l’université de Malte, auteur d’une thèse de doctorat en 2000 intitulé « La vie intellectuelle et culturelle des chevaliers de Malte au XVIIIe siècle », donne une description des exemplaires connus de ce texte, tous inédits, deux textes en français NLM.libr 1416 ; NLM.libr 324) Ainsi que deux versions italiennes, l’un : NLM.libr250 est comme notre exemplaire est composé des deux premières parties, l’autre : NLM.libr558 comporte les parties 3 à 5 et la table des matières. III – Remarques sur la nature de ce document Les nombreux remords, biffures, réécritures de texte sont parfois d’une importance considérable. Ils indiquent que notre manuscrit est un exemplaire de premier jet ou du moins dans un stade d’élaboration d’un texte définitif, comprenant d’amples extensions marginales possiblement intégrées au texte dans une version ultérieure. Ceci laisse à penser que ce manuscrit est vraisemblablement autographe. Une date en marge de 1688 indique par ailleurs que la rédaction de celui-ci est antérieure avec la date généralement donnée de 1689 à la version conservée à la Bibliothèque de La Valette. Les remords, salissures, taches, lignes raturées et ajouts inter-textuels ne laissent aucun doutent la nature originale de ce manuscrit. Un manuscrit du plus vif intérêt probablement autographe de Jean Baptiste le Marinier, Chevalier de Cany, qui eut un impact majeur sur l’ordre militaire des chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, dans lequel se trouve minutieusement décrit le déroulé de l’adoubement des membres de l’ordre.
CREBILLON (Prosper JOLYOT de) - MARMONTEL (Jean-François de) - [anonyme] - [DUPUY DEMPORTES (Jean-Baptiste)] & [anonyme] - [DESFORGES (Pierre-Jean-Baptiste CHOUDARD)].
Reference : 10810
(1749)
Catilina [a été relié à la suite :] Denis le Tyran [a été relié à la suite :] Lettre à Monsieur de *** sur la tragédie de Catilina [a été relié à la suite :] Natilica, conte indien ou critique de Catilina.
A Paris, chez Prault, 1749 ; A Paris, chez Sébastien Jorry, 1749 ; A Londre [sic, Londres], Par les Libraires associés, 1748 (décembre) ; A Amsterdam, s.é., 1749. 4 ouvrages reliés en 1 vol. in-12 (168 x 98 mm) de 4 ff. n.fol., 96 pp. et 2 planches dépliantes ; ix pp., 1 f. n.fol. et 82 pp. ; 58 pp. et 1 f. n.fol. ; 22 pp. et 2 ff. bl. Reliure de l'époque de plein veau moucheté havane, armes dorées portées au centre des plats, dos à nerfs orné de caissons d'encadrement à froid, fleurons à froid, titre doré, armes dorées en queue, palette à froid en queue, filet doré sur les coupes, toutes tranches mouchetées, dentelle intérieure dorée.
Exemplaire aux armes de Gabriel-Jérôme de Bullion de Bonnelles, chevalier et comte d'Esclimont, originaire de Mâcon en Bourgogne. En 1713, le jeune chevalier de Bullion entra chez les mousquetaires du roi. Il devint colonel en 1718. Prévôt de Paris, il fut officier avec le grade de colonel au régiment de Provence, maître de camp, maréchal de camp. Il commanda son régiment à la prise de Nancy en 1733, puis fut employé à l’armée du Rhin de 1734 à 1735. Promu maréchal de camp le 1er mars 1738, il fut conservateur des Privilèges Royaux de l'Université de Paris. Réunion de quatre textes, chacun ici en édition originale. ''La tragédie de Catilina, à laquelle Crébillon avait travaillé plus de vingt ans, fut jouée pour la première fois le 20 décembre 1748 avec un succès dont le poète septuagénaire fut redevable à la cour et surtout à Mme de Pompadour, qui avait intéressé le Roi en sa faveur : « On parla devant Mme de Pompadour de ce grand homme abandonné, qu’on laissait vieillir sans secours parce qu’il était sans intrigue. C’était la prendre par son endroit sensible. Que dites-vous ? s’écria-t'elle. Crébillon est pauvre et délaissé ! Aussitôt elle obtint pour lui du Roi une pension de cent louis sur sa cassette… On parlait de Catilina comme de la merveille du siècle. Mme de Pompadour voulut l’entendre. Le jour fut pris pour cette lecture ; le Roi, invisible et présent, l’entendit. Elle eut un plein succès et, lorsque Catilina fut mis au théâtre, Mme de Pompadour, accompagnée d’une volée de courtisans, vint assister à ce spectacle avec le plus vif intérêt. Peu de temps après, Crébillon obtint la faveur d’une édition de ses œuvres à l’imprimerie du Louvre, aux dépens du trésor royal. Dès ce temps-là Voltaire fut froidement reçu et cessa d’aller à la cour.'' (Marmontel, in Mémoires). ''Lorsqu'on présenta à Voltaire, Denis le Tyran, première et dernière tragédie de Marmontel (i), le vieux poète dit : II ne fera jamais rien, il n'a pas le secret. — Le génie peut-être ? — Oui, l'abbé, le génie, et puis le bon choix des sujets ; l'homme de Nature opposé à l'homme civilisé ; l'homme sous l'empire du despotisme ; l'homme accablé sous le joug de la tyrannie des pères, des mères, des époux, les liens les plus sacrés, les plus doux, les plus violents, les plus généraux, les maux de la société, la loi inévitable de la fatalité, les suites des grandes passions''. (Diderot, in Salons). ''Dans le conte satirique Natilica (Catilina), tous les noms propres sont anagrammarisés : ainsi, Inebami, c'est Bien-Aimé (Louis XV) ; Lovatire, c’est Voltaire ; Rebnocill, c’est Crébillon.'' (Drujon). Quérard II, La France littéraire, p. 332 (pour Catilina) - Cioranescu II, Bibliographie de la littérature française du XVIIIème, 43021 & Quérard IV, La France littéraire, p. 551 (pour Denys le tyran) - Barbier IV, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 1102-b (pour la Lettre [...] puis V, 397-c (pour Natilica, dans une édition à la même date mais au format in-4) puis Quérard II, La France littéraire, p. 512 & Cioranescu I, Bibliographie de la littérature française du XVIIIème, 23405 et Drujon II, Les Livres à clefs, 681. Angles élimés. Coiffes arasées. Dos à l'éclat légèrement altéré. Discrète auréole claire en marge supérieure des feuillets. Rares rousseurs dans le texte. Du reste, bonne condition.
Joannis Baptistae SANTOLII VICTORINI Operum omnium. Editio tertia in qua reliqua opera nondum conjunctim edita reperiuntur (3 volumes).
Parisiis, Apud Spiritum Billiot, 1729, complet en 3 volumes in-12 de 170x95 mm environ, Tome I : 1 f. blanc, 1 frontispice, xxxij-328 pages, 1 f.blanc, Tome II : 1 f.t blanc, 350-(1) pages, 1 f. blanc, Tome III : 1 f. blanc, 220 pages, 1 f. blanc, plein veau granité brun, dos à 5 nerfs portant titres dorés sur pièces de titre havane, ornés de caissons à fleurons dorés aux entre-nerfs, tranches mouchetées de rouge, coupes dorées, gardes marbrées. Petit trou de ver sur les mors des tomes II et III, une coiffe ébréchée (tome III), plis sur un coin du tome III, bordures des pages garde brunies, sinon bon état général.
Jean de Santeul, appelé aussi Jean-Baptiste Santeul ou Jean-Baptiste Santeuil, dit Santolius (né le 5 décembre 1630 à Paris et mort le 5 août 1697 (à 66 ans) à Dijon) est un poète français néolatin du XVIIe siècle. Santeul fut un éminent représentant du latin vivant, à une époque où cette langue disputait encore sa prééminence sur le français et les autres langues vulgaires. Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.
MARTINES DE PASQUALLY, WILLERMOZ Jean-Baptiste ; Vie, Doctrine et Pratiques Théurgiques de l'Ordre des Chevaliers Maçons Élus CoËns de l'Univers, une relation initiatique à l'origine du Régime Écossais rectifié - Éditions le mercure Dauphinois - Grenoble 2020
Broché, comme neuf, 140x220, 1290 gr, 1183 pages, quelques photos quelques photos N&B, ISBN : 9782356624727
L'histoire de la relation qui s'est établie entre Jean-Baptiste Willermoz et Martinès de Pasqually, débute en avril 1767, année où les deux hommes vont se rencontrer. A compter de cette date, Jean Baptiste Willermoz va découvrir auprès de Martinès, un ambitieux programme visant à la "réintégration des êtres dans leurs premières propriétés, vertus et puissances spirituelles divines", de même qu'une doctrine spirituelle absolument originale, gravissant tous les degrés initiatiques jusqu'à celui, ultime, de Réaux -Croix, trouvant dans " l'Ordre des Chevaliers Maçons Élus CoËns de l'Univers" , cE QU'IL AVAIT TOUJOURS attendu en matière de connaissances, et de surcroît la confirmation de ses espérances à propos des "mystères" subsistant au sein de la franc-maçonnerie. Ainsi que le montre la présente étude l'attachement et l'intérêt de Jean-Baptiste Willermoz pour la doctrine et les pratiques enseignées par Martinès de Pasqually vont dès lors se traduire par sept années d'une relation étroite (1767 -1774) certes parfois délicate et traversée par des doutes et des innombrables questions, mais toujours motivée par un souci permanent d'approfondir,sans cesse, les fondements doctrinaux et "opératifs" délivrés par les Élus Coëns.
"Mémoire de la construction et agréz d'une galère ordinaire, avec l'explication des termes, l'usage des manoeuvres, et de toutes les parties qui composent le corps de la galère et son armement" Manuscrit autographe complet
s. d. [1672-1674] | 24 x 34 cm | relié
Manuscrit autographe complet de 106 pages intitulé «?Mémoire de la construction et agréz d'une galère ordinaire, avec l'explication des termes, l'usage des manuvres, et de toutes les parties qui composent le corps de la galère et son armement?». Il est rédigé d'une écriture soignée et sans ratures. Une autre main a apposé quelques annotations marginales au texte. Reliure de l'époque en plein parchemin comportant de petites taches et infimes manques, dos lisse muet. Manuscrit capital et précieux témoignage de la résurrection des galères françaises, rédigé par le maître constructeur le plus influent de son temps?: Jean-Baptiste Chabert. Nous avons pu identifier deux autres manuscrits présentant le même titre que le nôtre?: l'un a appartenu au Commandant Noël Fourquin, capitaine au long cours et spécialiste de la lexicologie nautique, et l'autre à Louis-Philippe en personne. On retrouve ce dernier dans le catalogue de la vente de ses bibliothèques du Palais-Royal et de Neuilly en décembre 1852 sous le numéro 445?; il présente une reliure identique à notre exemplaire. * Cet important manuscrit est attribuable à Jean-Baptiste Chabert constructeur de galères à Marseille. Jan Fennis, dans son ouvrage intitulé Trésor du langage des galères (1995) rend compte de cette attribution par Jacques Humbert (La Galère du XVIIIè siècle) qui transmit le manuscrit au Commandant Fourquin?: «?Il nous paraît que cette uvre est celle d'un constructeur de galères travaillant à Marseille car il est question de l'arsenal de cette ville dans le texte. Il nous semble qu'on pourrait assez raisonnablement l'attribuer à Jean-Baptiste Chabert.?» Jean-Baptiste Chabert appartenait à une dynastie de constructeurs de galères marseillais dont le père construisait déjà des navires depuis le milieu du XVIIè siècle. Il fut notamment engagé dans la réalisation des galères présente dans l'hallucinante flottille du Grand Canal de Versailles qui furent réalisées à Marseille à partir de 1681. En 1682 il fut nommé professeur à l'école de construction de Marseille où étaient formés les officiers, lieutenants et sous-lieutenants des galères, avant d'obtenir en 1690 son brevet de premier maître constructeur des galères royales. Dans une lettre aux présidents de parlements datée du 11 avril 1662, Colbert annonce?: «?Le Roi m'a commandé de vous écrire ces lignes de sa part pour vous dire que, Sa Majesté désirant rétablir le corps des galères et en fortifier la chiourme par toutes sortes de moyens, est que vous teniez la main à ce que votre compagnie y condamne le plus grand nombre de coupables qu'il se pourra et que l'on convertisse même la peine de mort en celle des galères.?» Cette lettre permet de dater précisément autour de 1672-1674 notre manuscrit dans lequel l'auteur s'exprime dès les premières pages sur la «?nationalisation?» des galères?: «?Il faut savoir que le roi a l'économie de ses galères depuis dix à douze ans, les capitaines étant auparavant propriétaires du corps et agrès des galères.?» Cette datation peut également être confortée par le manuscrit du Commandant Noël Fourquin?: en marge de ce même passage concernant Louis XIV est indiquée la mention «?1672-74?». Il est ensuite immédiatement question de «?Monsieur [Nicolas] Arnoul intendant des galères de France?»?: «?Du depuis, Monsieur Arnoul [...] a fait construire à Marseille un arsenal très magnifique, dans lequel il y a toute sorte de manufactures pour fournir les choses nécessaires pour armer les galères.?» Le chantier de l'arsenal de Marseille s'étendit, en trois phases, de 1665 à 1690, mais Arnoul décéda en 1674. Chabert démarre son manuscrit en énonçant les différents types de galères?: ordinaire, Patronne, Capitane et Realle. Ces vaisseaux sont caractérisés par leurs tailles ,mais l'architecte ne s'attarde pas outre mesure sur ce sujet, témoignant de la culture du secret attachée au monde des constructeurs à cette époque. Chabert fait ensuite un bref point sur la situation des galères, le re


Phone number : 01 56 08 08 85
Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant de Jean-Baptiste Descamps (1769) Edition presentee et annotee par Gaetane Maes
, Brepols - Harvey Miller, 2018 Paperback 492 pages., 200 b/w ill. + 30 colour ill., 216 x 280 mm, Languages: French, Dutch, English. ISBN 9782503577036.
Cette edition du 'Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant' (1769) de Jean-Baptiste Descamps permet non seulement de comprendre l?importance de l'ouvrage dans l?emergence du tourisme d?art, mais elle est aussi la premiere a fournir la localisation actuelle des oeuvres commandees par les eglises aux anciens maitres flamands. En publiant le 'Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant' a Paris en 1769, Jean-Baptiste Descamps (1715-1791) a fait connaitre au public europeen les richesses artistiques conservees dans les eglises des Pays-Bas du Sud (actuelle Belgique). Alors qu?il etait d?usage de se rendre en Italie depuis la Renaissance, son livre etait le premier a imposer une autre destination culturelle aux amateurs d?art. A ce titre, il a connu un succes considerable, ne s?eteignant qu?a l?epoque napoleonienne en raison du nombre important d?oeuvres disparues ou deplacees. A cet egard, l?ouvrage de Descamps conserve une importance unique, car il fournit un etat des lieux du patrimoine visible dans la Flandre et le Brabant jusqu?au XVIIIe siecle, avant les trois evenements qui le bouleverserent a jamais. Il y eut, d?abord, les edits autrichiens supprimant l?ordre des Jesuites en 1773, puis les couvents en 1783, qui aboutirent tous deux a des ventes massives d?oeuvres d?art ; il y eut, ensuite, les saisies effectuees par les troupes francaises de la Republique en 1794. Par ces depouillements successifs, le guide ecrit par Descamps pour une banale vocation touristique est devenu un document irremplacable que l?edition critique vise a actualiser et a enrichir. Celle-ci donne, en effet, les moyens de visualiser cet etat originel du patrimoine belge decrit par l?auteur grace aux nombreuses illustrations et aux notes fournissant les localisations actuelles des oeuvres. Un index complete ces elements en repertoriant la production personnelle des artistes cites par Descamps afin de contribuer a une meilleure connaissance de chacun d?entre eux. Gaetane Maes est Maitre de conferences habilitee a diriger des recherches, et elle enseigne l?Histoire de l?Art des Temps modernes a l?universite de Lille. Specialiste des echanges artistiques entre la France et les anciens Pays-Bas (Flandre et Hollande), elle a notamment publie 'De l?expertise a la vulgarisation au siecle des Lumieres. Jean-Baptiste Descamps (1715-1791) et la peinture flamande, hollandaise et allemande' (Brepols, 2016). Elle est egalement l?auteur de nombreux articles sur l?historiographie des peintres et les fonctions sociales de l?art aux XVIIe et XVIIIe siecles.
Divers habillements suivant le costume d’Italie dessinés d’après nature par Jean-Baptiste Greuze peintre du roi ornés de fonds par J.B. Lallemand... Les tableaux savoyards et italiens de Jean-Baptiste Greuze en tout premier tirage.
Édition originale de l’un des plus beaux et des plus rares livres illustrés français du XVIIIe siècle orné d’un frontispice et 24 planches gravées à l’eau-forte. Paris, chez l’Auteur, 1768. In-folio de (1) f. de titre gravé dans un encadrement d’architecture et de paysage et 24 planches numérotées. Demi-veau à coins, plats cartonnés ornés d’un élégant papier vert, rouge et blanc. Reliure du début du XIXe siècle. 345 x 270 mm.
Edition originale de l’un des plus beaux et des plus rares livres illustrés français du XVIIIe siècle orné d’un frontispice et 24 planches gravées à l’eau-forte. Brunet, II, 1736 ; Colas 1317 ; Cohen 463 ; Lipperheide 1253 ; Vinet 2284 ; Sander 864. Le frontispice est de J.B. Lallemand ; 21 planches sont gravées par Angélique et P.E. Moitte d’après Jean-Baptiste Greuze, la onzième et la vingt-troisième sont de Barbault et une de Vleghels. Ces compositions représentent de jeunes femmes savoyardes ou italiennes, paysannes, bourgeoises ou nobles, dans leurs costumes caractéristiques et placées dans des sites ou des paysages évoquant leur origine. Une légende en italien ou en français complète chaque planche. « Ces dessins de Greuze ont été exécutés pendant le voyage fait par cet artiste en Italie en compagnie de l’abbé Gougenot, conseiller du Grand Conseil et qui avait emmené Greuze en Italie à ses frais. Les dessins de cette suite appartenaient lorsqu’ils ont été gravés par P.E. Moitte et F.A. Moitte à l’abbé Gougenot. » (Bulletin Morgand et Fatout, 10343). Greuze qui tirait d’abondants profits de la reproduction de ses œuvres, surveillait attentivement la gravure de celles-ci ; le rendu, remarquable, des compositions tient sans doute à cette exigence. Epreuves brillantes, imprimées sur papier vergé fort. Jean-Baptiste Greuze n’a publié que deux livres, Le recueil de Têtes de différents caractères, dont on ne connait qu’un seul exemplaire complet, et celui-ci, d’une grande rareté également, le format des estampes ayant, depuis plus de deux siècles, incité les marchands d’estampes à casser le volume et à vendre les planches à l’unité. Bel exemplaire de l’un des plus rares livres illustrés français du XVIIIe siècle.
EYRIES JEAN-BAPTISTE (1767-1846). ROUX DE ROCHELLE JEAN-BAPTISTE (1762-1849).
Reference : 1172
DANEMARK. VILLES ANSEATIQUES.
PARIS. FIRMIN-DIDOT FRERES, EDITEURS.(DE LA COLLECTION "L'UNIVERS. HISTOIRE ET DESCRIPTION DE TOUS LES PEUPLES") 1846 ET 1844. 2 OUVRAGES EN UN VOLUME IN-8 (13,5 X 21,5 X 5 CENTIMETRES ENVIRON) DE (4) + 416 ET 398 + (4) PAGES , RELIURE D'EPOQUE 1/2 VEAU HAVANE, DOS LISSE ORNE D'UN DECOR ROMANTIQUE DORE, TITRE DORE AVEC INDICATION DE TOMAISON «10», TRANCHES MARBREES. TEXTE IMPRIME SUR 2 COLONNES. ILLUSTRE DE 24 PLANCHES HORS TEXTE POUR LE DANEMARK ET DE 15/24 PLANCHES HORS TEXTE POUR LES VILLES ANSEATIQUES.
PETITS DEFAUTS EXTERIEURS, PETITES TRACES DE FROTTEMENTS, TITRE EN PARTIE DEDORE, SINON BON EXEMPLAIRE.
Description du royaume de France contenant ses principales divisions géographiques dressées pour la grande carte intitulée Le Royaume de France avec ses acquisitions &c. par Jean Baptiste Nolin. Avec une table alphabétique de tous les noms qui sont sur cette carte pour les trouver aisément par le Sieur Tillemon.
A Paris, Robert Pepie et Jean-Baptiste Nolin, 1693. In-12 de 1 titre-frontispice gravé et (16)-393 pp. mal chiffrées 379-(4) pp., veau brun granité, dos à nerfs fleurdelisé, tranches jaspées (reliure de l'époque).
Édition originale rare établie par Jean-Baptiste Nolin (1657-1708), géographe ordinaire du Roi, graveur, éditeur d'estampes.En 1686, le père Vincenzo Coronelli passa avec lui marché pour son globe céleste et 28 cartes de géographie - en collaboration pour la table avec le géographe et cartographe avec Jean-Nicolas de Tralage (1640-1720) sous le pseudonyme de TillemonMors très légèrement fendus en tête. Titre-frontispice Divisions de la France.Provenance : Exemplaire de l'auteur Jean-Nicolas de Tralage (ex-libris), neveu du lieutenant général de police La Reynie, qui légua sa collection en 1699 à l'abbaye de Saint-Victor.
[LYONNAIS] Le gouvernement général et militaire du Lyonnois comprenant les provinces du Lyonnois, du Forez, et du Beaujolois.
Paris, Mondhare et Jean, [circa 1780]. En deux feuilles pouvant être jointes pour former une carte de 779 x 616 mm ; repliée sous couverture cartonnée recouverte de papier bleu de l'époque (199 x 128mm) ; étiquette sur le premier plat portant le titre manuscrit à l'encre.
Belle et rare carte du Lyonnais, dressée en 1697 par Jean-Baptiste Nolin, et publiée à Paris par Louis Joseph Mondhare et Pierre Jean vers 1780. Le gouvernement général et militaire du Lyonnois comprenait les provinces du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais. Sous l'Ancien Régime, les gouvernements militaires étaient des circonscriptions administratives correspondant aux anciennes provinces du royaume. Les gouverneurs étaient nommés par le roi. Jusqu'au XVIe siècle, la France en comptait 12. En 1776, elle en comptait 39, dont dix-huit de la première classe (les titulaires percevaient 60 000 livres par an), et vingt-et-un de la seconde classe (30 000 livres par an). Le gouvernement général et militaire du Lyonnais appartenait à la première classe. Son chef-lieu était Lyon. La carte montre également une partie du gouvernement général de Bourgogne, comprenant le bailliage de Mâcon, le Comté de Charolais et une grande partie de la Bresse, la Principauté et Souveraineté de Dombes divisée en ses châtellenies, et la généralité de Lyon comprenant les élections de Saint-Étienne, Montbrison, Roanne et Villefranche ou Villefranche-sur-Saône. Sous l'Ancien Régime, les généralités étaient des circonscriptions administratives, formées de plusieurs élections ou juridictions de l'impôt. Elles étaient au nombre de treize : Paris, Amiens, Soissons, Champagne, Orléans, Bourges, Moulins, Poitiers, Tours, Limoges, La Rochelle, Dijon et Lyon. La carte s'étend au nord jusqu'à Saint-Gengoux (Saône-et-Loire), au sud jusqu'à Saint Siphorien ou Saint-Symphorien-de-Mahun (Ardèche), à l'ouest jusqu'à Pierrefitte ou Pierrefitte-sur-Loire (Allier) et Arlenc ou Arlanc (Puy-de-Dôme), et à l'est jusqu'à Colonia Coligny, actuelle commune de Coligny (Ain), Ambournay ou Ambronay (Ain), et Saint Rambert ou Saint-Rambert-d'Albon (Drôme). Le sommet du Pilat est nommé Le Mont Pila. Elle a été dressée d'après les mémoires de Claude-François Ménestrier, prêtre jésuite né à Lyon en 1631, auteur d'une Histoire civile ou consulaire de la ville de Lyon, publiée en 1696. Elle est dédiée au prévôt des marchands (équivalent du maire de Paris aujourd'hui) et aux échevins (assesseurs du prévôt) de la ville de Lyon. En 1697, année de la première édition de cette carte, le prévôt des marchands de Lyon était Louis Dugas, ses quatre échevins étaient Gabriel de Glatigny, Jacques Collabaud, Antoine Constans et David Olivier. La carte est décorée d'un grand et magnifique cartouche de titre orné en tête des armoiries de Lyon, des armoiries des dédicataires, de deux angelots, et de cinq figures allégoriques, dont deux symbolisent les fleuves Saône et Rhône. En haut à gauche figure une carte du Gouvernement général du Lyonnois suivant les Estats Généraux tenus à Paris en l'année 1614. En bas à gauche figurent l'échelle et la légende des signes conventionnels, ainsi qu'une note sur la rivière Furan dans le Forez : La petite rivière de Furand dans le Forez, est considérable pour les 117 moulins ou artifices qui sont dessus ; ils servent à fabriquer des armes, à faire du papier, à dévider les soyes, et à scier des planches de sapin, etc. L'on n'a pu marquer sur la carte que quelques uns de ces moulins. Cartographe, graveur, éditeur et marchand de cartes, Jean-Baptiste Nolin (1657-1708) fut nommé, en 1694, géographe auprès de Philippe II puis, en 1701, graveur du roi Louis XIV, pour lequel il réalisa plusieurs plans du château de Versailles. Il lança ensuite une maison d'édition familiale rue Saint-Jacques à Paris. En 1700, il devint célèbre en publiant une mappemonde intitulée Le globe terrestre représenté en deux plans-hémisphères. Ce chef-d’œuvre de la cartographie française est considéré comme l'une des plus belles mappemondes murales de tous les temps. À sa mort en 1708, son fils, également nommé Jean-Baptiste (1686-1762), lui succéda. Très rare édition publiée par Mondhare et Jean, dont nous n'avons trouvé aucune trace dans les collections publiques. Présentation peu commune pour cette carte, repliée et placée dans une couverture cartonnée recouverte de papier bleu de l'époque. Bel exemplaire, contours aquarellés à l'époque. Rousseurs à deux pliures de la première feuille.
![[LYONNAIS] Le gouvernement général et militaire du Lyonnois comprenant les provinces du Lyonnois, du Forez, et du Beaujolois.. NOLIN (Jean-Baptiste).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8422_1_thumb.jpg)
![[LYONNAIS] Le gouvernement général et militaire du Lyonnois comprenant les provinces du Lyonnois, du Forez, et du Beaujolois.. NOLIN (Jean-Baptiste).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8422_2_thumb.jpg)
![[LYONNAIS] Le gouvernement général et militaire du Lyonnois comprenant les provinces du Lyonnois, du Forez, et du Beaujolois.. NOLIN (Jean-Baptiste).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8422_3_thumb.jpg)
[GUYENNE & GASCOGNE] Le gouvernement général de Guienne et Gascogne dédié à Sa Majesté, divisé en deux lieutenances générales de Haute et Basse Guienne et en une lieutenance de roy particulier.
Paris, Mondhare et Jean, 1787. 462 x 618 mm ; repliée sous couverture cartonnée recouverte de papier bleu de l'époque (200 x 128mm) ; étiquette sur le premier plat portant le titre manuscrit à l'encre.
Belle et rare carte des provinces de la Guyenne et de la Gascogne, dressée par Jean-Baptiste Nolin en 1700, et publiée à Paris par Louis Joseph Mondhare et Pierre Jean en 1787. Elle a été dressée d'après les mémoires de Jean Nicolas du Tralage, dit le Sieur Tillemont, géographe, cartographe et historien, et neveu du lieutenant général de police La Reynie. La Guyenne est divisée en deux lieutenances générales de Haute Guyenne et Basse Guyenne, et une lieutenance de roy particulière. Ces lieutenances formaient le gouvernement général de Guyenne et de Gascogne. Sous l'Ancien Régime, les gouvernements généraux étaient des circonscriptions administratives correspondant aux anciennes provinces du royaume. Les gouverneurs étaient nommés par le roi. Jusqu'au XVIe siècle, la France en comptait 12. En 1776, elle en comptait 39, dont dix-huit de la première classe (les titulaires percevaient 60 000 livres par an), et vingt-et-un de la seconde classe (30 000 livres par an). Le gouvernement général de Guyenne et Gascogne appartenait à la première classe, et son chef-lieu était Bordeaux. Les lieutenances générales étaient quant à elles des circonscriptions dirigées par des lieutenants généraux, chargés de représenter le roi dans les provinces du royaume. La lieutenance de Haute Guyenne couvrait l'Armagnac, la Bigorre, le Rouergue et le Quercy, celle de Basse Guyenne, le Médoc, les Landes de Bordeaux, et le Périgord. Entre les deux se trouvait la lieutenance de roy particulière, qui couvrait le Condomois et l'Agenais. La carte s'étend au nord jusqu'à Saintes (Charente-Maritime) et Bourganeuf (Creuse), au sud jusqu'à la frontière avec l'Espagne, et à l'est jusqu'à Mende (Lozère) et Sette ou Sète (Hérault). Elle est décorée d'un beau cartouche de titre orné des blasons des quatorze provinces représentées, dont quatre ont été laissés vides (Bazadais, Agenais, Condomois et Soule). En bas à droite, un second cartouche contient l'échelle et la légende des signes conventionnels. Cartographe, graveur, éditeur et marchand de cartes, Jean-Baptiste Nolin (1657-1708) fut nommé, en 1694, géographe auprès de Philippe II puis, en 1701, graveur du roi Louis XIV, pour lequel il réalisa plusieurs plans du château de Versailles. Il lança ensuite une maison d'édition familiale rue Saint-Jacques à Paris. En 1700, il devint célèbre en publiant une mappemonde intitulée Le globe terrestre représenté en deux plans-hémisphères. Ce chef-d’œuvre de la cartographie française est considéré comme l'une des plus belles mappemondes murales de tous les temps. À sa mort en 1708, son fils, également nommé Jean-Baptiste (1686-1762), lui succéda. Très rare édition de 1787, dont nous n'avons trouvé qu'un seul exemplaire dans les collections publiques, à l'Universitätsbibliothek Bern. Présentation peu commune pour cette carte, repliée et placée dans une couverture cartonnée recouverte de papier bleu de l'époque. Bel exemplaire, contours aquarellés à l'époque. Cuzacq, Les grandes Landes de Gascogne, Études historiques et géographiques, 1893, p. 36, 5° (pour l'édition de 1700).
![[GUYENNE & GASCOGNE] Le gouvernement général de Guienne et Gascogne dédié à Sa Majesté, divisé en deux lieutenances générales de Haute et Basse ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8443_1_thumb.jpg)
![[GUYENNE & GASCOGNE] Le gouvernement général de Guienne et Gascogne dédié à Sa Majesté, divisé en deux lieutenances générales de Haute et Basse ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8443_2_thumb.jpg)
[ANJOU/GRENIERS à SEL] Gouvernement militaire de la province et Duché d'Anjou. Gouvernement du Saumurois - Direction d'Angers divisée en ses greniers à sel et dépôts, on y trouve aussy les bureaux pour les traites.
Paris, Mondhare et Jean. 1787 472 x 614 mm ; repliée sous couverture cartonnée recouverte de papier bleu de l'époque (200 x 127mm) ; étiquette sur le premier plat portant le titre manuscrit à l'encre.
Belle et rare carte de l'Anjou, dressée par Jean-Baptiste Nolin, gravée par Jean Emmanuel Jérôme Vallet, et publiée à Paris par Louis Joseph Mondhare et Pierre Jean en 1787. Il existe une édition datée de 1759, publiée par Longchamps. La province d'Anjou, divisée en Haut et Bas Anjou, comprenait les gouvernements militaires d'Anjou et du Saumurois. Sous l'Ancien Régime, les gouvernements militaires étaient des circonscriptions administratives correspondant aux anciennes provinces du royaume. Les gouverneurs étaient nommés par le roi. Jusqu'au XVIe siècle, la France en comptait 12. En 1776, elle en comptait 39, dont dix-huit de la première classe (les titulaires percevaient 60 000 livres par an), et vingt-et-un de la seconde classe (30 000 livres par an). Les gouvernements militaires d'Anjou (chef-lieu Angers) et du Saumurois (chef-lieu Saumur) appartenaient à la seconde classe. La carte représente également tous les greniers et dépôts de sel, ainsi que les directions des gabelles et des traites. La carte s'étend au nord jusqu'à Astillé (Mayenne), au sud jusqu'à Airvaut ou Airvault (Deux-Sèvres), à l'ouest jusqu'à Nantes (Loire-Atlantique), et à l'est jusqu'à Tours (Indre-et-Loire). Elle est décorée de deux beaux cartouches de titre. En haut à gauche figure la légende des signes conventionnels pour les universités, les directions des gabelles, les greniers à sel, les directions des traites, les dépôts de sel, ou encore les villes où l'on bat monnaye ; en bas à gauche, échelle en grandes lieues de France et lieues communes. Cartographe, graveur, éditeur et marchand de cartes, Jean-Baptiste Nolin (1657-1708) fut nommé, en 1694, géographe auprès de Philippe II puis, en 1701, graveur du roi Louis XIV, pour lequel il réalisa plusieurs plans du château de Versailles. Il lança ensuite une maison d'édition familiale rue Saint-Jacques à Paris. En 1700, il devint célèbre en publiant une mappemonde intitulée Le globe terrestre représenté en deux plans-hémisphères. Ce chef-d’œuvre de la cartographie française est considéré comme l'une des plus belles mappemondes murales de tous les temps. À sa mort en 1708, son fils, également nommé Jean-Baptiste (1686-1762), lui succéda. Très rare édition de 1787, dont nous n'avons trouvé qu'un seul exemplaire dans les collections publiques, à la Boston Public Library. La BnF et l'Universitätsbibliothek Bern conservent l'édition de 1759. Présentation peu commune pour cette carte, repliée et placée dans une couverture cartonnée recouverte de papier bleu de l'époque. Bel exemplaire, contours aquarellés à l'époque. Petite déchirure restaurée au centre de la carte. Mémoires de la Société Nationale d'Agriculture, Sciences & Arts d'Angers, Cinquième série, Tome XII, Année 1909, 1909, p. 299 (édition de 1759 publiée par Longchamps) ; Port, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, 1874, p. XXIV (édition de 1759 publiée par Longchamps).
![[ANJOU/GRENIERS à SEL] Gouvernement militaire de la province et Duché d'Anjou. Gouvernement du Saumurois - Direction d'Angers divisée en ses greniers ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8429_1_thumb.jpg)
![[ANJOU/GRENIERS à SEL] Gouvernement militaire de la province et Duché d'Anjou. Gouvernement du Saumurois - Direction d'Angers divisée en ses greniers ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8429_2_thumb.jpg)
Eyriès Jean-Baptiste Benoit (1767-1846) - Jean-Baptiste Benoit Eyriès (1767-1846) - Illustrations derouargue Frères - Louis-Hubert-Simon Deperthes (1730-1792)
Reference : 48123
(1870)
Histoire des naufrages, délaissements de matelots, hivernages, incendies de navires et autres désastres de mer, d'après M. Eyriès - nouvelle édition revue, augmentée et précédée d'une préface.
1870 Paris, Morizot - sans date vers 1870- Grand In-8 - Reliure polychrome rouge, Coins un peu émoussés - Dos à nerf à caissons ornés - Toutes tranches dorées. XII + 481 pages - Illustrations très fraîches de MM. Rouargue frères. Nouvelle édition revue, augmentée et précédée dune préface par Ernest Faye - Bel exemplaire - Réf. 48123
"Histoire des naufrages, ou Recueil des relations les plus intéressantes des naufrages, hivernemens, délaissemens, incidendies, et autres événemens funestes arrivés sur mer" de Jean-Louis-Hubert-Simon Deperthes (1730-1792) publié en 3 tomes en 1781, par l'auteur et éditeur scientifique Jean-Baptiste Benoit Eyriès (1767-1846). Une seconde édition parut Chez Née de la Rochelle en 1788-1789. Reprenant tout ou partie des 39 récits du texte original relatant de naufrages ayant marqué l'histoire maritime depuis le quinzième siècle, et complétée par des relations de naufrages récents, cette compilation, édulcorée et destinée aux familles, relate les périls des côtes africaines, asiatiques et américaines, et les naufrages au delà du cercle polaire, sur les côtes du Groenland, Spitzberg etc.
Histoire Pontificale ou plustost (plutot) demonstration de la vraye (vraie) Eglise, fondée par Iesus-Christ, & ses Apostres, contenante sommairement les faicts plus signalez aduenus en icelle, & les plus preignantes marques de la vraye Eglise, comme verrez en la page suivante. Deuat laquelle va l'adresse, qui monstre l'institution, auctorité, noms de l'Eglise, & plusieurs poincts fort utiles à ce mesme subiet (sujet)par F. Iean Baptiste de Glen, Doct. en Theologie & Prieur des Augustins Iez Liege. Avec les pourtraits naturels des Papes, taillez par Iean de Glen Liegeois.
A Liege, chez Arnoult Coersvvarem Imprim. iuré, demourat sur le marché, au Sampson, l'an 1600, 1 volume in-8 de 210x160x55 mm environ, 1f.blanc, 8ff. (titre, Extraict du Privilege, Epistre dédicatoire,Preface, Sonet), 889 pages, 21ff. (table), 1f.blanc, reliure pleine basane granitée brune, dos à 5 nerfs orné de caissons à motifs dorés (en partie effacés), tranches mouchetées de rouge. Ouvrage illustré de 236 portraits, 2 pages de titre à encadrement, 1 planche d'armoirie, des lettrines et culs-de-lampe. Des feuillets abimés sur la tranche supérieure et les premiers feuillets ainsi que la page de titre, avec légers manques de papier, sans atteinte au texte, cuir frotté avec manques sur les coiffes, les coupes et les coins, quelques erreurs de pagination (sans manque). Première traduction française de cet ouvrage donné en latin en 1597.
Jean-Baptiste de Glen (1552-1613), théologien flamand de l'ordre de Saint-Augustin. Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers![[ Lot de 3 documents manuscrits écrits ou signés par Jean-Baptiste Michel de Montaigne : ]Copie par Jean-Baptiste Michel de Montaigne d'une lettre ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CDL/68527_thumb.jpg)
![[ Lot de 3 documents manuscrits écrits ou signés par Jean-Baptiste Michel de Montaigne : ]Copie par Jean-Baptiste Michel de Montaigne d'une lettre ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CDL/68527_2_thumb.jpg)
![[ Lot de 3 documents manuscrits écrits ou signés par Jean-Baptiste Michel de Montaigne : ]Copie par Jean-Baptiste Michel de Montaigne d'une lettre ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CDL/68527_3_thumb.jpg)
![Atys, tragédie. [Copie manuscrite contemporaine / Contemporary handwritten copy].. LULLY (Jean-Baptiste).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TLS/5836_1_thumb.jpg)
![Atys, tragédie. [Copie manuscrite contemporaine / Contemporary handwritten copy].. LULLY (Jean-Baptiste).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TLS/5836_2_thumb.jpg)
![Atys, tragédie. [Copie manuscrite contemporaine / Contemporary handwritten copy].. LULLY (Jean-Baptiste).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TLS/5836_3_thumb.jpg)



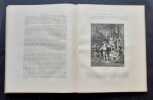
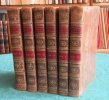


![« Reflexions dun Chevalier de Malte Religieux de l’ordre militaire des hospitaliers de Saint [Jean] de Jerusalem. Sur la grandeur et les devoirs de ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/OMB/3205_1_thumb.jpg)
![« Reflexions dun Chevalier de Malte Religieux de l’ordre militaire des hospitaliers de Saint [Jean] de Jerusalem. Sur la grandeur et les devoirs de ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/OMB/3205_2_thumb.jpg)
![« Reflexions dun Chevalier de Malte Religieux de l’ordre militaire des hospitaliers de Saint [Jean] de Jerusalem. Sur la grandeur et les devoirs de ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/OMB/3205_3_thumb.jpg)
![Catilina [a été relié à la suite :] Denis le Tyran [a été relié à la suite :] Lettre à Monsieur de *** sur la tragédie de Catilina [a été relié à la ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BLS/10810_1_thumb.jpg)
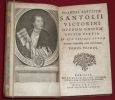


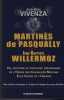






![[LYONNAIS] Le gouvernement général et militaire du Lyonnois comprenant les provinces du Lyonnois, du Forez, et du Beaujolois.. NOLIN (Jean-Baptiste).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8422_1.jpg)
![[GUYENNE & GASCOGNE] Le gouvernement général de Guienne et Gascogne dédié à Sa Majesté, divisé en deux lieutenances générales de Haute et Basse ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8443_1.jpg)
![[ANJOU/GRENIERS à SEL] Gouvernement militaire de la province et Duché d'Anjou. Gouvernement du Saumurois - Direction d'Angers divisée en ses greniers ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8429_1.jpg)