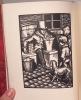VALLES (Jules), BARTHELEMY (Henri)
L'Enfant
Paris, chez A. & G. Mornay (coll. "Les beaux livres"), 1920. In-8, 439-VII pp., demi-maroquin rubis à coins, dos à nerfs mosaïqué, date en pied, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés (Lib. J. Platrier).
Reference : 14564
Un frontispice, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe sur bois par Henri Barthélemy. Un des 935 sur Rives. * Voir photographie(s) / See the picture(s). * Membre du SLAM et de la LILA / ILAB Member. La librairie est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 19h. Merci de nous prévenir avant de passer,certains de nos livres étant entreposés dans une réserve.
Bookseller's contact details
L'Ancienne Librairie
M. Alban Caussé
3 Rue Pierre l'Ermite
75018 Paris
France
librairie.ancienne.paris@gmail.com
09 78 81 38 22
Payment mode



Sale conditions
conforme aux règles du SLAM
5 book(s) with the same title
Mémoire de ce qu'il y a à faire pour être reçu dans la Maison royale de l'Enfant-Jésus. à Paris
S.l.n.d. (vers 1780) in-4, [2] ff. n. ch., en feuille.
Très rare. Les noms des administrateurs avaient été laissés en blanc, et ils ont été dans notre exemplaire renseignés à la plume : le nom du baron d'Ogny, intendant général des Postes (il fut nommé par Louis XVI le 25 janvier 1780 en survivance de son père) donne un terminus a quo.Suivi du Mémoire des titres qu'il est nécessaire de produire à Monsieur le Président d'Hozier, juge de la noblesse de France, pour les preuves de noblesse des demoiselles que l'on désire faire recevoir dnas la Maison royale de l'Enfant-Jésus.Fondée en 1724 par Languet de Gergy, alors curé de Saint-Sulpice, cette institution (appelée aussi Maison de l'Enfant Jésus, ou Hôpital de l'Enfant Jésus) était sise rue de Vaugirard, et accueillait des filles de la noblesse pouvant prouver au moins 200 ans de noblesse du côté paternel seulement, en sus de ses fonctions d'assistance proprement dites. C'est dans ses bâtiments que fut fondé en 1802 l'Hôpital des Enfants malades, premier site fondé en Europe pour l'hospitalisation des jeunes enfants, et qui fusionnera avec l'Hôpital Necker dans les années 1920.Aucun exemplaire au CCF. Absent de Saffroy. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT - LIEN DE PAIEMENT, NOUS CONSULTER.
La psychiatrie de l'enfant, Volume XXVI, n° 2, 1983,
Revue: "La psychiatrie de l'enfant", Volume XXVI, n° 2, 1983, PUF, p. 309-629, broché, dos et couverture en partie décolorés, état correct.
Contient: B. Cramer, F. Palacio, R. Dufour, P.-Y. Gottardi, D. Kanuer: Trente-six encoprétiques en thérapie; S. Pain: Le savoir de l'ignorance; M. Lefèvre, S. Lebovici, Ph. Jeammet: L'application de la nouvelle classification américaine dite DSM III à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent; J. Hochmann: Défense et illustration des techniques de maternage en psychaitrie de l'enfant; A. Restoin, D. Rodriguez, V. Ulmann, H. Montagner: Données nouvelles sur l'ontogénèse des séquences de comportement chez le jeune enfant; D. B. Kandel: Comportement des jeunes devant la drogue et l'alcool.
Phone number : 0033 (0)1 42 23 30 39
[PHILOSOPHIE SCIENCES HUMAINES] - ANTHONY / CHILAND / KOUPERNIK (E.-J. / C. / C. )
Reference : _202501145
(1980)
L'Enfant dans sa famille: L’enfant à haut risque psychiatrique.
Paris, Presses Universitaires de France, 1980 ; in-8 (132 x 221 mm), 552 pp., broché, couverture à rabats. Le fil rouge. Section 2: Psychanalyse et psychiatrie de l’enfant, dirigée par J. de AJURIAGUERRA, René DIATKINE, Serge LEBOVICI.
La psychanalyse de l'enfant n° 10: Les psychoses de l'enfant,
Editions de l'Association freudienne, La psychanalyse de l'enfant n° 10, 1991, 214 pp., broché, premier plat décoloré, bon état.
Phone number : 0033 (0)1 42 23 30 39
La Ville dont le prince est un enfant.
Bel envoi signé à Genevoix Paris, Gallimard, (octobre) 1967. 1 vol. (120 x 185 mm) de 282 p. et [3] f. Broché, sous jaquette illustrée. Édition définitive, remaniée. Envoi signé : «À Maurice Genevoix, Voici, mon cher ami, un 'climat' bien différent sans doute de celui dans lequel vous avez été élevé, mais vous êtes psychologue et il devrait vous intéresser, car il est vrai. Amicalement, Henry de Montherlant».
Pièce capitale du théâtre de Montherlant, La Ville dont le prince est un enfant condense, dans l'enceinte d'un collège religieux, les forces qui traversent toute son oeuvre : la fascination de l'enfance et des commencements, la jalousie comme clair-obscur du désir, l'emprise spirituelle et ses faux-semblants. Autour du surveillant général, l'abbé de Pradts, s'organise un huis clos, un « climat » dont parle l'auteur dans son envoi à Genevoix, mais qui n'est pas affaire de décor mais de vérité : celle d'un monde réglé où la morale sert de paravent à la domination. Dans une langue d'une netteté implacable, la version de 1967 - dite définitive - resserre encore la dramaturgie d'un système qui fabrique les fautes qu'il punit et va initier la rédaction des Garçons (1969), l'un des textes les plus tenaces sur l'autorité, l'innocence et la part d'ombre des institutions. Bel exemplaire, sous sa jaquette à parution, envoyé de l'académicien à son secrétaire perpétuel du quai de Conti.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers