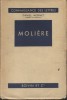MORNET Daniel
Molière.
Couverture souple. Broché. 11 x 17 cm. 200 pages.
Reference : 131029
Livre. Editions Boivin et Cie (Collection : Connaissance des lettres), 1950.
Bookseller's contact details
Librairie et Cætera
Mme Sophie ROSIERE
+33 (0) 5 56 88 08 45
Payment mode
Sale conditions
Envoi par la Poste à réception du paiement. Paiement par virement, chèque ou CB (Stripe) PAS DE PAIEMENT SUR LE SITE. Je vous enverrai les informations de paiement en validant votre commande. EXPEDITIONS du lundi au vendredi en courrier ordinaire ou suivi, sous étuis recyclables et/ou réutilisés. Les livres sont nettoyés, réparés si besoin, et couverts de papier cristal. FRAIS D'EXPEDITION : Pour un livre standard (moins de 500g): FRANCE : de 4,50 à 6,70€ en courrier suivi. Vers l'étranger, Jusqu'en juillet prochain, les frais de port indiqués sont en courrier ordinaire SANS SUIVI. Envoi suivi sur demande. EUROPE : 1 à 1,50€ au tarif économique livres et brochures AUTRES PAYS : 2 à 3€ au tarif économique livres et brochures. A compter de Juillet 2025, le tarif économique pour l'étranger n'existera plus. Tous les tarifs postaux sont consultables ici : http://www.librairie-et-caetera.fr/2021/01/tarifs-postaux-2021.html RETOUR : Conformément à la législation sur la vente à distance, vous disposez d'un droit de retour des ouvrages pendant 14 jours. Les frais de port restent à votre charge lorsqu'il s'agit d'une erreur de commande de votre part et à notre charge si le livre n'est pas conforme à notre description.
5 book(s) with the same title
Alain ABSIRE Baptiste ou la dernière saison roman sur molière
Les Editions de l'Homme 1990 1990. ouvrage broché 345 pages aux éditions Calmann Levy 1990; édition originale en TRES BON ETAT d'occasion; complet et solide sans déchirures ni annotations intérieur propre très peu de pliures sur la couverture; petites rousseurs sur la tranche inférieure des pages La gloire de Molière a fait de l'homme un personnage mythique offert à toutes les interprétations du farceur au héros romantique en passant par le libertin le courtisan ou le mari bafoué. Alain Absire nous restitue un nouveau Molière à ce moment de sa vie la dernière saison où parvenu au sommet de sa renommée il n'est occupé que de lui-même et de l'accomplissement de son destin.Premier roman français consacré au grand dramaturge cet ouvrage a su débarrasser son héros de la légende et nous donner un Molière homme de son temps et du nôtre
Très bon état
Rarissime recueil factice réunissant cinq pièces de Molière en reliure armoriée de l’époque dont deux éditions originales. L’un des seuls recueils de pièces de Molière - certaines en édition originale - conservé dans sa reliure armoriée de l’époque, vers 1666.
Paris, Guillaume de Luyne, Claude Barbin, Pierre Tribouillet, 1663, 1665 et 1666. In-12, plein veau brun granité, armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné, infimes restaurations, coupes décorées, tranches rouges. Reliure armoriée de l’époque. 140 x 82 mm.
« Après le succès des représentations de Molière, suivi de l’écoulement rapide dans le public des pièces imprimées séparément, il fallait s’attendre à ce qu’on vît publier, avec ou sans l’autorisation de l’auteur, un recueil général de ses comédies. Deux moyens s’offraient aux éditeurs. Le premier, le plus rationnel, était de constituer une édition collective autorisée ou non par Molière, édition à pagination continue, avec un faux-titre pour chaque pièce et un titre général pour l’ensemble. Au contraire, le deuxième procédé, beaucoup plus simple consistait à relier ensemble les pièces déjà imprimées et de faire précéder ou non le tout d’un titre général portant soit au verso, soit sur un feuillet séparé la liste des comédies contenues dans l’ouvrage. Bien entendu, il ne s’agissait plus dans ce cas de pagination suivie. Les pièces existaient déjà à leurs dates propres dans le recueil avec le nom de leurs imprimeurs » (A. J. Guibert. Molière CNRS - Premiers essais d’éditions collectives). Furent réunies et reliées à l’époque les cinq pièces suivantes : I- L’Escole des maris, Comédie, de I.-B. P. Molière représentée sur le Théâtre du Palais Royal. Paris, chez Guillaume de Luyne, 1663. In-12 de (5) ff. (frontispice, titre, épître, personnages), 65 pp. et (3) pp., (2) ff. bl. Seconde édition originale, reproduisant l’édition originale de 1661. Paul Lacroix la signale également sous la date de 1664 ; elle a été partagée entre les libraires concessionnaires du privilège de 1661. De toute rareté complète des deux derniers feuillets blancs en reliure armoriée de l’époque. II- Les Fascheux, Comédie de I.-B. P. Molière, représentée sur le Théâtre du Palais Royal. Paris, [Guillaume de Luyne], 1663. In-12 de 82 pp., (1) p., (1) p.bl. Rarissime édition grenobloise imprimée l’année d’après l’originale. III- L’Escole des femmes, Comédie. Par I.-B. P. Molière. Paris, Claude Barbin, 1665. In-12 de (6) ff. y compris une figure et 95 pp. Seconde édition, qui reproduit exactement l’édition originale. L’édition est ornée du précieux frontispice gravé par François Chauveau qui représente le plus ancien portrait de Molière. Elle peut être qualifiée de « seconde édition originale ». De toute rareté en reliure armoriée du temps. IV- La Critique de l’Escole des femmes, Comédie. Par I.-B. P. Molière. Paris, chez Claude Barbin, 1663. In-12 de (5) ff. (titre, épître, privilège et personnage), 117 pp. et (1) f.bl. Edition originale. Le privilège est daté du 10 juin 1663 et l’achevé d’imprimer du 7 août 1663. L’édition a été partagée entre Claude Barbin, Charles de Sercy, Thomas Joly, Guill. De Luyne, Louis Billaine, Et. Loyson, Jean Guignard et Gabriel Guinet. De toute rareté complète du dernier feuillet blanc conservé dans sa reliure armoriée de l’époque. V- L’Amour médecin. Comédie. Par I.-B. P. Molière. Paris, chez Pierre Trabouillet, 1666. Avec Privilège du Roy. In-12 de (6) ff. dont 1 frontispice gravé et 95 pp., la dernière chiffrée par erreur 59. Edition originale. Le privilège est daté du 30 décembre 1665 et l’achevé d’imprimer du 15 janvier 1666. L’édition a été partagée entre Pierre Trabouillet, Nicolas le Gras et Th. Girard. Ce type de recueil en reliure armoriée de l’époque est de la plus insigne rareté dans les bibliothèques de grands classiques du XVIIe siècle. La plupart des éditions originales ou rares des pièces de Molière ont été reliées par les grands maîtres du XIXe siècle. De très rares exemplaires en main privée sont à ce jour conservés dans leur reliure de l’époque non armoriée : vélin, veau ou maroquin. Ainsi Jacques Guérin possédait-il un seul exemplaire factice des Œuvres de Molière de 1673 relié en 8 volumes in-12, maroquin rouge non armorié de l’époque avec 7 pièces en édition originale, vendu 2 100 000 FF (320 000 €) il y a près de 30 ans, enchère considérable à l’époque. (Référence : Bibl. J. Guérin. Livres exceptionnels, Paris 29 novembre 1988, n° 23). Le présent exemplaire est l’un des seuls connu conservé dans sa reliure armoriée de l’époque attribuée à une demoiselle Cauchon dont la famille comptait au XVIIe siècle une abbesse.
Les Oeuvres de Monsieur de Molière
Chez Denys Thierry Claude Barbin Pierre Trabouillet | à Paris 1682 | 9 x 16.50 cm | 8 volumes reliés
Première édition illustrée et première édition collective complète, en partie originale et corrigée sur les manuscrits originaux. Édition originale pour les deux derniers volumes comprenant?: Dom Juan ou le Festin de Pierre, Dom Garcie de Navarre, LImpromptu de Versailles, Melicerte, Les Amans magnifiques, La Comtesse dEscarbagnas. Elle est illustrée de 30 figures gravées sur cuivre par Jean Sauvé daprès Pierre Brissart, dont 21 hors texte et 9 comprises dans la pagination. Reliures du XIXe en plein maroquin rouge, dos jansénistes à cinq nerfs, date dorée en queue, doubles filets dorés sur les coupes et les coiffes, large dentelle dorée en encadrement des contreplats et plats de papier à la cuve, toutes tranches dorées. Reliures signées M. Lortic. Réalisée par deux amis intimes de Molière, Vinot et Lagrange (le plus célèbre comédien et ami intime de Molière qui fut également le secrétaire de sa troupe, lIllustre-Théâtre), cette «?première édition complète des uvres de Molière [est composée à partir] du texte même des manuscrits de Molière, plus ou moins revu et corrigé par lui, soit pour les besoins des représentations, soit pour limpression. De sorte que le texte de 1682 diffère souvent un peu de celui des éditions originales séparées et de lédition collective de 1674.?» (J.Le Petit, Bibliographie des principales éditions originales). Cette édition demeure la plus célèbre édition complète des uvres de Molière et le modèle des éditions ultérieures. * Selon Anaïs Bazin, «?Cest dans la Préface de Lagrange et Vinot, placée en tête de la première édition des uvres complètes de Molière (1682)?; là et nulle part ailleurs que se trouvent encore aujourdhui les seuls renseignements certains que lon puisse accepter, les seuls peut-être, et cette conjecture est sérieuse, que Molière ait voulu laisser au public sur sa carrière de cinquante et un ans?!?» (Notes historiques sur la vie de Molière, Techener, 1851). Cette assertion, sans doute excessive, souligne cependant limportance unique de ce premier témoignage écrit par des amis intimes de notre plus grand dramaturge français. Mais celle-ci nous révèle également que les versions connues de lultime pièce et chef duvre de Molière, Le Malade imaginaire, imprimées après la mort de lauteur, étaient largement fautives. «?Cette comédie est corrigée, sur loriginal de lauteur, de toutes les fausses additions et suppositions de scènes entières faites dans les éditions précédentes. Et, pour fortifier cette déclaration, ils ont encore soin davertir, en tête de deux scènes du premier acte, que ces deux scènes et cet acte tout entier nétaient point de la plume de Molière dans les éditions précédentes, et quils les donnaient rétablis sur loriginal de lauteur.?» Dans sa bibliographie des uvres de Molière publiées au XVIIe siècle, Albert-Jean Guibert conclura?: «?Cette édition doit être considérée, à juste titre, comme la plus complète des éditions du XVIIe siècle. Les jeux de scène y sont introduits et, pour la première fois, chaque comédie est précédée dune gravure, particulièrement précieuse pour les attitudes et les costumes des personnages?» Superbe exemplaire de la fameuse édition de 1682 établi dans une très élégante reliure du XIXe signée de Marcelin Lortic, disciple et successeur de son père, le célèbre relieur de Baudelaire, Pierre-Marcellin Lortic. - Photographies et détails sur www.Edition-Originale.com -


Phone number : 01 56 08 08 85
[André, Barba, Alphonse Bérenguier, etc.] - BOUILLY, J*** N*** ; MOLIERE ; RACINE ; COLLIN D'HARLEVILLE ; DUVAL, Georges ; DESFORGES, Citoyen ; REGNARD ; BEAUMARCHAIS ; PIXERECOURT
Reference : 58860
(1799)
[ Recueil de 20 pièces de théâtre : ] L'Abbé de l'Epée, comédie historique en cinq actes et en prose, par J*** N***Bouilly, représentée pour la première fois, au Théâtre Français de la république, le 23 Frimaire an VIII [ Edition originale ] [ Suivi de : ] Le Chien de Montargis, ou La Forêt de Bondy, mélodrame historique en trois actes et à grand spectacle, par R. C. Guilbert de Pixérécourt, Représenté pour la première fois à Paris, sur le Théâtre de la Gaîté, le 18 juin 1814 [ Edition originale ] [ Suivi de : ] Le Bourgeois Gentilhomme, Comédie-Ballet en cinq actes et en prose, par Molière [ Suivi de : ] Le Tartuffe, Comédie en cinq actes et en vers par M. Molière [ Suivi de : ] Le Joueur, Comédie en cinq actes et en vers par M. Regnard, [ Suivi de : ] L'Ecole des Femmes, Comédie en cinq actes et en vers, par Molière, [ Suivi de : ] Les Châteaux en Espagne, Comédie en cinq actes, en vers, par M. Collin d'Harleville [ Suivi de : ] Le Barbier de Séville, ou la Précaution inutile, Comédie en quatre actes et en prose, par Beaumarchais [ Suivi de : ] Le Sourd, ou l'Auberge pleine, Comédie en trois actes et en prose, par le Citoyen Desforges, Chez Deperne, A Paris et se trouve à Lille, 1795, 40 pp. [ Suivi de : ] Les Fourberies de Scapin, Comédie en trois actes et en prose, par Molière [ Suivi de : ] L'Avare, Comédie en cinq actes et en prose de M. de Molière [ Suivi de : ] Les Folies Amoureuses, Comédie en trois actes et en vers de Regnard [ Suivi de : ] Les Plaideurs, Comédie en trois actes et en vers, de Racine [ Suivi de : ] L'Avocat Patelin, Comédie en trois actes et en prose, de Brueys et Palaprat [ Suivi de : ] Le Dépit Amoureux, Comédie en cinq actes et en vers de Molière, retouchée & mise en deux Actes, par M. Valville, Comédien Français [ Suivi de : ] Monsieur de Crac dans son Petit Castel, ou les Gascons, Comédie en un Acte et en vers, avec un divertissement, par J.-F. Collin-Harleville [ Suivi de : ] Une Journée à Versailles, ou le Discret malgré lui, Comédie en trois actes et en prose, de M. Georges Duval, Représentée pour la première fois sur le théâtre de l'Odéon le 20 décembre 1814 [ Edition originale ] [ Suivi de : ] Crispin, rival de son maître, Comédie en un acte et en prose, de Le Sage [ Suivi de : ] Dupuis et Desronais, Comédie en trois actes et en vers libres, de Collé, Représentée par les Comédiens Français ordinaires du Roi, en 1763 [ Suivi de : ] Défiance et Malice, ou Le Prêté Rendu, Comédie en un acte et en vers, Représenté pour la première fois sur le Théâtre Français de la République, le 17 fructidor an IX [ Edition originale ]
[ Recueil de pièces de théâtre : ] L'Abbé de l'Epée, comédie historique en cinq actes et en prose, par J*** N***Bouilly, représentée pour la première fois, au Théâtre Français de la République, le 23 Frimaire an VIII Chez André, Imprimeur-Libraire, et Palais-Egalité, An Huitième, Paris, XV-86 pp. [ Edition originale ] [ Suivi de : ] Le Chien de Montargis, ou La Forêt de Bondy, mélodrame historique en trois actes et à grand spectacle, par R. C. Guilbert de Pixérécourt, Représenté pour la première fois à Paris, sur le Théâtre de la Gaîté, le 18 juin 1814, Chez Barba, Paris, 1814, 64 pp. [ Edition originale ] [ Suivi de : ] Le Bourgeois Gentilhomme, Comédie-Ballet en cinq actes et en prose, par Molière, Nouvelle édition, Chez Alphonse Bérenguier, A Avignon, An Neuvième, 76 pp. [ Suivi de : ] Le Tartuffe, Comédie en cinq actes et en vers par M. Molière, Nouvelle édition, Chez Fages, Meilhac et Compagnie, A Toulouse, 1802 An XI, 64 pp. [ Suivi de : ] Le Joueur, Comédie en cinq actes et en vers par M. Regnard, Nouvelle édition, Chez Broulhiet, Toulouse, 1787, 47 pp. [ Suivi de : ] L'Ecole des Femmes, Comédie en cinq actes et en vers, par Molière, Nouvelle édition, Chez Alphonse Bérenguier, A Avignon, An Huitième, 56 pp. [ Suivi de : ] Les Châteaux en Espagne, Comédie en cinq actes, en vers, par M. Collin d'Harleville, Chez les Libraires du Théâtre Français, Paris, 1820, 53 pp. [ Suivi de : ] Le Barbier de Séville, ou la Précaution inutile, Comédie en quatre actes et en prose, par Beaumarchais, Nouvelle édition, Chez Alphonse Berenguier, A Avignon, 1810, 44 pp. [ Suivi de : ] Le Sourd, ou l'Auberge pleine, Comédie en trois actes et en prose, par le Citoyen Desforges, Chez Deperne, A Paris et se trouve à Lille, 1795, 40 pp. [ Suivi de : ] Les Fourberies de Scapin, Comédie en trois actes et en prose, par Molière, Nouvelle édition, Chez Alphonse Bérenguier, A Avignon, An Huitième, 52 pp. [ Suivi de : ] L'Avare, Comédie en cinq actes et en prose de M. de Molière, Nouvelle édition, Chez Broulhiet, Toulouse, 1792, 64 pp. [ Suivi de : ] Les Folies Amoureuses, Comédie en trois actes et en vers de Regnard, Nouvelle édition, Au Magasin Général des Pièces de Théâtre, Chez J. B. Broulhiet, A Paris et se trouve à Toulouse, 1788, 43 pp. [ Suivi de : ] Les Plaideurs, Comédie en trois actes et en vers, de Racine, Nouvelle édition, Chez Delalain, Paris, 1786, 44 pp. [ Suivi de : ] L'Avocat Patelin, Comédie en trois actes et en prose, de Brueys et Palaprat, Nouvelle édition, Chez Broulhiet, Toulouse, 1783, 38 pp. et 1 f. n. ch. [ Suivi de : ] Le Dépit Amoureux, Comédie en cinq actes et en vers de Molière, retouchée & mise en deux Actes, par M. Valville, Comédien Français, Chez Delalain, Paris, 1787, 28 pp. [ Suivi de : ] Monsieur de Crac dans son Petit Castel, ou les Gascons, Comédie en un Acte et en vers, avec un divertissement, par J.-F. Collin-Harleville, Représentée pour la première fois par les Comédiens Français le 4 mars 1791, et remise depuis au Théâtr de la rue Feydeau, Chez Barba, Paris, L'an Sixième, 36 pp. [ Suivi de : ] Une Journée à Versailles, ou le Discret malgré lui, Comédie en trois actes et en prose, de M. Georges Duval, Représentée pour la première fois sur le théâtre de l'Odéon le 20 décembre 1814, Chez Barba, Paris, 1815, 63 pp. [ Edition originale ] [ Suivi de : ] Crispin, rival de son maître, Comédie en un acte et en prose, de Le Sage, Nouvelle Edition, Chez J. B. Brouilhet, Toulouse, 1785, 36 pp. [ Suivi de : ] Dupuis et Desronais, Comédie en trois actes et en vers libres, de Collé, Représentée par les Comédiens Français ordinaires du Roi, en 1763, Chez N. B. Duchesne, Paris, 1789, 44 pp. [ Suivi de : ] Défiance et Malice, ou Le Prêté Rendu, Comédie en un acte et en vers, Par Michel Dieulafoi, Représenté pour la première fois sur le Théâtre Français de la République, le 17 fructidor an IX, Chez Barba, Paris, An X, 1801, 27 pp. [ Edition originale ]
Intéressant recueil, proposant notamment 4 pièces en édition originale, dont un rare exemplaire de la pièce de Bouilly consacrée à l'Abbé de l'Epée, rédigée dix ans seulement après la mort de l'abbé Charles-Michel de l'Epée. On y remarquera une autre pièce évoquant le thème de la surdité : "Le Sourd ou l'Auberge pleine" de Desforges. Etat satisfaisant (reliure frottée avec petits mq., sans la première garde volante, premier feuillet faible).
OEUVRES COMPLETES DE MOLIERE.
Paris, Imprimerie Nationale, édition Richelieu, 1947, complet en 11 volumes, petits in-8 brochés, environ 400 pp par volume, avec quelques illustrations, des bandeaux et des culs-de-lampe, couvertures rempliées. Tirage limité, celui-ci un des 3500 exemplaires numérotés sur Alfa ivoire. TITRES: I. Avant-propos de René Groos. Molière, par Gustave Michaut : La vie - L'homme - Sa pensée - Ses idées littéraires - Les précurseurs & l'originalité de Molière - Avertissement - Bibliographie - Iconographie. L'estourdy ou Les contre-temps. Appendice: Le dépit amoureux en deux actes, adaptation de Valville ; II. Les Précieuses ridicules. Dom Garcie de Navarre ou Le Prince jaloux. L'escole des maris. Documents contemporains: Récit en prose & en vers de la farce des Précieuses, par Mlle des Jardins - Commentaire de Sganarelle, par Neuf-Villenaine ; III. Les facheux. L'escole des femmes. La critique de l'escole des femmes. Documents contemporains: La précaution inutile, par Scarron - Zélinde, ou le véritable critique de l'école des femmes, par Donneau de Visé - Le portrait du peintre, par Boursault ; IV. L'impromptu de Versailles. Le mariage forcé. La Princesse d'Élide. Le Tartuffe ou L'imposteur. Documents contemporains: La vengeance des marquis, par Donneau de Visé - Lettre sur les affaires du théâtre, par Donneau de Visé - Panégyrique de L'école des femmes, par Robinet - L'impromptu de l'Hôtel de Condé, par A.-J. Monfleury - Les amours de Calotin, par Chevalier - La guerre comique, par Philippe de La Croix - Lettre sur la comédie de L'imposteur ; V. Dom Juan ou Le festin de Pierre. L'amour médecin. Le Misantrope. Documents contemporains: Observations sur une comédie de Molière intitulée Le festin de Pierre - Responses aux observations touchant Le festin de Pierre de monsieur de Molière - Lettre sur les observations d'une comédie du sieur Molière intitulée Le festin de Pierre ; VI. Le médecin malgré-luy. Mélicerte. Pastorale comique. Le Sicilien ou L'Amour peintre. Amphytrion ; VII. George Dandin ou Le mary confondu. Le grand divertissement royal de Versailles. L'Avare. Monsieur de Pourceaugnac ; VIII. Les amants magnifiques. Le Bourgeois gentilhomme. Psiché ; IX. Les fourberies de Scapin. La comtesse d'Escarbagnas. Les femmes savantes. Documents contemporains: La soeur, par Rotrou - Le pédant joué, par Cyrano de Bergerac - La comédie des Académistes, par Saint-Évremond - L'Académie des femmes, par S. Chappuzeau ; X. Le Malade imaginaire. Poésies: Remerciement au Roy - La gloire du Val-de-Grace. Poésies diverses: A Monsieur de La Mothe le Vayer sur la mort de Monsieur son fils - Quatrains - Sonnet au Roy, sur la conqueste de la Franche-Comté - Bouts-rimez commandez sur le Bel-air. Oeuvres attribuées à Molière: Farces: La jalousie du barbouillé - Le médecin volant. Poésies: Couplet - Les maris - Les Bohémiennes. Documents biographiques contemporains: Nouvelles Nouvelles, par Donneau de Visé - Zélinde, par Donneau de Visé - Elomire hypocondre ou les Médecins vengez, par Le Boulanger de Chalyssay - Préface de La Grange & Vivot ; XI. Notes et Variantes (des 10 tomes). La langue de Molière, par Georges Matoré: Introduction à la stylistique de Molière - Bibliographie de la langue de Molière - Index grammatical - Lexique. Addenda à la Bibliographie. Table alphabétique des Œuvres de Molière. PHOTOS SUR DEMANDE. PHOTOS AVAILABLE. Couvertures en bon état, intérieurs en très bon état.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers