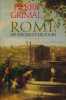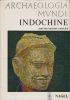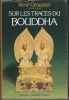Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (9)
19th (218)
20th (1942)
21st (182)
-
Syndicate
ILAB (2356)
SLAM (2356)
Masques Dogons.
P., Institut d'Ethnologie, 1938, fort gr. in-8°, xi-896 pp, 261 figures, certaines en couleur, 32 pl. de photos hors texte, représentant des Dogons, leur architecture et leurs habitations, des scènes de rituels funéraires, de préparation des masques et des costumes de danse, et des masques, une carte, tables et biblio, cartonnage à la bradel en toile verte de l'éditeur, dos lisse, bon état. Edition originale (Travaux et mémoires de l'Institut d'Ethnologie, XXXIII)
Edition originale de cet ouvrage qui expose les documents relatifs aux masques des Dogons, recueillis au cours de missions ethnographiques effectuées dans les Falaises de Bandiagara au Mali (entre 1931 et 1937) par l'ethnologue français Marcel Griaule (1898-1956). Cette véritable monographie dévoile un important corpus de mythes et propose un inventaire quasi exhaustif des masques dogons. Contient notamment un tableau des danses masquées (pp. 712-715), une description de celles-ci (pp. 716-739) et un lexique de la langue du Sigui (cérémonie qui a lieu tous les soixante ans et qui commémore la révélation de la parole orale aux hommes, ainsi que la mort et les funérailles du premier ancêtre). Tables et bibliographie. Bien complet du disque encarté à la fin du volume, qui reproduit les rythmes musicaux des danses Kagandige et Gona du masque Kanaga. Ouvrage important pour la connaissance des rites et du rôle des masques dans cette société africaine.
Rome. Les siècles et les jours.
Arthaud, 1982, gr. in-8°, 245 pp, 16 pl. de gravures et photos hors texte, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
Pierre Grimal (1912-1996), latiniste, archéologue, historien de Rome, nous livre, dans ce texte merveilleux, dense et subtil, sa vision passionnée et passionnante de Rome, oeuvre d'un humaniste dont le rêve se nourrit au contact de la réalité. Arriver à Rome, Les chemins de l'histoire, Nourritures romaines, Rome crucifiée, Les ombres du Trastevere, Rome des jardins, des palais et des églises, Rome et le Sacré... — "Rome est une ville inépuisable et qui n'abandonne plus ceux qui ont succombé à son charme. Pierre Grimal est de ceux-là. Il évoque ses premiers contacts avec la Ville éternelle, décrit ses divers quartiers, ses jardins, ses palais, déployant une rare érudition à l'endroit du passé de la ville et de ses monuments. Ce n'est pas à proprement parler un guide de tourisme. Mais c'est un compagnon de voyage à consulter." (Lectures n° 14, juillet-août 1983)
La Presse française de Turquie de 1795 à nos jours. Histoire et catalogue.
Istanbul, Editions Isis, 1985, gr. in-8°, xvi-261 pp, 24 reproductions de journaux à pleine page, broché, bon état (Varia Turcica II)
"Comme pour celle de la photographie, du télégraphe ou du chemin de fer, les Turcs doivent aux Français l’introduction de la presse dans leur pays. C’est pourquoi l’on ne s’étonnera pas que les premiers journaux furent d’abord des journaux écrits en français, avant d’être bilingues et qu’enfin apparaisse une presse turque proprement dite. En deux siècles, on y compte plus de 700 journaux entièrement ou partiellement écrits en langue française. Dès le XIXe siècle, on constate l’existence d’une abondante presse francophone, illustrée par des journaux dont certains se maintiendront un siècle, tel Stamboul (1875-1964). Plusieurs questions restent en suspens concernant le rôle joué par cette presse de langue française dans l’opinion publique, tant en Turquie qu’en France. Ce livre fait aussi remarquer qu’au cours de son histoire, cette presse ne fut pas obligatoirement pro-française mais elle reflétait le rôle véhiculaire joué par la langue française dans l’Empire ottoman." (Joëlle Pierre, 2005)
La vie des animaux sauvages de la région des grands lacs.
P., Durel éditeur, 1948, in-8°, 191 pp, 16 pl. de photos hors texte, une carte, broché, couv. illustrée, bon état
Dans ce nouvel ouvrage sur la vie des animaux sauvages de l'Afrique, l'auteur relate ses souvenirs de la région des grands lacs. Il décrit les moeurs de la faune africaine, évoluant ici dans un cadre particulièrement magnifique, certainement le plus curieux, le plus varié et le plus beau de l’Afrique : des lacs immenses, des volcans géants, des montagnes formidables. une faune présentant des spécimens remarquables, comme le gorille de Béringé ou l’Okapi, des races humaines variées, parmi lesquelles les pygmées...
Indochine.
Nagel, 1966, gr. in-8°, 281 pp, 145 illustrations hors texte dont 35 en couleurs, tableau chronologique, notes, biblio, index, cartes sur les gardes, reliure skivertex gris perle de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état (Coll. Archaeologia mundi)
"Bernard-Philippe Groslier, directeur de recherche au CNRS, correspondant de l'Académie, disparu le 29 mai 1986, était né à Pnom Penh en 1926. Son père, Georges Groslier, directeur des arts et conservateur du Musée national du Cambodge, a été en son temps l'un des meilleurs connaisseurs du monde khmer. De 1960 à 1975, Bernard-Philippe Groslier a maintes fois quitté ses travaux d'Angkor pour d'autres chantiers d'Extrême-Orient où l'appelait son incomparable expérience technique. Il est de ceux qui ont préparé le sauvetage du Borobudur. Il a fouillé au Siam, en Malaisie, jusqu'en Corée. Quand le Cambodge lui fut fermé, il se tourna vers les vestiges du passé birman. Ses travaux d'Angkor et sa familiarité avec les antiquités de l'Indochine lui ont inspiré une multitude d'articles et plusieurs ouvrages importants. Dès 1956, l'Académie couronnait son livre sur “Angkor. Hommes et dieux”. On lui doit aussi la publication des inscriptions du Bayon d'Angkor dans les Mémoires de l'École Française d'Extrême-Orient, en 1966, et la synthèse consacrée à l'Indochine dans la série “Archaeologia mundi”. Explorateur infatigable, organisateur intrépide, Bernard-Philippe Groslier a été l'un des archéologues français les plus riches d'expérience aussi bien par la diversité de ses compétences que par la variété des terrains où il les a acquises et appliquées." (André Caquot, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1986)
L'Allemagne de l'Occident, 1945-1952.
Gallimard, 1953, in-12, 340 pp, préface d'Edmond Vermeil, notes bibliographiques, reliure demi-toile verte à coins à la bradel, dos lisse avec titres dorés (rel. de l'époque), bon état, envoi a.s.
"Une étude fouillée qui commence par l'historique des négociations interalliées à propos de l'Allemagne entre 1941 et 1945. Rappel indispensable, car l'attitude des Alliés allait déterminer pour longtemps l'orientation et les destins du pays vaincu. Même au plus fort de la « Grande Alliance », la vieille idée d'utiliser l'Allemagne contre la Russie et le communisme hante certains esprits en Angleterre et aux États-Unis. A la mort de Roosevelt elle gagne les milieux dirigeants. Mais c'est surtout à partir de l'échec de la Conférence de Moscou en mars 1947, qu'elle domine la politique allemande des Occidentaux, avec tout ce que cela comporte sur les plans économique, social, politique, idéologique. La scission s'accentuant entre les anciens alliés entraîne la bipartition de l'Allemagne. L'auteur donne à ce propos une part de responsabilité à la France qui, au nom d'un fédéralisme inspiré par le souci de sa sécurité, s'oppose la première à l'établissement d'une administration centrale pour l'ensemble du pays. Quant au peuple allemand, quelles vont être ses réactions au lendemain de la tragédie nationale, dont il ne semble pas entièrement responsable, au dire de M. Grosser ? Il leur manifeste, en effet, beaucoup de compassion, de sympathie même et rappelle l'existence d'une Résistance sporadique qui néanmoins compte, de 1933 à 1938, 435 000 victimes de l'Hitlérisme. (...) Plus loin, l'auteur souligne d'ailleurs qu'il est devenu à l'heure actuelle de mauvais goût, voire dangereux, de rappeler ses états de service dans la Résistance. Si la dénazification aboutissait à un échec, la décartellisation, sur le plan économique, allait connaître un sort identique. Pour aider au relèvement de l'Allemagne, les Occidentaux étaient mus par différents mobiles. La crainte de laisser sans contrepoids la puissance accrue de l'URSS n'était pas le seul. Les milieux d'affaires anglo-saxons avaient des intérêts dans ce pays. De plus son entretien revenait fort cher à l'Amérique. Aussi fallait-il le remettre au travail et abandonner la plupart des restrictions prévues, les réparations, les démontages, la limitation de la production, etc. Les anciens maîtres de forge tels Krupp, les magnats de la finance et bien d'autres qui avaient commandité le nazisme, furent remis en selle. (...) Au total, l'image très complète que nous donne de l'Allemagne de Bonn M. Grosser est fort sombre et incite, comme le souligne M. Vermeil, à la plus grande vigilance." (Pierre Angel, Annales ESC, 1955)
L'Allemagne de notre temps.
Fayard, 1970, in-8°, 641 pp, 9 cartes et tableaux, biblio, index, reliure éditeur, jaquette, bon état (Coll. Les Grandes études contemporaines)
"Basé sur les connaissances assez étendues de l'auteur, l'agencement du livre fait penser à un bon cours d'université. Commencant avec un chapitre sur l'histoire, Grosser continue avec une description assez détaillée de l'Allemagne à l'heure zero (1945), une critique du procès de Nuremberg et une histoire de la division de ce qui reste du Reich en R.F.A. et R.D.A. Le coeur du livre consiste en une analyse du système et des forces politiques en R.F.A. jusqu'en 1974. Y est inclue une documentation assez valable, par exemple, une table donnant la composition de tous les cabinets federaux." (E. Mahant, Revue canadienne de science politique)
La vie politique en Allemagne fédérale.
Armand Colin, 1970, in-12, 350 pp, biblio, broché, qqs rares soulignures crayon, bon état (Coll. U2)
Histoire de la Chine.
Fayard, 1942, in-12, 428 pp, 2 cartes, broché, bon état (Coll. Les Grandes études historiques)
"La Chine n'a pas fini de faire parler d'elle. Qui veut connaître, dans ses grandes lignes, son passé – un des plus riches et des plus troubles passés qui soient – n'a qu'à recourir à l'Histoire de la Chine que René Grousset, spécialiste de l'Histoire Asiatique, a publiée en 1942 aux Editions A. Fayard. Ce volume maniable de 428 pp, qui présentera les conclusions les plus autorisées des historiens sur l'évolution d'un pays plus de trois fois millénaire." (Lucien Febvre, Annales d'Histoire Sociale, 1944)
Histoire de la Chine. Edition mise à jour par Vadime Elisseeff.
Fayard, 1962, in-12, 462 pp, 8 pl. de photos hors texte, tableau des dynasties chinoises, 2 cartes, reliure pleine toile parme de l'éditeur, titres dorés au 1er plat et au dos, bon état (Les Grandes études historiques)
"La Chine n'a pas fini de faire parler d'elle. Qui veut connaître, dans ses grandes lignes, son passé – un des plus riches et des plus troubles passés qui soient – n'a qu'à recourir à l'Histoire de la Chine que René Grousset, spécialiste de l'Histoire Asiatique, a publiée en 1942 aux Editions A. Fayard. Ce volume maniable présentera les conclusions les plus autorisées des historiens sur l'évolution d'un pays plus de trois fois millénaire." (Lucien Febvre, Annales d'Histoire Sociale, 1944) — "Bien qu'elle ne fût pas parfaite, cette histoire avait le mérite d'exister. Elle est heureusement mise à jour par l'addition d'un chapitre relatif au premier plan quinquennal (1952-1957) et d'un appendice relatif à la résistance spirituelle des catholiques chinois." (Revue française de science politique, 1957)
Histoire de la Chine. Edition mise à jour par Vadime Elisseeff.
Club des Libraires de France, 1957, in-8°, 344 pp, 34 documents sur 36 planches de gravures hors texte (la plupart dépliantes), dont des photos de Marc Riboud et Agnès Varda, 2 cartes en deux couleurs sur un dépliant volant hors texte, reliure pleine soie parme décorée de l'éditeur, rhodoïd, exemplaire numéroté sur alfa, signet, bon état
"La Chine n'a pas fini de faire parler d'elle. Qui veut connaître, dans ses grandes lignes, son passé – un des plus riches et des plus troubles passés qui soient – n'a qu'à recourir à l'Histoire de la Chine que René Grousset, spécialiste de l'Histoire Asiatique, a publiée en 1942 aux Editions A. Fayard. Ce volume maniable présentera les conclusions les plus autorisées des historiens sur l'évolution d'un pays plus de trois fois millénaire." (Lucien Febvre, Annales d'Histoire Sociale, 1944) — "Bien qu'elle ne fût pas parfaite, cette histoire avait le mérite d'exister. Elle est heureusement mise à jour par l'addition d'un chapitre relatif au premier plan quinquennal (1952-1957) et d'un appendice relatif à la résistance spirituelle des catholiques chinois." (Revue française de science politique, 1957)
Histoire de l'Asie. III : Le monde mongol, le Japon.
P., Crès & Cie, 1922, gr. in-8°, v-486 pp, 5 cartes dépliantes hors texte, reliure demi-basane verte, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres dorés couv. conservées (rel. de l'époque), dos lég. passé, bon état
Les empires mongols ; La Perse, l'Inde et la Chine modernes , Histoire du Japon. — "Voici, écrit de main de bon ouvrier, un ouvrage qui nous manquait. M. Grousset a, le premier, réussi à tirer de tous les travaux de détail accumulés par les orientalistes une vue d'ensemble vraiment suggestive de l'histoire de l'Asie depuis la plus haute antiquité jusqu'aux débuts de la colonisation moderne. Son livre se divise en trois grandes parties correspondant chacune à un volume. (...) Le tome III retrace l'histoire des empires mongols, de la Perse moderne, de l'Inde au temps de la domination musulmane et des Grands Mogols, de la Chine moderne et du Japon. Ce qui constitue l'originalité principale et le très grand mérite de ce vaste ouvrage, c'est le souci constant qui s'y affirme de réserver aux particularités de chacune des histoires envisagées une place infiniment moindre qu'aux faits d'ordre général qui permettent le mieux de rendre compte de l'évolution des empires asiatiques et des similitudes qu'on relève souvent entre les civilisations les plus éloignées dans l'espace..." (Louis Halphen, Bibliothèque de l'école des chartes, 1923)
Histoire de l'Extrême-Orient. Tome premier.
P., Geuthner, 1929, gr. in-8°, xvii-402 pp, un frontispice en couleurs, 26 planches hors texte, 4 grandes cartes dépliantes, index, broché, bon état
Tome I seul (sur 2) : L'Inde et la Chine. Le tome II traite de l'Empire Mongol, de la Chine des Ming et des Mandchous et de l'Indochine.
La face de l'Asie. Données permanentes et facteurs de renouvellement.
Payot, 1955, in-8°, 444 pp, broché, bon état (Coll. Bibliothèque historique)
Avec une préface et 2 chapitres complémentaires par George Deniker, Consul général de France, ancien secrétaire interprète à Pékin : La Chine, terre de culture et objet de convoitises ; Le Japon, le Pacifique et l'Extrême-Orient.
L'Empire des steppes. Attila, Gengis-Khan, Tamerlan.
Payot, 1976, fort in-8°, 651 pp, 4e édition, 30 cartes et 20 figures dans le texte, broché, couv. illustrée, dos uniformément passé, bon état (Coll. Le Regard de l'Histoire)
Vingt-cinq siècles d'histoire revisités par l'un des grands orientalistes français qui révèle le secret de l'évolution de l'Asie, la loi qui a présidé à la renaissance ou à la mort des Empires immémoriaux. Cette loi, c'est la lutte du nomade et du sédentaire, de l'homme de la steppe et de l'homme des cultures. Attila, Gengis Khan, Tamerlan... Leur nom est dans toutes les mémoires. Les récits des chroniqueurs occidentaux, des annalistes chinois ou persans ont popularisé leurs figures. Ils surgissent, les grands barbares, en pleine histoire civilisée et brusquement, en quelques années, font du monde romain, du monde iranien ou du monde chinois un monceau de ruines. Leur arrivée, leurs mobiles, leur disparition semblent inexplicables, si bien que l'histoire positive n'est pas loin de faire sien le jugement des anciens auteurs qui voyaient en eux les fléaux de Dieu envoyés pour le châtiment des vieilles civilisations. Une immense leçon de géographie humaine.
Sur les traces du Bouddha.
Perrin, 1977, in-8°, 315 pp, 16 pl. de photos hors texte, 2 cartes sur les gardes, reliure skivertex éditeur, demi-jaquette illustrée, rhodoïd, bon état
René Grousset nous fait revivre les voyages de ces deux pélerins bouddhistes chinois au VIIe siècle, Hiuan-Tsang et Yi-Tsing, l'un par terre et l'autre par mer, vers l'Inde, berceau du bouddhisme. — "Voici encore un bon travail de M. Grousset. Couvrant une période plus courte que les précédents, il s'attache à un grand siècle du bouddhisme, le VIIe de notre ère, mais l'ample information de l'auteur s'y retrouve. Il suit les pèlerins chinois, et surtout le plus illustre, celui dont on a pu écrire : « It is impossible to overestimate the debt which the history of India owes to Hiuen Tsang » (V. Smith). L'essentiel des récits de Hiuan-tsang et des biographies de Yi-tsing ; un tableau de la Chine des T'ang, de l'Asie Centrale avant « l'ébranlement des hordes », de l'Inde à la veille de la tourmente islamique; un sommaire du bouddhisme à l'un de ses apogées, voilà ce qu'enferme le volume, dans une présentation succincte et facile. L'illustration, sobre, bien distribuée, répond aux citations et suffit à faire sentir la justesse de cette méthode..." (Paul Mus, Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, 1929)
Sur les traces du Bouddha.
Plon, 1957, pt in-8°, iv-328 pp, 10 photos hors texte et une carte dépliante in fine, broché, papier lég. jauni, bon état
René Grousset nous fait revivre les voyages de ces deux pélerins bouddhistes chinois au VIIe siècle, Hiuan-Tsang et Yi-Tsing, l'un par terre et l'autre par mer, vers l'Inde, berceau du bouddhisme. — "Voici encore un bon travail de M. Grousset. Couvrant une période plus courte que les précédents, il s'attache à un grand siècle du bouddhisme, le VIIe de notre ère, mais l'ample information de l'auteur s'y retrouve. Il suit les pèlerins chinois, et surtout le plus illustre, celui dont on a pu écrire : « It is impossible to overestimate the debt which the history of India owes to Hiuen Tsang » (V. Smith). L'essentiel des récits de Hiuan-tsang et des biographies de Yi-tsing ; un tableau de la Chine des T'ang, de l'Asie Centrale avant « l'ébranlement des hordes », de l'Inde à la veille de la tourmente islamique; un sommaire du bouddhisme à l'un de ses apogées, voilà ce qu'enferme le volume, dans une présentation succincte et facile. L'illustration, sobre, bien distribuée, répond aux citations et suffit à faire sentir la justesse de cette méthode..." (Paul Mus, Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, 1929)
Histoire de Moscou et des moscovites.
Editions du Pont Royal, 1963, in-4°, 296 pp, 492 gravures et photos en noir et en couleurs, reliure toile décorée de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état (Coll. Panoramas d'histoire)
Moscou des tsars ; Moscou des nobles ; Moscou des marchands ; Prélude à 1917 ; Moscou des bâtisseurs ; Moscou des moscovites.
Le Ranz des vaches (Kuhreigen) de Gruyère et la Chanson du Vigneron (Winzerlied). Illustrés par G. Roux. Avec une notice littéraire de L. Favrat à Lausanne. Gravures sur bois par G. Perrichon à Paris et par Buri & Jeker à Berne. Deuxième édition.
Vevey, Loertscher & Fils Imprimeurs-éditeurs (Klausfelder Frères), 1885, in-4°, 60 pp, illustré de 29 gravures originales de Gustave Roux (1828-1885), dont 10 pleine page, musique notée, reliure demi-percaline havane de l'éditeur, premier plat illustré avec une gravure originale de G. Roux titrée "Armaillis et Vegnolans" en noir et titres dorés, coiffes manquantes, sinon bon état
Avec 2 chansons en patois. Ouvrage dans lequel sont réunies deux chansons en patois (paroles et partitions), l'une qui paraît originaire de la Gruyère et qui a sans doute pris naissance sur l'alpage des "Colombettes" et l'autre composée dans la région de Vevey pour la fête des vignerons. Les nombreuses illustrations dont il est composé représentent des scènes typiques de la vie des armaillis en Gruyère et du travail des vignerons sur les hauts de Vevey.
L'Aigle et la Sibylle. Fresques indiennes du Mexique.
Imprimerie Nationale Editions, 1994, gr. in-4°, 196 pp, texte de Serge Gruzinsi, photographies Gilles Mermet, une carte, notes, biblio, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état
La conquête du Mexique aurait pu n'être qu'une entreprise militaire et destructrice des sociétés indiennes. Elle a aussi provoqué une invasion des formes et des styles européens qui fit découvrir la Renaissance aux peintres de l'ancien Mexique. Confrontés à cette nouvelle façon de voir le monde, ces peintres réalisèrent des fresques d'un intérêt exceptionnel, mêlant la maîtrise acquise avant la conquête espagnole aux procédés et aux images de l'Europe victorieuse. Couvrant les murs des églises et des monastères, ces fresques ouvrent un chapitre oublié, et donc inédit, de l'histoire de l'art...
Ellenika limania, 1900-1940 / Greek Ports. Ports Grecs. Porti Greci. Griechische Häfen.
Athènes, Argo Publishing, 1999, in-8° à l'italienne, xv-167 pp, préface de l'auteur en grec, anglais, français, italien et allemand, suivie de 162 photographies et cartes postales anciennes reproduites à pleine page, une carte des ports grecs, reliure cartonnée illustrée de l'éditeur, bon état
Kings of the Oceans, 1948-1956. Ships built for the Hellenes.
Athènes, Argo Publishing, 2000, in-4°, 365 pp, texte en grec et en anglais, des centaines de photos, la description de 268 navires de haute mer avec leur photo, les informations techniques, le constructeur, le propriétaire, le tonnage brut..., index des noms de navires, reliure cartonnée illustrée de l'éditeur, bon état
Neo-classical towns and harbours of the Aegean. Greek cities.
Athènes, Ministry of the Aegean, 1992, in-8° à l'italienne, 115 pp, 418 photographies en couleurs, quelques-unes à pleine page, 9 gravures, biblio, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état. Texte en anglais
Aegina, Andros, Volos, Lavrion, Mytilene, Nafplion, Syme, Syros, Tinos, Hydra, Chalkis, Chios.
Sailing through Time. The Ship in Greek Art.
Athènes, Kapon Editions, 1995, in-4°, 271 pp, prologue Vassos Karageorghis, 361 illustrations, la plupart en couleurs, biblio, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état. Texte en anglais
[Grèce] – STEINHAUER (George A.), Matina G. MALIKOUTI, Bassias TSOKOPOULOS.
Reference : 55471
(2000)
Piraeus: Centre of Shipping and Culture / Peiraias : kentro nautilias kai politismou.
Athènes, Ephesus Publishing, 2000, pt in-4° à l'italienne, 347 pp, texte en grec et en anglais sur 2 colonnes, nombreuses photos en couleurs dans le texte et à pleine page, plans, notes, biblio, reliure pleine percaline bleu-nuit, dos lisse, titres argentés en grec et en anglais au dos et au 1er plat, une photo contrecollée au 1er plat (rel. de l'éditeur), sous emboîtage de percaline bleu-nuit (lui aussi avec titres argentés en grec et en anglais et une photo contrecollée au 1er plat) contenant également une véritable loupe
Superbe ouvrage sur le Pirée, le principal port d'Athènes. – 1. Ancient Piraeus, the City of Themistocles and Hippodamus (Geoege A. Steinhauer) ; 2. The Growth of Urban Piraeus 1834-1922, through the organization of space and the architecture of private buildings (Matina G. Malikouti) ; 3. Piraeus in the 20th Century (Vassias Tsokopoulos).
 Write to the booksellers
Write to the booksellers