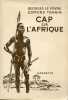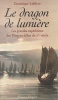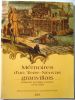Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (9)
19th (218)
20th (1942)
21st (182)
-
Syndicate
ILAB (2356)
SLAM (2356)
Georges Labit, un globe-trotter toulousain, 1862-1899.
Editions Daniel Briand, 1994, in-8°, 319 pp, 91 gravures et photos, une carte, repères chronologiques, sources et biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Grand voyageur de la fin du XIXe siècle, Georges Labit rapporta des réflexions originales sur les pays parcourus, et des objets témoins d'autres civilisations, présentés dans le musée tout à fait insolite qu'il créa à Toulouse. – Il reste surtout connu pour avoir été un grand voyageur devant l’Eternel. Et si sa passion pour les voyages l’a conduit dans différentes parties du monde (Scandinavie, Europe centrale, Afrique du Nord, etc.), il fut, avec Émile Guimet, l’un des rares aventuriers français à avoir visité l’Extrême-Orient et notamment le Japon sous l’ère Meiji et en avoir rapporté suffisamment de souvenirs de valeur pour leur faire prendre place dans des musées qui portent leur nom. Et si le Musée Guimet de Paris est bel et bien le plus connu des musées français pour les arts asiatiques en général et l’art japonais en particulier, le Musée Georges Labit prouve lui aussi qu’un Toulousain s’intéressa grandement à ce pays mêlant déjà ancienneté, longue histoire et traditions à une modernité naissante et menée tambour battant. Un musée qui mérite incontestablement le détour pour la variété et la qualité de sa collection d’objets d’art asiatiques. Sa mort reste aujourd’hui encore un mystère. — "La rumeur populaire ne s’embarrasse pas de délicatesse. Et en février 1899, à Toulouse, pour expliquer la mort de Georges Labit, fils du très fortuné Antoine Labit, on murmure qu’une maîtresse éconduite lui a tout simplement « coupé… son nom ». Une thèse de l’émasculation, parfaitement fantaisiste, mais qui vient combler l’absence d’explication officielle sur la brusque disparition d’un homme de 37 ans, notable apprécié de ses concitoyens, dont le mariage devait être célébré quelques jours plus tard. Sa fin ne sera jamais élucidée. Après son enterrement, son père s’oppose à toute enquête... Fait encore plus étrange, dans les jours qui suivent les faits, aucune autorité officielle n’insistera pour tirer au clair les circonstances du décès. La rumeur, toujours elle, s’empare alors de l’affaire. Bientôt, dans la ville, les hypothèses vont se multiplier quant à la cause réelle du décès de Georges. Une d’entre elle affirme que Labit a été terrassé à l’angle de la rue Bayard d’un coup de flèche empoisonnée ! L’auteur du meurtre, prétendent des proches de la famille, serait un certain Georges Sicard, frère d’une maîtresse abandonnée. Une vendetta familiale sur fond de romance qui n’a jamais trouvé une quelconque confirmation. En revanche, peu de temps après la mort de Georges Labit, son père, Antoine, fouille consciencieusement les archives de son fils. Il en retire ou découpe de nombreux documents. Les archives de Georges sont aujourd’hui encore conservées et attestent de cet étrange comportement. Antoine voulait-il cacher quelque chose ? Ce quelque chose avait-il un rapport avec la mort de son fils ? Difficile de répondre. Mais, une chose est sûre : tout au long de sa courte existence, Georges a entretenu des rapports particulièrement conflictuels avec son puissant père. Une quinzaine d’années plus tôt, ce dernier a d’ailleurs intenté une action en justice pour mettre son fils sous tutelle. Antoine reproche à Georges ses dépenses : la loi va lui donner raison et totalement assujettir Georges au bon vouloir de son père. La part de fortune venant de sa mère décédée lui est confisquée et confiée à Antoine Labit… Sombre histoire familiale, révélatrice de l’autorité d’un père qui ne tolère aucune rivalité. Issu d’une lignée de commerçants, Antoine a débuté sa prodigieuse ascension dans un bazar de la rue Saint-Rome. Rapidement, son sens des affaires lui permet d’ouvrir un nouveau magasin, nettement plus vaste, à l’angle des rues Lafayette et Alsace- Lorraine. Intitulé « La Maison universelle », ce grand magasin devient en quelques années le commerce le plus fréquenté de la ville. On y trouve de tout et Antoine engrange d’importants bénéfices qu’il réinvestit dans l’édification d’un vaste patrimoine immobilier. Quand Georges naît en 1862, il est déjà un des hommes les plus riches de Toulouse. Ses affaires dépassent le cadre de la cité. Connu à Paris, il en profite pour envoyer Georges parfaire ses études auprès d’un négociant en 1881. Le jeune homme a 19 ans et mène une vie de fils prodigue qui lui vaut sa mise sous tutelle. Une relation orageuse s’installe alors avec son père. Georges part quelques temps plus tard à Vienne pour parfaire son apprentissage du commerce. Trois ans plus tard, il rentre à Toulouse. Les relations avec Antoine se sont améliorées. Celui-ci consent à le charger d’une mission de prospection commerciale. Désormais, Georges parcourra le monde pour ramener au « Magasin Universel » des produits de tous les pays. En quelques années, il écume l’Europe, La Laponie, L’Afrique du Nord, la Chine, le Japon. Fasciné par les contrées qu’il traverse, le commerçant devient ethnologue. En plus des produits pour le magasin familial, il ramène des centaines de témoignages et d’objets des peuples qu’il visite. Ses connaissances l’amènent à devenir correspondant de la prestigieuse Société géographique de Toulouse. Il collabore à divers journaux et publie des reportages et des photographies sur ses voyages. Les années passent entre affaires et voyages. Devenu un notable toulousain, il est en 1894 le représentant de la ville de Toulouse aux funérailles du tsar de Russie, Alexandre III. En 1893, il inaugure un musée, financé par son père. L’endroit est dédié aux nombreux objets ramenés de ses voyages. Dans le même temps, peu à peu, son père consent à lui donner une part plus importante dans la gestion de ses affaires. Georges annonce même à un père réjoui son intention de se marier. L’époque des crises semble définitivement passée. A quelques jours de son mariage, le drame survient. Antoine restera inconsolable de la perte de son fils. Peut-être pour préserver l’honneur de sa mémoire, il ne souhaita pas que les causes de sa mort soient rendues publiques. Le mystère reste entier." (Philippe HUGON, « La Dépêche » 23 août 2001) — Le livre nous éclaire de façon très intéressante et parfois même amusante sur ce qu’était le Japon de cette époque ainsi que sur la présence étrangère. Ou du moins de ce que Georges Labit et son compagnon de voyage, un certain M. de Montreuil, en ont perçu. En voici un extrait : « Le port de Yokohama. – La traversée bord du Djemnah s’achève à Yokohama, le vaste entrepôt commercial de l’Empire. Le paysage est moins riant qu’à Kobé et la concession à l’air d’une banale ville de province anglaise, avec ses maisons blanchies à la chaux. Les riches hôtels américains qui n’ont rien emprunté au Japon, les magasins semblables à ceux de Londres ou de New-York et d’affreux bars où l’on débite du gin, whisky, cocktails, font oublier aux voyageurs l’éloignement de l’Occident. La livre sterling, aussi universelle que la langue anglaise, est acceptée dans tout le Japon, alors que la monnaie française s’échange uniquement à Yokohama contre des yens japonais, et encore, à un change très défavorable. La ville se divise en quatre parties principales : la ville européenne au bord de la mer, le Bluff sur la colline, la ville chinoise et la ville japonaise. Le Yokohama européen compte cinq mille habitants. Les plus nombreux sont les Anglais, dans le haut commerce et la banque, concurrencés par les Américains du nord et loin derrière, on recense seulement quatre-vingt cinq Français, en comptant le personnel du consulat et de l’agence des Messageries Maritimes. Chaque communauté forme une société avec ses intérêts à part. Depuis l’ouverture des ports du Japon, les commerçants et banquiers occidentaux qui ont fait fortune se sont fait construire de superbes maisons de plaisance sur la riante colline du Bluff – quartier qui est à Yokohama ce que Saint-John’s Wood est à Londres et Passy à Paris – où flottent des pavillons de différentes nationalités. Les Chinois sont aussi nombreux que tous les étrangers réunis. Ils ont des emplois de caissier ou de comptable dans les grandes maisons de commerce et de crédit ou font « la petite banque, le petit négoce » en vendant meilleur marché que les Européens. Comme toutes les villes chinoises, leur quartier, fait d’un amas de constructions mal bâties, se sent de loin… Ce centre pestilentiel regorge de maisons de jeux et de bouges fréquentés par la population interlope de Yokohama et par les marins de passage. La ville japonaise, très étendue, contraste par la propreté de ses belles rues bordées de maisons de bois sans la moindre peinture, « de vrais joujoux de chalets suisses » aux vitres en papier translucide. Dans la journée, on fait coulisser les unes sur les autres leurs façades légères en sapin, de sorte que l’on voit tout ce qui se passe à l’intérieur. Extrêmement inflammables, ces habitations sont à la merci de la moindre étincelle capable de réduire en cendre tout un quartier. En 1876, douze mille incendies ont anéanti près de quarante cinq mille maisons dans le pays. Les bâtiments qui échappent aux incendies risquent d’être démolies par les tremblements de terre si fréquents au Japon. C’est pourquoi il est rare qu’un Japonais naisse, vive et meure sous le même toit, sauf à la campagne où l’on trouve encore des constructions anciennes. »
Cap sur l'Afrique.
Hachette, 1947 gr. in-8°, 328 pp, illustrations d'Albert Brenet dans le texte et sur 8 pl. hors texte, une carte, broché, couv. illustrée par Albert Brenet, jaquette illustrée en couleurs par Albert Brenet (jaquette réparée avec du scotch), bon état
"Deux auteurs ayant beaucoup voyagé, comme en témoigne l'importante liste de leurs publications séparées, ont uni leurs souvenirs et leurs expériences pour décrire une sorte de voyage romancé à travers l'Afrique. C'est un très bon livre pour les enfants ou les jeunes gens. L'intrigue est saine, vive, intéressante ; elle permet de suivre les enfants du professeur Ansselin de Dakar à Brazzaville et jusqu'à Madagascar. Cependant certains détails, habituellement ignorés par les Français, seront aussi utiles aux grands. Quelques illustrations artistiques fort suggestives." (Jacqueline Beaujeu-Garnier, L'Information Géographique, 1948) — "Tardif mais amusant voyage imaginaire à la mode de la fin du XIXe siècle destiné à faire visiter l'Afrique aux jeunes (et moins jeunes) Français trop sédentaires. Dakar, Bamako, la Guinée, le Cameroun, le Congo, le Tchad et Madagascar sont ainsi visités." (Soumbala)
Découverte du Monde.
PUF, 1954, in-8°, vii-290 pp, préface de Ch.-A. Julien, 8 pl. hors texte de cartes anciennes, une carte dans le texte, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Pays d'Outre-Mer)
L'histoire de la découverte de la Terre par les Méditerranéens et les Occidentaux, de l'antiquité au XXe siècle. — "« Par ce titre de « découverte du monde », il faut entendre la découverte des peuples moins évolués par les peuples plus évolués, à laquelle fait suite celle des terres inhabitées ou désertes. » (...) L'ouvrage magistral de Georges Le Gentil, avec ses bibliographies suffisantes et qui dénotent une somme de travail considérable, ses mentions de voyageurs inconnus ou peu connus encore (l'exploration polaire est particulièrement réussie) est à la fois un instrument de travail commode, une mine de renseignements précieux, un monument à l'effort humain." (J.-P. Faivre, Journal de la Société des Océanistes, 1955)
Les Influences occidentales dans la révolution de l'Orient. Inde, Malaisie, Chine (1850-1950).
Plon, 1954, 2 vol. in-12, x-300 et 267 pp, 4 cartes, biblio, brochés, couv. défraîchies, bon état (Coll. Civilisations d'hier et d'aujourd'hui). Edition originale, envoi a.s. (Prix Paul-Michel Perret, décerné par l'Académie des Sciences morales et politiques, 1957)
"Etude de le façon dont les idées occidentales ont pu accélérer la transformation morale, politique et sociale de trois pays d'Extrême-Orient : l'Inde, la Malaisie et la Chine. Les perspectives adoptées ne sont pas les mêmes pour chacun de ces pays ; pour l'Inde, l'auteur se place surtout sur le plan de l'histoire des idées et montre comment les philosophes de la renaissance de l'hindouisme ont souvent été influencés par les idéologies occidentales. Pour la Malaisie, il s'efforce d'expliquer comment certaines structures politiques et sociales ont pu être complètement bouleversées par l'arrivée des Européens et comment sont nées des formes nouvelles de société et de civilisation. Pour la Chine, enfin, il suit le déroulement chronologique des événements politiques et militaires pour mettre en lumière les formes différentes que prend la confrontation des deux civilisations. Très riche bibliographie." (Revue française de science politique, 1955) — "Après un séjour de plusieurs années en Asie, Léger a entrepris de décrire la révolution qui s’y est produite depuis un siècle. L’Inde et le Pakistan, la Chine sont aujourd’hui des nations, la Malaisie où l’introduction de l’hévéa a changé le paysage, représente une puissance économique : si le temps a marché si vite depuis 1850, ce peut être en partie sous l’influence de l’Occident. Mais l’auteur nous fait assister, en historien et en psychologue, à ce qu’il appelle “le travail de désacralisation de l’Occident” dans ces pays, qui s’est opéré à la suite des succès japonais sur la Russie en 1905, et des deux guerres mondiales. Le départ des Anglais de l’Inde, leur retour en Malaisie, la chute de la Chine nationaliste malgré l’aide américaine, ouvrent de vastes perspectives à la réflexion." (Population, 1955)
La Perse actuelle.
Fécamp, Imprimeries réunies L. Durand et fils, 1895, gr. in-8°, 120 pp, un portrait gravé de S. M. Nassr-ed-in, Chah de Perse, imprimé sur papier fort, broché, bon état
Publié à compte d'auteur par Marcel Le Grand (1859-1916), sous-directeur puis directeur général de la distillerie de la Bénédictine à Fécamp. Cette liqueur, que la légende fait dater du Moyen Age et appréciée de François 1er, avait été lancée de manière entrepreneuriale en 1863 par son père Alexandre Le Grand (1830-1898), un négociant normand. Créateur de la célèbre liqueur en 1863, Alexandre la baptisa « Bénédictine » en l’honneur de l’abbaye de Fécamp. Il obtint également l'autorisation d’utiliser les armoiries de cette abbaye et la devise des bénédictins, D.O.M. (Deo Optimo Maximo).
Le Portugal. Notice historique, statistique & commerciale au point de vue du développement de ses relations avec la France.
Fécamp, Imprimeries réunies L. Durand et fils, 1895, gr. in-8°, 64 pp, imprimé sur papier vergé, broché, couv. rempliée, bon état
Publié à compte d'auteur par Marcel Le Grand (1859-1916), sous-directeur puis directeur général de la distillerie de la Bénédictine à Fécamp. Cette liqueur, que la légende fait dater du Moyen Age et appréciée de François 1er, avait été lancée de manière entrepreneuriale en 1863 par son père Alexandre Le Grand (1830-1898), un négociant normand. Créateur de la célèbre liqueur en 1863, Alexandre la baptisa « Bénédictine » en l’honneur de l’abbaye de Fécamp. Il obtint également l'autorisation d’utiliser les armoiries de cette abbaye et la devise des bénédictins, D.O.M. (Deo Optimo Maximo).
La Vallée du Nil. Epoque contemporaine.
P., Firmin-Didot, s.d. (1892), gr. in-8°, 253 pp, 50 gravures dans le texte et hors texte, reliure pleine percaline rouge, dos lisse avec titres dorés et caissons à froid, encadrements à froid sur les plats, motif doré au centre du 1er plat, dos lég. sali, bon état
L'Egypte à la fin du XIXe siècle. — Maxime Legrand est le pseudonyme de Maxime Petit (1858-1939), magistrat et historien, auteur de nombreux ouvrages chez Larousse, en particulier de manuels scolaires en collaboration avec Claude Augé. Il collabore à la "Revue bleue", à la "Nouvelle revue", à la "Revue universelle" et à diverses publications encyclopédiques Larousse, dont le Nouveau Larousse illustré. Il deviendra Président de chambre honoraire à la Cour des comptes en 1934, et sera membre de nombreuses commissions ministérielles et membre du conseil supérieur des colonies.
Histoire du Portugal du XIe siècle à nos jours.
Payot, 1928, in-8°, 175 pp, biblio, broché, bon état (Coll. Bibliothèque Historique)
Notre confrère Théodoric Legrand a rédigé une histoire du Portugal. L'utilité de cet ouvrage est aussi d'offrir au lecteur français un résumé commode de l'histoire du pays, qui a eu sa part importante dans le monde et tant de points de contact avec la France. Le plan est triparti : moyen âge, temps modernes, période contemporaine jusqu'à la proclamation de la république portugaise (1910). Dans chacune des parties, l'exposé sommaire des faits politiques est suivi d'indications relatives à l'état de la civilisation, à l'organisation administrative et sociale, à la vie économique. C'est avec la domination espagnole en Portugal (1580) que commence réellement la période moderne. (Eugène Martin-Chabot, Bibliothèque de l'École des chartes, 1929) — "M. Legrand s'est chargé, dans la Bibliothèque historique, de l'Histoire du Portugal, qu'il connaît d'ailleurs admirablement. C'est un peu une « nouveauté » pour le public français, qui ne sait guère du Portugal que son origine française et les très grands faits de son histoire. M. Legrand a divisé son ouvrage par règnes, en faisant suivre chaque grande période d'une synthèse des institutions sociales et politiques, des grandes découvertes et du développement des lettres et des arts. Ce procédé a le mérite d'être clair, de faciliter la consultation de l'ouvrage et d'en faire ainsi un excellent manuel. Sachons gré à M. Legrand de nous familiariser avec les institutions de ce pays si attachant, institutions souvent semblables aux nôtres, parfois curieusement en avance sur elles. Une bonne bibliographie termine l'ouvrage dans lequel on regrettera l'absence de tout renseignement sur le Portugal moderne, depuis l'avènement de la République." (Albert Depréaux, Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 1930)
Brouage Québec. Foi de pionniers.
Chez l'auteur, 1977, in-8°, 227 pp, un portrait de Champlain et 32 pl. de documents et photos hors texte, biblio, couv. illustrée, bande conservée, bon état
Histoire de Brouage, berceau de Neuve-France. La colonisation. Samuel Champlain. L'origine de la survivance française en Amérique. Les origines merveilleuses de Montréal. Mgr François de Laval, premier évêque de l'Amérique du Nord. Les Français en Amérique. La tragédie acadienne. Le marquis Louis de Montcalm. Lendemains de conquête. On joint un article du Figaro sur le livre.
L'Art précolombien.
P., Charles Massin, 1960, in-4°, 76 pp, 94 illustrations dont 15 planches en couleurs, les autres en héliogravure, cart. toilé créme de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état (Coll. Carrefour des Arts)
Henri Lehmann était sous-directeur du Musée de l'Homme.
Au Mexique.
P., Léopold Cerf, 1892, in-12, xvi-314 pp, reliure demi-chagrin chocolat, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres dorés (rel. de l'époque), dos lég. frotté, bon état
Récit d'un voyage fait au Mexique à la fin du XIXe siècle. — "Soit justification, soit rancoeur, les Français ont effacé toute image idyllique du Mexique et développé un sentiment de refus vis-à-vis de « ce pays de sauvages ». Ce sentiment a bien été compris par Lejeune, jeune ingénieur du corps diplomatique français, qui a cru trouver son origine dans les romans et récits de voyages." (Javier Pérez Siller, L'image du Mexique dans les publications françaises, 1867-1905) — Table : L'arrivée ; Environs de Mexico ; Les terres chaudes ; Les plantes industrielles (le tabac, le caoutchouc, le mezcal de Tequila...) ; A la frontière ; Les mines ; L'état politique ; Les Français au Mexique.
Le Dragon de lumière. Les grandes expéditions des Ming au début du XVe siècle.
France-Empire, 1996, in-8°, 423 pp, 2 cartes, repères chronologiques, principales dynasties chinoises, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Début XVe siècle, l'avenir se joue sur la mer. Le Portugal se lance dans l'aventure exploratrice, quand à l'autre bout du monde connu, une Chine revigorée entreprend les plus imposantes expéditions maritimes jamais réalisées jusqu'alors. Ses flottes majestueuses sillonnent sans discontinuer, les mers d'Orient. Commandées par Zheng He, un eunuque musulman, elles atteignent l'Inde religieuse, l'Arabie parfumée et l'Afrique exotique. Des témoins à bord des jonques décrivent les mœurs et les richesses des pays visités..., sans oublier les escales aux rencontres singulières avec le pirate de Palembang, le roi cupide de Ceylan, l'usurpateur de Semudra ou le samorin de Calicut... Et que dire de l'accueil somptueux du Bengale, des stèles humanistes de Ceylan et du triomphe de la girafe à Nankin. Sur terre comme sur mer, l'Asie entière est prise dans le vaste filet diplomatique tendu par les Ming. De tous côtés, on se presse pour verser tribut au Fils du Ciel. Victoires contres les Annamites puis contre les Mongols ajoutent à la gloire d'un empereur insatiable qui a décidé de reconstruire, à Pékin, la Cité impériale et de rebâtir le Grand Canal. L'heure est au gigantisme. Face aux énormes jonques, qu'auraient pesé, alors, les frêles caravelles ? Soixante ans plus tard la roue a tourné, les cartes sont redistribuées. L'Europe à rattrapé son retard et pousse ses pions. La Chine se claquemure derrière ses Grandes Murailles et abandonne sa magnifique marine. Les raisons de ce recul méritaient bien qu'on s'y attarde.
La Corée intime.
La Table Ronde, 1978, in-8°, 333 pp, une carte et quelques dessins dans le texte, broché, bon état
"... La Corée intime fait entendre le cœur d'un peuple déchiré, toujours menacé, héroïque, humble et superbe."
L'Europe et la conquête d'Alger. D'après des documents originaux tirés des Archives de l'Etat.
Perrin, 1913, in-8°, viii-340 pp, broché, rousseurs, bon état
L’Aventure de la mer. La vie des pêcheurs de morues.
Chez l'auteur, 1993, gr. in-8°, 239 pp, 143 illustrations au trait, gravures, photos, cartes, fac-similés (certaines illustrations en couleurs), broché, couv. illustrée, jaquette illustrée, bon état. Peu courant
Martinique, terre française. Le conflit des races et l'opinion métropolitaine. Victor Schoelcher.
P., Maisonneuve & Larose, 1962, in-12, 144 pp, broché, non coupé, bon état
Un siècle d'histoire industrielle du Royaume-Uni. Industrialisation et sociétés, 1873-1973.
SEDES, 1997, gr. in-8°, 231 pp, 52 graphiques et tableaux, carte, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Regards sur l'histoire)
"Cet ouvrage présente l'histoire de l'industrie et de la société industrielle britannique à l'ère de la seconde révolution industrielle. Il s'agit d'une synthèse bienvenue, dans un domaine négligé par les historiens français et où la bibliographie en langue française présente encore trop souvent (à l'exception notable des travaux de François Crouzet et de Jean-Pierre Dormois) une image déformée et périmée du déclin de l'économie britannique depuis 1880, par ignorance des travaux récents publiés en langue anglaise. L'ouvrage, très pédagogique, adopte une chronologie originale mais pertinente, abordant successivement le temps des doutes (1873-1913), le temps des bouleversements (1914-1931), le temps de l'effort (1932-1951), et le temps de l'abondance (1952-1973). Chaque partie analyse la conjoncture économique, les politiques gouvernementales, les mutations des structures et des stratégies des entreprises, et les évolutions sociales liées à l'industrialisation. Il faut louer la présence de nombreux tableaux, graphiques et cartes qui seront fort utiles. Mais le principal mérite de cet ouvrage est de souligner la double originalité de l'évolution britannique, dans l'entre-deux-guerres et pendant les « Trente Glorieuses ». M. Lemonnier montre que la crise de 1929 y est moins lourde de conséquences que celle de 1921, d'où le contraste entre le pessimisme des années 20, marquées par de douloureuses reconversions, et le redressement (incomplet mais spectaculaire) des années 30. Bertrand Lemonnier analyse également avec finesse le « paradoxe » des années 1952-73, âge d'or si on le compare avec les performances de l'industrie britannique depuis 1760, mais qui laisse un goût amer aux acteurs économiques, la comparaison internationale leur étant nettement défavorable : la croissance britannique est l'une des plus faibles de l'Europe occidentale, loin derrière l'Allemagne, la France et l'Italie. Ce livre est l'un des rares ouvrages à présenter en langue française un tableau réaliste des forces et des faiblesses de l'économie britannique depuis 1914. Les mutations sociales liées à l'industrialisation sont elles aussi bien vues, ce qui ne saurait étonner d'un historien de la société britannique de l'après-45, complétant ainsi le travail ancien, mais toujours d'actualité, de François Bédarida." (Isabelle Lescent-Giles, Histoire, économie et société, 1998)
Edouard VII, le roi de l'Entente cordiale.
Hachette, 1949, in-8°, 254 pp, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
"Léon Lemonnier, dont on connaît l'œuvre considérable, en partie vouée à l’étude de l’histoire d’Angleterre et à quelques-uns de ses principaux représentants, depuis Elisabeth et Sir Francis Drake jusqu’à Winston Churchill, narre, dans un livre bourré de faits et d’anecdotes extrêmement bien choisies, la carrière d’Edouard VII. Le contraste est saisissant entre la jeunesse austère du jeune prince et sa trop brève activité royale où il sut concilier à merveille le soin des intérêts diplomatiques supérieurs de son pays et de l’Europe et le goût qu’il eut toujours pour la société, les sports et notre belle capitale." (Edmond Delage, revue Défense Nationale, 1949)
Le Capitaine Cook et l'exploration de l'Océanie.
Gallimard, 1940, in-8°, 250 pp, 19 gravures et photos hors texte, 4 cartes, broché, bon état (Coll. la Découverte du monde)
"Après avoir écrit la biographie des grands marins Elizabethains dont l'un, Sir Francis Drake, touchait déjà au Pacifique, M. Léon Lemonnier a donné, en utilisant surtout les relations imprimées et ceux des textes et documents manuscrits qui ont été publiés, un « Capitaine Cook » qui se lit agréablement, qui est bien illustré à la fois de vieilles cartes et gravures et de photos récentes et dont les conclusions sont généralement justes. A l'inverse de Bougainville, Cook a été l'homme de l'Océanie : « Si on enlève de sa vie, dit avec raison M. Léon Lemonnier, l'histoire de ses voyages, il ne reste à peu près rien » (p. 241)..." (Jean-Paul Faivre, Journal de la Société des Océanistes, 1945
Le Chemin oublié de Compostelle.
Arthaud, 2004, gr. in-8°, 326 pp, 2 cartes hors texte, broché, couv. illustrée, bon état
Aller à Compostelle : en reprenant le Chemin Primitif – ou voie du nord –, chemin de chrétienté depuis plus d'un millénaire, voie romaine tracée encore mille ans plus tôt, mais aussi chemin ancestral vieux d'au moins cinq mille ans... Tous les peuples du passé: Celtes, Ibères, Goths et bien d'autres l'ont emprunté pour se rendre à Finisterra, en Galice, point extrême de l'Occident, « bout du bout » du monde, lieu mythique où le soleil meurt... De Soulac-sur-mer jusqu'à Hendaye, Philippe Lemonnier va retrouver une voie littorale oubliée. En Espagne, loin de prendre le Camino Francés, voie majeure depuis le Moyen Âge, il parcourt le Camino Primitivo, longeant d'abord plein ouest les côtes basque et cantabrique jusqu'à Ribadesella, puis obliquant sud-sud-ouest à travers la montagne asturienne pour arriver en Galice et, de nouveau plein ouest, rallier Finisterra par Saint-Jacques-de-Compostelle. Au terme d'un périple de 1300 kilomètres, à pied et seul, Philippe Lemonnier aura cheminé un mois et demi au fil des légendes, récits colportés, renouvelés, remodelés au cours des siècles et au goût des cultures. Il aura ainsi retrouvé l'esprit du voyage qui animait les pèlerins du Moyen Age.
LE PELLEY FONTENY (Monique) et Gilles Désiré dit Gosset.
Reference : 107750
(2001)
ISBN : 9782860500098
Mémoires d'un Terre-Neuvas granvillais : Eustache Le Pelley Fonteny (1745-1820). Edition établie et annotée par Monique Le Pelley Fonteny et Gilles Désiré dit Gosset, précédé d'une introduction historique par André Zysberg, avec une généalogie de la famille Le Pelley par Anne Cahierre.
Saint-Lô, Archives départementales de la Manche, 2001, in-4°, 143 pp, nombreuses gravures, illustrations et cartes en noir et en couleurs, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
La pêche de la morue au large de Terre-Neuve compte au nombre des épopées maritimes qui peuplent notre imaginaire, à tel point qu'on la désigne souvent du terme de "grande pêche" ou de "grand métier". Pendant quatre cents ans, elle a rythmé la vie de nombreux ports français jusqu'aux années 1930. Et l'on imagine mal combien rude, difficile et dangereuse était la pêche dans ces mers froides et tempétueuses. Les témoignages directs sur cette activité sont rares et même exceptionnels pour les périodes les plus anciennes. C'est ce qui fait tout l'intérêt des mémoires laissées par Eustache Le Pelley Fonteny (1745-1820), capitaine granvillais, à une époque où ce port de la côte ouest du Cotentin arme, à part égale avec Saint-Malo, les deux tiers de la flottille morutière française. En un style sobre et dépouillé, l'auteur raconte ses campagnes de pêche et "fortunes de mer" entre 1764 et 1779, quinze ans d'activité maritime ponctuée par ses voyages entre Terre- Neuve, Marseille, Le Havre et Granville, son port d'attache.
Le Chemin de ronde. Promenade autour de la terre, 1906-1916.
P., Librairie Le François, 1947, in-12, 318 pp, préfaces de Gabriel Hanotaux et du docteur Fiessinger, broché, bon état, envoi a.s.
Souvenirs de voyage du docteur Albert Le Play, ancien chef de clinique du Pr. Dieulafoy et petit-fils de l'illustre Frédéric Le Play, précurseur de la sociologie. On a d'abord les notes d'un long voyage effectué de novembre 1906 à juin 1907. L'auteur débute son récit à Stamboul, la côte d'Asie Mineure, l'Egypte, la Nubie, les Indes, l'Indo-Chine, la côte d'Annam, le Tonkin, la Chine, le Japon. Il termine son voyage par les Etats-Unis (les abattoirs de Chicago...) (pp. 15-211), puis une soirée à Tanger, le Gada de Debdou, qqs impressions de la guerre (Dixmude au début de 1915, Bucarest à la fin de 1916, le 16 décembre 1916 à Petrograd, lors de l'assassinat de Raspoutine, que l'auteur, alors sur les lieux, a failli voir de ses yeux...). Avec en épilogue les souvenirs de l'auteur sur l'Exode tragique de juin 1940 (pp. 253-316).
Le Japon.
Editions Sirey, 1966, in-8° carré, x-621 pp, 26 cartes (dont une dépliante), biblio, glossaire, index, reliure toile rouge éditeur, rhodoïd, bon état (Coll. L'histoire du XXe siècle)
"En partant des documents japonais mis désormais à la disposition des chercheurs, l'auteur, ancien directeur de l'Institut Franco-Japonais de Tokyo, trace un tableau extrêmement complet de l'évolution japonaise." (Politique étrangère, 1968)
Mythes et réalités transatlantiques. Dynamique des systèmes de représentation dans la littérature. Séminaires et actes du colloque international tenu à Talence les 8 et 9 décembre 1995.
Talence, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 1997, gr. in-8°, 465 pp, broché, couv. illustrée, bon état
38 études érudites. — Les auteurs de cet ouvrage, fruit d’une réflexion collective, s’attachent à rendre compte du dynamisme des échanges en même temps que de la plasticité des écarts entre les deux piliers de la culture transatlantique. Depuis la Renaissance, la circulation entre Ancien et Nouveau Monde a été globalement porteuse d’un enrichissement décisif de la pensée et, dans l’optique littéraire qui nous retient, de l’imaginaire.
Ménélik et nous. Le carrefour d'Aden. La route d'Addis-Ababâ. Je suis l'hôte du Négus. Vers le Nil Bleu. France et Abyssinie.
P., Librairie Nilsson, Per Lamm, successeur, s.d. (1902), gr. in-8°, 446 pp, 117 vignettes photographiques dans le texte et hors texte, 3 pl. en couleurs hors texte, 2 cartes dépliantes en couleurs, imprimé sur papier couché, reliure demi-basane maroquinée chocolat à coins, tête dorée, dos lisse avec titres et fleuron dorés, buste en médaillon doré de Ménélik II et titres dorés au 1er plat (rel. de l'éditeur), coiffes lég. abîmées, un mors faible, pt déchirures aux cartes réparées avec du scotch, sinon bon état
Intéressant récit d'un voyage effectué en 1900-1901 en Ethiopie par Hugues Le Roux (1860-1925) entre Djibouti et Addis-Ababâ (novembre 1900-juillet 1901) et d'Addis-Ababâ au Nil Bleu (mars-mai 1901). — "M. Le Roux est revenu récemment d'Abyssinie, où il a été l'hôte de Ménélik. « L'été dernier, je fis la connaissance en France de M. Il g, qui désirait décider un écrivain de langue française à se rendre sur le plateau abyssin pour décrire l'Abyssinie véritable. Au moment où le chemin de fer jeté à travers les pays issa et dankali va faire entrer définitivement l'Ethiopie dans le cycle de la politique européenne, l'empereur Ménélik tient à ce que le nuage dont sa personne et son peuple ont été longtemps enveloppés soit enfin dissipé. » L'orateur, aidé de nombreuses projections, décrit successivement les trois phases de son voyage : le désert, la route jusqu'à la capitale Addis-Ababa, puis, après la capitale elle-même, une longue exploration dans des régions encore indécises entre le Nil Bleu et le Nil Blanc, où il a fourni une intéressante contribution à la science géographique. M. Le Boux transporte ses auditeurs sur un plateau très élevé ressemblant à nos Alpes : la capitale du pays, Addis-Ababa est à 2650 mètres et à ces hauteurs M. Le Roux, grâce au climat équatorial, n'en a pas moins passé de long mois sous la tente. Mais ces pittoresques régions sont infestées de fauves, léopards, lions, etc. les fleuves foisonnent d'hippopotames. La végétation est superbe et permet de prévoir dans l'avenir, quand le pays aura été mis en valeur (ce à quoi va contribuer la ligne du chemin de fer de Djibouti créée par les capitaux français), des récoltes merveilleuses. Les cultures les plus disparates, protégées par la combinaison de ces deux termes fixes, l'altitude alpestre et la latitude équatoriale , se chevauchent ici. alternant dans la même région. Vous rencontrez en un jour, les bananes, les cannes à sucre, le caoutchouc, le café, le coton, les épices, le maïs, la vigne, les légumineuses ; sur les pla¬ teaux moyens, le blé; aux grandes hauteurs, l'orge. M. Le Roux a grande confiance dans l'avenir de l'Abyssinie. Ce qu'il y aurait de fatal pour ce pays, ce serait la conversion à l'islamisme, qui tuerait tout progrès ; heureusement que le christianisme y est implanté fortement depuis le IIIe siècle et que les Abyssins tiennent à leur religion encore qu'elle soit bien dégénérée. Quand un évêque meurt, on en demande un autre au patriarche copte à Alexandrie, et on l'achète en quelque sorte, car il s'engage à mourir dans sa nouvelle patrie. Le voyage accompli par l'orateur dans le Ouallaga n'a pas été sans péril : quelques-uns des hommes de son escorte furent pris par des bandes sauvages et coupés en petits morceaux, mais il y a eu des châtiments. Ménélik s'en est chargé..." (Le Globe. Revue genevoise de géographie, 1902)
 Write to the booksellers
Write to the booksellers