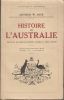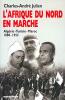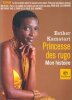Pages d'Histoire - Librairie Clio
8, rue Bréa
75006 Paris
France
E-mail : clio.histoire@free.fr
Phone number : 01 43 54 43 61-
Century
18th (9)
19th (207)
20th (1868)
21st (182)
-
Syndicate
ILAB (2271)
SLAM (2271)
Histoire de l'Abyssinie des origines à nos jours.
Payot, 1935, in-8°, 247 pp, traduit de l'anglais, une carte hors texte, reliure demi-percaline bordeaux, dos lisse avec titres dorés (rel. de l'époque), bon état (Coll. Bibliothèque historique)
Les deux-tiers du livre concernent les périodes antiques et médiévales (jusqu'au milieu du XVIIIe siècle) : origines légendaires, origines historiques, la dynastie salomonienne, le prêtre Jean, la civilisation médiévale, la première ambassade portugaise, la mission jésuite, l'Abyssinie au XVIIe siècle, etc.
L'Incroyable voyage.
Editions Maritimes et d'Outre-Mer, 1979, in-8°, 406 pp, 16 pl. de photos hors texte, 11 cartes et plans, 11 documents en fac-similé in-fine, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Navigateurs insolites). Edition originale française
L'incroyable voyage d'un baroudeur des mers. "Après 12 ans dans la Royal Navy, une guerre mondiale et trois naufrages, blessé à la colonne vertébrale, Tristan Jones est condamné à ne plus jamais pouvoir marcher, selon les médecins militaires... Il récupère ses capacités physiques, navigue... et se lance un étonnant défi : être le premier à naviguer, dans un même périple, sur les eaux les plus basses de la planète - la mer Morte - puis sur les plus hautes, sur le toit du monde - le lac Titicaca, dans la Cordillère des Andes. Six ans d'un incroyable voyage, en quête "d'un record qui ne pourra être battu que lorsque l'homme aura trouvé de l'eau dans les étoiles !" Héros, conquérant de l'inutile ? Excentrique, fêlé, déjanté ? A vous de juger, en lisant ce récit haletant, qui ne faiblit jamais. Pour accomplir son exploit, il démontrera l'inoxydable volonté d'un marin que rien ne peut abattre, l'exemple de la capacité de l'homme à se surpasser. Il risquera mille fois sa vie et souffrira mille morts dans l'enfer vert de l'Amazone, sur les hauteurs de l'Altiplano bolivien, au large du cap de Bonne Espérance... Il traversera Israël en état de siège, sera pris sous le feu des mitrailleuses égyptiennes en Mer Rouge. On lui tire dessus, durant une tentative de coup d'Etat en Bolivie... Il connaîtra les pires geôles et recevra la visite d'affreux dictateurs sud-américains, sans parler du roi des Rois, l'empereur d'Ethiopie Haïlé Selassié... Il remonte le redoutable courant de Humboldt, trouvant asile devant un pénitencier inhumain. Il traverse le Pérou en fraude, son bateau juché sur un camion. Il tractera son voilier à la main, dans une hallucinante épopée, sur les routes et les voies de chemin de fer et des cours d'eau infestés de piranhas, bravant une nature hostile. Superbe récit de navigation, ce carnet de voyage révèle un surprenant baroudeur des mers qui n'a pas froid aux yeux. Friand de cartographie, d'histoire, d'archéologie. Ouvert à la solidarité, aux plus belles amitiés... Vous n'oublierez pas une seule péripétie de cet incroyable voyage !"
Histoire de l'Australie depuis sa découverte jusqu'à nos jours.
Payot, 1930, in-8°, 339 pp, édition française par G. Roth, 13 cartes et figures, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Bibliothèque historique)
"Nous sommes en France si mal documentés sur l'histoire de l'Australie qu'il faut savoir gré à M. Georges Roth d'avoir traduit en français la remarquable Histoire de M. Jose, membre honoraire de la Société royale d'histoire d'Australie. On suit avec un vif intérêt l'histoire de cet énorme continent insulaire et de ses annexes naturelles, la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande, depuis le temps où l'Australie était une simple colonie pénitentiaire jusqu'au moment où ses différentes parties et ses dépendances ont acquis leur autonomie. Ce n'est pas seulement la découverte du pays que l'on peut suivre dans le livre, mais aussi son développement économique et sa littérature. Combien nombreux sont les Français qui connaissent même le nom des Australiens Kendell, Paterson ou Lawson, du poète zélandais Alfred Domett ?" (Revue Historique, 1931)
George Washington d'après ses mémoires et sa correspondance. Histoire de la Nouvelle France et des États-Unis d'Amérique au XVIIIe siècle.
Hachette, 1876, in-12, xv-282 pp, sources, cart. percaline bleue, dos lisse avec titres dorés et caissons à froid, encadrement à froid sur les plats, fer doré au 1er plat, bon état. Bon exemplaire très frais et sans rousseurs. Edition originale. Peu courant
Première partie : La Nouvelle France. Premières armes de Washington (1732-1761) – Deuxième partie : La guerre de l'indépendance (1761-1783) – Troisième partie : La République des États-Unis. Présidence de Washington (1783-1799).
Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer. Décembre 1901 à octobre 1904.
P., Librairie Illustrée, 1901-1904, 4 vol. gr. in-4°, 2760 pp, très nombreuses gravures et cartes (dans le texte, à pleine page et sur double page), reliures demi-toile verte, dos lisses avec pièce de titre basane carmin, fleuron et double filet doré en queue, couv. illustrées (rel. de l'époque), bon état
Le "Journal des voyages et des aventures de terre et de mer" est un hebdomadaire créé à Paris en juillet 1877 et disparu en 1949. Il mêlait des récits réalistes de voyage et d'exploration à des fictions rocambolesques, le tout abondamment illustré, souvent de manière fantastique. Une première série va du n°1 de juillet 1877 au n° 1012 du 29 novembre 1896 ; la deuxième série débute avec le n°1 du 6 décembre 1896. Elle durera jusqu'en 1915. Les quatre volumes de cette importante revue de voyages proposés ici contiennent les n° 261 (1er décembre 1901) à 413 (30 octobre 1904) de la deuxième série (153 numéros). L’ensemble est très copieusement illustré. — « Le goût de plus en plus marqué en France pour les récits de voyages et d’aventures est un des caractères de notre époque (...). L’éditeur du "Journal des Voyages" a donc voulu faire un journal que satisfît à la fois à ce goût et à la nécessité de connaître ce globe sur lequel nous nous agitons, et qui fût en même temps accessible à tout le monde, aussi bien par les conditions matérielles que par l’esprit qui y régnera (…). Les matières si variées comprises dans le vaste champ de la géographie et des voyages seront tour à tour abordées dans le "Journal des Voyages" dont chaque numéro, de seize grandes pages in-folio, contiendra toujours une grande relation de voyage, une aventure de terre ou de mer (récit de naufrage ou de chasse périlleuse, etc.), un article sur l’histoire des voyages, un attachant roman d’aventures, la géographie d’un département de la France, un chapitre du Tour de la Terre en quatre-vingts récits, une revue des plus récents ouvrages de voyages et enfin une chronique des voyages et de la géographie » (extrait de l’Avis de l’éditeur).
Le Chili sous Allende.
Gallimard/Julliard, 1974, in-12, 264 pp, 16 pl. de photos hors texte, chronologie, biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Archives)
Pendant trois ans, l'expérience chilienne a passionné et divisé le monde. Voici rassemblés pour la première fois les textes fondamentaux du Chili sous Allende : interviews et programmes, discours et journaux tissent la trame d'une histoire encore vive et disent les incertitudes d'une révolution légaliste, les espoirs et la colère d'un peuple. A travers l'analyse minutieuse des forces en présence et des moments de la lutte, Alain Joxe retrouve le sens de l'aventure et la dimension de l'échec
Belain d'Esnambuc.
Editions Bellenand, 1950, in-12, iv-175 pp, 2 cartes dont une dépliante hors texte, broché, couv. illustrée, bon état
Le créateur des établissements français des Antilles au XVIIe siècle. — "Le Belain d'Esnambuc, d'Auguste Joyau, est la biographie d'un homme qui a été à l'origine de la mise en valeur et du peuplement français de Saint-Christophe, donc de tous nos établissements des Antilles. Au départ, point de plan de bien sûr, mais le seul désir de trouver la fortune en courant sus aux Espagnols, donc la course, c'est-à-dire pillage et commerce, car on n'imagine point ces hommes ramenant leurs prises devant une amirauté. Puis à la suite d'un naufrage les premiers établissements à Saint-Christophe, à côté de Français déjà y cultivant le coton et le tabac, dans le voisinage des Anglais débarqués avec Warner quelques mois auparavant. D'Esnambuc revient en France chercher des hommes et des capitaux et se faire épauler par Richelieu. La Compagnie de Saint-Christophe est fondée, où Richelieu met quelques d'encouragement. Elle est bientôt élargie en Compagnie des Isles de l'Amérique. C'est une affaire normande et mais qui ne répond pas aux espoirs financiers. Mais des colons, des engagés arrivent à Saint-Christophe. Des de Hollande et de France y débarquent. La Martinique, la Guadeloupe sont explorées et occupées par des essaims partis de Saint-Christophe. Mais d'Esnambuc meurt en 1637. Le commandeur de Poincy qui lui succède bientôt lance un autre essaim, celui de Levasseur, vers la Tortue et Saint-Domingue..." (G. Debien, Revue d'histoire des colonies, 1953)
La Nouvelle Question d'Extrême-Orient. Tome 2 : L'ère du conflit sino-soviétique, 1959-1978.
Payot, 1988, in-8°, 493 pp, 14 cartes, chronologie des relations internationales en Extrême-Orient (1959-1978), textes annexes, index, broché, soulignures stabilo, pt accroc au dos, sinon bon état (Coll. Bibliothèque historique)
"L'étude minutieuse de la montée en puissance d'une partie du monde qui, de plus en plus, s'affirme. Pourquoi 1959 ? Parce que c'est l'année de la rupture du bloc soviétique. Les nombreux contrecoups, qui, du Nord-Pacifique jusqu'à l'Asie du Sud-Est, vont inévitablement accompagner un tel événement sont passés au crible. Pourquoi 1978 ? Parce que c'est l'année des réaménagements intermédiaires : Vietnam-URSS, Chine-Japon, Etats-Unis-Chine, pour ne citer que les principaux. Et c'est déjà considérable. Des cartes d'une lumineuse clarté affichent le détail de problèmes immenses. En annexe : chronologie, traités, résolutions, communiqués, déclarations. Une somme. Une documentation essentielle." (Georges Buis) — "L'Extrême-Orient occupe une place grandissante sur la scène internationale. Cette région du monde, que beaucoup d'observateurs considèrent comme un pôle de développement majeur, a fait l'objet d'innombrables ouvrages sur telle ou telle question précise – la guerre de Corée, le conflit sino-soviétique – ou sur la politique étrangère de tel ou tel pays. La nouvelle question d'Extrême- Orient retrace l'évolution internationale de l'ensemble de la région, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le premier volume de cet immense travail de synthèse, paru en 1985, portrait sur l'ère de la guerre froide (1945-1959). Le deuxième volume est consacré à l'ère du conflit sino-soviétique (1959-1978). L'auteur analyse avec force détails l'affrontement entre Pékin et Moscou, mais aussi le conflit sino-indien, la deuxième guerre d'Indochine, la détente entre la Chine et les Etats-Unis, l'ascension du Japon et l'attitude des pays de l'ANSEA face à l'Indochine socialiste. Nous ne saurions prétendre rendre compte en quelques lignes d'un travail nourri par la connaissance approfondie qu'a François Joyaux des questions d'Extrême-Orient. La richesse des informations contenues dans cet ouvrage, les tableaux, cartes, extraits de documents officiels, chronologie, index et bibliographie en font un précieux instrument de travail. Il est en outre un remarquable outil de compréhension des bouleversements survenus en Extrême-Orient entre 1959 et 1978. L'auteur souligne que cette période, communément qualifiée d'ère de la « détente », correspond en Extrême-Orient à des mutations politiques et stratégiques étroitement liées à la poursuite de la guerre froide. A la confrontation Est-Ouest, incarnée par la division de la Corée, de la Chine et du Vietnam, par le renforcement des alliances américaines et l'accroissement des forces militaires soviétiques dans la région, est venue se superposer la rivalité sino-soviétique qui modifia profondément l'équilibre en Extrême-Orient. Outre le conflit sino-indien et la deuxième guerre d'Indochine, dont il est à l'origine, l'affrontement sino-soviétique incita la Chine à rechercher d'autres appuis et, parallèlement, suscita l'élaboration d'une nouvelle politique asiatique aux Etats-Unis. En 1978, une « ligne de force » Pékin-Tokyo- Washington s'était constituée, qui marquait les débuts de l'ère de l'ouverture chinoise (1979-1989). Enfin, l'auteur fait observer que, si l'ère du conflit sino-soviétique fut une période d'expansion du communisme en Extrême-Orient, comme au temps de la guerre froide, l'affrontement sino-soviétique révéla combien deux Etats fondés sur la même idéologie pouvaient s'affronter radicalement. Poursuite de l'expansion communiste certes, mais pour la première fois, la rivalité de deux Etats communistes laissait entrevoir, en Occident, la possibilité « d'endiguer un communisme par un autre »." (Elisabeth Fouquoire-Brillet, Politique étrangère, 1989)
Nos Antilles et leurs voisines. Conférence donnée le 26 février 1936 à la Société internationale des Science Sociale.
P., Les Etudes Sociales, s.d. (1936), gr. in-8°, 39 pp, un tableau hors texte, broché, bon état
Par Frédéric Joüon des Longrais (1892-1975), professeur d'histoire du droit civil et du droit canonique à l'École des chartes (1941-1965), directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études (1922-1965), directeur français de la Maison franco-japonaise de Tokyo (1939-1946), membre honoraire de l'Académie du Japon (depuis 1952), avocat à la Cour d'appel de Paris (depuis 1911), archiviste paléographe (1921), docteur en droit (1924).
Histoire de l'Afrique du Nord. Tunisie - Algérie - Maroc. Tome II : De la conquête arabe à 1830.
Payot, 1956, in-8°, 367 pp, deuxième édition revue et mise à jour par Roger Le Tourneau, 27 croquis et cartes, biblio, index, broché, dos lég. taché, bon état (Coll. Bibliothèque historique)
Tomee II seul (sur 2) — I. La conquête arabe et les royaumes Kharijites ; II. Les dynasties arabe et berbères (IXe - XIe siècle) ; III. Les empires berbères : Les Almoravides et les Almohades ; IV. Retour aux royaumes berbères ; V. L'empire chérifien (1553-1822) ; La domination turque en Algérie et en Tunisie (1516-1830) ; VII. Vue d'ensemble.
Histoire de l'Afrique du Nord des origines à 1830. Tunisie - Algérie - Maroc.
Payot, 1978 2 vol. in-8°, 333 et 367 pp, 42 croquis et cartes, biblio, index, brochés, bon état
Deuxième édition revue et mise à jour par Christian Courtois (pour le tome 1) et Roger Le Tourneau (pour le tome 2) — Paru pour la première fois en 1931, une vingtaine d'années après l'implantation officielle de la tutelle française sur le Maroc et cent après la prise d'Alger, cet ouvrage se voulait à contre-courant du regard que les Européens portaient alors sur les "colonies" d'Afrique du Nord. Appuyé sur des recherches solides, l'historien cherchait à établir une continuité dans le passé maghrébin, depuis ses origines jusqu'à la colonisation, en étudiant de quelle manière Phéniciens, Vandales, Romains et Arabes se sont fondus dans la pérennité berbère. Dès lors, loin d'être le point de départ d'une nouvelle histoire comme elle se voulait, la colonisation n'apparaît plus que comme un simple épisode.
L'Afrique du Nord en marche. Algérie, Tunisie, Maroc, 1880-1952.
Omnibus, 2002, in-8°, xiii-499 pp, préface par Annie Rey-Goldzeiguer, bibliographies, annexes, index, broché, couv. illustrée, qqs soulignures crayon sur les 14 premières pages, bon état
Voici un livre d'histoire qui ne ressemble à aucun autre. Ecrit à chaud en 1952, alors qu'en Tunisie et au Maroc l'épreuve de force menaçait et que régnait en Algérie selon les spécialistes officiels « une extraordinaire quiétude », il fait le point sur l'aboutissement d'un siècle de système colonial et décrit la succession d'occasions manquées qui entraînera une décolonisation violente et traumatique. Livre d'histoire immédiate, considéré en France et à l'étranger comme un ouvrage de référence, il conserve près de soixante-dix après sa parution une présence saisissante par sa lucidité, l'honnêteté de ses choix et la vivacité de son style. Il demeure aujourd'hui encore une synthèse inégalée de l'histoire du Maghreb, indispensable à quiconque veut comprendre en profondeur les réalités maghrébines. — "« Nulle part au Maghreb ne joua la fatalité mais l'aveuglement colonial. » Ce que prouve amplement ce livre, écrit en 1952, et dont la deuxième édition était épuisée en moins d'un an malgré les obstacles mis à sa diffusion. Sa réédition, aujourd'hui, permet de juger de l'étonnante lucidité de son auteur, et de la justesse de points de vue soutenus il y a vingt ans. Le premier chapitre indique parfaitement « les données du problème » de l'Afrique du Nord coloniale : le portrait des colons européens laisse présager de l'issue du conflit à venir. Et l'on débouche sur le meilleur de ce livre, passionné autant que passionnant : l'étude de la genèse des nationalismes tunisien, marocain et algérien. La fin de l'ouvrage présente avec sûreté la crise des trois pays maghrébins au début des années 50. Ainsi que l'impasse à laquelle aboutit « la politique des occasions perdues » menée avec constance par la France pendant près d'un demi-siècle. Complété par de précieuses orientations bibliographiques, ce livre magistral fait honneur à son auteur. Il éclairera le lecteur sur les réalités de l'Afrique du Nord avant les indépendances du Maroc et de la Tunisie, et à la veille de la guerre d'Algérie." (S. Urfer, revue Etudes, 1972)
L'Afrique du Nord en marche. Nationalismes musulmans et souveraineté française.
Julliard, 1972, gr. in-8°, 439 pp, troisième édition revue et mise à jour, biblio, index, broché, couv. à rabats, bon état
Algérie, Tunisie, Maroc, 1880-1952. Voici un livre d'histoire qui ne ressemble à aucun autre. Ecrit à chaud en 1952, alors qu'en Tunisie et au Maroc l'épreuve de force menaçait et que régnait en Algérie selon les spécialistes officiels « une extraordinaire quiétude », il fait le point sur l'aboutissement d'un siècle de système colonial et décrit la succession d'occasions manquées qui entraînera une décolonisation violente et traumatique. Livre d'histoire immédiate, considéré en France et à l'étranger comme un ouvrage de référence, il conserve un demi-siècle après sa parution (en 1952) une présence saisissante par sa lucidité, l'honnêteté de ses choix et la vivacité de son style. Il demeure aujourd'hui encore une synthèse inégalée de l'histoire du Maghreb, indispensable à quiconque veut comprendre en profondeur les réalités maghrébines. — "« Nulle part au Maghreb ne joua la fatalité mais l'aveuglement colonial. » Ce que prouve amplement ce livre, écrit en 1952, et dont la deuxième édition était épuisée en moins d'un an malgré les obstacles mis à sa diffusion. Sa réédition, aujourd'hui, permet de juger de l'étonnante lucidité de son auteur, et de la justesse de points de vue soutenus il y a vingt ans. Si l'introduction est longue et confuse, le premier chapitre indique parfaitement « les données du problème » de l'Afrique du Nord coloniale : le portrait des colons européens laisse présager de l'issue du conflit à venir. Et l'on débouche sur le meilleur de ce livre, passionné autant que passionnant : l'étude de la genèse des nationalismes tunisien, marocain et algérien. La fin de l'ouvrage, quelque peu alourdie par un excès de faits, n'en présente pas moins avec sûreté la crise des trois pays maghrébins au début des années 50. Ainsi que l'impasse à laquelle aboutit « la politique des occasions perdues » menée avec constance par la France pendant près d'un demi-siècle. Complété par de précieuses orientations bibliographiques, ce livre magistral fait honneur à son auteur. Il éclairera le lecteur sur les réalités de l'Afrique du Nord avant les indépendances du Maroc et de la Tunisie, et à la veille de la guerre d'Algérie." (S. Urfer, revue Etudes, 1972)
La Révolution cubaine.
Julliard, 1961, in-12, 276 pp, broché, jaquette illustrée, manque la page de titre, bon état
"Etude des causes de la révolution fidéliste dans un sens extrêmement favorable aux révolutionnaires. L'auteur oppose au tableau tragique de la tyrannie de Batista les surprenantes réalisations du nouveau régime au cours de ses deux premières années, en particulier les réformes intéressant la population rurale où Fidel Castro trouve toujours un appui massif : réformes agraires, politique de logement rural, nationalisation des plantations sucrières, etc. Un danger réel pour l'avenir du mouvement, estime C. J., réside néanmoins dans le fait que cet avenir reste indissolublement lié à la personne même de Fidel Castro, en l'absence totale de structure politique. L'étude constitue également un vigoureux réquisitoire contre la politique du gouvernement américain qui, trop longtemps complaisant envers le règne sanglant de Batista, a accumulé les erreurs de jugement vis-à-vis du nouveau régime." (Revue française de science politique, 1961)
L'Empire américain.
Grasset, 1968, in-8°, 416 pp, une carte, biblio, index, broché, soulignures crayon, bon état
L'histoire des Etats-Unis depuis la guerre hispano-américaine de 1898 jusqu'en 1968, et les diverses formes de l'impérialisme américain.
L'Amiral Courbet d'après ses lettres.
P., Victor Palmé, 1889, in-12, ii-314 pp, broché, état correct
Prologue ; Nouvelle-Calédonie : Impressions de voyage. – Salons du Gouverneur. – Pénitenciers ; Nouvelles-Hébrides. – Missionnaires. – Madagascar ; Expansion coloniale. – Tonkin ; Thuan-an et Son-tay ; Diplomates et marins. – Fou-tchéou et Formose. Torpilles et droit des gens. –Sheï-poo et Pescadores ; Paix douloureuse ; Courbet et Paul Bert au Tonkin ; Notes. — "... Les lettres du gouverneur (et amiral) Courbet furent publiées après sa mort par Félix Julien dans l'ouvrage “L'amiral Courbet d'après ses lettres”. Dans le chapitre premier F. Julien dévoile l'affaire des lettres, privées et non destinées à la publication, dont la diffusion révéla que ce grand commis de l'État (catholique et monarchiste) était en désaccord profond avec la politique des républicains qu'il appliqua par devoir. Tout le deuxième chapitre comprenant lettres du gouverneur et notes de F. Julien est consacré au séjour de Courbet en Nouvelle-Calédonie, poste qu'il n'avait pas demandé et colonie où les atermoiements des civils lui laissèrent un goût amer. Toutes ses lettres dépeignent la vie du chef-lieu et la stratégie du gouverneur pour maintenir la paix civile entre colons, libérés et Kanaks, ces derniers n'étant quasiment pas cités si ce n'est comme menace moins grave qu'un éventuel soulèvement des transportés..." (Frédéric Angleviel, Historiographie de la Nouvelle-Calédonie, 2003)
Le Commandant Marceau et les Missions chrétiennes. (Commentaires d'un Marin).
Plon, 1870, in-8°, ii-302 pp, broché, bon état. Edition originale des “Commentaires d'un Marin” (1870) avec couverture de relais et changement de titre de 1873 (le titre devenant “Le Commandant Marceau et les Missions chrétiennes”, avec en sous-titre “Commentaires d'un Marin”). Rare
La première partie de l'ouvrage est consacrée au Commandant Marceau (1806-1851) (p. 1-63) ; la seconde aux Missions chrétiennes (p. 65-157) ; la troisième à l'Océanie (p. 159-248) ; la quatrième à Ernest Doudart de Lagrée (1823-1868) (orthographié Dondart de Lagrée, p. 249-294). — “Le Commandant Marceau (1806-1851) fut un marin de grande valeur qui, après une jeunesse sceptique et orageuse, se convertit avec un éclat qui fit sensation dans le corps auquel il appartenait. Il n'hésita pas, dès lors, à se consacrer tout entier au service de Dieu en prenant le commandement de “l'Arche d'alliance”, navire destiné au ravitaillement des missions éparses dans les îles de l'Océanie, Partout il édifia même les missionnaires qu'il égalait en zèle apostolique. Les conversions qu'il procura dans sa famille, dans son entourage, partout où il passa, furent nombreuses. Malheureusement Marceau mourut fort jeune et ce fut une grande perte pour la marine française aussi bien que pour la religion catholique.” (Comte de Bizemont) — "Les “Commentaires d'un marin”, par M. Félix Julien lieutenant de vaisseau, auteur des “Harmonies de la mer”, nous offrent la vie d'un des plus brillants officiers de la marine française, le commandant Marceau, dont toute la carrière est intimement liée au développement et à la transformation de nos forces navales." (Le Gaulois, 21 janvier 1870) — "Toute la vérité sur les missions chrétiennes, sur les immenses services qu'elles rendent, est exposée par M. Félix Julien, lieutenant de vaisseau, dans son nouvel ouvrage, les“ Commentaires d'un marin”, noble et touchante histoire de l'un des plus brillants officiers de notre marine, le commandant Marceau." (La Presse, 17 janvier 1870) — "Félix Julien, lieutenant de vaisseau en retraite et ancien aide de camp de M. l'amiral Bouët, né à Toulon en 1824, savant distingué, auteur de nombreux ouvrages sur la marine, entre autres : Les Harmonies de la mer. Les Commentaires d'un marin, Papes et Sultans, Lettres de l'amiral Courbet, et bien d'autres œuvres de mérite, est mort à Toulon, dans sa villa de l'Oratoire, à l'âge de 66 ans." (Polybiblion, revue bibliographique universelle, 1890)
Mers du Sud. Photographies d'André Serfati.
Lausanne, Editions Rencontre, 1965, pt in-4°, 192 pp, texte sur 2 colonnes, plus de 100 photos et gravures dans le texte et à pleine page, dont 16 pages en couleurs, reliure cartonnée illustrée de l'éditeur, bon état (Coll. Atlas des Voyages)
Mao. L'histoire inconnue.
Gallimard, 2006, fort in-8°, 843 pp, traduit de l'anglais, 32 pl. de photos hors texte, 4 cartes, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Fondée sur de multiples témoignages et sur les fonds d'archives de l'ancienne Union soviétique, cette biographie de Mao Zedong fait la lumière sur les raisons grâce auxquelles il a réussi à faire main basse sur le pouvoir puis à le confisquer à son unique profit. Son ascension, ses relations avec Staline, etc.
Le dernier Roi des Rois. L'Ethiopie de Haïlé Sélassié.
Plon, 1978, gr. in-8°, 416 pp, 16 pl. de photos hors texte, 4 cartes, chronologie, glossaire, sources et documents, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état. Edition originale
Haïlé Sélassié a régné pendant 58 ans sur une cohorte de personnages excentriques et difficile à gouverner : l'ambitieuse et cruelle impératrice Taïtou ; Yassou , l'intrigant, qui longtemps prétendit au trône d'Éthiopie ; Baltcha, le guerrier eunuque, célèbre pour sa bravoure, redouté pour ses complots... Le dernier Roi des Rois ne s'est pas content de ce tour de force. il faut ajouter à cette prouesse le « climat » éthiopien, avec l'esclavage, la torture et le retard économique; le tout aggravé par le contexte international, car l'Éthiopie fut le champ de bataille favori des grandes puissances pendant les deux guerres mondiales. Haïlé Sélassié a su faire face à toutes ces difficultés réunies. Cela donne une idée de l'exceptionnelle habileté de ce souverain. Politicien et diplomate hors pair, Haïlé Sélassié fut un être secret, mûrissant dans l'ombre des projets qu'il poursuivait avec une patience et une obstination capétienne. Haïlé Sélassié Ier est né en 1892 et prénommé Tafari. Il est couronné le 2 Novembre 1930. Il choisit alors le de Haïlé Sélassié (« Puissance de la Trinité »), avec les titres de Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Lion Conquérant de la tribu de Judah. Il règne jusqu’à son renversement en 1974 par une révolution marxiste. Il meurt assassiné en 1975. — L’auteur, Gontran de Juniac (1908-1998) a été successivement ambassadeur de France à Addis-Abébas, Ankara et Bruxelles.
La Révolution nationale algérienne et le Parti communiste français. Tome 1 : Positions du mouvement ouvrier français et international sur les questions coloniales et l'Algérie avant la naissance du Parti communiste français (1847-1920).
Editons du Centenaire, 1974, in-8°, 238 pp, biblio, broché, bon état
Tome I seul (sur 4 parus) — "De 1920 à 1962, le Parti communiste français a-t-il respecté ou trahi la ligne ainsi tracée par Lénine dans la Huitième des Vingt et une conditions d'admission à l'Internationale communiste ? Jacques Jurquet s'est attaché à répondre à cette question, en limitant ses recherches au cas de l'Algérie..." — "Jacques Jurquet a entrepris depuis 1973 une monumentale histoire des rapports entre le communisme français et le nationalisme algérien. L'auteur conçoit son travail comme une réfutation des thèses du PCF envers le nationalisme algérien." (Benjamin Stora) — Le tome 4 : 1945-1954 n'est paru qu'en 1984.
Histoire littéraire du Peuple anglais. 1. Des origines à la Renaissance. – 2. De la Renaissance à la guerre civile.
P., Firmin-Didot, Librairie de Paris, 1904, 2 forts vol. gr. in-8°, vii-580 et 994 pp, 2e édition revue et corrigée pour le tome 1, index dans chaque volume, brochés, papier lég. jauni au tome 1, manque les pages de faux-titre et de titre du tome 1, couv. lég. salies, état correct. Peu courant
"Si nous signalons ici ce livre brillamment écrit, mais qui repose sur des recherches très variées et très solides, c'est que l'auteur a fait à la littérature anglo-normande une place que ne lui avaient pas accordée ses nombreux prédécesseurs." (Romania) — "Voici le premier volume du grand ouvrage de M. Jusserand, auquel il travaille sans relâche depuis quinze ans , l'Histoire littéraire du peuple anglais. Ce volume comprend trois livres : Les Origines (Britannia, L'invasion germanique, La poésie nationale des Anglo-Saxons, La littérature nationale des Anglo-Saxons) ; L'invasion française [La bataille, Les lettres françaises sous les rois normands et angevins, Les lettres latines, Les lettres anglaises) ; L'Angleterre aux Anglais (Le nouveau peuple, Chaucer, Le groupe des poètes, William Langland et ses visions, La prose au XIVe siècle, Le théâtre, La fin du moyen âge). Il s'arrête aux approches de la Renaissance, au moment où va s'accomplir dans toute la vie de la nation anglaise une transformation profonde, dont le tableau remplira le volume suivant. Je n'insisterai pas sur les qualités d'écrivain et de savant de M. Jusserand : elles sont connues par ses précédents ouvrages. On retrouve dans celui-ci, avec plus de variété et d'étendue, le fonds solide d'érudition que recouvre une forme brillante et souple, qu'anime un sentiment constant de la vie, qu'éclaire une rare intelligence des choses du passé ; on y admire une composition habile, en même temps que les grandes lignes de l'histoire y sont toujours mises en évidence et guident avec sûreté l'attention du lecteur. Mais la principale originalité de ce nouveau livre consiste surtout dans la fusion intime de l'histoire politique, sociale, morale, artistique avec l'histoire littéraire. La littérature, au lieu d'être considérée en soi et isolément, apparaît comme une des manifestations de l'activité multiple du génie d'un peuple, comme une des formes sous lesquelles se révèle son âme et s'accomplit son évolution, indissolublement liée à toutes les autres, conditionnée par elles et influant à son tour sur elles , les expliquant et en recevant en grande partie son explication. C'est là dans la façon d'écrire l'histoire d'une littérature une innovation capitale..." (Gaston Paris, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1894)
Introduction à l'étude comparative de l'histoire du droit public des peuples slaves.
CHAMPION, 1933, in-8°, P., Champion 1933, VIII-328p., index, grand in-8, broché (bon état).
Le Millénaire du Catholicisme en Pologne. – Poland's Millennium of Catholicism.
Lublin, Société des lettres et des sciences de l'Université catholique de Lublin, 1969, gr. in-8°, 627 pp, 16 planches hors texte, dont 4 en couleurs, reliure toile éditeur, jaquette, pt trace de choc au bas du dos, bon état. Toutes les contributions sont en français, sauf 3 en anglais et une en allemand
"Le livre du Millénaire a d'abord paru en version polonaise : trois volumes, 29 contributions (La société religieuse, l'apport de l'Eglise dans les sciences et dans l'art, l'Eglise dans le cadre de la société et de l'Etat). La version en langues étrangères a sélectionné 14 contributions, groupées en un volume unique. Les plus intéressantes de notre point de vue : Zygmunt Sulowski, “Le Baptême de la Pologne” (p. 31-86) ; Mgr Marian Rechowicz, “La pensée théologique polonaise jusqu'à la fondation de la faculté de théologie à Cracovie” (p. 223-243) ; Karol Gorski, “L'histoire de la spiritualité polonaise” (p. 279-354) ; Mgr Wincenty Urban, “L'oeuvre des missions de l'Eglise catholique en Pologne” (p. 355-409) ; Andrzej Wojtkowski, “Données historiques sur l'enseignement catholique pour laïques” (p. 461-497) ; F. Hieronim Feicht, “An Outline of the History of Polish Religious Music” (p. 499-553) ; Witold Sawicki, “Rôle de l'Eglise dans l'organisation et l'administration de l'Etat polonais avant les partages (966-1795)” (p. 555-588) ; Czeslaw Strzeszewski, “The Catholic Church in Poland and Socio-economic Problems (966-1918)” (p. 589-627). Mais l'attention sera surtout retenue par un travail collectif conduit sous la direction de Jerzy Kloczowski, professeur à l'Université et directeur de l'Institut de Géographie historique de l'Eglise, “Esquisse du développement de l'organisation ecclésiastique en Pologne” (p. 87-143) : avec huit chercheurs, J. K. a entrepris de retracer l'histoire des structures de la communauté polonaise de rite latin en terre polonaise depuis le Xe siècle, avec un intérêt spécial pour les paroisses et les familles religieuses. Ensemble, ils élaborent un atlas historique du christianisme polonais dont j'ai pu apprécier sur place la qualité, et qui permettra une connaissance toute nouvelle de la Pologne catholique." (Emile Poulat, Archives de sociologie des religions, 1970)
Princesse des rugo. Mon histoire.
Bayard, 2001, in-8°, 258 pp, broché, couv. illustrée, coins très lég. abîmés, bon état, envoi a.s.
Première mannequin noire de France, Esther Kamatari est une vraie princesse royale. Née dans la colonie belge du Burundi, l’histoire de sa famille se mélange à celui du douloureux combat vers l’indépendance. — Esther Kamatari est née en 1951 au Burundi, dans une famille du clan royal ganwa, une caste autonome. C'est la nièce du roi Mwambutsa IV. En 1962, un coup d'état militaire renverse son oncle du trône et son père est assassiné deux ans plus tard. Après six années de précarité, durant lesquelles elle poursuit néanmoins ses études à l'École Nationale d'Administration du Burundi, la jeune femme obtient son diplôme en 1969. Elle s'exile alors en France, restée depuis son pays d'adoption, et entreprend des études de droit. Révélée par Paco Rabanne, Esther devient le premier mannequin noir africain. En 1990, elle fonde l'Association des Burundais de France. En 1993, avec le ravage du Burundi à cause de la guerre civile, apparaît la vocation humanitaire d'Esther Kamatari, concrétisée par la naissance de l'association "Un enfant par Rugo" en 1995. En juillet 2004, la princesse crée avec son frère le parti Ahuza ("rassembler" en kiswahili), dans le but de se présenter aux élections de 2005. Leur projet de restaurer à terme la monarchie sera un échec.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers