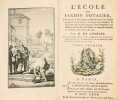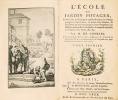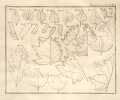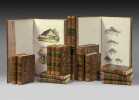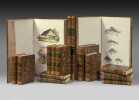Librairie Camille Sourget
93, Rue de Seine
75006 Paris
France
E-mail : contact@camillesourget.com
Phone number : 01 42 84 16 68Phone number : 06 13 04 40 72
Fax number : 01 42 84 15 54
Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages. Avec la Relation abrégée d’un Voyage fait en ce pays, pendant les années 1749, 50, 51, 52 & 53. Rare édition originale de ce récit de voyage au Sénégal par le naturaliste Michel Adanson illustrée d’une grande carte et de 19 planches gravées dépliantes.
« Cet ouvrage qui a eu un grand succès, comme le prouvent ses éditions en anglais et en allemand, reste encore aujourd’hui un grand classique de l’Histoire naturelle. » Paris, Claude-Jean-Baptiste Bauche, 1757. In-4 de (8) pp., 190 pp., (1) f., xcvi pp., 275 pp., 1 grande carte dépliante et 19 planches dépliantes. Veau marbré, triple filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, double filet or sur les coupes, tranches marbrées. Reliure de l’époque. 255 x 185 mm.
Rare édition originale de ce récit de voyage au Sénégal par le naturaliste Michel Adanson. « En 1757, Michel Adanson, jeune naturaliste de trente ans, élève de Réaumur et de Jussieu, publie son ‘Histoire naturelle du Sénégal’, livre dans lequel il apporte, après un séjour de cinq ans en Afrique, de très nombreuses nouvelles observations botaniques, zoologiques et ethnographiques. Cet ouvrage comporte une seconde partie intitulée ‘Histoire des coquillages’ qui contient, après une préface de 96 pages, 275 pages consacrées aux coquillages locaux, d’eau de mer ou d’eau douce, 19 planches de magnifiques dessins ainsi qu’une grande carte du Sénégal. Cet ouvrage qui a eu un grand succès, comme le prouvent ses éditions en anglais et en allemand, reste encore aujourd’hui un grand classique de l’Histoire naturelle. » (Bulletin de la Société pharmaceutique de Bordeaux). « ‘L’Histoire naturelle du Sénégal’, premier ouvrage de Michel Adanson (1787-1806), rassemble les observations faites au Sénégal pendant le séjour de cinq années qu’y fit ce jeune naturaliste élève de Réaumur et de Jussieu. Dans la première partie, Adanson donne une présentation complète des nouvelles plantes et des nouveaux animaux qu’il a découverts ; il rapporte également les caractères, modes de vie, mœurs et coutumes des habitants du pays. La deuxième partie, plus importante, est consacrée aux mollusques locaux et à leurs coquilles dont la description est précédée d’un chapitre proposant une nouvelle taxonomie… La mémoire de ce savant remarquable a été maintenant définitivement tirée de l’oubli et le monde scientifique s’attache à reconnaitre l’importance de l’œuvre de ce travailleur acharné que fut Michel Adanson, l’illustre auteur des ‘Familles des plantes’ et du ‘Voyage au Sénégal, à l’isle de Gorée et au fleuve Gambie’ ». (Guy Devaux, Revue d’Histoire de la Pharmacie) L’ouvrage est orné en premier tirage d’une grande carte dépliante du Sénégal et de 19 planches gravées dépliantes de mollusques et coquillages. Précieux exemplaire d’une grande fraicheur conservé dans sa reliure de l’époque parfaitement conservée.
Oiseaux dorés ou à reflets métalliques. I- Histoire naturelle et générale des colibris, oiseaux-mouches, jacamars et promerops. II- ... des grimpereaux et des oiseaux de paradis. 190 superbes estampes d’oiseaux imprimées en couleur et rehaussées d’or. L’un des 200 somptueux exemplaires du tirage de luxe au format grand in-folio avec les légendes imprimées en or.
"One of the most beautiful books of its era" (Fine Bird Books). Paris, Desray, 1802. 5 parties réunies en 2 grands volumes in-folio de : I/ (2) ff., x pp., 128, 70 planches numérotées à pleine page, 8 pp., 6 planches numérotées à pleine page, 28 pp., 9 planches numérotées à pleine page ; II/ (2) ff., 128 pp., 89 planches numérotées à pleine page (numérotées 88 car il y a une 26 bis), 40 pp., 16 planches numérotées à pleine page dont une sur double page (n°14). Soit au total 190 planches. Qs. légères piqûres sans gravité. Demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés. Reliure de l’époque. 505 x 333 mm.
Edition originale ornée de 190 estampes gravées sur cuivre d’après les dessins de Jean-Baptiste Audebert, imprimées en couleurs et rehaussées à l’or pur selon une méthode originale mise au point par Audebert. Fine Bird Books p. 56 ; Nissen IVB, 47; Ronsil 103; Wood, p. 206; Zimmer, p. 17; Sander, Illustrierten franz ö sischen Bücher des 18. Jahrhunderts, 58 ; Balis 52 ; Buchanan, Nature into Art 105 ; Copenhagen / Anker 14 ; Cottrell 19 ; Ellis/Mengel 93 ; McGilI/Wood 206. Publié en 32 livraisons sur 26 mois, le tirage fut limité à 312 exemplaires : 200 légendés en or, 100 exemplaires in-4 légendés en noir et 12 exemplaires avec le texte entièrement imprimé à l’or. L’un des très précieux 200 exemplaires de luxe tirés au format grand in-folio avec les légendes imprimées en or. Jean-Baptiste Audebert (1759-1800) mourut au cours de la publication de cette œuvre qui fut poursuivie par Louis-Pierre Vieillot (1748-1831). Il s’agit de l’une des plus importantes publications ornithologiques du XIXe siècle. L’illustration comprend 190 planches hors texte dessinées par Audebert, gravées sur cuivre par Louis Bouquet et imprimées en couleurs par Langlois, l’un des meilleurs imprimeurs en taille-douce de l’époque. Soixante-huit nouvelles espèces y sont décrites pour la première fois avec une extrême précision, "particulièrement de la Nouvelle Hollande". Audebert avait en effet sollicité collectionneurs et cabinets étrangers afin d'offrir l'ouvrage le plus complet possible. Ayant amélioré le procédé d'impression et de coloriage, Audebert avait également fait appel aux plus grands artistes de son époque. "Its plates, heightened with gold, and so finished that they are little less than hand-illuminated engravings, make this one of the most beautiful books of its era. It is the gold reflections of the plumage that render the book unique and wonderful" (Fine Bird Books). "The plates with the bird portraits are in beautiful colours; in this respect they are among the best color prints found in ornithology" Anker 14. L’ouvrage est un magnifique témoignage de l’engouement pour le livre d’ornithologie qui, né dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, s’épanouit au XIXe siècle grâce aux prouesses techniques de l’impression en couleurs. « Fleuron de cet âge d’or de l’iconographie ornithologique française, l’ouvrage de Jean-Baptiste Audebert et Louis-Pierre Vieillot a pour objet les oiseaux au plumage doré ou argenté que Buffon avait précisément renoncé à faire figurer faute de pouvoir en rendre le lustre ». (Bibliothèque nationale de France, Des livres rares depuis l’invention de l’imprimerie, n°108). Afin de restituer les effets de plumages, Audebert eut l’idée d’appliquer, [...] après l’impression de la couleur, un fin réseau de petits traits dorés ou argentés. Ainsi rehaussé, le plumage de l’oiseau devient étincelant et change de couleur et d’aspect suivant l’angle de vue sous lequel on l’observe. Une surprenante prouesse technique dont on ignore encore le procédé tenu secret » (Michel Schlup, Les grands livres d’oiseaux illustrés de la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, p. 85, article publié en 2000 dans la Revue de la Société suisse des bibliophiles). “On most of the plates, even the gold was applied mechanically and not by hand, with the effect that the plates « look like medieval illuminations »” (Buchanan). Le tirage in-folio avec les légendes en or est fort rare (200 exemplaires en 1802) et très recherché. Le 7 juin 1989, il y a 32 ans, l’exemplaire Bradley Martin en demi-reliure usagée était adjugé $44,000 par Sotheby’s New York. Le 16 juin 1988, l’exemplaire Marcel Jeanson relié par Bozérian était estimé avec frais 222 000 FF - 333 000 FF (33 800 € - 50 760 €), il y a 33 ans. Superbe exemplaire de l’un des plus beaux livres consacrés aux oiseaux, très grand de marges et conservé dans sa reliure de l’époque.
Les champignons de la province de Nice et principalement les espèces comestibles, suspectes ou vénéneuses dessinés d’après nature et décrits. Édition originale du premier ouvrage de l'auteur, illustré de 48 planches lithographiées en couleurs et rehaussées à la gomme arabique.
La présente iconographie est illustré de 48 planches lithographiées en couleurs et gommées d'après les dessins de l’auteur. Nice, imprimerie Canis frères, 1859. In-4 oblong de (1) f., lv pp., 138 pp., (1) f., 48 planches hors-texte en couleurs. Relié en percaline verte, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées. Reliure de l’époque. 263 x 345 mm.
Édition originale du premier ouvrage de l'auteur, consacré aux champignons de sa région natale. Pritzel, 410 ; Jackson, 288 ; Volbracht 59 ; Uellner 50 ; Stafleu 309 ; Nissen 77 ; Stiftung für Botanik 27. Fils et petit-fils de commerçants fortunés niçois, Jean-Baptiste Barla (1817-1896) s'intéresse dès son enfance à l'histoire naturelle et plus particulièrement à la flore de sa région, avec un intérêt marqué pour les champignons et les orchidées. Il fut l'élève d'Antoine Risso et fonda le Muséum d’histoire naturelle de Nice, auquel il légua ses collections comportant des milliers de champignons. « Nous devons une mention toute particulière au magnifique livre de M. Barla, directeur du Musée de Nice, dans lequel le savant mycologue italien a fait connaitre les Champignons de la province de Nice (1 vol. grand in-4, 1859), et principalement les espèces comestibles, suspectes ou vénéneuses. Les planches représentant toutes les espèces décrites ont été dessinées par l’auteur dans leurs divers états de développements avec un soin scrupuleux et coloriées avec une fidélité qui ajoute à l’intérêt incontestable attaché à ce bon et bel ouvrage. Les champignons de la province de Nice devraient être dans les mains de tous les amis de l’humanité et de tous les gens du monde. » La présente iconographie est illustré de 48 planches lithographiées en couleurs et gommées d'après les dessins de l’auteur. Précieux exemplaire portant un envoi autographe signé de l'auteur sur le faux-titre : « A l’Académie Mont-Réal. Hommage de l’Auteur. J.B. Barla », conservé dans sa reliure de l’époque.
Les Merveilles des Indes Orientales et Occidentales ou nouveau traitté des Pierres précieuses et perles, contenant leur vray nature, dureté, couleurs et vertus : Le tiltre de l’Or et de l’Argent. Les raisons contre les chercheurs de la Pierre Philosophale et souffleurs d’Alquemie… du prix des Diamants, & des Perles. Les pierres précieuses, perles, diamants, saphirs, topaze, rubis, émeraudes, etc…, leur prix « dédié A la Grande Mademoiselle, Duchesse de Montpensier ».
Edition ornée du portrait aux perles et collier de la Duchesse de Montpensier, dessiné par Larmessin en 1664. Paris, 1669. In-4 de (4) ff., 1 portrait et 152 pp. Maroquin olive, double encadrement de filets dorés sur les plats orné de motifs latéraux aux petits fers et d’un décor central composé d’un cœur percé d’une flèche ceint de petits fers dorés, dos à nerfs fleurdelysé, tranches mouchetées. Reliure de l’époque. 219 x 155 mm.
Rarissime et précieux volume consacré aux pierres précieuses et à la joaillerie et traitant des différentes pierres telles que diamant, saphir, topaze, rubis, émeraude, perles, or et argent. Sabin, 4957 ; Palau, 28.340 ; Penney, p.59 ; Goldsmith, 1921 ; Duveen, 71. L’un des ouvrages les plus intéressants concernant les pierres précieuses et la joaillerie. Cette seconde édition est plus intéressante que la première de 1661 car, elle est augmentée d'un « prix courant » pour les diamants et les perles et du chapitre « contre la fausse Pierre Philosophale et souffleurs d Alquemie » et une « Suite du chapitre de la perle » qui a trait à l'Amérique du Sud (Palau II, 194). Robert de Berquen était marchand orfèvre à Paris. « In terms of substance, this edition is considerably superior to the first; both are rare » (Sinkankas). « Svitte du chapitre de la Perle, comme elle fe pefche, & par quy, & autres chofes qui fe font paffées dans la Merique depuis l’Hiftoire de Francifque Coulombe. Vous, remarquerés Lecteur, Que les Perles que l’on voit à prefent qui font iaulnes, la nature ne les a pas créés imparfaites, comme nous les voyons, car s’il s’en voit tant rondes que autres qui font tellement iaulne que vous diriés que c’eft de l’Ambre iaulne, c’eft que deuant que les Efpagnols euffent conquis la Merique, qu’ils appellent à prefent la neufue Efpagne, il y à la riuiere de la Marguerite qui trauerfe une partie du Pays, & va rendre dans la mer, le reflus faifoit qu’il s’y pefchoit anciennement quantiré d’huitres dans cette riuiere, & les Indiens qui les pefchoient les faifoiet bouillir dans des chaudrons d’or où d’argent, car il n’y auoit point de cuiure, ny de laton, ny d’eftain, ny de plomb en ce pays là, les Efpagnols y en ont porté quantité depuis, comme des Chenets, des Chaudrons, des Chandeliers, & autres chofes de laton, les Indiens leur en donnoient le poids de l’or en efchange. Et pour ce qui eftoit de l’eftain qui eftoit en ouuraf et faits, comme Baffins, Plats Efcuelles leur en bailloient la pefanteur d’Argent ; tellement qu’en faifant cuire les fuiftres dans l’eau bouillante la chaleur leur faifoit venir cette couleur, ils les aymoient mieux de cette couleur que blanche à caufe qu’ils ont la chair grifattre, & la iaulneur de ces Perles leur faifoient paroiftre la chair plus blanche, & les Perles qui fe pefchoient anciennement dans cette riuiere eftoient plus belles que les autres ; c’eft pourquoy quant quelqu’un auoit de belle Perles à vendre il difoit elle font de la Marguerite, mais à prefent il n’y en a plus, car depuis les Efpagnols y font elle a tellement efté pefchée que l’on en a ofté la fource, & l’on à beau y traifner les grilles & des rateaux dans cette riuiere il ne s’y en trouue plus, car l’on n’oferoit ny beigner ny plonger dans icllee riuiere à caufe de la quantité de Cocodriles qui font dedans. » Belle édition dédicacée à la grande mademoiselle, duchesse de Montpensier, « seule fille de Gaston d’Orléans et de Marie de Bourbon », née en 1627. Elle est ornée de son portrait dessiné par Larmessin en 1664 rehaussé de son collier de perles. La présence peu banale sur cet ouvrage d’une reliure en maroquin, celle plus rare encore des fleurs de lys ornant le dos du volume, le cœur percé d’une flèche au centre des plats répondant à la dédicace où l’auteur supplie Mademoiselle de considérer la rareté des choses contenues dans ce livre et « le cœur de celuy qui la luy présente »…, la signature autographe du lieutenant de Police de Louis XIV, Nicolas Gabriel de La Reynie, nous permettent de considérer cet exemplaire comme un Présent de l’auteur à la Grande Mademoiselle. Provenances : La Grande Mademoiselle, Duchesse de Montpensier, née en 1627 ; Gabriel de La Reynie, premier lieutenant général de police de Paris (1625-1709) et Madame la Duchesse de Vendôme.
Kreutterbuch darin vnderscheidt Name(n) vnnd würckunng der Kreutter, Stauden, Hecken vnd Beümen, sampt iren Früchten, so inn Teütschen Landen wachsen... auB langwiriger vnnd gewisser erfahrung beschriben. Vnd jetzund von newem fIeiBig vbersehen, gebessert vnd gemehret... Le célèbre herbier de Bock de 1572 orné de plus de 500 gravures en coloris de l’époque.
Précieux exemplaire à grandes marges conservé dans sa belle reliure de l’époque. Strasbourg, Josias Rihel, 1572. In-folio de (20) ff., 369 ff., (17) ff. Qq. rousseurs et brunissures, qq. mouillures marginales, dernier f. déchiré sans manque. Peau de truie estampée à froid, trois frises d’encadrement sur les plats, attaches conservées. Reliure estampée à froid de l’époque. 319 x 204 mm.
Précieuse et fort rare édition imprimée et coloriée à la main à Strasbourg en 1572 du célèbre herbier de Bock orné des centaines de gravures sur bois bien connues de David Kandel : marque d’imprimeur sur le feuillet de titre, portrait de l’auteur et plus de 500 gravures dans le texte entièrement rehaussées de couleurs à l’époque. Le premier herbier méthodique du XVIe siècle. VD 16, B 6021 ; IA 120.597 ; Heilmann 193 ; Muller III, 519,137 ; Nissen, BBI 182 ; Stafleu/C. 575 ; STC 130 ; Pritzel 866, Jourdan, Biog. médicale, F. Ritter, Repr. bibliog. des livres imprimés en Alsace au xviè siècle, 1934, 219 ; Arber, Herbals, 1938, 59 et 221. Pasteur Luthérien, Jérôme Tragus, dit Bock (1498-1554), pratiquait également les fonctions de médecin et d’apothicaire. Exilé à Sarrebruck, à la suite des troubles religieux, il devint médecin à la cour du Comte de Nassau. Bock figure au premier rang des restaurateurs de la botanique au XVIe siècle. Ses études des plantes résultaient d’observations effectuées sur le vif, dans la nature, au cours de fréquentes excursions dans les Ardennes, les Vosges, le Jura, les Alpes Suisses et les bords du Rhin. « Bock est le second des fondateurs germaniques de la Botanique... Ses descriptions de fleurs étaient remarquablement claires… il prenait en considération des éléments que ses prédécesseurs avaient complètement ignorés. Il reconnaissait la corolle, les étamines et les pistils comme parties essentielles de beaucoup de fleurs et il est probablement le 1er botaniste du XVIe, siècle à avoir compris la nécessité d’une classification. » Hunt. « Ce fut lui qui, le premier introduisit dans la botanique une certaine méthode dont on ne trouve encore aucune trace ni dans Brunfel ni dans Fuchs. » (Jourdan, Biographie médicale.) Le « New Kreutter Buch », grand ouvrage de Jérôme Bock, vit le jour à Strasbourg en 1539. Loué pour ses admirables descriptions, il ne comportait cependant aucune illustration. Toute la partie iconographique du recueil fut confiée au peintre de fleurs David Kandel qui conçut et exécuta ainsi plus de 500 dessins de botanique, gravés sur bois dans l’ouvrage, certains avec monogramme de l’artiste. La plupart de ces planches, parues en 1546, étaient originales ; quelques-unes étaient inspirées de Brunfels et Fuchs. La 4ème partie posthume de l’ouvrage, d’un remarquable intérêt documentaire par son panorama des métiers du temps, ne fut adjointe au recueil que dans l’édition de 1556. Belle édition gothique strasbourgeoise ornée de plus de 500 gravures sur bois, dont la richesse iconographique manifeste est magnifiée dans l’exemplaire par les teintes douces dont un aquarelliste a revêtu, à l’époque, chacune des estampes. Beaucoup des gravures sur bois reprennent la présentation assez classique d’un herbier du XVIe siècle. Certaines, empreintes de fantaisie, sont cependant prétexte pour l’auteur à la représentation d’une scène animalière ou d’une scène animée, sur fond d’arbre ou de plante : Homme assoupi sous la Vigne. Porcs conduits à la glandée sous un chêne. Bergers sous un hêtre. Danse villageoise, cigognes, cueillette des cerises, cueillette des noix par femme parée... Plusieurs gravures sur bois, d’un grand intérêt, sont consacrées à un panorama de différents métiers du temps : forgeron, travaux des champs, traite des vaches et fabrication du beurre, ruches à miel, purification du sel, boulanger, pressoir, mise du vin en tonnelets, vente des œufs et basse-cour, boucher, fabrication du boudin, étal de poissons, épicier, marché villageois, repas bourgeois… Très bel exemplaire en séduisante reliure de l’époque en peau de truie estampée à froid sur ais de bois, avec les fermoirs conservés, magnifié par le coloris main de l’époque.
Iconographie des pigeons non figurés par Mme Knip (Mme Pauline de Courcelles) dans les deux volumes de MM. Temminck et Florent Prévost. Un grand livre de chasse et d’ornithologie consacré aux pigeons.
Edition originale de l’un des plus beaux livres de chasse et d’ornithologie consacré aux pigeons, orné de 55 estampes coloriées à la main à l’époque. Paris, P. Bertrand, 1857 (1858).Grand in-folio de (123) ff., 55 planches en couleurs à pleine page dans le texte. Relié en demi-maroquin bleu, titre frappé en lettres d’or sur le dos lisse, couverture de la 3è livraison reliée à la fin. Reliure du XXe siècle.550 x 360 mm.
Edition originale de l’un des plus beaux livres de chasse et d’ornithologie consacré aux pigeons, orné de 55 estampes coloriées à la main à l’époque gravées d’après les dessins de Paul-Louis Oudart, F. Willy et E. Blanchart, imprimées par Lemercier.Brunet, I, 1087 ; Nissen IVB, 117 ; Ronsil, p. 58 (donne par erreur 57 planches) ; Sitwell 79 ; Ayer/Zimmer 78 ; Fine Bird Books, 60 ; Mc Gill/Wood 248.Cette œuvre avait à l’origine pour but de compléter « Les Pigeons » de Madame Knip mais sa beauté en fit tout de suite une œuvre indépendante et originale.Ce traité fut édité par A. Moquin Tandon, un ornithologiste distingué, membre de l’Institut.Le prince Bonaparte avait planifié le projet en 30 livraisons et 150 estampes mais sa mort survenue après la publication de la 4e livraison laissa le manuscrit et les estampes inachevés ; ce qui explique l’irrégularité de numérotation des planches.Stiwell dans Fine Bird Books, l’ouvrage de référence, considère ce livre comme fort beau et lui décerne 2 étoiles.Considered among the finest books ever published on the subject of pigeons, this work was intended to form a supplement to Mme. Knip's Les Pigeons but “ranks as a completely separate work” (Fine Bird Books).“The hand-colored bird portraits are extremely fine.” (Mc Gill/Wood).L’illustration se compose de 55 superbes planches lithographiées et coloriées à la main à l’époque.
Le Jardinier françois, qui enseigne à Cultiver les Arbres, & Herbes Potagères ; Avec la manière de conserver les Fruicts, & faire toutes sortes de Confitures, Conserves, & Massepans. Dédié aux dames. Seconde édition corrigée & augmentée par l’Auteur. Un des ouvrages emblématiques des évolutions du goût culinaire en France au mitan du 17ème siècle.
«Très bel exemplaire dans une charmante reliure de cet intéressant ouvrage de Nicolas de Bonnefons, valet de chambre du Roi Louis XIV» (Bulletin Morgand, 1893, n° 23436). Paris, Pierre Deshayes, 1651. In-12 de 1 frontispice, (24) pp., 380 pp., (2), 3 planches hors texte à pleine page. Maroquin rouge, décor doré sur les plats en variante de l’encadrement à la Duseuil, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Trautz-Bauzonnet. 135 x 75 mm.
Seconde édition originale augmentée par rapport à la première parue cette même année 1651. Elle est si rare que Vicaire ne la connait pas. «Personnage à la fois introduit à la cour, où il porte le titre de valet de chambre du Roi, et propriétaire rural faisant commerce d’arbres et de graines, Nicolas de Bonnefons est l’un des principaux représentant de la vogue d’horticulture et de culture potagère qui gagne la société française au cours du 17ème siècle. Son Jardinier françois connaît un grand succès de librairie dès l’édition originale de 1651 et sera continûment réédité sans grand changement jusqu’en 1737. Si les deux premières parties du livre traitent respectivement de la culture des arbres fruitiers et de celle des jardins potagers, la troisième et dernière consiste en un traité de confiture. Sa principale originalité par rapport aux autres confituriers du 17ème siècle tient à la place accordée à la conservation des fruits sans préparation particulière: l’ouvrage s’ouvre par un long discours d’économie domestique exposant la manière de construire un fruitier et les façons diverses d’y conserver les fruits en leur naturel, selon leurs variétés, après quoi vient un chapitre consacré aux fruits que l’on sèche naturellement, sans les réduire en pâte. La suite du traité appartient davantage à l’art du confiseur à proprement parler, en proposant aussi bien des recettes de confitures que des recettes de pâtes de sucre permettant de contrefaire diverses figures d’aliments et de fruits – art d’illusion qui contribuait grandement au prestige des collations ou du service final du fruit dans les festins.» (Jean-Marc Chatelain). «Frontispice gravé, les 13 ff. limin. sont occupés par le titre, «l’épistre aux dames » signée : RDCDWBDN et datée de Paris, le 1er juillet 1651, la «préface au lecteur», et la table. Les initiales sont, à rebours, celles des prénom, nom et qualité de l’auteur, Nicolas de Bonnefons, valet de chambre du Roi. Le Jardinier françois est orné, en plus du frontispice, de trois figures, gravées par Chauveau, placées en tête de chacun des trois traités qui le composent. La première qui représente un jardin potager dans lequel travaillent des jardiniers et se promènent un seigneur et une dame, se trouve avant la page1; la seconde représentant un jardin, avant la page 117; et la troisième montrant un intérieur de cuisine, avant la page 245. Le premier traité occupe les pages 1-116; le second, les pages 117-244, et le troisième les pages 244 à 380. Ce dernier a rapport aux fruits, à leur conservation, aux confitures sèches et liquides, ainsi qu’aux «massepans» et aux macarons. Le privilège est imprimé au dernier feuillet (recto et verso); il est daté du «12ème jour de Iuin 1651» et l’achevé d’imprimer du «premier iour de Iuillet» de la même année. Il faut croire que le succès du Jardinier françois fut grand, car, paru pour la première fois en 1651, il en était déjà, deux ans plus tard, à sa quatrième édition, ainsi qu’on peut le voir sur le titre de l’édition suivante.» (Vicaire). Un des ouvrages emblématiques des évolutions du goût culinaire en France au mitan du 17èmesiècle. L’agronome Nicolas de Bonnefons est «un des principaux représentants de la vogue d’horticulture et de culture potagère qui gagne la société française au cours du 17ème siècle» (Jean-Marc Chatelain, dans Livres en bouche, Paris, BnF, Hermann, 2001, p. 147). Or c’est dans le milieu des agronomes que s’opérèrent les mutations les plus décisives dans la cuisine française au début du règne de Louis XV, dans le sens d’une «promotion inédite de la notion de saveur naturelle, obtenue par une meilleure exploitation des ressources du jardin et du verger» (op. cit., p. 120). Son ouvrage aborde ainsi ces deux aspects qu’il lie étroitement: les deux premières parties sont consacrées à la culture des arbres fruitiers et à celle des jardins potagers, tandis que «la troisième et dernière consiste en un traité de confiture. Sa principale originalité par rapport aux autres confituriers du 17ème siècle tient à la place accordée à la conservation des fruits sans préparation particulière [… Cette troisième partie] appartient davantage à l’art du confiseur à proprement parler, en proposant aussi bien des recettes de confitures que des recettes de pâtes de sucre permettant de contrefaire diverses figures d’aliments et de fruits – art d’illusion qui contribuait grandement au prestige des collations ou du service final du fruit dans les festins». (op. cit., n° 120, pour l’édition originale). La présente édition est ornée de 4 jolies figures gravées en taille-douce signés par François Chauveau, dont une placée en frontispice. Très bel exemplaire en maroquin signé de Trautz-Bauzonnet. Provenance: Des bibliothèques Huth; Alfred Henry Huth; James Toovey; le diplomate Michel Pierre Antoine Laurent Agar, comte de Mosbourg (vignette ex-libris au verso de la première garde volante); puis Bulletin Morgand 32 n° 23436.
Anthologia magna, Sive Florilegium novum & absolutum, variorum maximeque rariorum Germinum, Florum ac Plantarum, quas pulchritudo… Edition originale complète conservée dans sa pure reliure en vélin ivoire de l’époque à recouvrement.
Les exemplaires complets, tel celui-ci, des œuvres florales de Jean-Theodrore de Bry conservés dans leur pure reliure de l’époque sont très rares. Francofurti, in off. Brÿana, 1626. In-folio de (6) ff., titre finement gravé (avec une fontaine au centre, des pots de lys et de cyclamens et des guirlandes de fruits ornent la structure), illustré de 142 planches gravées (dont 5 dépliantes), numérotées de 1 à 23 et de 1 à 116. Les numéros 37 et 50 ont été utilisés deux fois, la dernière planche n'a pas de numéro. De nombreuses plantes non-européennes apparaissent dans le Florilegium novum... D'autres planches montrent des exemples de "monstruosités" qui étaient cultivées dans les jardins baroques. Reliure en vélin de l'époque, taches sur le plat inférieur, titre à l'encre sur le dos. 313 x 195 mm.
Edition originale. Pritzel 1299 ; Nissen BBI, 273 ; De Belder 92. Cet ouvrage est largement basé sur le Florilegium novum de l'auteur, 1612, qui comporte 87 planches qui réapparaissent ici. Exemplaire complet de l'un des plus célèbres et influents des premiers florilèges, publié pour la première fois en 1612 avec seulement 87 planches. « L'art inégalé pour lequel de Bry était renommé dans toute l'Europe apparaît clairement dans les planches de ce florilège. Chacune d'entre elles a été composée avec soin, et le trait assuré de la gravure, avec ses fines nuances, dénote la main d'un véritable maître. » « De nombreuses figures sur les planches sont des copies (à l'envers) du Jardin du Roy de Pierre Vallet, 1608, avec la suppression de certains des insectes montrés dans le Vallet, et avec l'ajout de bulbes pour certaines des plantes. Nissen... mentionne l'Hortus Eystettensis de Besler, 1613, et l'Hortus Floridus de Van de Pas, 1614, comme autres sources de l'œuvre ultérieure de De Bry » (Hunt). Jean-Théodore de Bry, né à Liège en 1561, mort à Francfort en 1623 fut un graveur habile, lequel, suivant Heinecken, surpassa son frère et même son père. Il a dessiné et gravé des fleurs pour le Florilegium novum, Francfort, 1612-18, 3 vol. in-folio. ; réimprimé en 1641, à Francfort, chez Merian, sous le titre de Florilegii renovati et aucti ; et pour l’Anthologia magna, 1626, ou 1692, in-folio : ces figures ont été utiles aux brodeurs et aux fabricants de papiers peints ainsi qu’aux botanistes. Les exemplaires complets, tel celui-ci, des œuvres florales de Jean-Theodore de Bry conservés dans leur pure reliure de l’époque sont très rares. L’exemplaire de Belder du Florilegium Renovatum de 1641 en coloris ancien « engraved title, B1-3 and the double-page garden plate skilfully remargined, a little worming in lower margins of last few plates ; recently expertly rebacked preserving original spine (extremitites very lightly rubbed) » fut adjugé GBP 181 250 le 23 octobre 2010. Superbe exemplaire complet de l’édition originale de 1626 conservé dans sa pure reliure de l’époque en vélin ivoire à recouvrement.
Le Grand Jardin de l’Univers, où se trouvent coloriées, les Plantes les plus Belles, les plus curieuses et les plus rares des quatre parties de la Terre, formant la continuation de l’Herbier de la Chine, de la Collection des Fleurs de la Chine et de l’Europe, des dons merveilleux dans le règne végétal et du jardin d’Eden. - [Suivi de] : Nouveau Traité physique et économique, par forme de dissertations, de toutes les plantes qui croissent sur la surface du globe... 234 superbes planches de fleurs, finement aquarellées à l’époque.
Edition originale extrêmement rare de cet ouvrage, complet des deux parties et de 200 belles planches gravées et finement rehaussées. 2 ouvrages en 2 volumes grand in-folio de : I/ (1) titre, 100 planches hors texte à pleine page, (1) f. de table, (1) titre, pl. 101 à 200, (1) f. de table ; II/ (2) ff., 25 planches accompagnées de leur texte explicatif, (2) ff., 9 planches. Premier volume en demi-maroquin rouge à encadrement, dos à nerfs orné d’entrenerfs mosaïqués en maroquin vert, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, encadrement de frises et filets dorés sur les bandes de maroquin bordant les plats, coupes décorées, guirlande dorée sur les chasses ; second volume dans une reliure homogène, demi-maroquin à coins, dos à nerfs orné d’entrenerfs en maroquin vert, pièce de titre et de tomaison en maroquin vert. Reliures homogènes de l’époque. 425 x 273 mm.
I – Edition originale extrêmement rare de cet ouvrage, complet des deux parties et de 200 belles planches gravées et finement rehaussées. Dunthorne 67 ; Great Flower Books p. 81 ; Nissen BBI 289 ; Pritzel 1331 ; Stafleu 891. Ouvrage extrêmement rare. Stafleu ne mentionne que deux exemplaires dans les institutions : le Natural History Museum de Londres, avec un exemplaire complet, et l'Herbarium du New York Botanical Garden, avec un exemplaire du premier volume seulement. "Cet ouvrage de M. Buchoz ne se retrouve pas souvent en vente". (Dictionnaire bibliographique, historique, et critique des livres rares..., p. 70) Pierre Joseph Buchoz (1731-1807), médecin agrégé à la Faculté et au Collège royal de médecine de Nancy, médecin-botaniste de Monsieur, ancien médecin de feu Sa Majesté le Roi de Pologne et de Monseigneur le Comte d'Artois... a publié pas moins de 500 ouvrages, devenus très rares, dont son célèbre Jardin d'Eden décrivant les plantes acclimatées et cultivées dans les jardins de la Reine à Trianon. Du Cap de Bonne Espérance à la Guyane, de la Chine au Canada et de l'Afrique à la Sibérie, les voyageurs rapportent des graines et des plantes que les jardiniers de Richard, père et fils, acclimatent dans les serres de Trianon, situées à l'emplacement de l'actuel jardin anglais de Versailles. Très proche de la cour, Buchoz rend compte des expériences scientifiques et botaniques des princes qu'il a le privilège de fréquenter. Pierre-Joseph Buchoz, originaire de Metz, est avocat, puis médecin et démonstrateur au Collège royal des médecins de Nancy. Il publie des ouvrages d'histoire naturelle dans l'esprit encyclopédique de l'époque. Aujourd'hui, ses livres sont très recherchés pour la beauté des estampes enluminées qui les accompagnent. Gravures à pleine page, en superbe coloris de l’époque. Les 200 planches qui constituent cet herbier représentent les plus belles fleurs, les plus curieuses et les plus rares des quatre parties du monde. II- Précieux recueil de 44 essais illustrés de 34 planches botaniques graveés et aquarellées. Buchoz a conçu son ouvrage comme "la quatrième partie de l'histoire générale et économique des trois règnes de la nature", mais dans le même temps il vendit ses essais à la pièce. Chacun pouvait composer un exemplaire à sa guise, si bien qu'il n'y en a pas deux identiques. Les dissertations peuvent être consacrées à une plante particulière ou à des sujets médicaux, les 5 dernières en latin. Cet exemplaire contient des dissertations sur le Pain des hottentots, Douce-amère, Vigne, Vin, Ellébore, Tourette, Lin de Sibérie, Calonne, Aristoloche, Breteuil, Besenval, Acacia de Constantinople, le supplément à la dissertation sur le café, Aron ou pied-de-veau, Quinquina, Albon, Trochereau, Lathrée, Willemetia, Digitale purpurine, Hélianthe, Toxicodendron, Buis, Ornithogalle, Narcisses, Dalechamp, Jacinthes, terre-nois, châtaigne d'eau, trèfle d'eau, etc. Superbe exemplaire de ce précieux herbier, conservé dans ses reliures uniformes de l'époque en demi-maroquin rouge finement décoré. Aucun exemplaire complet du Grand Jardin de l'Univers n'a été répertorié sur le marché depuis le début des années 1950.
Histoire générale des Animaux, des Végétaux et des Minéraux qui se trouvent dans le Royaume Représentés en Gravure et dessinés d’après nature […]. Rarissime suite de 38 estampes de sciences naturelles entièrement aquarellées à l’époque.
Seule et unique édition de la plus grande rareté de cette suite d’estampes de sciences naturelles, imprimée à compte d’auteur, par Pierre Joseph Buchoz. Paris, Chez l’auteur, Chez Debure, [1776]. In-folio comportant un titre gravé et 38 planches. Qq. taches. Brochure d’origine. Boite de protection en toile bleue moderne. 455 x 288 mm.
Seule et unique édition de la plus grande rareté de cette suite d’estampes de sciences naturelles, imprimée à compte d’auteur, par Pierre Joseph Buchoz (1731-1807). Conlon 76/768; pas dans Nissen ni dans Brunet. Elle comporte 38 superbes planches coloriées à la main à l’époque représentant des animaux sauvages et domestiques, toutes accompagnées d’un texte décrivant leur habitat, leurs habitudes et leur physionomie. Ces planches ressemblent pour certaines à celles dessinées par Buffon mais le texte est complètement différent. Conlon explique que cet ouvrage fut publié en 1776. Il parut en fait sous forme de livraisons de 8 à 10 planches chacune. Nissen liste sous la référence «Buchoz, Les dons merveilleux et divertisement coloriés de la nature dans le règne animal» (1782) un ensemble de planches (32 planches) ‘Quadrupèdes de France’ qui pourrait être un retirage partiel de cet ouvrage. “Very scarce. Tome I contains an introduction to the history of the quadrupedes. Bibliographical references: CBN: 20, col. 1147-75. • LKG: XIV 332b*”. (P. Schuh, Annotated Bio-Bibliography of Mineralogy and Crystallography 1469-1919). «Ce premier Cahier que nous avons sous les yeux, contient dix Planches représentant le cheval, l’âne, la vache du Cotentin, le bouc & la chevre, le cerf, la biche & son faon, l’ours, les chauves-souris, dites fer à cheval, & celles qu’on nomme Oreillard & Noctule. Ces gravures nous paroissent rendre la nature avec une grande vérité. M. Buchoz, l’un des plus laborieux Naturalistes qui ayent existé, donne fréquemment de nouvelles preuves de son zele & de sa fécondité par des productions qui se succedent dans des intervalles assez courts: elles contiennent un nombre considérable de Planches qui ont dû occasionner de très grands frais. Ce qui distingue singulièrement les travaux de cet Auteur, & ce qui rend en même temps ses Ouvrages très nombreux & très volumineux, c’est qu’il ne se contente pas de faire de simples descriptions des productions de la nature, il entre dans de fort grands détails sur leurs usages, sur l’utilité qu’on en retire dans la Médecine & dans tous les arts: ainsi, si d’un côté ces détails rendent l’histoire naturelle plus intéressante, ils ne peuvent manquer de l’autre d’étendre infiniment cette science déjà immense par elle-même. Le nombre des Ouvrages de M. Buchoz qui a embrassé une si vaste matiere, n’a donc rien d’étonnant, si ce n’est le courage & l’activité dont cet Auteur a besoin pour suffire à de si grands travaux.» (Journal des Scavans, 1788, 398-400). Précieux exemplaire de ce très rare ouvrage de zoologie conservé tel que paru dans sa brochure d’origine.
Histoire naturelle, générale et particulière. Les Oiseaux. Les Oiseaux de Buffon, complets en 18 volumes, illustrés de 114 planches d’oiseaux imprimés en 1785-1787, reliés en élégant cartonnage de l’époque.
Collection complète des 18 volumes d’oiseaux parus dans cette édition de 1785-1787 ornée de 114 planches d’oiseaux. Aux Deux-Ponts, chez Sanson & Compagnie, 1785-1787. 18 volumes in-12. I/ xxxiv pp., (1) f., 256 pp., (1) f., 12 planches hors texte dont 2 en couleurs; II/ 264 pp., 11 planches hors texte; III/ 305 pp., 6 planches hors texte dont 1 en couleurs; IV/ 299 pp., 8 planches hors texte; V/ 372 pp., 7 planches hors texte; VI/ 199 pp., 153 pp.de table, 4 planches hors texte; VII/ 336 pp. (relié à l’époque sans la p. 325), 3 planches hors texte; VIII/ 339 pp., li pp. de table, 7 pp. de table, 5 planches hors texte; IX/ 377 pp., 5 pp. de table, 6 planches hors texte; X/ 246 pp., L pp. de table, 4 pp. de table, 3 planches; XI/ 400 pp., 8 pp. de table, 6 planches; XII/ 391 pp., 6 pp. de table, 4 planches hors texte; XIII/ 370 pp., 6 pp. de table, 6 planches hors texte; XIV/ 299 pp., xviii pp., 6 pp. de table, 5 planches; XV/ 349 pp., 6 pp. de table, 7 planches hors texte; XVI/ 258 pp., 3 pp. de table, 7 planches; XVII/ 385 pp., (3) pp. de table, 10 planches; XVIII/ 110 pp., cxlix pp. de table, (3) pp., 4 planches hors texte. Soit 114 planches au total. Plein cartonnage marbré de l’époque. 165 x 98 mm.
Collection complète des 18 volumes d’oiseaux parus dans cette édition de 1785-1787 ornée de 114 planches d’oiseaux. Cette œuvre majeure de Buffon valut à celui-ci d'être admiré dans l'Europe entière et de connaître une célébrité égale à celle de Voltaire et de Rousseau. Buffon conçut le plan de cette œuvre grandiose lorsqu'il fut nommé Intendant du Jardin du Roi. Il fit collaborer un certain nombre d’hommes de sciences à cette vaste entreprise encyclopédique tels Daubenton, Guineau de Montbéliard ou Faujas de Saint-Fond. Dès la parution des premiers volumes « L’Histoire naturelle » connut un succès retentissant. On appela Buffon « le Pline et l'Aristote de la France » et on lui éleva une statue de son vivant. L'ouvrage apparut à juste titre comme un des monuments de la science moderne et du réveil des esprits au même titre que « l 'encyclopédie » qui lui est contemporaine. Il mit à la mode la science d'observation et suscita immédiatement un intense développement des sciences naturelles. « L 'Histoire naturelle » incontestablement appartient au siècle des Lumières. Buffon s'y révèle à de multiples égards un précurseur. Il éclaire de vues pénétrantes les avenues nouvelles où la science après lui va s'engager : écologie, éthologie, biogéographie, paléontologie, anatomie comparée, transformisme. Ses idées sur l'Homme et l'espèce humaine dont il affirme l'unicité et son insistance sur le rôle du temps dans l'histoire de la terre et de la vie, en font un esprit étonnamment « moderne ». Yves Laissus. Dix siècles de lumière par le livre. En français dans le texte, n° 153. Précieux ensemble des 18 volumes reliés en élégant cartonnage de l'époque.
Œuvres
Exemplaire remarquable complet de ses 150 estampes en éclatant coloris de l’époque enrichi du dessin original de l’une des estampes. Paris, 1853-1855. Buffon, Georges Louis Leclerc, Comte De. Œuvres Complètes, avec la nomenclature linéenne et la classification de Cuvier, Revues sur l’édition in-4 de l’Imprimerie royale et annotées par M. Flourens. Nouvelle édition illustrée de 150 planches gravées sur acier d’après les dessins de MM. Traviès et Henry Gobin et coloriées avec le plus grand soin. Édité par Garnier Frères, Paris, 1853-1855. 12 volumes in-4. Demi chagrin rouge à coins, têtes dorées. Reliure de l’époque. 277 x 183 mm. L'une des plus complètes et des meilleures éditions publiées au XIXe siècle, ornée d'un portrait de Buffon gravé par Giroux, d'un frontispice dessiné par Staal et gravé par Delaunay montrant "L'homme et la Femme", de 4 cartes, et de 144 gravures hors-texte sur acier représentant 800 sujets, ces dernières finement coloriées à la main la plupart d'après les dessins de Traviès. Nissen ZBI 704; Brunet, I, 1379 (mentionne 166 planches alors que la liste des planches reliées à la fin de l’ouvrage en liste bien 150). Cette édition (avec la Nomenclature Linéenne et la Classification de Cuvier) est annotée par M. Flourens et revue sur l'édition in-4° de l'Imprimerie Royale. Ouvrage orné de nombreuses planches en couleurs hors-texte sous serpente. Tome I: (2) ff., 686 pages. Théorie de la Terre - Histoire Générale des Animaux. Portrait de Georges Louis Leclerc Comte de Buffon, gravé par Émile Giroux, 2 Cartes en couleurs hors-texte, 3 planches hors-texte. Tome II: (2) ff., 667 pages. L'Homme - Les Quadrupèdes. 1 frontispice et 22 planches hors-texte. Tome III: (2) ff., 597 pages. Les Quadrupèdes. 19 planches hors-texte. Tome IV: (2) ff., 680 pages. Les Singes - Additions aux Quadrupèdes. 12 planches hors-texte. Tome V: (2) ff., 597 pages. Les Oiseaux. 23 planches hors-texte. Tome VI: (2) ff., 586 pages. Les Oiseaux. 20 planches en couleurs. Tome VII: (2) ff., 624 pages. Les Oiseaux. 21 planches hors-texte. Tome VIII: (2) ff., 631 pages. Les Oiseaux. 20 planches hors-texte. Tome IX: (2) ff., 670 pages. Introduction aux Minéraux - Époques de la Nature. 2 cartes et 4 planches hors-texte. Tome X: (2) ff., 568 pages, (1) f. de table. Les Minéraux. Tome XI: (2) ff., 609 pages. Les Minéraux. Tome XII: (2) ff., 824 pages, (3) ff.. Expériences sur les Végétaux, Arithmétique morale et Tables analytiques et raisonnées des Matières contenues dans l'Ouvrage entier. Superbe exemplaire, l’un des rares complet de ses 150 estampes en vif coloris de l’époque, enrichi d’un dessin original.
Dictionnaire élémentaire de botanique, ou exposition par ordre alphabétique, des Préceptes de la Botanique, & de tous les Termes, tant françois que latins, consacrés à l’étude de cette Science… Edition originale de la plus grande rareté du Dictionnaire de botanique publié par Bulliard pour compléter son Herbier de France.
Séduisant exemplaire conservé à toutes marges dans son cartonnage d’origine car non rogné, très frais intérieurement. Paris, chez l’Auteur et chez Didot le jeune, Barrois le jeune, Belin, 1783. In-folio de viii pp., 242 pp., (7) ff. d’explication des planches et (1) f. d’errata, 10 planches hors texte à pleine page dont 9 en couleurs. Cartonnage de papier marbré bleu de l’éditeur avec une pièce de titre au centre du plat supérieur, dos lisse, non rogné, qq. frottements. Reliure de l’époque. 352 x 226 mm.
Edition originale de la plus grande rareté de ce très pratique dictionnaire de botanique, qui connut de nombreuses rééditions dans les dernières années du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Pritzel, 1355. Monglond IV, 288. «Jean Baptiste François Bulliard (1752-1793), called Pierre Bulliard, was another picturesque outsider whose works represented the Linnaean tradition in Paris. Bulliard was a descriptive naturalist, little given to theoretical or methodological meditations, but an industrious and skilled draftsman and floristic botanist” (Stafleu). Bulliard obtint une place à la nomination de l’abbé de Clairvaux. A cet emploi, dont le modique revenu suffisait à tous ses besoins, était attaché un logement à l’abbaye; il employa le temps qu’il passa dans cette retraite à étudier l’anatomie et la botanique, dans les meilleurs ouvrages. Il apprit aussi le dessin, et vint ensuite à Paris, pour y continuer ses études médicales; mais son goût pour l’histoire naturelle lui fit changer de résolution. Il résolut de réunir en lui seul les talents de l’artiste à ceux de l’auteur, il perfectionna les connaissances qu’il avait acquises dans le dessin, et apprit à graver sous François Martinet, habile peintre et graveur. C’est la parution de sonHerbier de France, dont la diffusionpar cahiers débute en 1780, qui achèvera de lui donner une certaine célébrité.À son lancement, il était prévu que cet ouvrage comporterait cinq parties : plantes vénéneuses, plantes médicinales, champignons, plantes grasses, plantes frumentacées et fourrages. Abondamment illustrée par ses soins, cette publication bénéficied’une nouvelletechnique, mise au point parJohannes Teyler, qui évite d’avoir à faire des retouches au pinceau, ce qui a pour effet de faire baisser le coût de fabrication du livre sans nuire à la qualité du dessin en couleurs. En outre, la vente par livraisons permet à l’auteur d’étaler les frais d’impression dans le temps, et de mettre le livre en vente à un prix modique. Disciple de Rousseau, Bulliard ambitionne d’être un vulgarisateur qui mettrait la connaissance de la botanique à la portée du plus grand nombre. Il ne réalise pas de découvertes, il ne poursuit aucune recherche mais, partant de ce qui est déjà connu, il réalise un grand travail de synthèseet ouvre de nouvelles pistes de réflexion. Dès la parution de son ouvrage, il ressent le besoin de le compléter par un dictionnaire général sur la botanique, destiné aux lecteurs qui ne bénéficient pas au départ d’un grand bagage scientifique. C’est ainsi que paraît en 1783 leDictionnaire élémentaire de botanique, ou Exposition par ordre alphabétique des préceptes de la botanique et de tous les termes, tant françois que latins, consacrés à l’étude de cette science, dont il est bien précisé sur la page de titre qu’il a été composé comme une introduction à l’Herbier de France. Pédagogue avant tout, Bulliard multiplie les exemples et les études de cas à l’appui de ses démonstrations. Dans ses descriptions, ilse réfère en permanence à des illustrations qu’il a voulu les plus exactes possible.Si l’objectif premier de l’auteur consiste à “familiariser avec le langage de la Botanique etrendre plus facile l’étude des principes de cette science”, il entend également baliser la démarche de ceux qui voudraient aller plus loindans l’étude de la botanique,en traçant “un plan méthodique à celui qui désire la cultiver”. Dans ce but,à l’articlePrincipes, il explique qu’“on pourra voir de quelle manière il faut s’y prendre pour s’engager avec succès dans la carrière de la Botanique, soit que l’on se trouve à même de profiter des secours d’un jardin botanique, d’un herbier naturel ou artificiel, ou soit qu’absolument éloigné du commerce des lettres, on n’ait aucune de ces ressources à sa disposition”. Dans le même ordre d’idées, il défend la théorie“qu’une méthode est d’une nécessité indispensable, que c’est un fil qui nous guide, nous ramène au but lorsque nous nous égarons”, mais il ne peut s’empêcher en même temps de fustiger“l’abus que l’on ne fait que trop souvent des méthodes, et combien, en changeant tous les jours la surface de la Botanique, elles s’opposent à ce qu’on puisse diriger cette science vers l’utilité publique”. Il est vrai qu’à l’époque, la botanique, à l’instar d’autres sciences, est dans la phase de bouillonnement intellectuel qui précède inévitablement l’unification du corpus et de la méthodologie, caractérisée par la multiplication des classifications, des théories et des méthodes. Le latin constituant le véritable “espéranto” des botanistes, chaque nom de plante écrit en français est accompagné de son équivalent latin. Bulliard enrichit son livre d’un petit, qui est une traduction duTermini Botanici de Linné, dans lequel chaque mot est assorti d’unrenvoi à sa définition dans le corps du dictionnaire principal. Après le décès de Bulliard, survenu en 1793, ce dictionnaire, qui a rencontré le succès,connaîtra en 1797 une réédition. Ilsera ensuite repris, corrigé et refonduparLouis-Claude Rciahrd, qui le republiera en1800, puis en1802 dans une nouvelle version augmentée. «Bulliard a fait lui-même les dessins et les gravures de ses ouvrages». Le présent dictionnaire est orné en premier tirage de 10 planches à pleine page dessinées et gravées par Bulliard lui-même dont 9 ont été coloriées à la main à l'époque. Séduisant exemplaire conservé à toutes marges dans son cartonnage d’origine car non rogné, très frais intérieurement.
Flora Parisiensis ou descriptions et figures des plantes qui croissent aux environs de Paris avec les différens noms, classes, ordres et genres qui leur conviennent, rangés selon la méthode sexuelle de Linné. Première édition du traité de botanique de Bulliard orné d’un titre et de 642 estampes aquarellés à l’époque. Bien complet de la rarissime introduction.
Superbe exemplaire bien complet du titre et des 642 planches à pleine page gravées et aquarellées en brillant coloris. Paris, chez Didot jeune, 1776-1783. 6 tomes en 4 volumes in-8 + index in-8 : I/ (3) ff. dont un frontispice, 32 pp. (enrichi comme souvent de l’Introduction à la flore des environs de Paris de 32 pp. publiée à part), (2) ff., 68 pp., 2 planches (complet des 2 planches supplémentaires reliées dans l’introduction), planches 1 à 169 avec autant de ff. de texte explicatif ; II/ (1) f. de titre, pl. 170 à 318 avec autant de feuillets explicatifs ; III/ (1) f. de titre, pl. 319 à 462 avec autant de ff. explicatifs ; IV/ (1) f. de titre, pl. 463 à 640 avec autant de ff. explicatifs. Index : 16 pp., 52 pp. (les 52 pp du système de Linné publiées également à part ont bien été insérées dans cet exemplaire). Veau marbré, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angle, dos lisses finement ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, pastilles de tomaison de maroquin rouge, coupes décorées, tranches dorées. Reliure de l’époque. 182 x 123 mm.
Première et seule édition de ce fort bel ouvrage illustré consacré par le botaniste Pierre Bulliard à la flore des environs de Paris. Stafleu & Cowan 902 ; Nissen BBI 295 ; Great Flower books p. 52 ; Brunet, I, 1388 ; Pritzel 1353. “Jean-Baptiste François Bulliard (1752-1793) was a descriptive naturalist, little given to theorical or methodological meditations but an industrious and skilled draftsman and floristic botanic. His works represented the Linnaean tradition in Paris.” Stafleu. Bulliard obtint une place à la nomination de l’abbé de Clairvaux. A cet emploi, dont le modique revenu suffisait à tous ses besoins, était attaché un logement à l’abbaye ; il employa le temps qu’il passa dans cette retraite à étudier l’anatomie et la botanique, dans les meilleurs ouvrages. Il apprit aussi le dessin, et vint ensuite à Paris, pour y continuer ses études médicales ; mais son goût pour l’histoire naturelle lui fit changer de résolution, et ses promenades aux environs de la capitale lui donnèrent l’idée de sa Flore Parisienne. Pour l’exécuter d’une manière neuve et utile, il résolut de réunir en lui seul les talents de l’artiste à ceux de l’auteur, il perfectionna les connaissances qu’il avait acquises dans le dessin, et apprit à graver sous François Martinet, habile peintre et graveur. « Bulliard a fait lui-même les dessins et les gravures de ses ouvrages ». Superbe exemplaire bien complet du titre et des 642 planches à pleine page gravées et aquarellées en brillant coloris. Il présente la rare introduction avec titre séparé qui manque souvent et notamment dans l’exemplaire de la bibliothèque nationale. « Les ouvrages de Bulliard, utiles et estimés, ont contribué à répandre le goût de la Botanique. Il dessinait et gravait lui-même ses figures. Le premier, il employa le procédé d’imprimer en couleur ». “The six volumes ‘flora Parisiensis (1776-1783), now a rarity, had descriptions and plates (by Bulliard himself) of 640 taxa… The Linnaean system was outlined in a separate introduction » (Stafleu, p. 289). “Un so sympathischer stechen von diesen ansprunchsvollen Darbietungen die mit liebevoller Sachlichkeit gezeichneten Figuren des - wie Nic. Robert aus Langres stammenden – Botanikers Pierre Bulliard ab. In seiner “Flora Parisiensis”… hat er Abbildungen von erstaunlicher Einprägsamkeit geschaffen, und zwar mit den simpelsten Mitteln. Es sind einfache Umrissradierungen, die mit der Roulette schattiert sind. Das Koloriet ist von einer seltenen Delikatesse und Naturtreue” (Nissen BBI p. 137). Précieux exemplaire complet de ses 642 estampes coloriées à la main à l’époque sur papier fort de Hollande, conservé dans sa reliure uniforme de l’époque aux dos finement ornés.
Exactissima descriptio rariorum quarundam plantarum, Que continentur Rome in Horto Farnesiano : Tobia Aldino Cesenate Auctore. L' "Hortus Farnesianus" en édition originale
Première édition de l’ « Hortus Farnesianus » imprimé à Rome en 1625. Magnifique exemplaire conservé dans sa première reliure d’éditeur. Rome, J. Mascardi, 1625.In-folio, plein cartonnage d’éditeur. Reliure de l’époque. 350 x 243 mm.
Edition originale. Hunt, 208 ; Nissen, 13 ; Seguier, p.34 ; L. Allatius, Apes Urbanae, sive de viris illustribus qui ad anno 1630 per totum 1632 Romae adsuerunt, 1633, p.218. 1 titre gravé, 22 gravures à pleine page, 6 gravures sur bois. « There has been considerable dispute about the authorship of this work; Seguier quotes Allatius for the statement that Petrus Castelli wrote a book which answers to this description “Alieno nomine… edidit” but Nissen quotes a contrary opinion from a friend of Castelli. It has not, we believe, been previously noticed that the preliminary leaf with the poem “to the learned author” by J.C. Lummenaeus contains an acrostic, the initial letters giving “Petrus C&stellus Romanus”. » « Le livre parut sous le nom de Tobie Aldini. Celui-ci, médecin et botaniste italien de Césène, dans le XVIIe siècle, était médecin du cardinal Odoard Farnese, qui l’établit directeur de son jardin botanique. Aldini en fit imprimer une description sous ce titre : « Descriptio plantarum horti Farnesiani, Tomoe », 1625, in-folio, cum tab. 28, plus connu sous le nom d’ « Hortus Farnesianus ». Aldini a donné d’assez bonnes figures de quelques-unes de ces plantes, et des descriptions exactes, mais surchargées d’érudition. Dans ce nombre, il y a un acacia, ou un mimosa, auquel on a conservé le surnom de Farnesiana, qui rappelle la reconnaissance que l’on doit à la mémoire du cardinal Farnèse, protecteur et ami des savants, et qui indique le jardin où cet arbre a été cultivé pour la première fois. Il est aujourd’hui naturalisé en Italie et dans les contrées méridionales de la France. L’auteur avait promis de publier beaucoup d’autres figures ; mais elles sont restées inédites. Il paraît qu’Aldini ne fut que le prête nom de cet ouvrage, et qu’il était réellement de Pierre Castelli, Médecin de Rome, qui dit expressément dans la préface, qu’il a tout écrit : « Omnia scripsi ». Magnifique exemplaire à toutes marges, absolument non rogné, les gravures de plantes en très beau tirage, conservé dans sa première reliure d’éditeur en cartonnage de l’époque, condition des plus rares.
De Koninglycke hovenier aanwyzende De Middelen om Boomen, Bloemen en Kruyden, te Zaayen, planten, aen, queeken en voort teelen. Les fleurs, fruits et jardins de l’âge d’or hollandais. Premier tirage de toute beauté de 55 estampes.
En séduisantes reliure hollandaise de l’époque au chiffre couronné. Amsterdam, Marcus Doornick, [1676]. - [Relié avec :] Commelyn, Johannes. Nederlantze hesperides, Dat is, Oeffening en Gebruik van de Limoen en Oranje-Boomen Geftelt na den Aardt, en Climaat der Nederlanden. Amsterdam, Marcus Doornick, 1676. 2 ouvrages en 1 volume in-folio de: I/ 1 frontispice, (2) ff., 144 pp. (1) f., pp. 145 à 224, 31 planches hors-texte dont 4 remontées; II/ 1 frontispice, (2) ff., 47 pp., (2) pp., 26 planches hors-texte. Veau fauve moucheté, double encadrement de filet or, large chiffre couronné frappé à froid sur les plats, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, tanches jaspées. Reliure hollandaise de l’époque. 358 x 215 mm.
[video width="1920" height="1080" mp4="https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2024/02/CAUSE.mp4"][/video] Réunion des premières éditions de deux ouvrages illustrant la flore et les jardins hollandais du XVIIe siècle. - Première édition du plus attractif des ouvrages hollandais du XVIIe siècle consacré aux jardins. Ce recueil illustré avec art par Hendrick Cause (1648-1699) est dédicacé à Guillaume d’Orange (le futur roi anglais). Il présente 31 estampes à pleine page dont la finesse évoque la maîtrise de De Pass. Deux estampes représentent le jardin royal de Saint-Germain-en-Laye et celui du Prince d’Orange à Soestdijk. 13 estampes doubles sont consacrées aux fruits et aux fleurs: roses, pavots, iris, jacinthes, narcisses, hellébores, lis martagon, œillets, pivoines, fritillaires, anémones, nigelles, aquillées, cyclamens, tulipes…, peuplées d’insectes et de papillons. 16 estampes à pleine page présentent enfin les plans élaborés de 32 jardins. Nissen; Benezit, II, 601; Hunt, 344. - Première édition de l’ouvrage de Johannes Commelin (1629-1692) consacré aux citronniers, aux orangers et aux jardins d’hiver et d’été d’agrumes au Pays-Bas. Il renferme 26 estampes à pleine page d’agrumes et d’orangeries, gravées sur cuivre sur les dessins de C. Kick. Cet ouvrage illustré constitue un document d’importance pour l’histoire de la culture sous serre des agrumes dans le nord de l’Europe au XVIIe siècle. Nissen, 390; Hunt, 345. Précieux recueil sur très grand papier présentant deux ouvrages de botanique hollandais préservés dans leur séduisante reliure de l’époque au grand chiffre couronné.
Dictionnaire des jardiniers
L’exemplaire est «imprimé sur beau papier». Le célèbre dictionnaire des jardiniers présentant «beaucoup de plantes inconnues». Bruxelles, 1786-1789. Chazelles - Miller. Dictionnaire des jardiniers et des cultivateurs, par Philippe Miller: Traduit de l’Anglois sur la VIIIè édiiton; Avec un grand nombre d’Additions de différens genres, par MM. le Président De Chazelles, le Conseiller Holandre, &c. Nouvelle édition, Dans laquelle on a rectifié un très grand nombre d’endroits de l’édition de Paris, afin de rendre la Traduction françoise conforme à l’Original Anglois; & de plus, on y a ajouté les noms Anglois des plantes, & plusieurs nouvelles Notes. A Bruxelles, chez Benoit le Francq, Imprimeur-libraire; rue de la Magdelaine, 1786-1789. 8 volumes in-8 de: I/ 1 frontispice gravé, L pp., (1) f., 543 pp., 8 planches numérotés hors-texte; II/ (2) ff., 697 pp., 3 pp.; III/ (2) ff., 597 pp., 2 planches; IV/ (2) ff., 574 pp.; V/ (2) ff., 592 pp., 2 planches; VI/ 533 pp., 8 planches; VII/ (2) ff., 544 pp., 2 planches; VIII/ (2) ff., 244 pp., 86 pp., 184 pp., 3 planches hors texte. Pleine basane havane marbrée, dos lisse peint en noir, filet or sur les coupes, tranches mouchetées, pièces de titre et tomaison en maroquin orange. Reliure de l’époque. 214 x 125 mm. Rare édition bruxelloise ornée d’un frontispice allégorique et de 25 planches hors texte. L’exemplaire est imprimé sur beau papier. L’auteur de l’œuvre principale, Philippe Miller (1691-1771), célèbre jardinier anglais qui, par son intelligence et son érudition, mérite de prendre place parmi les botanistes du XVIIIè siècle, naquit en 1691. Il succéda, en 1722, à son père, dans la place de surintendant du jardin de la compagnie des apothicaires à Chelsea et, sous sa direction, ce riche établissement ne tarda pas à devenir le plus magnifique de l’Europe, pour les plantes étrangères. C’est par ses soins qu’un grand nombre de plantes exotiques ont été acclimatées avec succès en Angleterre; et ses relations nombreuses et multipliées avec les plus célèbres botanistes, soit en Europe, soit dans les indes, ont puissamment contribué à répandre les découvertes botaniques. Il se fit d’abord connaître par quelques mémoires insérés dans les Transactions philosophiques; mais son Dictionnaires des jardiniers, publié en 1731, souvent réimprimé, et toujours avec des augmentations considérables, mit le sceau à sa réputation. Linné disait que ce livre serait le dictionnaire des botanistes, plutôt que celui des jardiniers. L’auteur eut le bonheur peu commun d’en donner, trente-sept ans après, la huitième édition. Dans les premières, il n’avait suivi que les méthodes de Ray et de Tournefort; mais dans l’édition de 1768, il employa les principes et la nomenclature de Linné, dont il finit par devenir un des plus zélés admirateurs. Il ne conservait pas moins de reconnaissance des leçons qu’il avait reçues de Ray, son premier maître; et dans ses dernières années, il se faisait honneur d’être resté le seul botaniste qui pût se vanter d’avoir vu ce grand naturaliste, et il ne le citait jamais sans montrer une émotion visible sur sa physionomie. Miller était membre de la société royale de Londres, de la société botaniques de Florence, etc.; il mourut à Chelsea le 18 décembre 1771. Le huitième volume contient, outre l'important chapitre sur le vin, illustré de 3 planches (pressoirs), des catalogues détaillés des noms des arbres (français, latin et anglais) ainsi qu'un calendrier couvrant les travaux à effectuer pendant l'année. Laurent-Marie de Chazelles traduisit le dictionnaire de Miller et ajouta beaucoup de plantes inconnues.
Chocolata inda, Opusculum De qualitate & natura chocolatae. Traité sur le chocolat par Colmenero de Ledesma
Edition originale latine du premier ouvrage européen consacré au chocolat et au cacao, conservée dans son pur vélin à recouvrement de l’époque. I-COLMENERO DE LEDESMA, Antonio. Chocolata inda, Opusculum De qualitate & natura chocolatae. Nuremberg, Wolfgang Ender, 1644. [Suivi de :] II-VOLCKAMER, Johann Georg. Opobalsami orientalis In Theriaces Confectionem Romae revocati examen... Nuremberg, Wolgang Ender, 1644. [Et de :] III-TENTZELIUS, Andrea. Medicina diastatica. hoc est singularis illa et admirabilis ad distans... Jehn, Johannis Birckneri, 1629. 3 textes reliés en 1 volume petit in-12 de : I/ 1 frontispice sur double-page, (10) ff., 73 pp., (7) pp.; II/ 1 frontispice, (3) ff., 224 pp., (8); III/ 1 frontispice, (7) ff., 188 pp. Le dernier texte est uniformément bruni, quelques rousseurs, petite restauration en marge de la p. 83 du deuxième texte sans atteintes au texte. Relié en plein vélin rigide de l’époque à recouvrement, dos lisse. Reliure d’époque. 120 x 67 mm.
Ce traité sur le chocolat, originellement écrit en espagnol par Antonio Colmenero de Ledesma en 1631, fut traduit en latin par Marcus Aurelius Severinus. Le présent texte sur le chocolat franchit rapidement les frontières comme cet aliment devient de plus en plus apprécié. Ce texte sera un des plus grands textes du siècle sur le chocolat et il sera largement diffusé sur le continent et traduit en français en 1641, en latin en 1644, et en italien en 1678, mais aussi en anglais en 1652. Il est ici suivi d’extraits de deux autres traités: une dissertation sur l’arbre à cacao par J.-E. Nieremberg, et un article sur l’hypocondrie par P. Zacchias. «Antonio Colmenero de Ledesma wrote his monograph in 1631, entitled ‘Curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocolate’, a much-cited and much-translated publication. Colmenero’s text was highly circulated throughout Europe, so much so that different editions and translations of his work have been difficult to attribute to specific authors. » (L. Grivetti & H-Y. Shapiro, Chocolate: history, culture and heritage). Dans le présent ouvrage, Colmenero considère les vertus médicales du chocolat, et c’est à ce titre qu’il sera mentionné dans bien des bibliographies et revues médicales des XVIIème et XVIIIème siècles. Selon l’auteur, le cacao permettrait de conserver une bonne santé, et rendrait ses consommateurs corpulents, beaux et aimables. L’auteur présente également ici pour la première fois la recette d’une boisson chocolatée faite à base de 100 fèves de cacao, de fruits secs, d’épices mais aussi de piments et de sucre. Cette recette sera reprise et modifiée par de nombreux auteurs au cours du XVIIème siècle tels que: Thomas Hurtado, l’auteur de Chocolate y tabaco, Ayuno eclesisatico y natural en 1645, Thomas Gage, l’auteur de The English American: his travel by sea en 1648, et Henry Stubbe l’auteur de The Indian nectar, or, a Discourse concerning Chocolata en 1662. Antonio Colmenero de Ledesma était un fervent amateur de chocolat qui cherchait à promouvoir les multiples propriétés médicinales de ces fèves. Le présent traité est illustré d’un très beau frontispice sur double page montrant Neptune debout sur son char marin, à qui une indienne offre une boite de chocolats. «La figure représente une conque marine traînée par des chevaux marins. L’Indien qui la conduit, muni d’un trident, remet à un personnage du continent une boîte de chocolats avec la mention ‘chocolat inda’». II/ Série d’articles et de controverses, par divers médecins de l’époque, au sujet d’un baume oriental. Krivatsy 12472; Poggendorff, II, 1228; Oberlé, n°730. Le beau frontispice montre un Indien avec la plante et un pot de pharmacie. Séduisant exemplaire de ce traité fondamental sur le chocolat, conservé dans son vélin à recouvrement de l’époque. Provenance: ex libris Christoph. Iac. Trew. M. D.
L’Ecole du jardin potager, Contenant la Description exacte de toutes les Plantes potagères ; leur Culture ; les terres, leur situation, & les climats qui leur sont propres ; leurs Propriétés ; les différents moyens de les multiplier, le temps de recueillir les Graines, leur durée, &c. &c. par M. de Combles. Troisième édition augmentée du Traité de la Culture des Pêchers, du même auteur ; & à laquelle on a joint la Manière de semer en toute saison. Peut-être le plus bel exemplaire répertorié de L’École du jardin potager revêtu d’une somptueuse reliure de l’époque en maroquin vert à large dentelle aux oiseaux de Derome le Jeune.
De la bibliothèque de la Comtesse de Behague. Paris, Didot le Jeune, Delalain, 1780. 2 tomes en 2 volumes in-12 de : I/ 1 frontispice, vi pages, 512 pp., 120 pp. ; II/ (1) f., 386 pp., xii pp., 167 pp. Maroquin vert, large dentelle aux petits fers spéciaux dont les colombes se becquetant, dos à faux nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, filet doré aux coupes, dentelles intérieures, doublures et gardes de soie rose, tranches dorées. Riche reliure à dentelle de l’époque de Derome le Jeune. 164 x 94 mm.
Édition en partie originale augmentée du Traité de la culture des Pêchers. Précieux exemplaire orné de la vignette de titre du premier volume délicatement coloriée à la main à l’époque. Charles-Jean de Combles est un écrivain et agronome français né à Lyon en 1735. Il publie plusieurs traités sur son passe-temps favori qu’il développe à Naples, le jardinage. Lorsque Combles, prit la plume, il y avait déjà bien des années, ainsi qu’il le dit lui-même, qu’il faisait « du jardinage l’amusement de son loisir et la plus solide occupation de sa vie ». Il aimait ce genre de travail ; il voulut le connaître à fond. Livré d’abord à un jardinier routinier et présomptueux, comme le sont ordinairement les ignorants, de Combles s’aperçut bientôt qu’il était devenu plus habile que celui dont il avait la bonhomie de recevoir les leçons. Le premier fruit des connaissances qu’il avait acquises dans les diverses parties du jardinage fut un Traité sur la culture des pêchers (1745, in-12), qu’il rédigea par complaisance et à la recommandation d’une personne qu’il désigne comme étant de la plus haute considération. Ce traité ayant passé manuscrit par plusieurs mains, et obtenu l’approbation des connaisseurs, l’auteur se décida à le livrer à l’impression. « Si le succès de ce morceau, dit-il, peut répondre à mon intention, j’en donnerai successivement sur la culture des autres fruits, et sur toutes les autres parties du jardinage. » Malheureusement le Traité sur la culture des pêchers fut accueilli d’abord assez froidement ; les amateurs des jardins étaient peu nombreux encore. Cependant la 2ème édition fut mise au jour en 1750, revue, corrigée et augmentée ; la 3ème parut en 1770 ; la 4ème en 1802 ; la 5ème est de 1822. C’est le premier traité qui ait été publié sur cette importante partie de notre jardinage, puisque les Observations de Roger Schabol sur Montreuil et les pêchers ne furent imprimées qu’en 1755. En 1749, de Combles livra au public le fruit de ses longues observations et de sa pratique éclairée, son École du jardin potager, ou l’Art de cultiver toutes les plantes potagères, 2 vol. in-12. C’est le plus connu et le plus recherché de ses ouvrages : production très utile, et qui n’a pas cessé d’être consultée avec avantage. Magnifique exemplaire revêtu de maroquin vert par Derome le Jeune orné d’une somptueuse dentelle aux oiseaux se becquetant. De la bibliothèque de la Comtesse de Behague et du Marquis de Ganay.
British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland: containing coloured figures from nature of the most rare and beautiful species, and in many instances of the plants upon which they are found. Cuvier considérait l’ouvrage de John Curtis comme « the paragon of perfection ».
770 planches d’insectes et de fleurs finement coloriées à la main à l’époque. London, printed for the author, 1824-1839. 16 volumes in-8 illustrés de 770 planches au total, un cahier dérelié dans le tome 16, pl. 737 reliée à l’envers, quelques discrètes rousseurs. Ensemble relié en percaline beige de l’époque, dos lisses. 231 x 147 mm.
Edition originale de ce splendide ouvrage consacré aux insectes par l’entomologiste anglais John Curtis (1791-1862). Nissen ZBI 1000 ; Brunet, II, 447. L’ouvrage, publié sous forme de livraisons mensuelles par souscription de 1824 à 1839, est considéré comme l’un des meilleurs ouvrages d’entomologie du XIXe siècle. L’auteur précise dans la préface que "the plates of several of the early volumes for the greater part, and those of the last and a considerable part of the fifteenth were entirely my own engravings, and all the others were corrected and finished by myself: the drawings also are the effort of my pencil, and the articles and descriptions are my own writing; for any errors therefore I alone am accountable". Il poursuit en expliquant qu’en décembre 1839 les planches avaient "already cost upwards of £3000". "Cuvier pronounced British Entomology to be 'the paragon of perfection'" (ODNB). L’ouvrage est orné de 770 planches hors texte (planches 1 à 769 et une planche 205*) gravées d’après nature et finement coloriées à la main à l’époque. Elles montrent les espèces d’insectes que l’on trouvait au Royaume-Uni avec les différentes parties de leur anatomie détaillées dans des dessins au trait occupant souvent le bas des planches, et les insectes présentés dans leur milieu naturel sur des plantes ou des fleurs. Précieux exemplaire bien complet de l’ensemble de ses planches, conservé dans sa reliure de l’époque.
Manuel de botanique, contenant Les propriétés des Plantes utiles pour la Nourriture, d’usage en Médecine, employées dans les Arts, d’ornement pour les Jardins, & que l’on trouve à la campagne aux environs de Paris. Superbe exemplaire de ce Manuel de botanique du plus grand intérêt relié en maroquin olive de l’époque pour Madame Victoire, la fille du Roi Louis XV.
Edition originale de ce Manuel de botanique de la plus grande rareté. Paris, chez Didot le jeune, C. J. Panckoucke, 1764. In-12 de xxiv pp., 44 pp., 76 pp., 92, 94, (2), 75, (1) p. Plein maroquin vert olive, triple filet doré autour des plats, armes frappées au centre, dos à nerfs orné, filet or sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées. Reliure armoriée de l’époque. 161 x 93 mm.
Edition originale de ce Manuel de botanique de la plus grande rareté. «L’Auteur a distribué les plantes dont il parle en quatre classes principales. La première comprend celles dont nous mangeons diverses parties, différemment préparées, soit par besoin soit par sensualité, & celles qui nous fournissent nos boissons agréables: on peut les nommer en général plantes utiles pour la nourriture; elles sont rassemblées dans la première partie, & présentées dans l’ordre de 58 familles, établies par B. de Jussieu. Cette partie comprend non seulement les plantes qu’on cultive ordinairement, mais encore les plantes sauvages qui peuvent servir de nourriture aux pauvres, & dans les disettes. On y a ajouté celles que Linné a comprises parmi les plantes alimentaires de la Suede. La seconde classe concerne les plantes d’usage en médecine: on n’y a admis que celles qui sont approuvées dans la pharmacopée de la Faculté de médecine de Paris. La troisième est composée des plantes employées dans les Arts. Enfin, la quatrième comprend les plantes dont la propriété est d’embellir les lieux destinés à la promenade, c’est-à-dire, les plantes d’ornement pour les jardins; elles y sont rassemblées: on y a joint une courte description de ce qui fait leur mérite, l’indication de la saison où l’on en jouit, & de la place qu’elles peuvent occuper dans les parterres, les gasons, les pièces d’eau, les grands & les petits bosquets, les avenues & autres parties d’un jardin ou d’un parc régulier. Ce manuel est terminé par des tables latines & françoises très étendues: ces tables contiennent les familles, les genres & les espèces des plantes dont il est parlé dans l’ouvrage. On y a joint l’Index ou table alphabétique des genres sous lesquels les plantes sont placées dans le ‘Botanicon Parisiensis’ de Vaillant. On y trouve enfin les noms des familles introduites par Jussieu. Cet ouvrage, considéré sous plusieurs aspects, est véritablement neuf; il paroit fait pour cette classe de citoyens qui ne souhaitent prendre de la botanique que les connaissances les plus agréables & de l’utilité la plus générale». (Bibliothèque littéraire historique et critique de la médecine ancienne et moderne, II, p. 502). « Les uns et les autres trouveront de quoi se satisfaire dans ce ‘Manuel’. Il a de plus l’avantage de présenter un ordre de familles dû aux observations du plus grand de nos maîtres. Enfin, on y remarquera que toutes nos Plantes ont des noms François; ce qui manquait dans presque tous les Catalogues. Cette espèce d’Introduction à la Botanique donne de grandes lumières sur cette Science. On est porté à croire qu’il n’y a aucune plante qui n’ait son utilité particulière. On ne connait les propriétés que d’un très petit nombre; ce sont de ces plantes dont M. Duchesne parle, en se bornant à celles que l’on trouve à la campagne aux environs de Paris. Indépendamment de ses connaissances, M. Duchesne a le mérite de la franchise. Il prend plaisir à nommer avec reconnaissance les diverses personnes qui lui ont aidé dans son ouvrage, & qui lui ont communiqué leurs lumières […] Cet ouvrage ne peut que mériter l’approbation du public et plaire à tous les Lecteurs». (L’Année littéraire, 1764). Superbe exemplaire relié en maroquin olive de l’époque pour Madame Victoire, la fille du roi Louis XV. Mesdames de France, Adélaïde, Sophie et Victoire avaient chacune leur bibliothèque aux armes de France, mais les livres de Madame Victoire étaient reliés en maroquin vert olive. «Madame Victoire était belle et très gracieuse. Son accueil, son regard, son sourire étaient d’accord avec la bonté de son âme. Elle vivait avec la plus grande simplicité. Sans quitter Versailles, sans faire le sacrifice des commodités de la vie, ni de la moelleuse bergère à ressort qu’elle ne quittait jamais et qui la perdait, disait-elle, elle n’oubliait aucun devoir, donnait aux pauvres tout ce qu’elle possédait, et se faisait adorer de tout le monde. On raconte qu’elle n’était pas insensible à la bonne chère, mais elle rachetait ces péchés de paresse et de gourmandise par une humeur toujours égale et par une inépuisable bienveillance. » (Quentin-Bauchart, Les Femmes bibliophiles de France, pp. 123-130).
Traité de la conservation des grains
Célèbre édition originale, rarissime en maroquin de l’époque. Paris, 1753. Duhamel Du Monceau, Henri-Louis. Traité de la conservation des grains, et en particulier du froment. Par M. Duhamel du Monceau de l’Académie Royale des Sciences, de la Société royale de Londres, Inspecteur de la Marine dans tous les Ports & Havres de France. Avec Figures en Taille-douce. Paris, Hippolyte-Louis Guerin & Louis-François Delatour, 1753. In-12 de xxviii pp., 294 pp., 12 planches dépliantes. Plein maroquin rouge, triple filet doré autour des plats, dos lisse orné, filet or sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées. Reliure en maroquin de l’époque. 165 x 98 mm. Edition originale ornée de 12 planches dépliantes, rarissime en maroquin de l’époque. Ouvrage qui fait suite à la famine de 1752 dans lequel Du Monceau essaie de proposer des solutions pour une meilleure conservation des réserves de blés lors des années de récoltes fastes. Elles passent notamment par un meilleur séchage et nettoyage des grains, et l'aération des grands greniers par des soufflets. Dès le début de sa carrière, Duhamel s’intéresse aux arbres, en commençant par les arbres fruitiers. Il constitue une collection à Vrigny, dont beaucoup de spécimens viennent des pépinières des chartreux du château de Vauvert. Son goût pour l’amélioration des productions le conduit à s’intéresser au greffage, technique qui permet de multiplier rapidement les variétés sélectionnées. Dans son mémoire de 1744 sur les boutures et les marcottes, il conclut à l'existence de deux sèves, l'une montante et l'autre descendante. À l’exception de ses recherches sur le safran (1728), l’œuvre d’Henri-Louis ne devient réellement agronomique qu’à partir de 1748, date de la traduction de l’ouvrage de Jethro Tull, que Duhamel est chargé de superviser. Comme il est d’usage à l’époque, la traduction est libre, l'auteur enlevant tel développement perçu comme superflu, remplaçant la description d’une machine par une autre jugée plus performante… C’est ainsi que naît de 1750 à 1761 le Traité de la culture des terres, en six tomes dont seuls les deux premiers portent la mention « Suivant les principes de M. Tull, Anglois ». Tull, comme Duhamel, ont noté les effets bénéfiques du tallage des céréales pour augmenter les rendements. Il note l’intérêt des labours pour affiner la terre et augmenter le contact racinaire ; il teste à Pithiviers les modalités d’une diminution de la densité de semis. Celui-ci se fait en ligne de façon à pouvoir désherber l’interrang, et Duhamel de mettre au point semoirs et charrues étroites pour réaliser l’opération. Duhamel y intègre le fruit de ses expériences personnelles, effectuées dans son domaine de Denainvilliers qui faisait figure de véritable station d’agriculture expérimentale. Plus encore, au fil des ans, le Traité de la culture des terres devient une sorte de revue publiant les résultats des essais agricoles que des correspondants lui adressent et qu’il juge dignes d’intérêt, préfigurant ainsi les Annales agronomiques. Dès 1762, il publie Les éléments d’agriculture en deux tomes, dans lesquels il synthétise les principes de la « nouvelle culture » développés dans le Traité de la culture des terres. Concernant la nutrition végétale, il s’intéresse à toute sorte de résidus et minerais, et se distingue ainsi de Jethro Tull qui préconise uniquement l’usage du fumier. Les prairies artificielles sont étudiées en remplacement de prairies naturelles peu productives. Animé par une démarche de filière, Duhamel fait de nombreuses expériences sur la conservation des céréales par ventilation mécanique forcée, technique qu’il juge alors plus utile que le seul étuvage proposé par Inthierri, et construit diverses installations. En 1753, il publie le Traité de la conservation des grains ; le Roi lui demande de lui présenter une maquette de son installation de Denainvilliers et lui attribuera quelques années plus tard une pension de 1 500 livres à titre de récompense. Dix ans avant les publications d'Antoine Parmentier, et précédant Samuel Engel, il s’intéresse à la pomme de terre dont il décrit la plante et la culture, contribuant ainsi à sa popularité. De la plus grande rareté en maroquin de l’époque.
La Physique des arbres : où il est traité de l'anatomie des plantes et de l'économie végétale : Pour servir d'Introduction au Traité complet des Bois & des Forests ; avec une dissertation sur l'utilité des Méthodes de Botanique ; & une Explication des termes propres à cette Science, & qui sont en usage pour l'exploitation des Bois & des Forêts. L'œuvre de Duhamel du Monceau sur « La Physique des Arbres » ornée de 50 estampes à pleine page.
Edition originale ornée de 50 planches gravées hors-texte du premier grand ouvrage de Duhamel du Monceau (1700-1782), célèbre botaniste et agronome français. A Paris, Chez H.L. Guérin & L.F Delatour, rue Saint Jacques, à Saint Thomas d'Aquin, 1758. Avec approbation et privilège du Roi. 2 volumes in-4: I/ (3) ff., lxviii pp., 307 pp., 28 planches ; II/ (2) ff., iii pp., 432 pp., 22 planches dépliantes. Plein veau fauve marbré, dos à nerfs richement ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, filet or sur les coupes, tranches mouchetées rouges. Reliure de l'époque. 255 x 194 mm.
Edition originale ornée de 50 planches gravées hors-texte du premier grand ouvrage de Duhamel du Monceau (1700-1782), célèbre botaniste et agronome français. « Se logeant près du Jardin des Plantes, il suivit les leçons de Dufay et de Bernard de Jussieu. Comme il était riche, il put cultiver aisément ses deux sciences favorites, la botanique et l'arboriculture, soit à Paris, soit dans sa terre du Gâtinais. « En sa qualité d'inspecteur de la marine, Duhamel avait été amené à rechercher tout ce qui concernait la culture et la conservation des bois propres aux constructions navales. Il en était ensuite venu à s'occuper des plantes et des arbustes qui pouvaient supporter le climat de la France. C'est ainsi qu'il fit connaître en Europe un grand nombre d'espèces américaines. Les espèces et les variétés énumérées par Duhamel, au nombre de plus de 1 000, sont rangées par ordre alphabétique, suivant leur nom latin générique. L'auteur prit pour base de son ouvrage la nomenclature de Tournefort. On doit regretter qu'il n'ait pas adopté la nomenclature de Linné, dont le Species Plantarum avait paru 2 ans auparavant ; mais peut-être Duhamel n'était-il pas assez classificateur pour comprendre le mérite transcendant de ce dernier ouvrage. De la physique des arbres ; 1758, 2 volumes in-4 est le chef-d'oeuvre de Duhamel ; il y a réuni tout ce qu'avaient dit avant lui sur cette matière Malphighi, Grew, Hales et Bonnet, ainsi que ses observations et ses remarques particulières. Le grand mérite de cet ouvrage consiste dans des détails concernant la structure, l'anatomie et la physiologie des plantes. » Le premier volume traite de l'Anatomie des Arbres, des Boutons, Fleurs et Fruits, des Semences, de l'accroissement des arbres, des maladies des Arbres, etc... Très bel exemplaire conservé dans ses belles reliures de l’époque en veau fauve marbré.
Traité élémentaire d’histoire naturelle. L'enseignement des sciences naturelles
Édition originale de cet ouvrage dédié à l’enseignement des sciences naturelles dans les lycées. Paris, Deterville, 1804.In-8 de (1) f.bl., xii pp., 394 pp. Quelques piqûres. Relié en pleine basane racinée, filet à froid encadrant les plats, dos lisse finement orné, pièce de titre de maroquin vert, filet doré sur les coupes. Reliure de l’époque. 197 x 128 mm.
Édition originale de cet ouvrage composé par ordre du gouvernement pour servir à l’enseignement de l’histoire naturelle dans les Lycées. Pritzel, 2476.« J’ai inséré dans le premier volume de l’anatomie comparée de M. Cuvier, en 1800, les premières tentatives que j’ai faites de la classification, par familles naturelles, des genres d’insectes. Dans les deux années suivantes, j’ai continué ce travail. L’An IX j’en ai publié un extrait dans le Journal de physique et dans le Magasin encyclopédique. En 1804 parut la première édition de mon Traité élémentaire d’histoire naturelle, dans lequel j’ai exposé avec plus d’étendue le plan que je suivais depuis près de quatre ans dans mes cours d’histoire naturelle aux écoles centrales » (Duméril).André-Marie-Constant Duméril (1774-1860), médecin et naturaliste, eut une grande carrière dans l’enseignement. Il fut professeur d’anatomie à la Faculté de Médecine, et enseigna également au Musée d’Histoire naturelle, tout comme à l’Ecole centrale du Panthéon en tant que remplaçant de Cuvier. Il fut élu membre de l’Académie des Sciences en 1816, et membre de l’Académie de médecine en 1731. Il est enfin fait chevalier de la Légion d’Honneur deux mois avant sa mort.L’épitre dédicatoire à Cuvier présente ce dernier comme un ami cher à Duméril, mais également comme un grand naturaliste qui a contribué par ses études à faire que l’auteur puisse produire cet ouvrage. Ils ont d’ailleurs travaillé ensemble sur les Leçons d’anatomie comparée de M. G. Cuvier publié en 1799 à Paris. Duméril explique dans cette épitre les différentes classifications faites dans ce livre et se réfère à d’autres savants qui ont contribué à ce bilan de l’état actuel de l’histoire naturelle en France, tels que Lacepède, Lamarck, Haüy, etc. Intéressant ouvrage d’enseignement de sciences naturelles réalisé par un grand naturaliste français sur commande du gouvernement impérial. Provenance : ex libris Doisy Md, Passementier à Verdun sur le faux titre.
Voyage de la corvette de l’Astrolabe (autour du Monde) exécuté par ordre du Roi pendant les années 1826-1827-1828-1829. Edition originale du plus important voyage français entrepris dans le Pacifique au XIXe siècle.
Bon exemplaire de ce très important voyage dans le Pacifique, conservé dans ses reliures uniformes de l’époque. Paris, J. Tastu, 1830-1834. 11 volumes grand in-8 et 3 parties en 1 volume in-4 pour le texte, 5 parties en 4 volumes in-folio pour les Atlas; des rousseurs à l'atlas historique. Demi-basane brune, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert. Reliure de l'époque. Dimensions des volumes de texte : 230 x 143 mm / 293 x 226 mm. Dimensions des atlas : 550 x 350 mm.
Edition originale du plus important voyage français entrepris dans le Pacifique au XIXe siècle. Bagnall, 1687 (partie); Davidson, pp. 115-6 (partie); Ferguson, 1341 (partie); Hill 2, 504 (partie); Hocken, p. 47 (partie); Sabin, 21210 (partie) ; Chadenat 60 ; Hill, p.88. Il s'agit de la première expédition de Dumont d'Urville, qui avait pour objet de préciser et de compléter les informations sur les îles du Pacifique déjà recueillies par Duperrey. Après avoir passé le Cap de Bonne Espérance, l'Astrolabe fit relâche à Port Jackson, avant de se diriger vers la Nouvelle Zélande et en particulier le détroit de Cook. Les navigateurs explorèrent ensuite les îles Tonga, une partie de l'archipel des Fiji, la Nouvelle Angleterre, la Nouvelle Guinée, Amboina, la Tasmanie, Vanikoro et Java. Grâce aux importantes collections et observations rapportées, l'expédition de Dumont d'Urville fut un grand succès scientifique. Les textes sont illustrés de 9 planches pour l'Histoire du voyage, 8 planches pour la Zoologie, 2 tableaux dépliants pour les Observations nautiques; les atlas contiennent un portrait, 8 cartes dont une en couleurs, et 239 planches (dont 57 coloriées) pour l'Histoire du voyage, 204 planches de zoologie, 80 planches de botanique. 1° Historique – 10 tomes en 5 vol. avec gravures, et 2 Atlas de 247 belles planches, noires et coloriées : vues, paysages, portraits, types d’indigènes, scènes de mœurs, etc. 2° Zoologie – 6 parties en 4 vol. in-8 avec 8 pl. et Atlas de 192 pl. coloriées. 3° Botanique – 2 tomes en 1 vol. et Atlas de 80 pl. noires et coloriées. 4° Entomologie – 2 tomes en 1 vol. et Atlas de 12 pl. coloriées. « The scientific voyage of the Astrolabe was arguably the most important and the most influential nineteenth-century French voyage to the Pacific. In addition to its comprehensive hydrographical work, especially in New Zealand, the Astrolabe scientists made extensive scientific observations and vast collections of natural history. The outstanding results of the expedition were published from 1830 to 1835. The atlases contain what are generally acknowledged to be some of the finest plates ever produced of the natural history, topography, and anthropology of the Australasian and South-west Pacific. Most of the fine topographical views are after Louis Auguste de Sainson. The official account of the voyage is rarely found complete ». Bon exemplaire de ce très important voyage dans le Pacifique, conservé dans ses reliures uniformes de l’époque. Il manque à cette collection les 2 tomes de texte de Philologie par Dumont d'Urville, et l'atlas d'hydrographie, d'un format supérieur aux autres atlas et qui manque souvent.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers