30176 books for « joseph d »Edit
-
Latest
Last 24h (7)
Last 3 days (264)
Last month (413)
Last week (23)
-
Language
Dutch (13)
English (73)
French (29154)
German (15)
Greek (1)
Italian (2)
Japanese (2)
Latin (12)
Russian (903)
Spanish (1)
-
Century
16th (11)
17th (58)
18th (1291)
19th (3373)
20th (11515)
21st (1080)
-
Countries
Belgium (2102)
Brazil (5)
Canada (236)
China (19)
Côte d'Ivoire (79)
Denmark (236)
France (24602)
Germany (104)
Greece (25)
Italy (19)
Netherlands (3)
Switzerland (1834)
United Kingdom (6)
United States of America (906)
-
Syndicate
ALAC (181)
CLAM (117)
CLAQ (96)
CNE (28)
ILAB (13756)
NVVA (540)
SLACES (537)
SLAM (12338)
SNCAO (128)
Type
- Art print (1)
- Autograph (6)
- Book (29633)
- Disk (1)
- Drawings (23)
- Engraving (29)
- Magazine (14)
- Manuscript (4)
- Maps (57)
- Music sheets (337)
- New book (4)
- Old papers (18)
- Photographs (44)
- Postcards (1)
- Posters (3)
- Reprint (1)
Topics
- Alsace (211)
- Aquitaine (107)
- Archaeology (215)
- Architecture (157)
- Army (109)
- Autographs (218)
- Bedier joseph (121)
- Belgium (234)
- Biography (404)
- Brittany (207)
- Calmette joseph (127)
- Catholicism (223)
- Children’s books (102)
- China (94)
- Christianity (317)
- Churches (103)
- Comic strip (100)
- Conrad joseph (247)
- Dauphiné (117)
- Dedication (176)
- Delteil joseph (122)
- Detective novels (90)
- Dictionaries (121)
- Drawings (97)
- Early printed books (243)
- Economics (275)
- Education (122)
- English (139)
- Engraving (books about) (99)
- Esotericism (103)
- Ethic (138)
- Ethnology (95)
- Fine arts (182)
- First edition (743)
- Flowers (97)
- Franz joseph (113)
- Genealogy (156)
- Geography (254)
- Germanic languages (181)
- Germany (122)
- Haydn joseph (117)
- Helvética (249)
- History (1945)
- Hunting (145)
- Illustrated books (98)
- Industrial arts & crafts - fine arts (110)
- Italy (93)
- Joffo joseph (208)
- Jolinon joseph (112)
- Kessel joseph (356)
- Languedoc (102)
- Law (423)
- Linnean society of lyons (104)
- Literature (2214)
- Lyons and area (103)
- Lyons college (103)
- Lyons college pc (104)
- Lyons revue (103)
- Magazine (108)
- Manuscripts (111)
- Medicine (392)
- Memories (137)
- Méry (124)
- Middle ages (134)
- Military arts (111)
- Music (108)
- Napoleon i (165)
- Navy (160)
- Newspapers press (184)
- Nobility (101)
- Paris (280)
- Peyre joseph (338)
- Philosophy (522)
- Photography (134)
- Poetry (397)
- Policy (255)
- Provence (227)
- Psychology (174)
- Regionalism (468)
- Religions (739)
- Reliure (115)
- Review (192)
- Reviews (158)
- Revolution 1789 (225)
- Savoy (93)
- Sciences (187)
- Scores (498)
- Socialism (95)
- Sociology (93)
- Songs (359)
- Switzerland (351)
- Theatre (200)
- Theology (446)
- Travel (121)
- Various (194)
- Wallonia (93)
- War (260)
Collection des vues des ports de mer en France… Témoignage pittoresque de la vie portuaire en France au temps de la marine à voile.
Réunion très rare de l’ensemble des gravures des vues et ports de France, de Joseph Vernet, dans leur superbe tirage d’origine. Paris, J. P. Le Bas, [1760-1778]. In-plano oblong de (2) ff., 16 planches, reliure du temps à dos de veau fauve marbré orné de faux nerfs et de motifs dorés, cartouche de maroquin rouge avec dentelle en encadrement et titre dorés au centre des plats, non rogné. Reliure de l’époque. 800 x 550 mm.
[video width="996" height="1920" mp4="https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2024/07/VERNET-bis.mp4"][/video] Superbe suite des 16 vues des ports d’après Joseph Vernet finement gravées par Charles-Nicolas Cochin et Jacques-Philippe Le Bas. L’exemplaire comporte les deux planches supplémentaires - la dernière (Le Havre) d’après Cochin - terminées à l’eau-forte par P. Martini. Joseph Vernet n’a pas peint de tableau représentant le port et la ville du Havre. La planche n°16, jointe à la série des gravures reproduisant les peintures de Joseph Vernet, a été dessinée par C. N. Cochin et gravée par J. Ph. Le Bas. Vernet reçut du marquis de Marigny, directeur général des bâtiments du roi et frère de la marquise de Pompadour, une commande de Louis XV pour la représentation des principaux ports de France, tâche à laquelle il s’attela en 1753. Après avoir peint Marseille et le golfe de Bandol, il partit pour Toulon, puis Antibes et Sète. De Bordeaux, où il reçut un accueil très brillant, il redescendit à Bayonne puis remonta vers La Rochelle et Rochefort. Installé à Paris en 1763, il se rendit à Dieppe, dernier port qu’il représenta. Nicolas Ozanne accompagna Joseph Vernet pendant une partie de son voyage. La commande royale concernait vingt ports, mais Vernet n’en peignit que neuf, plus la baie de Bandol, de 1753 à 1765, donnant lieu à quinze tableaux. La guerre de Sept Ans et les difficultés financières qui en découlaient suspendirent ses travaux. Liste des seize planches: Planche N°1. Le port neuf ou l’Arsenal de Toulon, vu de l’angle du parc de l’artillerie - peinture de 1755 - gravure de 1760. Planche N°2. L’intérieur du port de Marseille, vu du Pavillon de l’horloge du Parc - peinture de 1754 - gravure de 1760. Planche N°3. La Madrague ou la Pêche du Thon, vue du golfe de Bandol - peinture de 1754 - gravure de 1760. Planche N°4. L’entrée du Port de Marseille, vue de la Montagne appelée Tête de More - Peinture de 1754 - gravure de 1760. Planche N°5. Le Port vieux de Toulon, vu du côté des Magasins aux Vivres - peinture de 1756 - gravure de 1762. Planche N°6. La Ville et la Rade de Toulon vues à mi-côte de la montagne qui est derrière - peinture 1755 - gravure 1762. Planche n°7. Le Port d’Antibes en Provence, vu du côté de la Terre - peinture de 1756 - gravure de 1762. Planche N°8. Le Port de Cette en Languedoc, vu du côté de la mer, derrière la jettée isolée - peinture 1756-57 - gravure 1762. Planche N°9. Vue de la Ville et du Port de Bordeaux, prise du Côté des Salinières - peinture 1757-59 - gravure 1764. Planche N°10. Vue de la Ville et du Port de Bordeaux, prise du Château Trompette - peinture 1757-59 - gravure 1764. Planche N°11. Vue de la Ville et du Port de Bayonne, prise à mi-côte sur le Glacis de la Citadelle - Peinture de 1759-61 - gravure de 1764. Planche N°12. Vue de la Ville et du Port de Bayonne, prise de l’allée de Bouflers, près de la Porte de Mousserole - peinture de 1759-61 - gravure de 1764. Planche N°13. Le Port de Rochefort vu du Magasin des Colonies - peinture de 1761-62 - gravure de 1767. Planche N°14. Le Port de La Rochelle, vu de la petite Rive - peinture de 1761-62 - gravure de 1767. Planche N°15. Vue du Port de Dieppe - peinture 1763-65 - gravure de 1778. Planche N°16. Le Port et la Ville du Havre, vus du pied de la Tour de François premier, 1776. Les ordres du roi étaient clairs: «vos tableaux doivent réunir deux mérites, celui de la beauté pittoresque et celui de la ressemblance, autant que son intention: voir les ports du royaume représentés au naturel dans vos tableaux». A Toulon: le quai aux vivres est une véritable exposition de ce que l’on pouvait trouver à bord en matière de sacs, de jarres, de corbeilles, de paniers, de bouteilles et de futailles. Le vin, la viande salée, les fromages dont on voit des meules que l’on roule, les légumes secs, les épices, le bétail sur pied sont embarqués sur l’allège à quai qui chargera les munitions à bord d’un vaisseau en partance. A Marseille: sur le quai du vieil arsenal, au fond du port, s’active une foule animée et colorée de femmes et d’hommes du peuple auxquels se mêlent gentilshommes, femmes de qualité et religieux. Des levantiers, Turcs ou Barbaresques enturbannés arpentent aussi les quais. L’entrée du port est animée de multiples embarcations, canots, allèges, bateaux pêcheurs, tartanes. A Bordeaux, sur le quai des Salinières, nous voyons des jésuites, d’élégantes jeunes femmes en robes à panier, mais aussi des boulangers et un garçon vacher; un précieux tilbury lancé à vive allure contrastant avec un attelage de bœufs traînant un lourd charroi de tonneaux. Sur le fleuve, des bateaux de commerce viennent charger le vin contenu dans les tonneaux alignés sur le quai. A Rochefort, nous voici sur le quai aux vivres: les tonneaux de vin de Bordeaux, les chaudrons, les marmites sont destinés à l’approvisionnement des vaisseaux, de même que les bestiaux qui paissent dans la prairie. Les paquets de toiles à voiles et les gros écheveaux de chanvre vont alimenter les ateliers de l’arsenal dont la magnifique corderie qui s’étend sur la droite. A La Rochelle, au milieu des ballots, des panières, des fûts, des bois, des ancres, des femmes et des hommes travaillent, se reposent ou discutent, en un mot vivent sous nos yeux une attitude, un geste, un regard nous les rendent plus proches que de longs discours sur la société du XVIIIe siècle. Alors que bien souvent Vernet prend de grandes libertés face aux demandes très précises du roi pour le choix des sites ou du point de vue d’où il les dépeint, il répond pleinement à ses vœux en décrivant partout des scènes de la vie quotidienne: devant nos yeux vit tout un peuple au naturel. Témoignage pittoresque de la vie portuaire en France au temps de la marine à voile et de la douceur de vivre sous le règne de Louis XV le bien-aimé. Réunion très rare de l’ensemble des gravures des vues et ports de France, de Joseph Vernet, dans leur superbe tirage d’origine. Avec Joseph Vernet et sa descendance directe s'affirme une dernière fois la continuité de cette école d'Avignon qui, depuis le XIVe siècle, n'a cessé de se manifester par des artistes de talents et de caractères forts différents mais unis par d'indiscutables affinités. On peut faire remonter l'origine de cette école à l'époque où Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, devenu pape sous le nom de Clément V, transporta la cour pontificale à Avignon. Dans cette «petite ville paisible, dont le charme ne pouvait leur échapper, les papes firent éclore un puissant foyer artistique, dont l'éclat devait se prolonger jusqu'au XIXe siècle. À Avignon, qui garde intacts tant de vestiges de son destin exceptionnel, le jeune Joseph Vernet pouvait à chaque pas rencontrer des monuments susceptibles de lui donner un avant-goût de la ville unique qui devait plus tard le révéler à lui-même. Face au Palais des Papes s'élève cet Hôtel de la Monnaie, construit par un cardinal Borghèse, légat du Pape, et qui porte sur sa façade le dragon et l'aigle, armes de la famille, enfin la colline des Dons, où la vue est si belle sur le Rhône et sur Villeneuve est une réduction de ces jardins du Pincio, qui forment avec la Villa Médicis l'un des plus beaux lieux de Rome et du monde. Cet appel de l'Italie, Joseph Vernet le ressentit de bonne heure, et son père, Antoine Vernet, fut assez heureux pour intéresser aux dons brillants du jeune peintre plusieurs nobles personnages de la ville, en particulier le marquis de Caumont et le comte de Quinson, qui lui ouvrirent leur bourse et lui permirent de partir pour Rome, qui offrait à cette époque aux artistes des ressources incomparables. Mais au cours de ce voyage pour rejoindre la Ville éternelle, dont la première étape le conduisit à Marseille, Joseph Vernet devait faire une rencontre capitale : celle de la mer ; en effet des hauteurs qui dominent la ville elle lui apparut pour la première fois dans toute sa beauté ; ce fut le coup de foudre, et lorsque quelques jours plus tard, après une tempête spectaculaire, Vernet arrive à Civita-Vecchia, son destin est fixé : il deviendra le peintre de la mer qui, désormais, sera présente dans presque toutes ses œuvres. La vie que mène à Rome le jeune artiste est des plus agréables ; il y a été fort bien accueilli et s'y est fait rapidement une clientèle avide de tempêtes et de naufrages. Les livres de raison de Vernet nous donnent sur ses travaux des renseignements précis : en 1743 il est reçu membre de l'Académie de Saint Luc, honneur assez rare pour un étranger, la mer l'attire de plus en plus, c'est avec joie qu'il se rend en pèlerinage à Naples, où le maître qu'il admire tant, Salvator Rosa, trouva la source principale de son inspiration. Cependant à Rome la popularité de Vernet croît de jour en jour ; sa clientèle devient européenne. En Italie, Joseph a trouvé la fortune, la gloire et l'amour ; aussi n'est-il pas pressé de quitter un pays qui l'a si bien reçu. Pourtant, sollicité par ses protecteurs français, il se décide à rentrer définitivement dans son pays, mais il retourne en Italie à plusieurs reprises et ce n'est qu'en 1753 qu'il se fixe en France pour toujours. Grâce au haut patronage de M. de Marigny, directeur suprême des Beaux-Arts et frère de Mme de Pompadour, qui avait à ce moment toute la faveur de Louis XV, Vernet obtint du roi une commande où il devait donner toute la mesure de son talent : Les Ports de France. La mer qui l'inspira si souvent dans ses œuvres antérieures va lui fournir encore un thème important, mais elle ne sera cette fois que le complément de ses compositions ; pour un moment il va cesser de peindre des tempêtes, des orages et des coups de vent. Ces ports de France seront des paysages où la vérité et la fantaisie se mêlent agréablement, témoin ce Port de Marseille lumineux et doré comme un Claude Gellée, qui nous montre au premier plan un groupe réuni pour un goûter en plein air, un autre pour un bal ; les robes et les ombrelles des femmes animent ce paysage aux lignes si nobles et lui donnent un air de fête familiale. Même procédé dans la Vue de la Ville et de la Rade de Toulon, où nous voyons à mi‑hauteur des collines qui dominent la rade, s'activer sur une terrasse monumentale, des cavaliers, des chasseurs, des joueurs de boules et des dames en grande toilette. Cette volonté d'humanisation du paysage se retrouve dans presque toutes les œuvres de J. Vernet, même dans celles où elle pourrait paraître artificielle; dans les tempêtes, les naufrages, les orages, nous verrons toujours l'homme opposer à la force aveugle des éléments son courage, son ingéniosité ou son désespoir. Cette introduction du drame humain au milieu des aspects pittoresques d'une nature hostile, c'est là la véritable originalité de Joseph Vernet. «C'est un grand magicien, que ce Vernet, écrit Diderot, on croirait qu'il commence par créer un pays et qu'il a des hommes, des femmes, des enfants en réserve, dont il peuple sa toile comme on peuple une colonie, puis il leur fait le ciel, le temps, la saison, le bonheur, le malheur qu'il lui plaît ». La production de J. Vernet est considérable et ses contemporains raffolèrent de lui. Dans cette œuvre consacrée presque exclusivement à la mer, aux tempêtes, et aux orages, on peut distinguer au moins deux périodes, une période romaine profondément marquée par les peintres napolitains, Salvator Rosa et Solimena, qu'il admirait sans réserve ; il leur doit ce sentiment dramatique de la nature et cette largeur de facture qu'il manifesta dès ses premières œuvres. À son retour en France, son art s'humanise et s'enrichit de détails savoureux qui, loin d'en altérer le caractère, lui confèrent une grande part de son charme. Certes, J. Vernet a entendu le message de Poussin et de Claude Gellée, mais au sublime de l'un et au mystère de l'autre, il a substitué un pathétique humain et familier, et s'il n'atteint pas leur grandeur, il garde avec son siècle un contact plus étroit et une audience plus large en lui tenant un langage plus accessible. Après les fêtes galantes de Watteau et les Bergeries de Boucher, la nature telle que la conçoit Vernet et si apprêtée qu'elle nous paraisse, est une nature vraie et non un décor d'opéra. Si Vernet eut une influence manifeste sur le goût de son temps, il est plus difficile de percevoir son passage dans la peinture moderne. Pourtant bien des œuvres qui nous ravissent toujours portent sa marque indiscutable ; comment ne pas penser à lui devant les Ruines et les Cascades d'Hubert Robert et plus près de nous, comment oublier le Ponte Rotlo en admirant les Corot d'Italie ? Heureusement la postérité si sévère envers les gloires récentes en apparence les plus solides et qu'elle précipite si volontiers en enfer ou en purgatoire, révise tôt ou tard ses jugements les plus définitifs ; et tandis que les grandes batailles d'Horace Vernet ne font plus recette, la gloire du grand peintre des Ports de France, si aimable et si française nous apparaît toujours aussi pure et aussi justifiée.» J. Dupuy. Très bel exemplaire à grandes marges relié en demi-veau fauve.
Li Prouvençalo. Poésies diverses. Précédées d'une Introduction par M. Saint-René Taillandier, et suivies d'un Glossaire
Avignon Seguin Aîné 1852
In-12 (189 x 120 mm), xlv - (1) pp. - (1) ff., 437 pp., demi-cartonnage bleu à la bradel, coins, non rogné (reliure d'époque). Edition originale de ce recueil de poésies en provençal, contenant 10 poèmes de Frédéric Mistral, 16 de Joseph Roumanille, ainsi que de Joseph-Jacques-Léon d'Astros, Théodore Aubanel, Gustave Bénédit, François-Henri-Joseph Blaze (Castil-Blaze), Augustin Boudin, Marius Bourrelly, Barthélémy Chalvet, Antoine-Blaise Crousillat, Paul Giéra (Glaup), Anselme Mathieu, etc. Orné d'un portrait dédicace de Roumanille, et enrichi d'un feuillet de vocabulaire provençal manuscrit du même. Contient un Glossaire franco-provençal. Célèbre recueil, qui fut l'une des premières manifestations du Félibrige, fondé en 1854 par sept poètes provençaux dont Joseph Roumanille, Frédéric Mistral, Théodore Aubanel, etc. (quelques défauts sur les coupes et les coins, quelques petites mouillures claires, rousseurs). // 12o (189 x 120 mm), xlv - (1) pp. - (1) ff., 437 pp., bradel blue quarter-cloth, uncut (contemporary binding). First edition of this poetry collection in Provençal dialect, containing 10 poems by Frédéric Mistral, 16 by Joseph Roumanille, and also by Joseph-Jacques-Léon d'Astros, Théodore Aubanel, Gustave Bénédit, François-Henri-Joseph Blaze (Castil-Blaze), Augustin Boudin, Marius Bourrelly, Barthélémy Chalvet, Antoine-Blaise Crousillat, Paul Giéra (Glaup), Anselme Mathieu, etc. Illustrated with a portrait of Roumanille with dedication, enriched with an handwritten leaf of Provençal vocabulary by him. Contains a "Glossaire", french-Provençal. Famous poetry collection, one of the first expression of the Félibrige, founded in 1854 by seven Provençal poets including Joseph Roumanille, Frédéric Mistral, Théodore Aubanel, etc. (some defects on corners and turns-in, some little light water-stains, spots).
Lot de 7 Lettres autographes signée de François Deloncle et de 3 longues lettres autographes signées de Joseph Deloncle, adressées à et réunies par Gustave Lévy dont : 1 L.A.S. de Joseph Deloncle datée de Mayotte, 2 juillet 1889 : "A Diego Suarez je n'ai pas trouvé traces de passage de votre protégé" [ ... ] "Enfin notre campagne décline et il n'est que temps. J'en reviendrai complètement dégoutté de mon métir, ayant désappris le peu que m'avait donné mon service dans les ports et surtout mes relations avec M. Meslant. Au dégoût vient s'ajouter encore le découragement. Notre corps est mort, et il faudrait un rude coup pour le relever, l'avancement y est presque nul, aucunes compensations n'est offerte aux ennuis et aux difficultés d'un métier des plus mesquins" [ ... ] "Allons, j'entame mon antienne et vous allez me dire "Voilà Joseph qui me la refait à la Jérémie" [ ... ] Nous allons et venons tout le temps : juif errant de la côte malgache, le B. B. est partout, bien chez les Mahafales dans la baie Saint Augustin au Sud de Madagascar, aujourd'hui dans les Comores, hier arrêtant par sa formidable apparence les sauvages guerriers de sa Majesté Tompoumane de la baie St Augustin, aujourd'hui bombardant la Grande Comore où le féroce Ashimou avait élevé l'étendard de la révolte [ ... ] "Nous revenons des Comores où un sultan s'était déclaré indépendant ; il avait refusé de reconnaître l'autorité des princes que nous avions nommé, et les autres Comores menaçaient de se révolter en face de notre faiblesse. Enfin on a autorisé le concours de la force en présence des échecs diplomatiques et nous sommes allés protéger son Altesse Saïd Ali à coups de canons, victoire, triomphe, rentrée pittoresque dans la capitale. Le Saïd ali au milieu d'une multitude de gens de race arabe qui nous acclament, lancent des fantasias avec des cris à rendre sourd tout un décor d'opéra comique [ ... ] Puis nomination dans l'ordre peu connu - mais très estimé - de l'Etoile des Comores. Votre serviteur est chevalier et nous avons tous eu un sabre pris sur l'ennemi. En avant la musique !!! Tout cela aide à passer le temps et ici il faut le tuer deux fois. [ ... ] Et puis nous avions Papinaud, le tonnelier député, gouverneur Papenaud, qui a force de faire des tonneaux est devenu un foudre de guerre tout à fait réjouissant. Il voulait tout brrrûler, couper toutes es têtes, et envoyer des personnes en Calédonie, "un pays peuplé de sauvages, qui mangent les blancs, mon bon, et les prréfèrrent aux noirs encore, eh ! oui !" Quel beau Tartarin ! Brave homme, finaud comme un paysan, prometteur comme un Roumestan, et incapable de faire du mal à une mouche [ ... ] "Il est énergique, et au lieu de retenir notre commandant ce qui eut été dans l'ordre des choses, c'était lui qu'il fallait retenir" [ ... ] "je crois qu'on en ferait difficilement un ambassadeur mais comme gouverneur de Mayotte, il est très bien" [ ... ] / 1 LAS de Joseph Deloncle datée d'Obock, le 7 novembre 1891 : [ ... ]Pour moi, je continue à être content de mon sort ; ma femme et les bébés votn bien et j'ai pu faire quelque chose pendant mon intérim. On m'a un peu traité d'emballé, mais j'ai la conscience d'avoir noué avec les abyssins des rapports utiles et peu me chaut que cela ennuie l'Italie" [... ] "Mon chef M. Lagarde est un homme charmant, bien élevé, auquel je suis sincèrement dévoué, il ne me lâchera pas et je lui crois le bras long. Puis j'ai l'inspection dans deux ans" [ ... ] / 1 LAS de Joseph Deloncle datée d'Obock, le 17 mai 1892
Lot de 10 L.A.S. montées ensemble sur onglet par le destinataire Gustave Lévy, dont 7 Lettres autographes signée de François Deloncle et de 3 longues lettres autographes signées de Joseph Deloncle, adressées à et réunies par Gustave Lévy dont : 1 L.A.S. de Joseph Deloncle datée de Mayotte, 2 juillet 1889 : "A Diego Suarez je n'ai pas trouvé traces de passage de votre protégé" [ ... ] "Enfin notre campagne décline et il n'est que temps. J'en reviendrai complètement dégoutté de mon métir, ayant désappris le peu que m'avait donné mon service dans les ports et surtout mes relations avec M. Meslant. Au dégoût vient s'ajouter encore le découragement. Notre corps est mort, et il faudrait un rude coup pour le relever, l'avancement y est presque nul, aucunes compensations n'est offerte aux ennuis et aux difficultés d'un métier des plus mesquins" [ ... ] "Allons, j'entame mon antienne et vous allez me dire "Voilà Joseph qui me la refait à la Jérémie" [ ... ] Nous allons et venons tout le temps : juif errant de la côte malgache, le B. B. est partout, bien chez les Mahafales dans la baie Saint Augustin au Sud de Madagascar, aujourd'hui dans les Comores, hier arrêtant par sa formidable apparence les sauvages guerriers de sa Majesté Tompoumane de la baie St Augustin, aujourd'hui bombardant la Grande Comore où le féroce Ashimou avait élevé l'étendard de la révolte [ ... ] "Nous revenons des Comores où un sultan s'était déclaré indépendant ; il avait refusé de reconnaître l'autorité des princes que nous avions nommé, et les autres Comores menaçaient de se révolter en face de notre faiblesse. Enfin on a autorisé le concours de la force en présence des échecs diplomatiques et nous sommes allés protéger son Altesse Saïd Ali à coups de canons, victoire, triomphe, rentrée pittoresque dans la capitale. Le Saïd ali au milieu d'une multitude de gens de race arabe qui nous acclament, lancent des fantasias avec des cris à rendre sourd tout un décor d'opéra comique [ ... ] Puis nomination dans l'ordre peu connu - mais très estimé - de l'Etoile des Comores. Votre serviteur est chevalier et nous avons tous eu un sabre pris sur l'ennemi. En avant la musique !!! Tout cela aide à passer le temps et ici il faut le tuer deux fois. [ ... ] Et puis nous avions Papinaud, le tonnelier député, gouverneur Papenaud, qui a force de faire des tonneaux est devenu un foudre de guerre tout à fait réjouissant. Il voulait tout brrrûler, couper toutes es têtes, et envoyer des personnes en Calédonie, "un pays peuplé de sauvages, qui mangent les blancs, mon bon, et les prréfèrrent aux noirs encore, eh ! oui !" Quel beau Tartarin ! Brave homme, finaud comme un paysan, prometteur comme un Roumestan, et incapable de faire du mal à une mouche [ ... ] "Il est énergique, et au lieu de retenir notre commandant ce qui eut été dans l'ordre des choses, c'était lui qu'il fallait retenir" [ ... ] "je crois qu'on en ferait difficilement un ambassadeur mais comme gouverneur de Mayotte, il est très bien" [ ... ] / 1 LAS de Joseph Deloncle datée d'Obock, le 7 novembre 1891 : [ ... ]Pour moi, je continue à être content de mon sort ; ma femme et les bébés votn bien et j'ai pu faire quelque chose pendant mon intérim. On m'a un peu traité d'emballé, mais j'ai la conscience d'avoir noué avec les abyssins des rapports utiles et peu me chaut que cela ennuie l'Italie" [... ] "Mon chef M. Lagarde est un homme charmant, bien élevé, auquel je suis sincèrement dévoué, il ne me lâchera pas et je lui crois le bras long. Puis j'ai l'inspection dans deux ans" [ ... ] / 1 LAS de Joseph Deloncle datée d'Obock, le 17 mai 1892
Remarquable ensemble de lettres des frères Deloncle adressées à leur ami Gustave Lévy, dont 2 remarquables lettres de Joseph (qui fut un temps gouverneur intérimaire à Obock), dans lequel il évoque ses pérégrinations à Madagascar, ses "succès militaires" lors des événements de la Grande Comore en 1889, ses contacts avec les Abyssins lors de son séjour à Obock.
ALMANACH DES SAISONS. 4 NUMÉROS : Printemps 1920 - Automne 1920 - Hiver 1920-1921 - Printemps 1921. MANQUE Eté 1920 pour être complet en 5 livraisons.
Coutances, Au logis du pou qui grimpe, 12,5x16cm, broché sous couverture rempliée, Bon état pour l'ensemble de cette fragile publication.
PRINTEMPS 1920 : Boniment, 7 Le Colporteur de Mirages, poésie, Félix ROUSSEL, 10 Calendrier pour l'année 1920, 12 La Chanson des Mois, poésie, André ROMANE, 12 Pronostics, 14 Les Semaines du Printemps, Jardinage — Cuisine — Cave,16 Des Eclipses — Les Etoiles, Henry DUBUS, 30 Fra Angelico, Joseph QUESNEL, 36 Aphorismes, Rémy de GOURMONT, 40 Quatre-Temps, poésie, Paul HAREL, 42 L'Ane au Pré, Henri BACHELIN, 43 Le Premier Printemps de la Paix, poésie, Léon CHANCEREL, 46 Tabart et sa Plante, Marcel LEBARBIER, 49 Cinq Actes en vers, poésie, Georges LAISNEY, 63 Hulu, NOLA FREYNES, 67 En Guerre, Eveil du Printemps — Ecrit cinq ans plus tard, Henri DUTHEIL, 70 Le Rossignol est revenu, poésie, Maxime LÉRY, 81 Notre Printemps, Adolphe WILLETTE, 83 Histoire vraie du Chalutier Printemps, René DE LARGUILLY, 85 L'Idylle de M. Gustave, Robert REY, 88 Chroniques de la Saison, K. F. H., 103 des Livres, des Revues, Léon CHANCEREL, Marcel BOUYER, Marcel LEBARBIER, Joseph QUESNEL. Une Maison à la Campagne — Variations sur la Mode, André CARMIN, 116 MUSIQUE Ariette Printanière, Charles GALBRUN, 38 Rondel de Charles d'Orléans, ROLAND SAINT-AULAIRE, 99 IMAGES de CARLÈGLE (Hors-texte) Ludovic Rodo — JOANNY-DURAND — Joseph QUESNEL — Henry CHAPRONT — Georges LAISNEY — René JOUENNE — René LE CONTE — René GABRIEL. Têtes de Chapitres, Lettrines et Culs de lampe de Jean THÉZELOUP.AUTOMNE 1920 : Elles sont mortes... poésie, Robert DESNOS, 5 Calendrier pour l'année 1920, 6 Automne rêche, poésie, Joseph DELTEIL, 6 Pronostics, 8 Les Semaines de l'Automne, Jardinage — Cuisine — Cave, 10 Les Maladies du pommier, 24 Eclipses, 26 Le Soleil, Henry DUBUS, 27 Automne, poésie, Ernest RAYNAUD, 29 Oggi Trippa, G. AUBAULT DE LA HAULTE CHAMBRE, 31 Louis XVII, poésie, Pierre BENOIT, 39 De la Chasse, SULPICE DE LA RÉAUTIERE, 40 Le Bolet Noir, poésie, Fernand MAZADE, 48 Conseils du bon Champignoniste, Agénor CAMPINOLIN , 49 Un Automne en Alsace après la reconquête, poésie, Henri DUTHEIL, 52 Notre-Dame et le Paysan, Henri-François DE MALHERBE, 55 L'inutile départ, poésie, Yves BLANC, 68 Calendrier des Pêches, René DE LARGUILLY, 70 Apothicairerie, Joseph-Louis D'AVRY, 80 Sur une carte à jouer, 86 Liqueurs dites de ménage... L'Ancien Mousse du Bateau-Ivre, 88 Petit Traité de Savoir-Dire, RUFFIN, 92 Le Salon d'Automne, Robert SIGL, 100 La Mode et l'Ameublement, André CARMIN , 107 Au Jardin du Papier Noirci, L'HOMME A LA BÊCHE, 111 IMAGES de Adolphe WILLETTE (Hors-texte) — Gérard COCHET — Pierre LE CONTE — René JOUENNE — Amand LEPAUMIER — Joseph QUESNEL. Têtes de Chapitres, Lettrines et culs de lampe de Jean THÉZELOUP. Couverture de Joseph QUESNEL.HIVER 1920-1921 : Boniment, 4 Table pour l'année 1920, 9 Prédictions pour 1921, 1 Les Semaines de l'Hiver, Jardinage — Cuisine — Cave, 16 Maladies des Boissons Fermentées MAURICE DE STEMPOWSKI, 30 Poésies de Philippe CHABANEIX, 38 Astrologie, Henry DUBUS, 34 Aubade, poésie, André ROMANE, 39 L'Hiver, Pierre MAC-ORLAN, 36 La Messe du 21 Janvier, 40 Pensées de NOLA FREYNES, 45 Conte pour Noël, Léon CHANCEREL, 47 Poème de Marcel MILLET, 53 Hiver, CHRISTIAN, 56 Zigoui, Jean DE GOURMONT, 59 Branle de la Chandeleur, George AURIOL, 65 Contes de Province, Jane RAMEL, 73 Jules BARBEY D'AUREVILLY, 77 Petit Traité de Savoir-Dire, 89 Saison d'Hiver, Paul PITCH et Edm. BARIN , 98 La Mode et l'Ameublement, 102 Au Jardin du Papier-Noirci, 105 IMAGES de Suzanne DE GOURMONT (Hors-texte) — Pierre FALKÉ — René JOUENNE — Pierre LE CONTE — Joseph QUESNEL — Jeanne RAMEL (Jane Cals).PRINTEMPS 1921 : Boniment, 7 Jardins, poésie, d'André DAVID, 9 Astrologie, 11 Les Semaines du Printemps, 12 Recettes de cuisine, 26 La Science de Gueule, Sulpice de la RÉAUTIÈRE, 29 Broutilles de Printemps, FLORIMOND, 35 Danse, poésie, d'André SPIRE, 43 Le Bâton, Henri BACHELlN, 45 Poésie, de Robert DESNOS, 52 Petit Traité de Savoir-Dire, RUFFIN, 53 Sonnet, Yves BLANC, 66 Le Printemps au Presbytère, abbé SOURY, 67 Primevères, poésie, d'Emile MASSON, 74 Calendrier des Pêches, René de LARGUILLY,76 L'Aventure Printanière, Madeleine et Marcel MILLET, 89 Poésie, Albert HENNEQUIN, 96 Entretien sur les Ruches J.-L. d'AVRY, 97 Petite chronique de la Mode et de l'Ameublement, Sigismond CHROME, 103 Au Jardin du Papier Noirci, l'Homme à la Bêche, 113 IMAGES de Mme M. MARTINIE — ANDRIEUX — Pierre LE CONTE — Joseph QUESNEL — JEAN THÉZELOUP — Couverture de Pierre LE CONTE.
JOSEPH DELTEIL PROPHÈTE DE L'AN 2000
Montpellier Les Presses du Languedoc / Imago 1990 in 8 (24x15,5) 1 volume broché, couverture illustrée, 249 pages [2], avec de nombreuses photographies en noir et blanc, dont photographies tirées du documentaire de J.-P. Berroux "Vive Joseph Delteil ou la Grande journée". Joseph Delteil en quelques dates; Premiers tournages avec Joseph Delteil; Pour mieux connaitre Delteil, descendons dans sa cave; Enfance de Joseph Delteil; Interlude; Du rituel des repas chez les Delteil; Du charme de nos familles d'antan; Caroline et Joseph ou deux coeurs d'amour épris; Une amitié oecuménique: Joseph Delteil - Henry Miller; En tête à tête avec Joseph Delteil. Bibliographie. Etat de neuf
Neuf Broché
Le roman des Cent-Jours. Traduit de l'allemand par Blanche Gidon.
Paris, Bernhard Grasset 1937. 8°. 254 S. Originalbroschur mit Deckelbild.
Erste französische Ausgabe. - Nr. 6/61 Exemplaren auf Velin pur fil (weitere 45 numerierte Exemplare wurden auf Alfa Navarre gedruckt). Joseph Roths "französischer" Roman über die 100 Tage der Rückkehr Napoleons an die Macht. "Le roman: C'est triste, je ne voudrais pas livrer le secret, mai je vous le dis à vous: les 100 jours. Il m'intéresse, ce pauvre Napoléon - il s'agit pour moi de la transoformer un Dieu redevenant un homme - seule phase de sa vie, ou il est 'homme' et malheureux. C'est la seul fois dans l'histoire où on voit qu'un 'incroyant' devient visiblement petit, tout petit. Et c'est ça qui m'attire. Je voudrais faire un 'humble' d'un 'grand'. C'est visiblement la punition de dieu, la première fois dans l'histoire moderne. Napoleon abaissé: voilà le symbole d'une âme humaine absolument terrestre qui s'abaisse et qui s'élève à même temps." (Brief von Joseph Roth an Blanche Gidon, Nizza 17.11 1934) - Joseph Roths verstand sich als Europäer und fühlte nach seiner Flucht aus dem deutschen Sprachraum das sprachliche und kulturelle Defizit des Monolingualen. In einem Brief an Blanche Gidon beklagt er sich über seine mangelden Französischkenntnisse: "Oh, si je pouvais écrire en français! Maintenant presqu' à quarant ans, je commence à comprendre qu'écrire qu'en une langue seulement c'est comme avoir un seul bras. Ayant deux patries je devrais pouvoir maitriser deux langues paternelles." (Brief vom 9.6. 1934 in der Orthographie Roths). - Blanche Netter-Gidon (1883-1974) war eine der engsten Vertrauten und die wichtigste Übersetzerin von Roths Schriften während des Exils in Paris. Sie stammte aus einer jüdischen Familie aus dem Elsass und wuchs in Rouen auf. 1911 heiratete sie den Mediziner Ferdinand Gidon. Sie war als Lehrerin an verschiedenen Gymnasien in Paris tätig und begann für den Verlag Payot E.T.H. Hoffmann und Heinrich Heine zu übersetzen. Über Maryla Reifenberg, der Frau des FAZ Journalisten Benno Reifenberg, lernte sie 1933 Joseph Roth kennen. Sie übersetzte den Roman "Radetzkymarsch". Obwohl Roth sich über die Qualität der Übersetzung beklagte, blieb sie bis zu seinem Tode die wichtigste Beraterin in Paris. Der grösste Teil des Nachlasses wurde von ihr nach dem Tode Roths am 27. Mai 1939 aus dessen letzter Wohnung in der Rue Tournon 18 gerettet. - Seite 22/23 mit schwachem Fleck wahrscheinlich durch die Einlage eines säuerhaltigen Papiers. Unbeschnittenes Exemplar. - Première édition française. - No. 6 des 16 exemplaires sur Velin pur fil (45 autres exemplaires numérotés furent imprimés sur Alfa Navarre). Le roman français de Joseph Roth sur les 100 jours qu'il fallut à Napoléon pour reconquérir le pouvoir. "Le roman: C'est triste, je ne voudrais pas livrer le secret, mai je vous le dis à vous: les 100 jours. Il m'intéresse, ce pauvre Napoléon - il s'agit pour moi de la transoformer un Dieu redevenant un homme - seule phase de sa vie, ou il est 'homme' et malheureux. C'est la seul fois dans l'histoire où on voit qu'un 'incroyant' devient visiblement petit, tout petit. Et c'est ça qui m'attire. Je voudrais faire un 'humble' d'un 'grand'. C'est visiblement la punition de dieu, la première fois dans l'histoire moderne. Napoleon abaissé: voilà le symbole d'une âme humaine absolument terrestre qui s'abaisse et qui s'élève à même temps." (Lettre de Joseph Roth à Blanche Gidon, Nice 17.11.1934). Joseph Roth se voyait comme un européen, mais ressentait en tant que germanophone son déficite culturel et linguistique. Dans une lettre à Blanche Gidon il se plaint de son manque de connaissance de la langue française. "Oh, si je pouvais écrire en français! Maintenant presqu' à quarant ans, je commence à comprendre qu'écrire qu'en une langue seulement c'est comme avoir un seul bras. Ayant deux patries je devrais pouvoir maitriser deux langues paternelles."(lettre du 9.6.1934 dans la manière d'écrire de Roth). - Blanche Netter-Gidon (1883-1974) était l'une des plus proches confidentes de Roth, ainsi que sa plus importante traductrice durant son exil à Paris. Elle était issue d'une famille juive alsacienne, elle grandit à Rouen, en 1911 elle épousa le médecin Ferdinand Gidon. Elle enseigna dans différent lycée parisiens et commença à traduire E.T.H. Hoffmann et Heinrich Heine pour l'éditeur Payot. Joseph Roth en lui fut présenté en 1933 par Maryla Reifenberg la femme du journaliste à la FAZ ( Frankfurter Allgemeine Zeitung) Benno Reifenberg. Elle traduisit le roman « Radetzkymarsch ». Même si Roth se plaignit de la qualité de sa traduction, elle resta, jusqu'à sa mort, sa plus importante conseillère à Paris. La plus grande partie de son héritage laissé à son dernier domicile au 18 rue Tournon, fut sauvé par Blanche Gidon après le décès de Roth le 27 mai 1939. - Pages 22/23 avec une légère tache provenant probalbement d'un papier intercallé avec un ph acide. - Exemplaire non coupé.
LA FAYETTE (Gilbert du Motier de), POIREY (Joseph-Léonard), BAILLY (Jean Sylvain), BOULA (Guillaume-Sylvain).
Reference : 4503
(1791)
Brevet de lieutenant de chasseurs volontaires de la Garde Nationale Parisienne.
Hotel de ville de Paris, 1er et 6 septembre 1791. 1791 1 feuille in-folio manuscrite à l'encre brune recto-verso (382 X 246 mm.) signée Henry, La Fayette, Bailly, Poirey et Dejoly, cachet en bas à droite (traces de plis avec cassures ancienement restaurées, taches ou traces d'adésif ). Chemise de papier ancien.
Brevet de lieutenant de la Garde Nationale Parisienne portant les signatures de Bailly, premier maire de Paris, de La Fayette, commandent fondateur de la garde et de Joseph-Léonard POIREY, son ancien compagnon darmes de la Guerre dAmérique, alors secrétaire général des Gardes nationales, document raturé postérieurement. Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert Motier, marquis de La Fayette (1757-1834), auréolé par son héroïsme à défendre les libertés pendant la guerre dindépendance américaine, est en 1789 le fondateur de la Garde nationale à Paris le 15 juillet 1789. Il en demeure le général jusquà sa démission le 8 octobre 1791 suite aux troubles révolutionnaires survenus les mois précédents. Joseph-Léonard Poirey (1748- , qui fut son secrétaire militaire pendant la Révolution américaine, participe à aux batailles à Petersburg, Jamestown et Yorktown. Rentré en France avec Lafayette, il sert comme capitaine secrétaire général de la Garde nationale française fin 1789 et ensuite secrétaire général des troupes parisiennes. En 1790, le Sénat des États-Unis confirme la nomination de Poirey par le président George Washington au grade de brevet de capitaine et, l'année suivante, il est admis dans la Society of the Cincinnati. George Washington écrit au sénat le 30 mai 1790 : « M. de Poirey served in the American Army for several of the last years of the late war, as Secretary to Major General the Marquis de la Fayette, and might probably at that time have obtained the Commission of Captain from Congress upon application to that Body. At present he is an officer in the French National Guards, and solicits a Brevet Commission from the United States of America. I am authorised to add, that, while the compliance will involve no expense on our part, it will be particularly grateful to that friend of America, the Marquis de la Fayette. Et La Fayette écrira le 20 avril 1801. « I do but justice to Captain [Joseph-Léonard] Poirey when being called upon as a witness of his services in the American Revolution... » Jean Sylvain Bailly (1736-1793), mathématicien, astronome, académicien, écrivain est désigné maire de Paris le 15 juillet 1789 par acclamation. C'est à ce titre qu'il remet la cocarde tricolore au roi, lors de la visite que celui-ci rend à l'hôtel de ville, le 17 juillet. Le 17 juillet 1791, la Garde nationale, sous ses ordres, tire sur les pétitionnaires qui se tiennent sur le Champ-de-Mars. Sa popularité tombe au plus bas et le 12 novembre, il démissionne. Le présent brevet établis au nom du lieutenant Guillaume-Sylvain Boula étant rédigé au début du mois de septembre 1791, il porte les signatures de Bailly et de La Fayette alors en fonction. Sy ajoute celle du greffier (Dejoly). Cependant, celle du général a été postérieurement barrée ainsi que les mots imprimés « Par Monsieur le Maire » et « Général ». Rare et beau document. 1 sheet in-folio handwritten in brown ink on both sides (382 X 246 mm.) signed Henry, La Fayette, Bailly, Poirey and Dejoly, stamped at the bottom right corner (traces of folds with old restored breaks, stains or traces of adesif ). Old paper folder. Patent of lieutenant of the Parisian National Guard bearing the signatures of Bailly, first mayor of Paris, of La Fayette, founding commander of the guard and of Joseph-Léonard POIREY, his former comrade-in-arms of the American War, then secretary general of the National Guard, document erased later. Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert Motier, marquis de La Fayette (1757-1834), honored by his heroism in defending liberties during the American war of independence, was the founder of the National Guard in Paris on July 15, 1789. He remained its general until his resignation on October 8, 1791, following the revolutionary unrest of the previous months. Joseph-Léonard Poirey (1748- , who was his military secretary during the American Revolution, participated in the battles at Petersburg, Jamestown and Yorktown. Returning to France with Lafayette, he served as captain general secretary of the French National Guard at the end of 1789 and then general secretary of the Parisian troops. In 1790, the U.S. Senate confirmed President George Washington's appointment of Poirey to the rank of captain and the following year he was admitted to the Society of the Cincinnati. George Washington wrote to the Senate on May 30, 1790: "M. de Poirey served in the American Army for several of the last years of the late war, as Secretary to Major General the Marquis de la Fayette, and might probably at that time have obtained the Commission of Captain from Congress upon application to that Body. At present he is an officer in the French National Guards, and solicits a Brevet Commission from the United States of America. I am authorized to add, that, while the compliance will involve no expense on our part, it will be particularly grateful to that friend of America, the Marquis de la Fayette. And La Fayette will write on April 20, 1801. "I do but justice to Captain [Joseph-Léonard] Poirey when being called upon as a witness of his services in the American Revolution..." Jean Sylvain Bailly (1736-1793), mathematician, astronomer, academician, writer was appointed mayor of Paris on July 15, 1789 by acclamation. It was in this capacity that he gave the tricolor cockade to the king during the latter's visit to the town hall on July 17. On July 17, 1791, the National Guard, under his orders, shot at the petitioners who were standing on the Champ-de-Mars. His popularity fell to a low point and on November 12, he resigned. The present patent established in the name of lieutenant Guillaume-Sylvain Boula being written at the beginning of September 1791, it bears the signatures of Bailly and La Fayette then in office. The clerk's signature (Dejoly) is added to it. However, that of the general was later crossed out as well as the printed words "Par Monsieur le Maire" and "Général". Rare and beautiful document.


Phone number : 06 81 35 73 35
Promenades de Critès au sallon de l'année 1785.
Londres, Paris, chez les Marchands de nouveautés, 1785. In-8 de 22 pp.[GORSAS (Antoine-Joseph)]. Deuxième promenade de Critès au sallon. Londres, Paris, chez les Marchands de nouveautés, 1785. 39 pp.[GORSAS (Antoine-Joseph)]. Troisième promenade de Critès au sallon. Londres, Paris, Hardouin et Gattey, chez les Marchands de nouveautés, 1785. 60 pp.[GORSAS (Antoine-Joseph)]. L'âne promeneur, ou Critès promené par son âne ; Chef-d'oeuvre pour servir d'Apologie au goût, aux mœurs, à l'esprit, et aux découvertes du siècle. Première édition revue, corrigée, et précédée d'une préface à la mosaïque, dans le plus nouveau goût. Pampelune, chez Démocrite, imprimeur-libraire de son Allégresse Sereinissime Falot Momus, au Grelot de la Folie, et Paris, chez l'auteur, Mde. veuve Duchesne, Hardouin et Gatey, Voland, Royez, Versailles, chez l'auteur et aux quatre coins du monde, 1786. (2)-302-(2) pp. [GORSAS (Antoine-Joseph)]. La Plume du coq de Micille, ou aventures de Critès au Sallon, Pour servir de suite aux Promenades de 1785. Premiere journée. Londres, Paris, Hardouin & Gattey, 1787. 46 pp.[GORSAS (Antoine-Joseph)]. La Plume du coq de Micylle, ou aventures de Critès au Sallon , Pour servir de suite aux Promenades de 1785. Seconde journée. Londres, Paris, Hardouin & Gattey, 1787. 39 pp.6 pièces reliées en 1 vol. in-8, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert (reliure de l'époque).
Recueil très rare de l'ensemble des pièces en édition originale consacrées au Salon de 1785 sous le pseudonyme de Critès par Antoine-Joseph Gorsas (1751-1793) dont l’Âne promeneur illustré du portrait de l'auteur dans le texte (page 277) : « L’Âne promeneur, ou Critès promené par son âne d’Antoine-Joseph Gorsas, imprimé semi clandestinement en 1786, flétrit sans retenue par l’entremise de l’insolent Critès et de son âne ratiocineur, les mœurs, les lubies et « l’ingoût » de ce « siècle des singularités », réservant à Beaumarchais un traitement particulièrement ravageur. Un joyau de fronde littéraire publié trois ans avant le grand chambardement de 1789 qui fera de son auteur un journaliste reconnu puis une des premières victimes de la Terreur » (Philippe Hoyau). Les trois Promenades de Critès publiées un an auparavant (1785) furent suivies deux ans plus tard par la Plume du coq de Micille « superbe compte rendu publié en 1787, salué pour son originalité [dans lequel] Critès qui avoue d'emblée son naturel « curieux, bavard, indiscret et médisant » se rend au Salon muni d'une plume qui lui donne le pouvoir d'apparaître ou de disparaître à sa guise. En note, Gorsas reconnaît sa dette à l'égard de Lucien et du dialogue qu'il « fait faire entre Micille et ce coq », « un badinage vif et léger, sous lequel l'auteur déguise la morale la plus pure, et donne les leçons les plus sérieuses » [Ferran Florence. Mettre les rieurs de son côté : un enjeu des salons de peinture dans la seconde moitié du siècle. In: Dix-huitième Siècle, n°32, 2000. pp. 181-196].Antoine-Joseph Gorsas (1751-1793) imprimeur-libraire, était l'auteur de nombreux pamhlets avant la Révolution dont celui dirigé contre Loménie de Brienne en 1788 le conduisit à la prison de Bicêtre. En 1789, il fonda le Courrier de Paris devenu Courrier des (83) départemens (1790-1793) et rédigea plusieurs périodiques dont Le Courrier de Versailles à Paris et de Paris à Versailles. Député à la Convention proche des Girondins, son imprimerie fut saccagée le 9 mars 1793. Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire, il fut exécuté à Paris le 7 octobre suivant. Monogramme en clé de sol (G?) sur le titre de la Deuxième promenade et correction manuscrite en marge de la page 13. Discrètes restaurations. Très bon exemplaire.Quérard III, 411 ; Sgard, Journalistes, n°350 ; McWilliam, A Bibliography of Salon criticism in Paris from the «Ancien Régime» to the Restoration, 1699-1827, (1991), n°399-440 ; Collection Deloynes, 333-334-335, 382-383.
PFISTER R., SRTRZYGOWSKI Joseph, CASTAGNÉ Joseph, TROISKY V, BUHOT Jean
Reference : 50113
Revue des Arts Asiatiques, Annales du Musée Guimet, N°1 du Tome IV, 1929 (R. PFISTER: Gobelins sassanides du Musée de Lyon. Joseph SRTRZYGOWSKI: Eléments proprement asiatiques dans l’art, Joseph CASTAGNÉ: L’Orientalisme et l’archéologie au Turkestan russe, V. TROISKY: Expédition scientifiques soviétiques. Fouilles dans l’asie centrale. Bibliographie.
Editions G. Van Oest, Paris, Bruxelles, 1929.
Un volume in-4° (23 x29 cm), couverture souple éditeur de couleur crème. 72 pages et 4 articles. R. PFISTER: Gobelins sassanides du Musée de Lyon ( 5 planches). Joseph SRTRZYGOWSKI: Eléments proprement asiatiques dans l’art (4 planches). Joseph CASTAGNÉ: L’Orientalisme et l’archéologie au Turkestan russe (3 planches), V. TROISKY: Expédition scientifiques soviétiques. Fouilles dans Asie centrale. Exemplaire complet de ses planches dont 2 en couleurs. Quelques très discrets signes d’âge mais TRES BON ETAT.
Considérations intéressantes sur les affaires présentes. -- Exhortation a la Concorde envoyée aux Etats-Généraux sous le nom du Roi. -- Vues générales sur la constitution françoise ou exposé des droits de l'Homme dans l'ordre naturel, social & monarchique. -- Harangue de la nation à tous les citoyens sur la nécessité des contributions patriotiques. -- Correspondance entre M. C*** et le comte de Mirabeau, sur le rapport de M. Necker, et sur l'arrêt du conseil du 29 décembres, qui continue pour six mois, force de monnoie au papier de la caisse-d'escompte.
Londres, Paris Barrois - Desenne 0 fort in-8 Reliure d'époque
5 textes reliés en un volume: [MIGNONNEAU]. Considérations intéressantes sur les affaires présentes. Londres, Paris, Chez Barrois, 1788. Seconde édition augmentée. 207 pp. --- [CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim)]. Exhortation a la Concorde envoyée aux Etats-Généraux sous le nom du Roi. S.l., s.n., 1789. 78 pp. --- CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim). Vues générales sur la constitution françoise ou exposé des droits de l'Homme dans l'ordre naturel, social & monarchique. Paris, Desenne, 1789. 165 pp. --- CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim). Harangue de la nation à tous les citoyens sur la nécessité des contributions patriotiques. Paris, Desenne, 1789. 74 pp. --- [CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim)]. Correspondance entre M. C*** et le comte de Mirabeau, sur le rapport de M. Necker, et sur l'arrêt du conseil du 29 décembres, qui continue pour six mois, force de monnoie au papier de la caisse-d'escompte. S.l., s.n., 1789. 60 pp. >> Relié à l'époque: plein vélin tenité vert, pièce de titre avec lettre or au dos, tranches rouges. Très bon 0
Mémoire pour Pierre-Joseph-François Luneau de Boisjermain, souscripteur de l'encyclopédie.
Paris, imprimé par Grangé par ordre supérieur, 1771. In-4 de VIII-152-50-(2) pp., errata, tableau typographique replié, cartonnage ancien, pièce de titre manuscrite au dos. La seconde partie Pièces justificatives (titre et pagination séparée) est placée à la fin du volume.
Édition originale du célèbre mémoire contre les imprimeurs de l’Encyclopédie et diffuseurs de livres Le Breton et Briasson, rédigé en deux parties par Luneau de Boisjermain dont la description détaillée des faits et la réunion des pièces justificatives : arrêts, privilèges dont celui pour l’impression de l’Encyclopédie, etc. ; un tableau donne les détails du calcul des sommes reçus en trop par les libraires Briasson, Le Breton, David et Durand. Pierre-Joseph-François Luneau de Boisjermain (1732-1801) instituteur et auteur de manuels scolaires, voulut en 1768 donner une édition de Racine ornée de figures et la vendre lui-même, pratique formellement interdite par le code de la librairie de 1723 qui défendait tout individu en dehors de la corporation de « faire le commerce de livres ». Accusé d’activité commerciale illicite par la corporation des libraires, Luneau de Boisjermain décida d’attaquer les syndicats de librairies pour une mauvaise gestion de la souscription à la célèbre Encyclopédie, dont Le Breton était le dernier libraire associé encore en vie : « Luneau et quelques adhérents qu'il réussit à entraîner à sa suite, prétendaient, en leur qualité d'anciens souscripteurs, non seulement recevoir gratuitement neuf volumes, mais encore se faire rembourser cent soixante-quatorze livres huit sols, qui, selon eux, avaient été exigées indûment. Si chaque confrère de Luneau avait émis une prétention semblable, les libraires auraient été tenus de rembourser 1,948,052 livres. » (Tourneux). Diderot, qui avait connu Le Breton et souffert de leur collaboration, commit l’imprudence d’écrire à Boisjermain, qui réutilisa et déforma ses propos à deux reprises, poussant l’écrivain à rédiger à son tour un factum. L'affaire s'éternisa jusqu'en 1778, date à laquelle Luneau et ses partisans furent déboutés et condamnés aux dépens. Toutefois, c’est grâce au retentissement de cette affaire que le 30 août 1777 furent promulguées des arrêts accordant aux auteurs de vendre leurs propres ouvrages. [Suivi de :] 1. LUNEAU DE BOISJERMAIN (Pierre-Joseph-François). Mémoire et consultation pour M. Luneau de Boisjermain contre le sieur Briasson, libraire, syndic des libraires & imprimeurs… et le sieur Le Breton… associé avec le sieur Briasson pour l’impression de l’Encyclopédie. Paris, imprimerie de Louis Cellot, 1770. In-4 de 14 pp. Édition originale.2. LUNEAU DE BOISJERMAIN (Pierre-Joseph-François). Lettre de M. Luneau de Boisjermain à M. Diderot et réponses [de M. Luneau] à la lettre adressée aux sieurs Briasson et Lebreton par Diderot. Paris, P.-G. Simon, 1771. 32 pp. Signé : Cournault. 1er décembre 1771. Édition originale. Réponse très détaillée à la lettre de Diderot publiée en août 1771, imprimé en deux colonnes avec le texte de Diderot en face. 3. LUNEAU DE BOISJERMAIN (Pierre-Joseph-François). Réponse de M. Luneau de Boisjermain au mémoire des libraires associés à l'Encyclopédie, distribué au mois d'août 1771. Paris, P.-G. Simon, 1771. 84 pp. Édition originale avec le mémoire en regard.4. À Nosseigneurs de parlement. Paris, P.-G. Simon, 1772. 8 pp. Édition originale. Requête d'intervention des sieurs N. Leguay et consorts, prenant fait et cause pour le sieur Luneau de Boisjermain contre les libraires associés à l'Encyclopédie. Signé Desroches.5. LUNEAU DE BOISJERMAIN (Pierre-Joseph-François). Réponse signifiée de M. Luneau de Boisjermain au précis des libraires associés à l'impression de l'Encyclopédie, distribué le 15 juin 1772. Paris, P.-G. Simon, 1772. 20 pp. Édition originale. 6. Précis sur délibéré prononcé le 22 juin 1772, entre Pierre-Joseph-François Luneau de Boisjermain, et les sieurs Le Breton et Briasson et les héritiers des feus sieurs David et Durand, libraires associés à l'impression de l'Encyclopédie. Paris P.-G. Simon, 1772. 16 pp. Édition originale. Signé Cournault.Provenance : Jean-Charles Ledesme, baron de Saint-Élix (1721-1802), chevalier Saint-Louis, avec son ex-libris gravé augmenté à l'encre du temps « Johannes Carolus Ledesma bibliothèque de St Elix » (contreplat). Cartonnage défraîchi.Précieux recueil consacré à l'affaire de l'Encyclopédie qui marqua le début du droit de l’auteur à distribuer ses propres ouvrages.
Factums ROMETTE (Jean) - COTTIER (Charles) - FAUDON (Joseph-Thomas).
Reference : 18285
REPONSE pour Mrs. Juvenal frères, Mr Descotte, & autres proches parens de Messire Joseph-Hyacinthe De Chaud De Colombier du lieu de Villes, au mémoire dressé pour ledit seigneur De Colombier, & pour noble Joseph-Thomas Faudon, docteur ez droits & avocat, son prétendu curateur à plaid.MEMOIRE pour messire Joseph-Hiacinthe De Chaud De Colombier, du lieu de Villes, & pour le soussigné Joseph-Thomas Faudon D. ez D. Son avocat & curateur à plaid. Contre le Sr. Descottes, Mrs. Juvenal frères, Mr. Allibert notaire & autres collatéraux de Mr. De Colombier.
A Carpentras chez Dominique-Gaspard Quenin et chez Jean-Joseph Penne, 1777, 1 broché, sans couverture. in-4 de 111, 12 et 40 pages ;
Joseph-Hyacinthe de Chaud de Colombier, seigneur de Villes sur Auzon, prés de Carpentras est accusé par les membres de sa famille de dilapider ses biens, ceux-ci prétendent qu'il est devenu fou et demandent des réquisitions pour lui interdire de gérer ses biens.De Chaud de Colombier est défendu par son épouse qui ne vit pas avec lui, Dame de Savoillans, fille de Vincens de Mauléon de Causans, seigneur de Savoillans.Ces deux factums sont les plaidoiries des avocats des deux parties.
Phone number : 06 80 15 77 01
Trente tableaux d'Histoire de France. Revue et corrigée par Joseph Hemard.
Paris EDITION DU SOURIRE 1912 1 Maquette préparatoire à la mine de plomb, signée en bas à droite, 17.5 x 28.5, titrée "Les Petites premières : hommages en 950. Illustrations de Joseph Hemard. Paris, Éditions du Sourire, 1912, in-4 oblong, demi-percaline rouge, plats cartonnés illustrés en couleurs.
Maquette préparatoire non retenue, à la mine de plomb "Les Petites premières : hommages en 950. Us et coutumes des Carolingiens". Un chevalier est à genoux devant son suzerain en signe de soumission. Usures et rousseurs à la couverture de l'ouvrage et aux coins, plis, piqûres interne. "Le grand illustrateur qu'est aujourd'hui Joseph Hemard (1880 - 1961) se trouve en effet tout entier dans cet ouvrage (...) où avec un sens étonnant de l'histoire, il a délicieusement ramassé vingt siècles. Du format des albums enfantins, imprimé par des procédés grossiers et sur le papier habituel à ce genre de publication, ce recueil a pourtant une allure magnifique et il est déjà (...) avidement recherché par les amateurs. Tout l'instinct mystérieux que son auteur méconnaissait peut-être (...), s'épanouit dans ces pages où s'anime la vie des siècles lointains, savoureuse et vivante, tragique, naïve ou glorieuse, toujours d'une humanité et d'une vérité qui nous empoignent (...)" (in Revue "Vient de paraitre" 1923). Ouvrage imprimé par la Société Générale d'Impression, gravé par A. et P. Groley. s.
The Art of Body-Loading and productions.
Bideford, Devon, The Surpreme Magic Compagny. (Nachdruck der Ausgabe von 1950). 4°. 40 Bl. Originalbroschur, geheftet.
Vervielfältigtes Typoskript. "Eddie Joseph (1899-1974) was a full-time professional performer, teacher and writer on things magical. Working under the name Eddie Jason, he played exclusive club and party dates in and around Calcutta and Bombay. He also conducted the School of Magic in Bombay. Eddie Joseph was a Baghdadi Jew from Calcutta where he was born. Most of his life he lived in India. Later he moved to England, working for Max Andrews. Contributions in magazines and internet claim he was born of English parents, which is obviously wrong. His interest in magic was aroused at an early age and at the age of twelve he saw his first big mystery show, Nicola. At eighteen, he became a part-time professional and remained so until 1945 when he became a full-time professional performer, teacher and writer. He was chosen to appear in the Silver Jubillee Show for King George V. He was also the first magician to do magic over the radio in India in 1933, making over 30 broadcasts from the All India Radio stations in Calcutta, Bombay and Lucknow. He had worked out an act in which he used no apparatus except ordinary and borrowed objects. He also did a mental act assisted by his wife, Sarah. For many years, Joseph was the Indian Representative of the I.B.M. and he was active in the Society of Indian Magicians. During World War II, he was drafted to do a turn in a revue for the entertainment of British and American servicemen. He and his wife traveled all over India for the balance of the war. - It's been said that he tried to invent one new trick every day. He wrote over 70 books and pamphlets and contributed many articles to Genii and The New Tops. Joseph's first contribution to The Linking Ring was in the September 1927 issue. The IBM Ring in Bombay, India is known as the Eddie Joseph Ring. Eddie Joseph passed away in England in June of 1974." (Magicpedia).
L'ECHO DES ALPES - PUBLICATION DES SECTIONS ROMANDES DU CLUB ALPIN SUISSE N°2 - Une excursion au Vésuve par J.-L. Binet-Hentsch, les jumeaux de Valtournanche - la pointe Sella par Joseph Corona, ascension du Weissmies par Joseph de Rivaz
LIBRAIRIE J. JULLIEN. 1876. In-12. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. Paginé de 65 à 135.. . . . Classification Dewey : 551.43-Montagnes
Sommaire : Une excursion au Vésuve par J.-L. Binet-Hentsch, les jumeaux de Valtournanche - la pointe Sella par Joseph Corona, ascension du Weissmies par Joseph de Rivaz, note sur le massif du Trient par E. Javelle, le charme des montagnes par L.-D Classification Dewey : 551.43-Montagnes
MESSIEURS LES RONDS DE CUIR. Illustrations de JOSEPH HEMARD.
Paris Nouvelle Librairie de France GRÜND 1947 -in-4- broché un volume, broché crème in-quarto Editeur, couverture rempliée imprimée en noir et vert illustrée en couleurs par JOSEPH HEMARD, toutes tranches non-rognées, orné d'un Frontispice et de nombreuses illustrations in et hors-texte en noir et en couleurs par JOSEPH HEMARD, 210 pages, 1948 à Paris Nouvelle Librairie de France GRÜND Editeur,
BEL EXEMPLAIRE.....en trés bon état (very good condition). Messieurs les ronds de cuir.Nouvelle librairie de France. Librairie Gründ., Paris, 1948. 209p 1 volume IN8 broché.Couverture rempliée. Préface de Marcel Schwob. Illustrations en couleurs h.t de Joseph Hémard. Exemplaire numéroté N°71/1150 sur Alfa Navarre, celui-ci h.c. en trés bon état
Gustave le mauvais sujet. Illustrations de Joseph Hémard.
1927 Paris, M. P. Trémois, 1927. 20,5 x 15,5 cm (R), in-8, 314 (4) pp., dessins de Joseph Hémard reproduits en noir dans le texte, reliure de demi-chagrin brun à petits coins, dos lisse décoré en long, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure signée M. P. Trémois).
Premier tirage. L'un des 45 exemplaires sur vélin pur fil (n° XLIII), premier papier avant 1600 sur alfa, enrichi d'un DESSIN ORIGINAL signé à l'encre de Chine de Joseph Hémard (celui de la page 169). Bel exemplaire, relié, comme il se doit, par Trémois. (MONOD, 6578 ; CARTERET, V, 114)
[Chez Pleyel, Auteur et Editeur] - HAYDN, Joseph ; (LOBRY)
Reference : 69076
(1803)
Oeuvres d'Haydn en Partitions. Quatuors (10 Tomes en 5 Volumes - Complet)
Gravés par Lobry, 5 vol. in-12 cartonage bradel vert postérieur, collection "Bibliothèque Musicale", Chez Pleyel, Auteur et Editeur, Rue Neuve des Petits Champs n° 1286 ou n° 728, Chez Richault, (tome 7), Paris, s.d. [ 1803, vers 1810-1815 pour Richault pour le tome 7 ], Vol. I : portrait en frontispice, 2 ff., 126 pp., 3 ff., 124 pp. (Opus 76, Quatuors 1, 2, 3, 4, 5, 6); Vol. II : 2 ff., 130 pp., 2 ff., 116 pp. (Opus 20, Quatuors 1, 2, 3, 5, 4 et 6) ; Vol. III : 2 ff., 132 pp., 2 ff., 126 pp. (Opus 50, Quatuors 5, 2, 3, 6, 4, 1); Vol. IV : 1 f., 111 pp., 2 ff., 105 pp. (Opus 33, Quatuors 1, 2, 3, 4, 5, 6); Vol. V : 2 ff., 128 pp., 2 ff., 139 pp. (Opus 71, Quatuors 1, 2, 3 et Opus 74, Quatuor 1, 2, 3)
Très rare ensemble bien complet réunissant, en 10 tomes reliés en 5 volumes, 30 quatuors de Joseph Haydn (1732-1809). De la bibliothèque du musicologue Claude Chauvel, qui a précisé au crayon les noms des pièces ; dans cette édition, les pages de titre n'indiquaient pas la tomaison, destinées à être rajoutée au crayon par l'acheteur. En 1801, Ignace Joseph Pleyel avait déjà publié la célèbre « Collection complète des quatuors d’Haydn », composée de quelque 80 quatuors. Pleyel fut le premier éditeur à publier des partitions miniatures avec sa collection « Bibliothèque Musicale », commençant par quatre symphonies de son ancien professeur Joseph Haydn en 1802, suivies de ces 10 tomes de partitions des quatuors de Haydn, puis par la musique de chambre de Beethoven, Hummel et Onslow. Le tome 7 mentionne comme éditeur Richault (qui s'établira comme éditeur en 1810) et ne contient pas le feuillet de faux-titre mentionnant la collection "Bibliothèque Musicale" ; la gravure du titre est identique, à l'exception du nom de l'éditeur, de la mention du prix et de la tomaison. Bon ensemble (un cahier faible avec petite mouill. marginale en début du tome 7, très bon état par ailleurs). A very rare collection of 30 quartets by Joseph Haydn (1732-1809) in 10 volumes bound in 5. From the library of musicologist Claude Chauvel, who added the names of the pieces in pencil. In 1801, Pleyel had issued the landmark "Collection complette des quatuors d’Haydn", consisting of some 80 quartets. Pleyel was the first publisher to issue miniature scores (the series "Bibliotheque Musicale"), starting with four symphonies of his former teacher Joseph Haydn in 1802, then with scores of the Haydn quartets and chamber music of Beethoven, Hummel and Onslow. "Complete sets of this edition are very rare. They are generally reorganised as the first attempt at a pocket score. The Quartets here are Op.20, 33, 50, 71, 74 & 76" (Blackwell's Cat. 734 [ 1971 ], n°254)
zu Racknitz, Joseph Friedrich, and Simon Swynfen Jervis
Reference : 120255
(2019)
ISBN : 9781606066249
A Rare Treatise on Interior Decoration and Architecture - Joseph Friedrich zu Racknitz's Presentation and History of the Taste of the Leading Nations
zu Racknitz, Joseph Friedrich, and Simon Swynfen Jervis: A Rare Treatise on Interior Decoration and Architecture - Joseph Friedrich zu Racknitz's Presentation and History of the Taste of the Leading Nations. 2019. 368 pages, profusely illustrated in colour. Hardback. 27 x 25cms. Full translation of Joseph Friedrich zu Racknitz's four volumes on the global history of design and ornament, published between 1796 and 1799. With reproductions of the original color plates and essays on Racknitz's biography, his publications and the larger German Enlightenment context that influenced it. The treatsie includes chapters on ancient and modern European taste as well as on Persian, Chinese, Mexican, Indian and Tahitian amongst others.
Full translation of Joseph Friedrich zu Racknitz's four volumes on the global history of design and ornament, published between 1796 and 1799. With reproductions of the original color plates and essays on Racknitz's biography, his publications and the larger German Enlightenment context that influenced it. The treatsie includes chapters on ancient and modern European taste as well as on Persian, Chinese, Mexican, Indian and Tahitian amongst others. Text in English
Joseph M. (Dr. Max Joseph) Guide to the Study of Hair Diseases (Antique Book, 1
Joseph M. (Dr. Max Joseph) Guide to the Study of Hair Diseases (Antique Book, 1912) In Russian /Iozef M. (Dr. Max Joseph) Rukovodstvo k izucheniyu bolezney volos (Antikvarnaya kniga 1912g.) St. Petersburg Practical Medicine 1912. 252 and IVc. We have thousands of titles and often several copies of each title may be available. Please feel free to contact us for a detailed description of the copies available. SKUalb395285568f35aed5.
[Hémard Joseph ] - HÉMARD Joseph ( illustrations par ) Hémard Joseph
Reference : 053615
CHANSONS DE SALLES DE GARDE illustrées par Joseph Hémard
Paris Au Quartier Latin, (sans date) 1930 in 4 (24x19,5) 1 volume reliure demi maroquin rouge à coins de l'époque, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée, 224 pages, avec de nombreuses illustrations par Joseph Hémard, dont 12 planches hors-texte en couleurs. Cette nouvelle édition des ''chansons de salle de garde'' dans leur texte exact, est réservée à un groupe d'amateur. Le tirage très limité, n'est pas mis dans le commerce (sic). Exemplaire numéroté. Bel exemplaire, bien relié
Très bon Couverture rigide Ed. limitée
MORCEAUX CHOISIS INCONNUS DES CLASSIQUES FRANÇAIS. Illustrations en couleurs de Joseph Hémard
Paris François Sant'Andrea Editeur 1948 petit in 4 (25x19,5) 1 volume broché, couverture rempliée, plat supérieur titré et illustré de 2 portraits en médaillon en couleurs, 220 pages [1]. Ouvrage orné d'illustrations en couleur dessinées par Joseph Hémard, et coloriées sous sa direction par Eugène Charpentier. Tirage limité à 670 exemplaires numérotés, celui-ciun des 600 exemplaires numérotés sur vélin chiffon les Frères Lafuma. Bon exemplaire
Bon Ed. numérotée
[ Manuscrit : ] Essais Poétiques, offerts en hommage à Leurs Altesses Royales Messeigneurs les Ducs de Nemours et d'Aumale, dignes fils de Sa Majesté Louis-Philippe 1er, Roi des Français ; à l'occasion de leur honorable séjour à Bordeaux en 1845 : Par un humble citoyen de cette ville [ Contient notamment :] Joseph en Egypte, de Bitaubé, mis en vers presque littéralement, par Joseph Emile Astaix Ogier [ Suivi de : ] Poésies diverses. Fragment de l'Essai sur l'Homme de Pope [ Suivi de : ] Couplet sur ce dicton : Il faut prendre l'argent pour ce qu'il vaut et les hommes pour ce qu'ils sont [ ... ] Chanson sur le Choix d'une épouse [ ... ] La Liberté ou la parfaite indifférence. Traduction de Métastase [ ... ] Sonnet acrostiche sur le pont de Bordeaux [ ... ] Acrostiche à Melle Rachel Félix, Tragédienne distinguée, A la dernière représentation de son passage à Bordeaux en 1841 [ ... ] Acrostiche. Hommage de vénération sur la tombe de Monseigneur Daviau du Bois de Sanzay Archevêque de Bordeaux [ ... ] Envoi du 18 Janvier 1844 à mon frère aîné, Receveur principal à Lyon, père de Jules Astaix, ex-condisciple de son Alt. Royale Monsg. le duc de Nemours, au Collège Royal de Henry IV [ ... ] Couplet à M. Gabriel-Pierre Astaix, mon père, Ancien Maire et juge de paix à Manzat, et notaire à Clermont-Ferrand, le jour de sa fête [ ... ] Couplet sur le séjour à Bordeaux de LL. AA. RR. Messeigneurs les ducs de Nemours et d'Aumale, et de Madame la Duchesse de Nemours, en 1845
1 vol. in-4 reliure de l'époque demi-chagrin à coins noir, dos à 4 nerfs plats dorés, s.d., 1845, 3 ff., 460 pp. et 1 f. n. ch. Rappel du titre : [ Manuscrit : ] Essais Poétiques, offerts en hommage à Leurs Altesses Royales Messeigneurs les Ducs de Nemours et d'Aumale, dignes fils de Sa Majesté Louis-Philippe 1er, Roi des Français ; à l'occasion de leur honorable séjour à Bordeaux en 1845 : Par un humble citoyen de cette ville [ Contient notamment :] Joseph en Egypte, de Bitaubé, mis en vers presque littéralement, par Joseph Emile Astaix Ogier [ Suivi de : ] Poésies diverses. Fragment de l'Essai sur l'Homme de Pope [ Suivi de : ] Couplet sur ce dicton : Il faut prendre l'argent pour ce qu'il vaut et les hommes pour ce qu'ils sont [ ... ] Chanson sur le Choix d'une épouse [ ... ] La Liberté ou la parfaite indifférence. Traduction de Métastase [ ... ] Sonnet acrostiche sur le pont de Bordeaux [ ... ] Acrostiche à Melle Rachel Félix, Tragédienne distinguée, A la dernière représentation de son passage à Bordeaux en 1841 [ ... ] Acrostiche. Hommage de vénération sur la tombe de Monseigneur Daviau du Bois de Sanzay Archevêque de Bordeaux [ ... ] Envoi du 18 Janvier 1844 à mon frère aîné, Receveur principal à Lyon, père de Jules Astaix, ex-condisciple de son Alt. Royale Monsg. le duc de Nemours, au Collège Royal de Henry IV [ ... ] Couplet à M. Gabriel-Pierre Astaix, mon père, Ancien Maire et juge de paix à Manzat, et notaire à Clermont-Ferrand, le jour de sa fête [ ... ] Couplet sur le séjour à Bordeaux de LL. AA. RR. Messeigneurs les ducs de Nemours et d'Aumale, et de Madame la Duchesse de Nemours, en 1845
Né le 9 décembre 1791 à Manzat (Puy-de-Dôme), Joseph Astaix, auteur de cet impressionnant manuscrit, était caissier des échanges de la banque de Bordeaux, (succursale bordelaise de la Banque de France). Il obtint en 1850, par décret présidentiel, d'ajouter à son nom celui d'Ogier, et de se faire appeler Astaix-Ogier. On notera que dans son acrostiche consacré au Pont de Pierre, les initiales des vers forment les mots "Deschamps Fecit", en l'honneur de son ingénieur. Beau et curieux manuscrit bordelais en bon état (coins un peu frottés, ex-libris en garde).
Jacques le fataliste et son Maitre. Préface de Georges Grappe. Illustrations en couleurs de Joseph Hémard. Dessins originaux.
Paris, Lapina, 1922. 25,5 x 18 cm, xix et 404 pp. Relié demi-maroquin rouge à coins, dos lisse, titre doré, tête dorée, couvertures et dos conservés. Très bel exemplaire dans une reliure signée de Colette Bertin. Ouvrage illustré de 120 aquarelles reproduites au pochoir. Tirage limité à 521 exemplaires, ici un des 444 ex. num. sur vergé et signé par Joseph Hémard. Envoi autographe signé de Joseph Hémard au comte Joseph de Montrichard. INSÉRÉS EN FIN D'OUVRAGE : 30 dessins et aquarelles originaux de Joseph Hémard.
 Write to the booksellers
Write to the booksellers





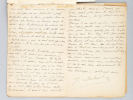
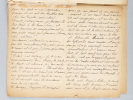







![Promenades de Critès au sallon de l'année 1785.. [GORSAS (Antoine-Joseph)].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/42033_1_thumb.jpg)
![Promenades de Critès au sallon de l'année 1785.. [GORSAS (Antoine-Joseph)].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/42033_2_thumb.jpg)
![Promenades de Critès au sallon de l'année 1785.. [GORSAS (Antoine-Joseph)].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/42033_3_thumb.jpg)








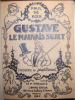




![[ Manuscrit : ] Essais Poétiques, offerts en hommage à Leurs Altesses Royales Messeigneurs les Ducs de Nemours et d'Aumale, dignes fils de Sa Majesté ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CDL/67004_thumb.jpg)
![[ Manuscrit : ] Essais Poétiques, offerts en hommage à Leurs Altesses Royales Messeigneurs les Ducs de Nemours et d'Aumale, dignes fils de Sa Majesté ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CDL/67004_2_thumb.jpg)
![[ Manuscrit : ] Essais Poétiques, offerts en hommage à Leurs Altesses Royales Messeigneurs les Ducs de Nemours et d'Aumale, dignes fils de Sa Majesté ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CDL/67004_3_thumb.jpg)




